
|

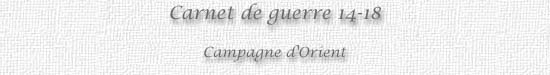
"Quand donc ces pauvres humains voudront-ils se rendre compte que toutes leurs puissances réunies ne peuvent les conduire qu'à la poussière d'où ils sortent !? Je ne veux pas vous traiter un sujet au dessus de ma compétence..."
Les
trois lignes ci-dessus  disent beaucoup du contenu et de l'esprit de ces
deux
cent trente lettres adressées par Louis à sa famille de Verne, en grande
partie à Félicie la mère, certaines destinées aux frères Henri et
Julien. Cette série de courriers débute à son rapatriement sanitaire
de Macédoine, disent beaucoup du contenu et de l'esprit de ces
deux
cent trente lettres adressées par Louis à sa famille de Verne, en grande
partie à Félicie la mère, certaines destinées aux frères Henri et
Julien. Cette série de courriers débute à son rapatriement sanitaire
de Macédoine, après trente mois d'armée d'Orient, précédés de trois
années de service militaire. après trente mois d'armée d'Orient, précédés de trois
années de service militaire.
Il n'est pas
trop besoin de commentaires
pour dire la force émotionnelle de ces courriers ni même de préambule pour
justifier la présence d'un tel document aux côtés des carnets d'Édouard, son frère
aîné. Son frère d'armes, bruyantes. Et de larmes, sourdes...
Rémy Cœurdevey, son petit-neveu. Le 28 septembre 2009.
|
6 janvier 1917
Très chers,
|
Je vous avais envoyé un mot l'autre jour, le 4, depuis le milieu de l'immense étendue d'eau. Je n'ai pu hier vous faire part de mon arrivée à bon port, car muni d'une étiquette comme un colis je fus embarqué sur le quai même du port dans un train sanitaire qui m'a déposé hier soir à dix heures, à la gare d'Alais (Gard).
|
|
A présent c'est confortablement installé sur une table que j'ai le plaisir de vous faire part du bien-être qui m'arrive après tant de déboires. Espérons toujours ! Après la pluie le beau temps !
|
|
Je ne veux pas aujourd'hui vous faire un grand journal, de l'extrait du grand volume que j'aurais à vous écrire. L'essentiel est accompli ! Je suis là, à côté de vous ; en apparence, mieux soigné que chez nous : un large lit, dans une grande salle où tout brille, un tas d'infirmières que je n'ai pas encore distinguées entres elles, une chemise fine, une table
(...?)... etc... un tas de choses qui rendent bébête votre vieux poilu abruti par vingt-huit mois de tranchées !... C'est que nous ne sommes plus en Orient mais au milieu des habitudes de notre belle France !
|
|
Je resterai méridional tant qu'on voudra me garder ici, car par le temps qui court, je ne suis pas pressé ; si ce n'était le bonheur d'aller vous embrasser. Louis C.
|
6 janvier 1917
Chers aimés,
|
Je veux achever ce dimanche avec vous bien que mes nouvelles ne doivent pas vous faire défaut. De mon voyage je ne vous ai pas fait grands détails et ceux-ci sont déjà vagues en ma mémoire ; il vaut mieux que je m'occupe du nouveau "front" qui m'est assigné, et je suppose que les moindres détails de mon séjour vous intéresseront.
|
|
D'abord je suis toujours assez bien portant, en apparence, et serai assez embarrassé pour vous dire que je souffre ; mais puisque je suis classé comme convalescent de l'Armée d'Orient je veux volontiers être traité comme tel,
voilà trente mois que je n'ai pas eu grande satisfaction, à part celle d'avoir la vie sauve, mais au prix de quelles peines !
|
|
Une partie des malades du bateau ont pris la direction de Nice, moi je fis partie du train de Nîmes. Le voyage fut assez long, deux cent cinquante kilomètres environ par Marseille, Tarascon, Nîmes et Alais, qui d'après mes souvenirs d'école possède des puits à charbon. Nous avons pris deux repas dans le train et quelques boissons dans certaines gares.
|
|
Nous sommes dans une ancienne école libre du genre Mi-Cour, qui domine la ville, ce n'est plus la plaine sans grandes montagnes. La bise n'est pas trop chaude, mais nous n'avons pas à craindre le froid dans un pays de charbon, le poêle est toujours alimenté.
|
|
Je ne possède encore pas grands tuyaux, mais l'hôpital doit être dirigé par les anciennes sœurs de l'école, secondées par les
bigotes de la ville, de la haute naturellement. Quelques unes des infirmières sont déjà âgées. C'est le danger du nouveau "front" à tenir ! Représentez-vous, un établissement géré par Mlles Damotte et compagnie ! Vous ne douterez pas de la propreté qui nous entoure, j'espère bien perdre la semence de poux... Mais comment faire pour avoir bonne contenance, et plaire à des vieilles filles qui sont naturellement comme toutes ? Et puis toutes les salles ont un nom de grand Saint, le Christ est resté suspendu. Hier soir, comme tous les jours il y a prière en famille, puis ce matin messe à l'hôpital. Pour moi, ça va bien, mais les mangeurs de curés ont de quoi débiter ; mais en cachette, ils marchent comme les autres, pour ne pas déplaire aux infirmières. Ce matin j'ai mélangé ma voix au chœur, oubliant la guerre et me remémorant mes anciens bons souvenirs.
|
|
Comme nourriture, le goût (?) n'a rien de militaire, mais tout de la bonne cuisinière. Café au lait le matin, dîner à onze heures, table mise, serviette, pain à volonté, vin assez bon, un tiers de litre par repas, pas de café, mais un petit dessert, après le potage la viande et les légumes. Le soir on mange à six heures. Avec mon bon appétit vous allez me voir rentrer avec une mine de bourgeois. Je ne sais pas le temps qu'on peut nous garder, car l'hôpital vient d'être ouvert depuis Noël pour les évacués d'Orient. Nous avons un Major qui s'occupe bien des malades. Je ne lui donnerai pas beaucoup de travail ; mais il y a encore beaucoup de fiévreux. Il m'a bien ausculté hier matin, je lui ai expliqué tous mes cas d'évacuation ; il m'a trouvé seulement encore fatigué.
|
|
Quel temps avez-vous ? Je vous ai dit que nous avions de la bise, pas trop chaude, mais à midi, le soleil est chaud, je rentre de faire un petit tour ; pour aller en ville il faut une permission, être ciré, ce que j'ai fait ce matin, la première fois depuis trente mois !
|
|
Qu'allez-vous me dire de ma nouvelle situation ? Il me tarde de vous lire ! Vous n'aurez plus besoin de mettre un numéro de secteur ou d'Armée d'Orient. Je suis sûr que si je n'étais pas si loin maman viendrait me voir ! S'il y avait urgence, je vous y engagerais, mais peut- être avant la fin du mois serai-je parmi vous. En attendant ce plaisir je vous embrasse tous bien fort. Louis.
|
|
Hôpital 22 bis (Ste Barbe) à Alais. Gard. Salle Jeanne d'Arc.
|
Alais, le 10 janvier 1917
Chers aimés,
|
Je rentre d'une promenade à travers la ville, par suite d'une permission qui m'autorisait à quitter l'hôpital de midi à trois heures. En compagnie du Breton qui me voisine, ce fut principalement une occasion de faire sortir le porte-monnaie ; bien qu'en apparence rien ne nous manque. Seulement il y a beaucoup plus de choses sur les étalages que dans les villages macédoniens que j'ai connu. Je ne parle pas de Salonique, que je n'ai d'ailleurs qu'aperçu de loin, ou traversé en service, en y arrivant, ou bien en auto pour aller à l'hôpital ou pour venir ici.
|
|
Ne parlons plus de Salonique mais d'Alais, qui me restera d'un meilleur souvenir. La ville doit son importance au bassin minier des environs ; il y a environ trente mille habitants. Une petite rivière y passe, le Gardon, affluent du Gard. Les environs sont très accidentés, on aperçoit la neige sur le Mont Lozère, aussi la bise est très fraîche. J'ai rencontré en ville les copains d'hôpital et de voyage, tous sont assez satisfaits de leur sort.
|
|
Je suppose que vous ne devez pas être sans nouvelles de mon côté, jusqu'à la direction de l'hôpital qui vous renseigne de ma santé. Seulement moi je vais être jaloux car rien ne m'arrive ; pourtant il me semble qu'au bout de huit jours je devrais avoir des réponses.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui, je vais joindre une carte à cette feuille qui vous apportera les...
|
Alais, le 12 janvier 1917
Chers aimés,
|
Il y a huit jours que j'ai mis le pied sur la terre de France. Il est deux heures, je pouvais être à Marseille où notre train a laissé les grands blessés ou malades couchés. Ce matin m'arrive votre bonne carte. Nous sommes en contact au bout de huit jours. Il est vrai que ma lettre a fait vite pour aller vous porter la bonne nouvelle, la vôtre a mis un peu plus de temps.
|
|
Je devinais un peu la surprise heureuse qu'allait provoquer l'annonce de mon arrivée en France. Deux jours avant mon départ de Salonique je vous avais expédié une carte, sitôt que j'ai connu la décision me concernant, avant d'arriver à Toulon, je vous prévenais de ma bonne traversée mais comme le service postal est si bien fait, vous avez reçu les dernières nouvelles les premières. Mais ce n'est qu'un détail, puisque je suis parvenu à ce que je désirais. C'est dommage que vous ayez envoyé promener un mandat à Salonique. Il n'est sans doute pas prêt de me trouver.
|
|
Je devine l'anxiété que vous a donnée l'annonce de la mort de Montenoise. J'avais mauvaise opinion de le voir embarquer si faible. J'avais dû vous l'écrire, ça a dû être pénible pour Petit du Lambevaux
(?) qui l'accompagnait. Cela doit dépendre de la conscience du Major qui nous soigne. Je crois que le cas ne se produira pas pour Georges.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui, je rentre de faire une promenade et me repose en vous écrivant, vous voyez que tout va bien.
|
|
Bons baisers. Louis.
|
Alais, le 14 janvier 1917
Chers aimés,
|
Depuis ce matin il neige à gros flocons. Ce n'est pas ça le beau ciel du midi que nous avons eu depuis que nous sommes ici. Pas moyen de sortir pour faire la promenade hygiénique, mais je vais me rattraper en causant un peu plus longtemps avec vous. Et puis, il ne s'agit pas de ne vous envoyer qu'une feuille chère maman, sinon vous allez bien me le dire à l'occasion ! Il est deux heures, par cet après-midi de dimanche il me semble que je vous vois en train de me tracer une longue lettre, car je les aime aussi, les quatre pages bien remplies. Je viens de relire votre grande lettre de mercredi soir qui m'est arrivée hier soir.
|
|
Je vous remercie bien de tous les détails que vous me donnez. Quand à moi, je crois vous avoir donné déjà tous les renseignements que comporte ma nouvelle situation. Si je ne le faisais pas je serais bien coupable, car le temps et l'installation ne me manquent pas. D'un jour à l'autre, c'est la même vie monotone, au bout de
huit jours me voilà au courant. En fin de semaine, échange de linge, à peine sali, serviettes de table, de toilettes, lavabo, cabinets à proximité, parquet carrelé, lavé chaque matin, calorifère, éclairage électrique. Une nourriture abondante ; café au lait le matin, potage aux pâtes, bœuf bouilli, haricots, dessert, pain à volonté, vin, un quart ou un tiers de litre à chaque repas, les légumes varient, on nous sert des fois de bons choux-fleurs ou une bonne soupe trempée aux légumes, comme il y a trente mois que je n'en ai pas goûtée. A sept heures chaque matin, une marchande passe avec des petits pains, de l'orange, des journaux. A midi pendant la promenade individuelle, on peut s'offrir un café avec pousse-café pour six sous. Chaque jour à dix heures, je me lève à neuf, visite du major, qui est très sympathique, et s'occupe bien de ceux qui sont malades, moi je ne lui donne aucun travail, mais il y en a qui ont toujours les fièvres ou la jaunisse. Avec ça, des infirmières éblouissantes sous leurs costumes, nous en avons une très jolie, mais elle le sait trop bien, à côté des vieilles, il y en a qu'on appelle Demoiselle, d'autres Madame ; toutes sont d'une politesse sans borne, nous servant à table, une prévenance apparente exquise...
|
|
Que voulez-vous de mieux. Nous sommes des princes ! L'État nous doit bien ça. Mais c'est grâce au dévouement, au zèle de ces personnes charitables et fortunées qui se sacrifient pour nous. J'en profite certes, mais c'est tout du chiqué, ce n'est pas là le vrai sacrifice. Moi aussi je me suis sacrifié, combien de fois ? Je ne m'en rappelle pas et c'était ma vie qui était en jeu ; mais c'était un sacrifice forcé, sans mérite. Ces privilégiés de la fortune ne peuvent guère faire moins ; c'est aussi une façon de prolonger la guerre, qui leur est dictée par leurs intérêts ; c'est une façon de nous exploiter, mais nous n'avons pas le droit de rien dire devant de si bons soins. Si nous ne trouvions pas ici de quoi nous refaire un peu, la misère nous pousserait à la rébellion. Et puis encore, ne faut-il pas être trop malade ici, pour être bien. Je le vois à la physionomie de ceux qui souffrent. Où peut-on rencontrer des soins donnés avec la même intention que ceux prodigués par des mains d'êtres chers ? Cela n'existe pas.
|
|
Et puis nous sommes servis par des personnes qui ont des femmes de chambre chez elles, et qui n'ont jamais beaucoup travaillé.
|
|
Elles sont à deux ou trois dans une chambre, qui vont qui viennent, comptant l'une sur l'autre, et finissent par ne pas donner à un malade ce dont il a besoin. Pour des femmes, c'est un peu partout la même chose ! Mais il faut que je m'arrête, vous allez dire que la guerre m'a rendu mauvais ou que je deviens vieux garçon. Il y a du vrai dans les deux hypothèses. Mais vous m'avez demandé des détails chère maman, "trop parler nuit", mais je vous transmets mes impressions et mes idées bouleversées par suite de l'état actuel. Dieu jugera.
Voilà déjà un moment que j'écris et j'aurais voulu vous parler de diverses autres choses, mai ce sera pour un autre jour ; on m'appelle pour le goûter : brioche et vieux vin, parce que c'est dimanche. Ce matin nous avons eu messe ; j'y ai pris part en m'associant au chœur qui accompagnait une infirmière sur un harmonium.
|
|
Affectueux baisers à tous. Louis.
|
Alais, le 16 janvier 1917
Chers aimés,
|
C'est sur cette feuille de la Croix-Rouge anglaise que j'ai reçue pour mon Noël que je vais passer quelques moments avec vous.
|
|
J'ai pu à peine répondre à votre grande lettre du 10, avant-hier, vous promettant une autre lettre. Hier c'est mon infirmière qui a dû vous renseigner sur mon état de santé. Vous me demandez chère maman, si vous devez m'envoyer quelque chose ? Vous ne pouvez m'envoyer que du superflu, et puis je me réserve pour quand je serai là. Quant à de l'argent,
Édouard m'envoie de généreuses étrennes, qui vous exempteront de me faire un envoi, et puis des fois, mon mandat de Salonique peut m'arriver, ainsi que mes colis ; mais il faut savoir patienter et pouvoir. Je ne me rappelle pas si je vous ai dit que j'avais reçu la veille de mon départ, le 28 décembre, le colis de viande cuite, qui était déjà bien abîmé, le bout de filet seulement. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre dans mes colis, je n'ai pas reçu celui du 9 novembre et un en décembre, car je n'ai pas reçu de brioche.
|
|
J'ai avisé Melle Pautignat de mon retour, elle prend part à ma joie en m'envoyant une boite de dragées à l'occasion d'un baptême d'un petit neveu. Elle m'a expédié à Salonique à l'occasion de Noël un colis de friandises, qui pourrait bien être fondues lorsqu'elles m'arriveront. Je l'ai remerciée du mieux que j'ai pu, naturellement.
|
|
Hier soir,
m'est parvenue votre carte lettre du 13, chère maman ; la
première ligne n'est pas encourageante : quatre vingt
neuvième jour de guerre ! Est-ce possible. Il ne me le semble pas ! Et à ce sujet j'avance que je trouve le temps très long ici ; c'est plutôt bizarre mais c'est réel. C'est sans doute le rapprochement et désir d'aller vous voir, mais je saurai bien attendre le moment venu.
|
|
D'après votre conseil, je viens de faire une lettre à la tante. Vos relations s'améliorent-elles ?
|
|
J'ai dû vous faire part de la mauvaise opinion que j'avais de voir partir Montenoise aussi faible, mon opinion fut malheureusement justifiée, il ne put supporter la traversé, qui est toujours dure même aux tempéraments les plus robustes. Et d'après cet exemple, je comprends les inquiétudes que doit susciter l'état de Georges. Je l'ai vu une demi-heure avant mon départ, il y avait quelques jours qu'il était mieux ; le major l'avait même autorisé à manger un œuf, je l'ai quitté avec le ferme espoir qu'il allait mieux. Naturellement il était encore très faible, car la fièvre très forte même, ne l'a pas quitté pendant plus d'un mois, il est le seul que j'ai vu dans son cas. Avait-il le paludisme, j'en doute. La première fois que je l'ai vu, je n'ai pas osé rester trop longtemps près de lui ; la faiblesse le faisait délirer. Ses copains m'ont dit qu'il devait écrire des bêtises à sa femme, de la prévenir, mais des commissions comme ça n'ont rien d'urgent. Mais son major ne le laissera pas partir trop faible, et le rétablira bien, à moins de complication. Pour toute commission il m'a dit : "Tu n'as qu'à dire comme je suis, chez nous." Je crois qu'Héranney doit être en communication avec sa femme.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui et bons baisers à tous. Louis.
|
Alais, le 18 janvier 1917 Dernière heure.
Mes chers,
|
Depuis que je vous ai fait ma lettre, un major à quatre galons est venu me voir. Il a trouvé que j'avais bonne mine et pas de fièvre, qu'on pourrait bientôt m'envoyer en convalescence.
|
|
D'après ces prévisions vous ne tarderez pas trop à m'envoyer le certificat de subsistance qu'on pourrait me demander. Vous savez ce dont il s'agit : une attestation signée du Maire, ou son suppléant, sur papier libre. Vous pouvez faire ajouter qu'il n'existe aucune maladie contagieuse dans la région.
|
|
Bons baisers à tous. Louis.
|
Alais, le 18 janvier 1917
Chers aimés,
|
Mon Henri, je suis en possession de ta lettre du 16. Heureusement que tu as été un peu "patraque", comme tu dis. Sans cela j'aurais été privé du plaisir de lire cette bonne grande lettre dictée par une intelligence éclairée, cultivée et affectueuse, car la poussière de la grange aurait sans doute obstrué quelques unes de ces qualités.
|
|
L'ambition est sans bornes ! Encore un reproche pour des lettres trop courtes, des détails trop restreints, un manque de patience, qui ne doit plus avoir lieu d'être à présent. Vous devez bien vous représenter les conséquences de la vie militaire qui est continuellement sous l'inquiétude, par suite de l'incertitude du lendemain. Dans la tranchée c'est la vie qui est en jeu, ici il ne s'agit que des actes à accomplir ; qu'est ceci en comparaison de cela. Vous n'êtes donc pas encore devenu philosophe en passant des années sous de telles incertitudes ? Sans doute que si, et je devine bien les sentiments qui animent votre intérêt à mon égard.
|
|
Pas plus qu'à Salonique je ne peux prévoir ce qu'on me gardera ici. Les premiers malades ne sont ici que depuis le 23 novembre et aucun n'est encore sorti. Je crois que j'attraperai la fin du moi à Alais, mais ce n'est qu'une supposition. Je m'attendais à rejoindre mon dépôt et c'est la France qui m'est réservée. Je vous ai parlé de Genin d'Autechaux qui fut envoyé en dépôt par le même major qui m'envoya en France complètement rétabli : c'est le hasard ou la destinée qui nous est réservée, qu'il faut bien accepter en ces temps où nous ne sommes plus que des instruments entre les mains de ce que d'ingénieux exploiteurs appellent la "Patrie". Ah ! Les sujets ne manquent pas pour faire des lettres ! Vous voulez m'envoyer du papier ? Il y en a beaucoup trop de papier d'écrit. C'est surtout avec ça qu'on entretient la guerre. C'est des journaux que je veux parler, et si je les lis, c'est que j'ai le temps, et pour voir la tournure que prendra la loi sur les réformés. Mon cher Henri, j'ai encore bon espoir en ce qui concerne ton cas.
|
|
Je vous ai donné déjà des détails sur les envois à me faire, colis ou argent. Certes, je regrette la promenade de ton bleu qui se promène, mais d'est de peur qu'il ne se perde, ce n'est pas le besoin.
|
|
Je n'ai rien à ajouter non plus en ce qui concerne Georges, mais sur ton avis, j'écrirai à Mme Dormois ce que j'aurais ou croyais pouvoir lui dire de vive voix.
|
|
Mon cher Henri, tu y vas fort en me souhaitant un ou deux mois de convalescence et vingt jours de perm. Ce serait parfait et mérité. Mais tu sais bien qu'ici plus on en fait plus on est "bête", et c'est les mêmes qui font tout. Combien ai-je laissé de camarades à Monastir dans le même cas que moi et comme je pourrais encore m'y trouver sans que leur en soit tenu aucun compte. C'est encore une question de chance et de hasard. Nous avons comme toujours de la neige, et la bise n'est pas bien chaude. J'ai pu avoir une perm de trois heures hier. C'était la foire. J'ai eu une petite illusion de ces foires de jadis qui tenaient tant de place dans mes occupations et mes intérêts. Cela reviendra t'il un jour ?
|
|
En prévision du congé de convalescence qui me sera accordé vous m'enverrez un certificat d'hébergement signé du maire. Qu'est-ce qui rempli ces fonctions ?
|
|
Je termine en adressant mes tendres baisers à tous. Louis.
|
|
Marie Coulon m'envoie un petit mot, remerciez-la à l'occasion. Qu'a-t-elle eu ?
|
Alais, le 21 janvier 1917
Chers aimés,
|
Quel triste dimanche nous avons aujourd'hui. Mais nous sommes en hiver ! Que je me trouve bien d'être à l'abri, en comparaison de ce qui pourrait m'être réservé : être dans un trou ou sous une mauvaise toile, comme je l'ai été pendant quatorze mois. Jugez de l'effet produit par la comparaison que j'en peux faire, lorsque je compare mon bon lit avec sommier et matelas de laine, qui est recouvert d'un drap blanc qui sert de couvre-lit parce que c'est dimanche. Aussi parce que c'est dimanche je me suis levé de bonne heure ce matin : à sept heures, les autres jours c'est à neuf. Nous avions messe d'aurore comme tous les dimanche. Presque tous les malades y assistent et chantent des cantiques avec accompagnement. C'est que c'est administré par une volonté de femme, et ce que femme veut... Il faudrait bien que les femmes prennent aussi la direction de la guerre ; elles seraient aussi aptes que nos bons gouvernants, qui ne cessent pas de cumuler fautes sur fautes. J'ai eu la satisfaction de lire ce matin sur le Journal que Lyautey n'a pas envie de te convoquer à nouveau mon cher Henri. Je viens de recevoir une lettre de la tante en réponse à la lettre que j'hésitais à lui faire et que vous avez lue jeudi, me dit-elle. J'y envoie un mot en même temps qu'à vous. Vous ne m'avez rien dit des bonnes relations qui ont l'air d'être rétablies.
|
|
J'ai fait aussi une lettre à Mme Jeanne D. J'ai reçu un petit mot d'Édouard qui comme vous, comme moi voudrait bien savoir si je dois rester longtemps ici.
|
|
Je n'ai pas connaissance de la décision prise par la visite du médecin-chef l'autre jour. Aucun malade n'est encore sorti. Nous avons tous le temps. Je n'ai encore rien reçu depuis Salonique, mais je n'y compte pas encore maintenant.
|
|
J'ai écrit à Henri de Munans hier ; si vous connaissez l'adresse de Frédo vous me la donnerez.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui. Gros baisers à tous. Louis.
|
|
Le bonjour aux amis.
|
Alais, le 23 janvier 1917
Chers aimés,
|
Les postiers sont-ils en grève ? Je vais le croire, car il est invraisemblable que vous ne m'ayez pas envoyé un petit mot depuis huit jours. Je n'ai rien reçu de vous depuis la bonne lettre d'Henri, écrite il y a huit jours. Peut-être que ce soir je serai rassuré ! Mais j'attendais quelque chose ce matin. Nous avons nos lettres deux fois par jour.
|
|
Le soleil a l'air de nous revenir, comme une invite à voyager... mais toujours rien de précis. Et puis je ne m'impatiente pas trop. Il m'est arrivé une petite raison d'être ici : je me sentais un peu constipé depuis quelques temps, j'ai demandé une purge au major qui m'a bien débarrassé (la purge). Je suis au petit régime pour quelques jours.
|
|
Je vais écrire à Quatre pour faire connaître ma nouvelle situation aux compagnons de misère restés là-bas. Si vous avez d'autres nouvelles de Dago vous me les direz.
|
|
Je n'aborde pas d'autres sujets et vous quitte en vous embrassant tous comme je vous aime. Louis Coeurdevey.
|
Alais, le 24 janvier 1917
Chers aimés,
|
Hier, je vous
disais qu'il était invraisemblable que vous ne m'ayez pas écrit. Je
m'impatientais trop car mon inquiétude se dissipa avant la fin de la
journée. Mais que voulez-vous quand je vois trois jours sans rien
recevoir ça porte un malaise dans la marche de ma vie bourgeoise qui
est réglée comme une horloge : à sept heures du matin, la marchande
de petits pains nous offre sa marchandise et le journal, la café est
servi au lit, l'infirmière prend les températures pendant qu'on lit
le journal au lit. Je me lève à environ neuf heures. Faire son lit,
sa toilette, c'est dix heures, l'on s'attend à la visite qui est
rapide, deux ou trois malades sur vingt. Les paludéens ont toujours
quelques accès de fièvre. C'est l'heure de mettre la table pour être
prêt à manger pour onze heures. Les infirmières ont hâte de rentrer
chez elles, elles nous servent avec rapidité, trop vite à mon avis.
Midi c'est l'heure de la promenade quand il fait beau. Les
permissionnaires vont en ville, les autres à la campagne
individuellement ; il y a toujours moyen d'aller prendre un petit
café à six sous. L'après-midi les uns jouent, les autres écrivent ou
souvent discutent, mais sans résultat. Il y a surtout quatre
parisiens qui se font entendre car en général ils ont la langue
déliée et se croient supérieurs aux autres. A quatre heures il y a
toujours un petit casse-croûte : pain ou gâteau avec une boisson
quelconque. Jusqu'à six heures la discussion s'anime pendant que
l'infirmière prend les températures. Nouveau repas à six heures. Après avoir tout mis en ordre et dit quelques mots de prières l'infirmière nous quitte. Une veilleuse vient pour monter la garde la nuit, nous donner un peu de tisane à neuf heures. Après tout le monde se couche. Les journées passent encore assez vite, et je ne trouve plus le temps si long que la première semaine.
|
|
Comment voulez-vous qu'un homme ainsi réglé n'ait pas son courrier quotidien ? J'en ai raconté long pour en revenir au début de ma lettre et justifier mes inquiétudes de hier. Cela va me faire user du papier. Mais je ne peux invoquer l'économie puisque hier à deux heures le vaguemestre me remettait quatre papiers, malgré la défense que je vous avais faite. A la distribution du soir on me donna mon certificat d'hébergement qui est venu plus vite que je ne croyais. C'est tout ce qu'il faut. J'avais en même temps une bonne lettre du père Pastif qui m'apprend le mariage de Caillet de Bonnal et sa mutilation. Il me dit aussi qu'il fait très froid à Gouhélans.
|
|
Ce matin je reçois votre carte de dimanche chère maman, remplie de l'illusion de la joie que provoquera mon arrivée. Et moi donc quel effet cette perspective doit-elle me faire ?...
|
|
A vous demander mon certificat, je me croyais déjà en partance. Mais comme souvent cela arrive dans le métier militaire ne vient que l'imprévu. Je ne suis pas désigné pour le premier départ, il n'y en a que trois dans la salle sur dix-neuf. Il y en qui demandent à sortir. Comme je me suis purgé et ai parfois la tête lourde, je n'ai rien dit. Ce sera encore huit ou quinze jours de plus. Sans doute au moment où je m'y attendrai le moins.
|
|
Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
Alais, le 28 janvier 1917
Chers aimés,
|
Votre bonne carte-lettre du 26 m'est arrivée ce matin. Elle dissipe toutes les inquiétudes créées par un croisement banal dans nos correspondances. Chère maman votre carte me renseigne sur bien des nouvelles du pays qui m'intéressent d'autant plus que j'en suis rapproché, et bientôt que je verrai.
|
|
On a envoyé Dago sur la Côte d'Azur, afin de dissiper les accès de paludisme qui alimentent sa jaunisse. C'est encore une victime de ces pays enchanteurs... moi je vais vous revenir sans aucune trace de ces généreux souvenirs ! Je ne sais pas ce que vous voulez me dire par la lettre de Quatre. Je devine qu'il a dû m'écrire à Verne et que vous m'avez retourné la lettre.
|
|
Ce dimanche a débuté pour moi comme les autres : messe le matin. La température m'a permis une petite ballade à midi. Je rentre de prendre un café dans un bistrot du faubourg, car il faut une perm pour s'aventurer en ville. Comme toujours il y en a qui font des bêtises quand il sont sortis, ce qui rend les majors stricts à ce sujet.
|
|
Vous me dites, chère maman que Jeanne va venir à Tarascon voir Georges. Je comprends votre tentation à l'occasion ! Combien j'ai regretté que vous ne soyez pas venue à Meximieux avec elle. A présent il faut éloigner l'envie et oublier les regrets. Dans quinze jours je serai parmi vous sans doute, peut-être avant. Voici comment je peux vous disposer mon emploi du temps. Les premiers malades désignés comme je vous l'ai dit, doivent partir demain matin pour Nîmes. Là, j'ignore la durée du séjour. Moi je suis désigné pour le deuxième départ qui aura lieu probablement le demain en huit, le 5 février. Notre major actuel nous quitte, il a voulu mettre ses papiers en règle et faire nos dossiers avant de partir. C'est d'après ses dires que je vous donne ces indications. Mais quant à préciser le jour, c'est impossible. Ceux qui partent demain viennent d'être seulement avisés. A mesure que j'aurai d'autres indications plus précises je vous les donnerai.
|
|
Pour aujourd'hui je n'ai que mes affectueux baisers à vous transmettre. Louis.
|
Alais, le 29 janvier 1917
Chers aimés,
|
Il est sept heures du soir, la manille bat son plein. La salle est plus déserte que de coutume. Sur dix-huit que nous étions hier soir il en manque quatre des plus enragés. Ils ont pris le train ce matin à six heures pour Nîmes qui est à quarante kilomètres d'ici.
|
|
Demain matin, le vaguemestre nous apportera le résultat de la visite. Il parait que ces médecins-majors ne sont pas bien généreux. Dix, quinze ou vingt jours suivant la "frimousse" de l'intéressé. A mon tour cette fois-ci. Il parait que les évènements vont se précipiter pour le nouveau départ. Notre infirmière disait ce soir qu'il devait arriver des malades samedi, et que nous pourrions de ce fait être appelés jeudi à Nîmes. Comme toujours rien de précis. Mais je tiens à vous tenir au courant des événements car je pouvais l'espérer hier. Je vous réécrirai probablement demain, si ces nouveaux renseignements se confirment.
|
|
Bonne nuit à tous. Louis.
|
|
Ce matin j'ai eu une carte de Marcellin Génin...
|
Alais, le 31 janvier 1917
Chers aimés,
|
Jugez de mon inquiétude ! Je ne sais encore si c'est demain que j'irai à Nîmes ou lundi. Nous ne serons prévenus que ce soir. Je m'y attends, les sortants sont prêts. Donc demain je vous écris soit depuis Nîmes ou depuis ici, s'il y a du changement.
|
|
Je reçois à l'instant une lettre de Georges. La Jeanne lui a donné mon adresse me dit-il. En même temps je reçois d'un copain le résultat de la commission qui a siégée lundi. Le tarif, c'est quinze ou vingt jours, trente jours aux plus malades, ce qui est rare ! Ce n'est guère encourageant ! Mais il faut bien encore cette fois avoir l'air content. Je m'attends à avoir quinze jours. Le voyage ne sera pas très chaud. Il gèle encore fort la nuit ici.
|
|
J'espère pouvoir à l'avance vous préciser l'heure de mon arrivée. En tous les cas, si les chemins sont trop mauvais, ne venez pas à Baume avec une voiture. Je serai apte à faire la route à pied. Quant à mes valises, elles sont peu volumineuses. Au contraire si le temps le permet, maman viendra avec la moins frileuse des jeunes, et s'il faut marcher vous m'enverrez un de vos "lascars" ou papa, si les jambes sont toujours aussi bonnes, afin que je puisse retrouver le chemin...
|
|
Maintenant vous n'avez plus qu'à attendre que je vous dise le jour et l'heure de mon arrivée.
|
|
Donc à bientôt quelques instants de bonheur... Louis. Inutile de m'écrire sans avis.
|
Nîmes, le 2 février 1917
Mes chers,
|
La sentence est prononcée, quinze jours, le tarif ordinaire. Je pense partir ce soir ou demain. Impossible d'être plus précis, ne connaissant ni l'heure du départ ni les conditions du voyage. J'arriverai samedi ou dimanche, peut-être avant ces quelques mots. S'il m'est possible je vous enverrai un télégramme.
|
|
A bientôt. Louis.
|
Alais, le 20 février 1917
Chers aimés,
|
Voilà un jour de passé et pas grands renseignements à vous donner, à moins que je ne vous détaille mon emploi du temps. La tante m'accompagna à la gare, j'avais l'air moins seul ; le trajet se fit en compagnie d'Armand et Corneille qui venaient demander une prolongue. Je me rends au bureau du Commandement qui me renvoie à Charmont où je fus proposé pour la visite de ce matin. Je profite de ma liberté pour faire bonne chère chez Vuillermoz (Place Labouré), l'idée me vint de partir à la recherche de M. Fourgeot, qui garde les boches à la Citadelle. Il vint souper hier soir avec moi et un copain d'occasion chez Feuvrier. Je suis venu passer la nuit sur un grabat à Charmont en attendant la visite de ce matin, et diverses inscriptions à donner. Là on me dit que je devais faire partie du 260ème. Alors tout est à recommencer, je repasse la visite demain matin. En attendant je vais aller du coté de Champforgeron demander des tuyaux à la cousine sur les perms. Je crois que j'aurai avantage à demander une perm agricole. Celles d'Orient n'ont pas l'air d'avoir grand succès.
|
|
Votre Louis.
|
|
Mme Besançon m'a forcé à lui dire bonjour hier, me courant après...
|
Besançon, le 24 février 1917
Très chers,
|
Si je prends la plume pour vous écrire (sic) c'est que je ne passe pas vous voir demain. Je suis encore trop bleu pour hasarder la contrebande. Ou plutôt, j'aime mieux être privé du plaisir de vous voir demain, que de m'exposer à en être privé pour quinze ou vingt jours que peut me procurer une perm agricole. Donc au lieu d'aller moi-même chercher mon certificat agricole avec le plaisir de voir Georges s'il est là, je vous charge de me remplacer, en remerciant d'avance Mme Raguin du dérangement que je lui cause et du délassement qu'elle peut me procurer. Faites-lui remarquer que je me suis inscrit cordonnier de profession, mais que néanmoins je suis le principal bailleur d'une exploitation agricole de quarante à cinquante hectares. Vous enverrai le certificat aussitôt que possible, je peux adresser ma demande au bout de dix jours de présence à la compagnie, au Capitaine Jeanneret, qui ne verra sans doute aucun inconvénient à ce que j'aille cultiver le terrain régional. Seulement, je peux être retardé. On ne doit pas chasser deux lièvres à la fois dit-on. Mais j'ai demandé à ce qu'on me place un dentier (puisque le temps travaille pour nous) je suis comme Joffre le "Temporisateur", donc je dois passer la visite encore demain pour ça, ça me fera la quatrième dans huit jours; quel dommage que je sois si bien portant... Enfin, je me consolerai en allant dîner demain avec Berthe, puisqu'elle m'a invité depuis lundi.
|
|
Je ne puis rien vous préciser de plus, le moral remonte un peu en s'habituant mieux à la nouvelle vie de caserne, je vais enfin avoir des draps pour mieux dormir, j'ai noyé un peu le cafard en allant dîner quelques fois chez Mme Feuvrier, où l'on est toujours assez bien soigné à des prix abordables. Hier je suis allé trouver Lucien à Saint-Jacques, il ne se fait pas de bile en attendant qu'on le liquide. Ce matin j'ai revu Mr. Fourgeot, toujours aussi affable. J'ai aussi reçu toutes mes anciennes correspondances de Salonique, y compris mon mandant de vingt francs, avec quarante francs qu'on m'a donné, je suis obligé de répudier l'ordinaire et le réfectoire avec ses nausées de rabiot.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
Besançon, le 27 février 1917
Chers aimés,
|
J'ai quelques minutes avant la soupe, je vous consacre cette feuille. Je ne vous parlerai pas de cafard cette semaine puisque Julien me prédit que je regretterai mon séjour ici. Tu as raison, encore faudrait-il s'abandonner à une passion quelconque, ici les occasions sont nombreuses, mais celui qui garde sa dignité ne trouve pas de bonnes places tant qu'il est attaché à un poste malgré lui, surtout quand il faut observer les énervants règlements militaires. Ta lettre m'est venue dimanche pendant que je passais quelques instants chez la famille Troncin, où j'ai laissé une impression indifférente sans doute.
Ça change un peu, j'ai eu cette satisfaction. |
|
Hier soir je suis allé voir Melle Pautignat qui était déjà en peine de mon sort, quand aux amies du Quai, je ne les ai pas revues, j'ai acheté un journal ce matin à la "Civette" pour voir la figure de la "vieille". Je revenais de Saint-Jean à la prothèse dentaire. Les jours passent en d'interminables motifs de visites.
Ça n'a pas l'air d'être facile à s'esquiver bien longtemps. Enfin j'attends un certificat agricole que j'utiliserai dès qu'il me sera possible. Armand de Baume est venu me retrouver, mes anciens copains sont principalement à Brégille au 25ème. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
Besançon, le 28 février 1917
Chers aimés,
|
Je venais de vous expédier une lettre hier lorsque m'est parvenu votre gros envoi chère maman. Vous avez bien fait de me retourner mes lettres d'Alais. Il me semblait bien que mes infirmières étaient trop polies pour ne pas me répondre. Ce pauvre gros Léon jalouse sans doute mon sort, mais ce n'est qu'à la fin que nous pourrons comparer nos chances ! Julien ne m'avait pas dit qu'il projetait encore une ballade.
|
|
Vous ferez part de mes amitiés et remerciements chez Raguin. Je pourrais utiliser mon certificat maintenant si je n'avais pas demandé des dents, mais je crois que cela ne peut me retarder que de huit jours. Je vais toujours demander vingt heures pour dimanche, avec destination inconnue, peut-être Verne.
|
|
J'ai rencontré Bouhelier hier soir au restaurant comme moi mangeant pour deux sous de frites en buvant un litre, pour tuer le temps. Les principaux copains sont au 35
(?), au Fort Brégille, il y a un des Postif avec lui m'a dit Bouhelier, sortant du 49 territorial. Les conscrits de Verne étaient à Besançon hier soir. Rien de plus nouveau. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
Besançon, le 7 mars 1917
Mes chers aimés,
|
Voilà le troisième jour que je suis rentré et je ne vous ai même pas encore dit si j'avais fait bon voyage. C'est que ces deux jours, je n'ai rien fait naturellement. Sinon que m'esquiver des corvées en "vadrouillant" en ville. Heureusement que j'ai trente ans et plus, sans ça je me laisserais entraîner au vice ; mais jusqu'ici il n'y a que le porte-monnaie qui est avarié, je m'en console en pensant au sort de celui de Salonique... Et à propos c'est le contraire qui m'arrive. Je n'ai pu me défaire du billet que je devais à Georges, qui me fut glissé dans ma poche après d'inutiles supplications. Je n'ai pu vous le dire avant de vous quitter. Je me trouve obligé de ce fait, je rapporterai un petit cadeau à la "Dédé" après l'avis que je demanderai à une de mes femmes...
|
|
J'attendais aussi un peu pour vous écrire, afin de vous donner des renseignements plus précis sur ma perm : ce sera sans doute pour samedi, car on ne m'a rien redit. Figurez-vous que le beau "cogne" qui m'a pincé avant la guerre est venu me demander une perm dimanche soir à la gare de Baume (il n'était pas à Verdun) quel dommage. Sans ma perm de sept jours ça y était. Ce fut mon seul incident, je regagnai le Séminaire avec le copain de Fontaine. Lundi j'ai trouvé Lucien Bouvresse en ville, et le soir je suis allé payer ma boite de sucre trente-trois sous ; on m'attendait en me demandant si j'avais embrassé le "Sergent" et un tas de choses... Hier après-midi, je le tire encore des pattes, un nouveau copain de Macédoine voulait aller à Brégille, je l'accompagne jusqu'au plateau où je vais faire la connaissance de la "Villa Lèche", Mme Besançon était là, l'école est fermée par suite d'épidémie, j'en ai fait connaissance par une reproduction photographique, ça suffit. Nous avons beaucoup causé et visité... mais je n'ai pu rester longtemps. Assez dit pour aujourd'hui. Demain j'irai voir la marraine. Je n'ai pas vu la tante dimanche soir. Au revoir. Louis.
|
Besançon, le 17 avril 1917
Mes chers aimés,
|
Des renseignements à tout instant, comme planton, mais je m'y connais autant que ceux s'adressent à moi.
|
|
C'est aujourd'hui l'arrivée des bleus, à part ceux qui sont paysans. Pauvres gosses, sont-ils contents d'être soldats ! Toujours la neige ! C'est désolant. Avec l'offensive Française et son bilan de dix mille prisonniers c'est tout ce que je peux vous apprendre de nouveau, n'ayant encore vu personne.
|
|
Affectueux baisers de votre Louis.
|
Charmont, le 17 avril 1917
Très chers,
|
Le retour fut excellent en compagnie de Bouhelier, mais aussi froussards l'un que l'autre nous avons regagné nos corps respectifs. Je fus complimenté à mon arrivée à la Citadelle avec vingt-quatre heures de retard qui seraient signalées au Capitaine. C'est un mauvais sergent fourrier qui a usé de son prestige pour m'intimider, mais il n'a pu que me faire rire.
|
|
Le plus gros inconvénient de la journée de hier fut la neige persistante qui me cloua à la chambre jusqu'au moment où le sergent de semaine vint me cueillir pour la garde. J'eus beau protester que je n'étais pas encore arrivé, si bien que je pris le service à
six heures hier soir au poste de police de Charmont, sans avoir le temps de me reconnaître, ni de reconnaître personne.
|
|
Je n'ai eu jusqu'à présent de consolation que dans ma musette, je vais aller voir Berthe dans un instant. Je suis obligé de donner...
(?)
|
Citadelle, le 19 mars 1917
Chers aimés,
|
Voilà le quatrième jour que je suis rentré dans cet exécrable métier ; ceci dit d'une façon générale, car je n'ai pas encore fait grand chose ; la visite de classement hier, je crois rester encore à la 25ème huit jours de plus avec trois kilogrammes de déficit. Je dis bonjour à toutes mes amies, sans rien d'intéressant à vous signaler. Tous les copains sont rentrés, Armand, Oudin, etc... Ils jalousent un peu ma chance d'avoir huit jours de plus qu'eux. Ils n'ont même pas eu l'idée de faire une deuxième demande.
|
|
Quand à une deuxième permission je n'ai pas grand espoir, la perm agricole tient lieu de détente. J'ai demandé vingt-quatre heures pour dimanche, je ne sais ce que j'en ferai si elle est accordée.
|
|
Et vous, vous devez avoir le temps de vous préparer pour les prochains beaux jours, qui ont l'air de vouloir s'éloigner d'avantage. Mais les journaux n'en sont pas moins enthousiasmés par les récents événements ; moi je reste indifférent et vous embrasse tous bien fort. Louis.
|
Besançon, le 26 avril 1917
Chers aimés,
|
Ah ! Le beau temps ! Avec la "Canadienne" vous ferez un meilleur travail que je n'ai pu en faire au bas de la fin ! Mais sans doute que maman avait deux bras occupés ce matin pour venir exposer son précieux produit. Jean-Louis a dû vous donner de mes nouvelles. Je le verrai peut-être demain pour avoir des vôtres. Je préférerais un petit résumé par l'un de vous ; mais à défaut de ceci je me consolerai en attendant dimanche. Si je peux m'esquiver je me rendrai jusqu'à vous. J'ai des nouvelles d'Édouard du 18, à son petit mot il m'envoie un souvenir de sa visite à Verne : où j'ai bien l'air d'un convalescent.
|
|
L'intrigante Mme Besançon a demandé une équipe agricole pour un jardin, et moi comme chef. C'était décidé pour aujourd'hui, mais par une cruelle fatalité, la mère est morte subitement. C'est partie remise, peut-être pour demain.
|
|
C'est tout le nouveau. Affectueux baisers. Louis.
|
Valdahon, le 1er mai 1917
Chers aimés,
Nous sommes ici depuis hier soir, par le train. J'ai eu juste le temps d'aller faire mes adieux au Plateau hier matin. Mme Besançon est venue me dire au revoir à la Mouillère me regrettant pour son jardin. Rien que du bleu pour moi encore ici. Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
Valdahon, le 1er mai 1917
Cher Édouard,
Je progresse... Je suis ici depuis hier soir. J'étais à Verne dimanche. Je croyais te voir pendant mon séjour au pays. Je regrette un peu mon trop court séjour à Besançon. Bons baisers à vous. Louis.
Valdahon, le 3 mai 1917
Chers aimés,
|
Je ne vous ai encore pas dit grand chose de mon nouveau séjour, car une simple vue du camp vous fut envoyée avant-hier sans que je sache même dans quelle direction était le pays. Mais en bon soldat oriental je me suis orienté, c'est facile par ce beau temps clair qu'éclaircit le même vent qui va faire bientôt gercer vos terres battues par les pluies. Ah ! ce temps-là, et la "Canadienne" ! Pas besoin de repiquer les patates.
|
|
Pour quant à moi, je suis mieux ici qu'au mois de janvier car ça doit bien souffler la bise. Il y encore de la neige aux environs, la pousse a bien du retard avec Besançon, du terrain comme à Fontenotte. Heureusement tous les fils de France apportent de quoi faire vivre le pays, presque rien que du "bistro"
(?). |
|
Voilà deux jours que nous faisons l'école de section, modernisée il est vrai, mais toujours aussi rasante. Ils n'ont pas envie qu'on s'aime bien ici. J'ai retrouvé mon ancien commandant d'Orient. J'essaierai de le peloter pour ma perm d'Orient. Mais j'ai demandé à être mitrailleur pour un plus long stage à l'abri, cela entravera peut-être ma demande.
|
|
Je ne sais pas ce que je vais devenir. Dimanche j'ai demandé deux heures, peut-être irai-je jusqu'à Besançon. Enfin je verrai. Plus qu'à vous embrasser tous comme je vous aime. Louis.
|
Valdahon, le 22 mai 1917
Chers aimés,
|
Édouard a dû vous apprendre notre emploi du temps lundi à Besançon. Je l'ai quitté en heureuse compagnie pour regagner Verne. Quant à moi mes sympathiques compagnons m'ont reconduit jusqu'à la dernière minute qui m'envoya au Valdahon. A la Mouillère mes compagnons Armand et Oudin me réservaient une place dans le wagon.
|
|
Depuis ce matin la pluie semble vouloir envenimer le "cafard" inévitable.
(illisible) de heureux font le restant. |
|
Rien de plus nouveau à vous signaler pour l'instant. Bons baisers à tous. Louis.
|
Valdahon, le 25 mai 1917
Chers aimés,
|
Que faites-vous aujourd'hui ? Par ce temps merveilleux ? Que de travail ce beau soleil va vous procurer ! Et bien des absents depuis huit jours... vous ne mangerez pas la fournée cette semaine... Julien doit être à Paris aujourd'hui en compagnie d'Édouard. Moi je viens de rentrer d'une manoeuvre qui m'a beaucoup intéressé... Surtout que je m'attends d'un jour à l'autre à partir pour Besançon à la Compagnie de départ. Armand est parti depuis hier matin, comme volontaire pour l'Orient. Moi, je reste avec le copain Oudin, pour le premier départ, car tous ceux qui avec nous sont plus nouveaux que nous à la Compagnie. Notre perm nous a privé du stage à la mitraille, tant pis.
|
|
Il y a des perms de quarante-huit heures pour dimanche et lundi, mais pas pour nous. Je ne sais ce que je deviendrai. En tous cas, envoyez-moi deux mots comme consolation sur ce que vous avez fait ou qui a pu vous arriver. Bons baisers. Louis.
|
Valdahon, le 29 mai 1917
Chers aimés,
|
Encore un anniversaire ! Le trente-deuxième. Oh ! Quelle destinée, quel sort m'était réservé ! Cependant une petite aubaine m'arrive ce matin : un cas d'oreillon dans la chambre m'envoie à la visite comme les copains. Ceci me permet de faire mon courrier de bonne heure, et vous donner mon emploi du temps de ces deux derniers jours qui furent fériés. Les privilégiés ont eu quarante-huit heures de perm. Moi, j'ai essayé et réussi à passer deux bonnes journées.
|
|
Une récente invitation de Louis me décida à m'orienter pour la Vallée, qui me rappela des souvenirs vieux de quatorze ans. Je fus reçu, avec toujours les mêmes sentiments qui caractérisent mon cousin, j'ai profité d'un peu d'orgueil inévitable et suis rentré à bon port sans trop de fatigues.
|
|
Hier matin j'ai mis les voiles pour le Plateau où j'étais à moitié attendu. La pluie ne m'a pas permis grandes promenades, et ai regagné la gare en sympathique compagnie.
|
|
Aucune nouvelle, pas même du "Sergent", mais
je compte un peu sur la distribution de midi. Sur ce je vous embrasse. Louis.
|
Valdahon, le 31 mai 1917
Chers aimés,
|
Votre carte, chère maman, est venue me trouver hier. Je commence déjà par être inquiet sur ce que vous deveniez tous, car il me semble qu'il y a un mois que je vous ai quitté. Et puis j'ignorais si Julien était parti avec
Édouard. J'attends un petit récit à ce sujet. Et puis votre voyage à Rougemont avec le "Noirot", vous n'avez pas la frousse ; je ne croyais pas que la Noire aurait été immobilisée aussi longtemps. Vous me direz ce qu'il en est survenu, et puis si vous avez donné "Valère" à "Loulette".
|
|
Quel vilain temps cette semaine, je vois l'herbe envahir vos beaux champs de pommes de terre ou autres. Avez-vous pu enlever tous vos chardons ?
|
|
Quant à moi, toujours sur le qui-vive ; comme contaminée, la chambrée a quitté le bâtiment, cela retardera t'il le départ ? Je l'ignore, huit jours plutôt au plus tard... Rien de plus nouveau que mes affectueux baisers à tous. Louis.
|
|
Que devient Jules Curty ? Je n'ai pas revu Marie.
|
Valdahon, le 4 juin 1917
Chers aimés,
|
Quel beau soleil ce matin ! Quelle semaine en perspective ! Quel bon travail vous allez faire. Mais mon Henri, je vois du foin par-dessus les toits. Les irrévocables règlements militaires nous ont fait perdre ou piétiner
(?) des voitures chaque jour à travers le camp. Il vaut mieux t'occuper de la "Deering" que des superbes
(illisible) qui doivent avoir bonne mine derrière vous ce matin, quant aux autres plantations, c'est de la distraction en attendant les beaux jours, mais puisqu'ils ont l'air d'être là, récoltez le foin. J'ai honte d'être de mon pays quand je vois des bœufs de mille kilos à trois ou quatre ans ici, dans ces pays, et tous pour la boucherie ; j'ai un sentiment de pitié pour nos deux gros bœufs pleins de poux...
|
|
Mais dans ces montagnes du Doubs il y a toujours une réserve de quarante à cinquante voitures de foin à cette époque, et tant au pâturage, on ne casse pas tant de charrues qu'a Verne, c'est le système de Gustave Fayette. Aussi les femmes y sont plus belles qu'à Verne...
|
|
Peut-être allez-vous supposer que j'en viendrai chercher une ici après la guerre, surtout quand je vous aurai dit que je me suis baladé hier à Fallerans. Le camp en est à trois kilomètres, comme nous sommes toujours contaminés, nous avons la visite tous les jours à neuf heures, je ne pouvais guère aller loin hier. Donc mes anciennes connaissances de Fallerans furent le but de mon voyage... Je fus reçu comme il convient pour un poilu,
Melle Rose Gerrier m'a reconnu de suite, j'ai vu aussi la femme Barthod, toutes deux vous envoient le bonjour maman. Mais le fils à Gerrier et Barthod sont toujours à Monastir.
|
|
Rien de plus nouveau. Bons baiser à tous. Louis.
|
Valdahon, le 6 juin 1917
Chers aimés,
Mon cher
Julien, les récits de ton voyage à Paris viennent de m'arriver.
J'aurais pu te voir à ton passage à Besançon si je l'avais su. Je ne
puis guère commenter ce que tu me racontes puisque je n'y connais
rien. Par
je savais ton passage à l'aller et c'est tout. Voici trois jours que le soleil doit te faire perdre les souvenirs que tu avais pu rapporter.
Quant à moi ma situation de contaminé me permet de supporter ces chaudes journées par les désirs du parfait "tire-au-flanc" ; mais aussi ce privilège est payé par le refus de toute sortie régulière. Je ne prévois encore pas le moyen de m'esquiver dimanche prochain.
Je viens de recevoir un rayon de la gaieté qui règne au Quai, il parait que vous avez reçu l'avis d'invitation qui y fut rédigé. Il m'intéresse sans doute plus que vous, grâce à ma situation de séquestré, mais ne pourrai sans doute pas y répondre.
Rien de plus nouveau que mes affectueux baisers à tous. Louis.
Valdahon, le 14 juin 1917
Chers aimés,
|
Mon cher Julien, quel a été le résultat de notre démarche de dimanche par ce temps abominable ! Des avalanches de pluie presque tous les jours, déjà dimanche ici il était tombé un orage dont nous avons senti seulement le poids du soleil en te reconduisant à la Viotte. Mes aimables compagnes en ont eu pour jusqu'à six heures à la Mouillère. Je ne sais pas ce qu'est devenu le foin, mais j'ai reçu des cerises par un permissionnaire qui fut réquisitionné à Besançon, une grande boite qui fut confectionnée au Quai.
|
|
Je n'aurai pas de perm pour dimanche. Je m'attends à être appelé à Besançon d'un jour à l'autre pour les dents. Ce sera plus commode d'aller jusqu'à vous, si j'y reste quelques jours. Qu'allez-vous devenir si ce mauvais temps persiste
? |
|
Quant à moi je laisse aller les événements. Je crois que pour le moment il n'y a plus guère à faire, qu'à nous faire miroiter quelques espérances quelconques, américains ou autres... Rien de plus nouveau que mes affectueux baisers à tous. Louis.
|
|
Chère maman, Julien vous a-t-il dit que j'ai raté l'occasion de vous faire venir à Besançon avec lui ?
|
Charmont, le 27 juin 1917
Chers aimés,
|
Je suis encore à Besançon, car lundi je n'ai pu obtenir mes passeports pour le Valdahon. J'ai perdu la confiance, je fus porté manquant depuis samedi soir à lundi matin, je rejoindrai donc le camp en détachement, samedi je crois, en attendant je couche à la boite, et pas moyen de sortir.
Ça ne vaut pas le lit du Plateau, enfin c'et une petite indigestion de dragées qui n'aura pas eu de suites fâcheuses.
|
|
A part cela, j'ai fait bon retour lundi en compagnie de Bonfils, j'ai à peine vu mes amis au Quai, et je fus consigné en arrivant au bureau de ma Compagnie. Quelques corvées pour tuer le temps, voilà comme je vais faire les foins. L'occasion est excellente pour m'habituer à mon dentier, j'ai même dormi avec cette nuit et pourrai peut-être m'y habituer.
|
|
Vous m'écrirez à Valdahon. Vous me direz si la Faucheuse marche mieux. Louis.
|
Charmont, le 4 juillet 1917
Chers aimés,
|
Je suis toujours à Besançon, mais plus en boite, cette aventure m'a valu de prolonger mon séjour ici et manquer un renfort pour le 363ème.
|
|
Mon copain Oudin a été embarqué ce matin, j'étais sur la liste à Valdahon. Je ne sais ce qu'on va faire de moi, en attendant je m'esquive le plus que je peux. J'ai retrouvé mes amies qui ont bien rigolé de ma séquestration. Seulement j'aurais bien aimé recevoir une petit mot de vous, me disant tout le foin que vous avez de pourri. Peut-être irai-je dimanche. Quitte à avoir encore huit jours. Sur ce je vous embrasse tous bien fort.
|
Valdahon, le 9 juillet 1917
|
Je suis rentré sans embûches à mon port d'attache, les dernières minutes de la journée m'ont trouvé au plumard. J'ai distribué mes denrées à leur affectation respective ce matin ; le blé m'a valu un verre de blanc, le beurre un agréable plat de petits pois. Enfin je crois que je vais laisser couler encore quelques bons jours pendant que vous attendrez peut-être vainement le beau temps
(?). Affectueux baisers à tous. Louis.
|
|
Une laconique carte d'Édouard est arrivée à Mme Besançon.
|
Charmont, le 10 juillet 1917
Chers aimés,
|
Voilà un temps qui permet de réfléchir à bien des choses... Est-ce ça qui fait qu'on pense à moi ? Peut-être. Toujours est-il qu'on va me réexpédier à Valdahon ce soir. Je viens de l'apprendre à l'instant et m'empresse de vous le communiquer au cas où vous auriez besoin de m'écrire.
|
|
J'ai soupé chez Mme Bey hier soir, je fus cordialement reçu, mais ne fus qu'un personnage secondaire parmi les convives invités.
|
|
J'ai fait une carte à Édouard ce matin, mais n'ai rien reçu de lui.
|
|
En vous permettant de vous tenir au courant sur ce qui m'arrivera, je vous embrasse fort. Louis.
|
Valdahon, le 11 juillet 1917
Chers aimés,
|
Cette fois ça se précise pour moi. Ma Compagnie m'a rappelé pour m'expédier en renfort, je ne sais au juste encore quel régiment, peut-être le 363ème où est Oudin. Je passe la visite cet après-midi pour descendre demain matin à Besançon. Là si je puis disposer de quelques heures j'irai vous dire au revoir, mais rien de certain, comme toujours.
|
|
J'ai eu des nouvelles d'Oudin depuis le Dépôt de son régiment où il est arrivé du coté de Suippes je crois.
Ça ne me déplait pas trop si nous allons là. |
|
Les amies du Quai m'on fait la dernière reconduite à la Mouillère hier soir.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui que mes affectueux baisers à tous. Louis.
|
|
Je n'ai pas pu déposer ma demande pour essayer de rejoindre Édouard. Maintenant c'est trop tard, tant pis.
|
Charmont, le 18 juillet 1917
Chers aimés,
|
Le soleil m'a trouvé ce matin sur une voie de garage aux environs de Charmont ; la chaleur et la fatigue m'y ont fait arriver cette nuit sans que je m'en doute. Je crois que nous allons repartir du coté de Saint-Dizier au D.Dre. Des tuyaux ou des "canards" parlent des secteurs célèbres, des environs de Verdun où serait le régiment... Mais cela ne m'émotionne pas encore.
|
|
Chère maman, le départ de Besançon s'est effectué comme je l'avais prévu, nous sommes même restés un jour de plus que je ne croyais. J'ai eu la tentation d'aller encore une fois jusqu'à Verne, mais on avait bien soin de ne pas nous renseigner sur le départ. Enfin je me suis consolé en allant coucher deux bonnes nuits au Plateau, je ne puis oublier la gentille attention de Mme Besançon et de
Melle Jannet qui m'ont accompagné hier jusqu'au départ du train.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui que mes affectueux baisers à tous. Louis.
|
le 19 juillet 1917
Chers aimés,
|
Je suis arrivé au matin de mon premier jour d'arrivé au D.Dre dans les parages que je vous signalais hier. Mais ici ce n'est pas encore le danger, à peine quelques coups de canons à quatre-vingt kilomètres. J'en suis heureux en pensant à la situation prolongée d'Édouard dans les conditions où je me trouve pour combien de temps je l'ignore ? Mon régiment a dû être éprouvé ces jours-ci d'après les communiqués concernant cette fameuse côte dominant la "Tour Eiffel".
|
|
Je ne suis pas trop fatigué de mon voyage, à part mon porte-monnaie, car pour deux jours j'ai eu une boule de pain moisi, et deux petites portions de viande. Ici nous sommes à quatre ou cinq kilomètres de la gare dans un petit village sur les confins des trois départements : Haute-Marne, Marne et Meuse. On peut avoir du vin à vingt-six sous et autre chose comme épicerie, mais ma foi très cher. Hier soir nous deux, Lanoix, il nous a fallu acheter pour trois francs
(?) de saucisse et de fromage pour ne pas se coucher à jeun.
|
|
Avant de partir de Besançon j'ai eu une lettre d'Édouard, je vais m'empresser d'envoyer mon adresse aujourd'hui en commençant par vous afin d'obtenir quelques bonnes paroles, le plus tôt possible, dans cet espoir je vous embrasse tous bien fort. Louis.
|
|
Si Jeannin est ici, envoyez-moi son adresse.
|
le 6 août 1917
Chers aimés,
|
Depuis que je vous ai quittés j'ai encore pu passer quelques bons moments à Besançon. Mme Besançon était à la gare et nous a emmené dîner au Plateau.
Melle Jannet est venue nous aider à descendre, nous avons eu tout le temps voulu de faire nos adieux à nos sympathiques compagnes, car nous avons attendu nous deux
Édouard le train militaire de dix heures et demie qui nous a amené ensemble jusqu'à Dijon.
|
|
Une carte de Troyes vous a indiqué la ballade que j'ai dû faire pour mon dimanche. Inutile de vous dire tout le travail qu'a fait mon esprit pour arriver à mon Dépôt hier soir à neuf heures trente. Je n'ai pas perdu de temps car je vous écris déjà depuis ma nouvelle affectation. Ce matin un détachement m'a amené au régiment. Je suis à la 17ème compagnie. Nous allons partir pour les tranchées ces jours-ci. Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
le 8 août 1917
Cher Édouard,
|
Pour moi les événements se précipitent. C'est à proximité de ces lignes tant bouleversées que je t'envoie ces deux mots.
|
|
J'aurai passé mes derniers instants de tranquillité en la Compagnie. Hier soir les autos nous ont amenés ici, dans un bourbier sous bois, tout creusé d'abris souterrains, où l'on respire la dernière minute avant de s'engager dans les boyaux boueux, ce que nous allons faire ce soir.
|
|
J'ai à te faire part de la lamentable impression que produit ces embarquements en autos. Pourquoi les hommes ont-ils le cruel pressentiment de ce qui leur est réservé en ces temps tragiques ? Le sort des bœufs gras est préférable. Aussi les cris, les chants les plus réprimés sortent-ils de ces convois qui filent à toute vitesse, et pourtant ce n'est pas le vin qui grisait les hommes, les cafés furent consignés en vue du départ. En route j'enviais le sort d'un convoi d'évacués, masses boueuses plutôt qu'humaines.
|
|
J'arrête ces tristes descriptions que tu n'ignores pas mais qui frappent celui qui les subit pour la première fois comme moi, mais crois à la tranquille assurance de ton frère qui t'embrasse. Louis.
|
le 8 août 1917
Chers aimés,
|
Les jours se suivent mais ne se ressemblent guère. Il y a quinze jours j'arrivai tout joyeux de Besançon ; il y a quatre jours je le quittais sans trop de tristesse. Aujourd'hui c'est au milieu d'un bourbier dissimulé sous bois que je vous fais part de ma triste situation présente. Je m'en estime heureux cependant d'avoir eu une permission, car à présent elles sont suspendues à la Division, j'envisage l'avenir avec une calme résignation.
|
|
Je suis rentré juste pour repartir, j'ai eu le temps de voir les rares copains que je connaissais. Je n'ai pu voir Jeannin qui reste au D.Dre comme père de trois enfants, et qui reviendra sans doute plus en arrière prochainement, mon copain de Battant est passé cycliste à la Division sous le même titre, ah ! que ne me suis-je pas marié à dix-huit ans !... J'ai trouvé avec satisfaction Lanoix, en arrivant, qui m'a bien débarrassé, nous partagerons à peu près les mêmes misères ou dangers, étant au même bataillon.
|
|
Je vous ai déjà dit que nous irions sous peu aux tranchées. Donc hier soir, les autres sont venus nous chercher à domicile, quatre-vingt kilomètres environ, dans la direction de ces si célèbres endroits, nous ont amené ici d'où je vous trace ces lettres sur mes genoux. Trois ans de guerre ont fait même sécher les gros arbres à la forêt, nous avons couché dans des abris souterrains, entassés comme des harengs ; cependant les obus ne sont pas venus jusqu'à nous, les "totos" ne m'ont pas encore trop envahis mais les rats me sautaient sur le nez. Enfin l'image de Mme Besançon va bientôt m'être propre. Je crois que c'est ce soir que nous allons faire la relève.
|
|
J'ai à vous faire part de la lamentable impression que produit les embarquements en autos. Le sort des bœufs gras est préférable. Les hommes conscients du danger qui les attend sont grisés ; ce n'était pas par le vin, car les cafés du village furent fermés en prévision du départ ; aussi les plus échaudés chantaient-ils l'Internationale ; ce n'est plus le dépôt de Besançon. Nous avons croisé un convoi d'évacués, plutôt malades que blessés, ah! j'enviais leur sort malgré leur forme d'une masse jaune de boue aussi jaune qu'un curé puisse paraître noir sous sa soutane ! Je m'arrête en vous priant de croire que mes sentiments ne sont encore pas si désespérés que mes lignes pourraient le faire supposer. Louis.
|
le 10 août 1917
Chers aimés,
|
Ma situation présente ne me permet pas de vous donner grands détails aujourd'hui. Qu'il vous suffise de savoir que je vous trace ces mots à la faveur de la lumière d'un trou de sape ventilé par le sifflement des obus, le bois que nous occupons est privé de toute végétation tellement il est retourné et brûlé, seuls quelques gros arbres laissent voir un bout de moignon, le boyau d'accès est tracé par quatre kilomètres d'une boue gluante de trente centimètres d'épaisseur. Jugez de mon état !
|
|
Dans quelques jours j'espère pouvoir vous adresser des paroles moins lugubres. Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
le 12 août 1917
Chers aimés,
|
Il y a huit jours je m'acheminais tristement vers ma destination inconnue. Ma tristesse était motivée par le souvenir des bons moments d'une permission et par l'appréhension d'un sort futur. Certes ! je n'avais pas tort ! Me voici aujourd'hui faisant un grand effort pour avoir le courage de trouver un petit brin de bonheur en pouvant causer un petit peu avec vous. Ce sera ma seule marque de ce dimanche que je ne trouve que marqué sur mon petit calendrier.
|
|
Je viens de réussir à arriver à la lumière du jour par l'étroit escalier qui permet de sortir de ma sape, où nous sommes abrités environ cinquante. Là ce souterrain nous sert de dortoir, mais sans pouvoir s'allonger, de salle à manger, mais quels repas, je viens de manger un bout de viande pioché dans un sac, avec des légumes cuits de la veille, un quart de vin, et un café froid. Jamais rien de chaud. Le ravitaillement arrive chaque nuit à deux heures du matin, c'est moi qui suis allé le chercher cette nuit par un boyau de quatre kilomètre, encadré par les obus, et où à chaque pas je me demandais si je n'avais pas perdu un brodequin dans la boue gluante. C'est le travail de chaque jour ou bien d'améliorer les positions jusqu'à quatre heures du matin. A peine pouvons-nous avoir de l'eau pour boire, un espèce de trou de mare nous donne une eau épaisse, et la moindre marche ou corvée nous trempe la chemise.
|
|
La description est suffisante pour un dimanche, car je ne vous parle pas du sifflement perpétuel d'obus qui s'entrecroisent, jour et nuit qui bombardent l'arrière, jusqu'ici les "crapouillots" ou "torpilles" nous ont réservé, nous aurons l'arrosage d'obus les jours d'attaques. Voilà quatre jours que nous sommes dans les trous, nous pouvons y rester encore quatre ou cinq jours je crois.
|
|
En tous cas j'aurai été bien remis en main et promptement. Je n'avais encore rien vu, et m'attends à voir encore autre chose un jour d'attaque. Comme les copains je suis consterné, ou résigné, me demandant si une issue quelconque ne serait pas préférable...
|
|
Enfin à la garde de Dieu, j'attends machinalement le sort qui m'est tracé. J'espère trouver quelques bonnes paroles sous peu. Je n'ai encore rien reçu ici, les lettres viennent tous les jours ou à peu près. Ma lettre est finie, mais vais rester avec vous le plus longtemps possible. Louis.
|
le 14 août 1917
Chers aimés,
|
Ma vie d'enfer continue ! Je vous trace à la hâte quelques mots du fond de mon trou de taupe, étroit et infect. Au dehors c'est le feu roulant qui prépare une attaque... La férocité humaine est indescriptible. La fureur des éléments est secondaire ; la pluie, le chaud, le froid, la faim ne sont rien. Il y a de l'eau ou de la boue jusqu'aux genoux dans les tranchées, on ne pense même pas à lever la tête, tellement le sifflement des obus est continu. Je ne crois pas pouvoir résister bien longtemps. N'importe quelle issue me sera favorable...
|
|
Pardonnez-moi cette franchise cruelle. Je crois en avoir encore pour deux ou trois jours. Une premier mot d'affection m'est arrivé hier de Mme Besançon.
|
|
Au revoir et affectueux baisers de votre martyre. Louis.
|
le 15 août 1917
Chers aimés,
|
En l'honneur de cette fête je veux vous dire quelques paroles moins lugubres que précédemment. Je ne suis pas sous la même influence désespérante. Pourtant je n'ai pu encore bien me réclaircir les idées, ni même la vue, car mes mains n'ont encore vu l'eau que deux fois depuis que je vous ai quitté. Je suis obligé d'avoir le casque pour vous écrire à l'entrée de mon trou car les éclats d'obus tombent de chaque coté de moi, et le masque ne nous quitte jamais.
|
|
Mais tout de même, on nous a ramené quelques kilomètres en arrière cette nuit, je me suis déchaussé, j'ai eu quelques cuillerées de soupe à dix heures, et puis j'ai eu votre bonne lettre, hier soir, du 10, chère maman. Telles sont les légères améliorations dans mon triste sort.
|
|
Afin que rien de vienne gâter ces bonnes dispositions je m'empresse de vous embrasser tous bien fort. Louis.
|
|
Plus que jamais, j'ai perdu la notion de vos occupations, cependant dites-moi ce que vous faites, le plus souvent possible.
|
le 17 août 1917
Chers aimés,
|
Je suis un peu moins désemparé, nous ne sommes plus si près des boches, l'habitude et surtout le puissant espoir du retour permettent d'affronter tout ce que l'imagination peut supposer de terrible. Cependant
voilà dix jours que je ne connais pas la minute du silence, même au fond du souterrain étroit et infect, le déplacement d'air provoqué par la puissance des explosifs éteint la bougie. J'ignore encore si nous allons bientôt en arrière. Cet infernal bombardement a une signification...
|
|
Voilà quinze jours aujourd'hui que je faisais mes préparatifs de départ, je me demande comment je peux m'en souvenir ? C'est sans doute par ma boite de cancoyotte. Je l'avais oubliée au Plateau, Mme Besançon sait que j'y tiens me l'a réexpédiée au D.Dre. Je n'y comptais plus quand hier elle m'arrive. Une bande de papier collée autour du couvercle faisait soudure, elle est encore bonne et suis content de l'avoir.
|
|
Un envoi de fruits du Plateau m'est signalé, mais j'ai bien peur que ce ne soit de la compote. Louis.
|
|
Édouard ne m'a encore rien envoyé.
|
le 18 août 1917 6h
Chers aimés,
|
Je suis matinal avec vous n'est-ce pas ? C'est que la fraîcheur m'a éveillé de bonne heure, m'étant endormi cette nuit au pied d'un foyard, nous allons repartir, et ma foi, mon sac comme siège, mes genoux pour pupitre, je vous transmets mes premières pensées. Oui, tout de même on nous retire du milieu de l'enfer, après douze jours, nous sommes partis hier soir, non sans être accompagnés le long du chemin par les obus. Ce ne sera pas nous qui ferons l'attaque, mais peut-être reviendrons pour la contre-attaque ; enfin pourrons-nous avoir le temps de nous décrotter un peu. J'ai encore ma barbe de Verne, avec treize jours de boue, sans pouvoir se laver, voyez votre "poilu". C'est égal, quand on y tourne le dos, c'est une résurrection que je m'empresse de vous faire part.
|
|
J'ai enfin des nouvelles d'Édouard. Le beau temps à l'air de vouloir revenir, autant de facteurs qui me permettent de vous dire que je vais bien, je vous ai assez inquiété dernièrement !
|
|
Vous devez encore avoir des gerbes à rentrer, peut-être serez-vous un peu favorisé, mais déjà le regain va vous occuper. Avez-vous un berger ? Eu Musener
(?) ; autant de choses que j'espère apprendre un de ces jours. Bons baisers. Louis.
|
|
Lanoix vient de me dire bonjour, je ne l'avais pas revu depuis que nous étions en ligne.
|
le 18 août 1917
Chers aimés,
|
Comme vous le supposiez, votre lettre du 16 est venue me trouver en assez bonne situation, chère maman. Voici le quatrième jour de repos, les émotions de douze jours sont un peu dissipées, les dégâts physiques se réparent. La cuisine n'est pas trop mauvaise, l'eau est en abondance, le beau temps persiste. Une coopérative nous vend quelques bricoles, mais pour avoir du vin le soldat de deuxième classe n'est pas digne d'en disposer à sa guise... Cependant je me suis hasardé hier jusqu'au village voisin, ou plutôt les ruines du village, j'ai trouvé du vieux bordeaux à trois sous ! Mais qu'est-ce que le prix quand on fête une résurrection en même temps qu'on envisage une avenir incertain. Car nous sommes restés trop près de la fournaise pour ne pas aller remplacer ceux qui y sont depuis quatre jours, à tout instant les obus viennent arroser notre camp. Chère maman vos quatre pages sont remplies de l'angoisse que vous a causée ma franchise sur la description de ma situation, peut-être ai-je eu tort, mais vous savez bien que l'on peut compter sur la véracité de ce que j'écris et puis à quoi bon bercer de fausses illusions ceux que l'on aime ? moi j'estime que le véritable amour consiste d'abord par la franchise.
|
|
Je suppose que vous n'allez pas vous affoler en lisant les pompeux communiqués qui concernent les secteurs que je peux occuper. La coupure ci-jointe va vous fixer. J'ai dû vous dire que nous n'avons pas fait l'attaque, mais seulement coopéré à la préparation. Aurons-nous la contre-attaque, c'est probable ? A la garde de Dieu. Maintenant l'orage est passé, ça se calme un peu. C'est au service de santé à travailler, les autos défilent remplies de blessés, quant aux autres, les morts, les trous d'obus ne manquent pas pour les pousser dedans ; la semaine prochaine la contre-attaque les déterrera, c'est l'éternelle horreur qui se répète
voilà trois ans ! A l'arrière les journaux n'ont pas de caractères assez gros pour imprimer tous les exploits de nos "poilus" mécaniques, le haut commandement a la satisfaction du devoir accompli et ne craint pas les interpellations, et les badauds applaudissent, repoussant toute initiative de paix, qu'elle vienne de Bonne
(?) ou de Stockholm, tant que l'envahisseur sera là.
|
|
Je n'ai plus de place, et vous n'avez pas le temps de me parler de vos affaires. Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
le 26 août 1917
Cher Édouard,
|
Après huit jours de qui-vive l'ordre va enfin arriver je crois. Ce soir c'est la direction de la "victoire" qu'il faudra prendre. Mais il vaudrait mieux être spectateur qu'acteur...
|
|
Mais j'aurais eu le temps de me reconnaître ou d'être mieux habitué que la dernière fois. Je ne m'effraie pas trop et ai bon espoir.
|
|
J'ai enfin pu encaisser tes deux mandats. Pourvu que les boches me permettent d'en profiter quand nous pourrons fêter une petite résurrection. Ici nous n'avons que du vin à trois sous la bouteille, il n'est pas destiné pour le "poilu" de deuxième classe...
|
|
Depuis les derniers événements tu as pu supposer que je faisais partie de la 2ème Armée qui est en train de se couvrir de gloire. Tu me demandais ce petit renseignement étant en perm. Quelle conclusion pourras-tu en tirer ?
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui que mes affectueux baisers. Louis.
|
le 26 août 1917 12h
Chers aimés,
|
Je ne croyais vous expédier cette feuille aujourd'hui. Mais je ne pensais pas hier que ce serait aujourd'hui dimanche. J'ai même pu entendre un bout de messe ce matin, dans notre camp sous bois et sous obus. Voilà huit jours qu'on se "fait du lard". C'est ainsi la vie militaire. Je vous ai dit ou redit que nous étions sur le qui-vive. Prêt à secourir les braves qui reçoivent tant d'éloges, plus qu'ils ne s'en attribuent sur nos journaux actuellement.
|
|
Notre heure est venue, ce soir nous allons nous rapprocher, je viens de faire mon sac, si je passe entre deux obus, ce ne sera sans doute pas commode d'éviter les gaz. Mais j'ai mes deux masques, il faudra faire Carnaval sans beignets... Mais ce ne sera pas si brutal que le premier coup. Je suis mieux habitué, et puis si le beau temps persiste, les fatigues ne seront pas comparables.
|
|
Hier la famille bregillotte m'a envoyé ses vœux de bonne fête, c'était la Saint-Louis.
|
|
Peut-être m'en arrivera t'il de Verne ce soir. Si ce n'est pas à l'occasion de mon nom, ils n'en seront pas moins ardents et sincères.
|
Dans l'espoir de cette douce illusion, je vous embrasse tous bien tendrement. Louis.
le 28 août 1917
Chers aimés,
|
Jamais je n'aurai tant usé de papier à lettre que ce mois d'août. Puisque je vous ai dit dimanche que je retournais au danger, je me suis obligé à vous renseigner plus souvent. Et puis hier m'a semblé un jour sans pain, il fut seulement sans correspondance.
|
|
Donc par un mince filet de lumière qui m'arrive par l'escalier de ma sape, j'essaie de vous griffonner cette feuille. J'étais déjà à cette place au 15 août. Ne suis pas encore au premier rang. Y irai-je ? Je l'ignore. L'air est sillonné par le sifflement lugubre des obus, je suis la trajectoire des nôtres et celle des obus boches qui vont plus loin que nous... car tout est assez bien servi. Depuis la dernière attaque le bois est de plus en plus déchiqueté et les feuilles intoxiquées par les gaz font avancer la saison de deux mois. Car ça c'est la guerre ! mais tout de même, la gueule des canons n'écume pas de rage comme ces temps derniers, c'est une légère accalmie. De quel coté nous reviendra l'orage ? Seulement après huit jours de beau voilà la pluie qui va remplir nos boyaux ainsi que les trous de vos prés. Cela me permettra peut-être de vous lire plus souvent. Dans cet espoir je vous embrasse tous. Louis.
|
|
Georges est-il encore à Verne ? Le bonjour à Jeanne que vous voyez chaque jour.
|
le 29 août 1917
Chers aimés,
|
Dans les mauvais jours je vous écrivais souvent. Pourquoi ne pas le faire dans les moments oisifs ? Au moins mes lettres n'auront pas toujours des sentiments d'inquiétudes pour vous ! Et puis le temps passe plus vite pour moi, il me semble qu'il y a longtemps que je ne vous ai rien dit lorsqu'il y a deux jours que je ne vous ai pas écrit. Seulement les vôtres ne viennent pas souvent, vivement que les veillées s'allongent un peu, l'un ou l'autre pourra m'envoyer deux mots lorsqu'il ne sera pas encore dix heures du soir. Pour le moment j'ai la famille bregillotte qui y supplée, la mère, les filles n'oublient pas l'Oriental. J'ai appris que vous aviez des orages terribles il y a huit jours, mais je suppose que comme nous le soleil vous aura un peu indemnisé, et sans doute à cause de cela n'avez-vous pu avoir la minute pour me le dire. Mais tout le monde aura compté sur la maman qui aura rogné une heure sur la journée avant l'arrivée du facteur.
|
|
Dans cet espoir et toujours assez tranquille dans l'attente des ordres incertains je vous embrasse tous bien fort. Louis.
|
|
Édouard m'apprend la mort du fils Jannet, tombé à Ypres. J'use beaucoup de papier, je vous réserve l'autre feuille pour demain ou après.
|
le 30 août 1917
Cher Édouard,
|
Comme je t'ai dit dimanche que je retournais aux tranchées, je me suis engagé de ce fait à rassurer ton inquiétude tant qu'il me le sera possible. Eh ! bien ce matin les artilleurs ne sont pas trop fâchés et me permettent de sortir de mon trou pour t'expédier ceci.
|
|
Nous ne sommes pas en premières loges mais en secondes, sous la trajectoire de nos obus et celle des boches qui vont plus en arrière. Cependant je crois que nous allons être relevés pour aller villégiaturer quelques temps au pays du mousseux. Je serai rapproché de toi. si tu voyageais autant que jadis, peut-être pourrais-tu venir me rendre visite.
|
|
Le retour du mauvais temps ne permet pas plus que le beau aux gens de Verne d'écrire, pourtant ça leur est plus facile qu'à moi, mais le temps leur manque, croient-ils ! Je n'ai rien reçu d'eux voilà quinze jours.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui que mes fraternels baisers. Louis.
|
le 31 août 1917
Chers aimés,
|
Nous sommes toujours à l'époque de la grande patience, ce que donne toujours l'espérance.
|
|
Hier soir me sont parvenus malgré les obus deux grands colis. L'un tombé du 13 août était des reines-claudes que Mme Besançon avait fait la folie de m'expédier. La caisse était intacte, mais quant aux prunes... pas une n'était intacte.
|
|
Le vôtre du 17 août aurait eu plus de chance si la boite avait été en bois. Ayant été écrasée d'un bout, l'eau ou l'humidité avait fait fondre le chocolat et moisir le gâteau, mais il y avait encore du bon. Quant au pain d'épices, vous direz à la Marie qu'avec une "topette" de rhum il fait oublier la guerre, et que je ne puis que l'embrasser de trop loin pour la remercier. Je puis avoir quelques bouts de sucre en cas de besoin. Est-ce encore des dragées de Fontenelle ? Je n'ai encore pas goûté la saucisse qui ne doit pas s'abîmer. Ne m'envoyez pas de conserves qui coûtent trop cher et que l'on peut trouver ainsi que le chocolat. Vous pourrez m'envoyer de temps en temps une petite boite de cancoyotte seule, en colis postal non recommandé, qui pourra m'arriver comme une lettre, ou bien du beurre, mais pas mélangés.
|
|
Pour l'instant je ne vais pas trop mal, si j'avais eu la satisfaction de vous lire, vos dernières nouvelles ont quinze jours, et habituellement elles viennent en quatre jours. D'un jour à l'autre j'espère recevoir une lettre, mais rien, sera-ce pour ce soir ?...
|
|
Nous sommes en instance de départ, nous allons prendre le train pour d'autres régions non moins célèbres, prendre d'abord quelques jours de repos.
|
|
Rien de plus pour aujourd'hui que mes affectueux baisers à tous. Louis.
|
|
Hier j'ai eu des nouvelles de Gouhélans. Léon est rentré aussi.
|
le 1er septembre 1917
Bien chers aimés,
|
Il m'est loisible de vous embrasser en ce jour du seigneur. J'en aurais un remord de ne pas le faire par un entraînement de nonchalance. Rien de nouveau pour moi. Les inquiétudes dangereuses ne paraissent plus imminentes. Par ce temps pluvieux on nous a ramené un peu plus en arrière, sous un pan de toit que les marmites ont laissé en l'air où j'ai pu changer de linge et faire ma toilette. Je viens de remercier Mr. Fourgeot, c'est l'heure de la tranquillité intime. Le restant de cette feuille contient pour vous ce qui ne s'écrit pas et ne se paye pas. Votre Louis.
|
|
Après s'être égarés sans doute j'ai eu hier les aimables mais surprenants vœux de ma chère marraine.
|
le 3 septembre 1917
Chers aimés,
|
Après vingt-trois jours sans quitter le casque et le masque, les autos et le train nous ont enfin sorti des régions infernales. Je vous ai envoyé hier une carte du pays qui va enfin nous donner un peu de repos. Nous avons quitté la glu de la Meuse pour le plâtre de la Champagne. Lequel des deux vaut-il mieux ? Nous occuperons sans doute un secteur aussi célèbre que celui que je viens de quitter. Mais pour l'instant, à part les absurdes emplois du temps des règlements militaires, le principal sera de se "retaper" pour une prochaine secousse. Nous pourrons trouver à peu près ce qu'il nous faudra ici, mais hier matin en arrivant, au lieu de prendre ses poux il a fallu commencer par la garde ; d'où je vous ai expédié ma carte qui vous disant mon inquiétude de ne rien recevoir de vous. Enfin à présent la distribution vient de me rassurer. Mon cher Julien ta lettre du 28 m'arrive à l'instant. Elle aura demain huit jours. Ce sont ces Messieurs du contrôle postal qui l'ont ouverte. Ils ont eu du temps pour la lire. Ils ignorent que tu es obligé d'être aussi patriote qu'eux, par conséquent incapable d'écrire des documents compromettants... C'est sans doute en raison des dernières attaques qu'a eu lieu ce zèle de la censure. Mme Besançon me dit qu'ils ont ouvert une carte où une croix indiquait le lieu où je le trouvais, comme sur la coupure que je vous ai adressée. Plusieurs copains signalent le même fait.
|
|
Le calme des lieux que j'occupe me permet de m'intéresser à tous les détails que tu me signales. Les vesces que tu me revendiques n'auront guère eu de chance, pas plus que le regain de Saussaie. Où allez-vous loger mes petits veaux ? Si vous n'avez rien vendu ?
|
|
A part le beau temps qui nous est revenu, rien de plus à vous signaler pour l'instant ; je vais expédier ma lettre pour le premier courrier de demain, il est six heures du soir avec une bonne nuit que je vais enfin dormir tranquille, la première depuis que je vous ai quittés. Je vous dis bonsoir et vous embrasse tous affectueusement. Louis.
|
|
Le bonjour de ma part aux rescapés d'Orient.
|
le 7 septembre 1917
Chers aimés,
|
J'en suis à mon quatrième jour de repos. Le 255ème est en plein printemps. Presque encore rien à faire qu'à s'installer et à se nettoyer. Il a bien fallu trois jours pou ça, car il y avait quelque chose à faire, mais nous sommes favorisés, des brasses, de l'eau, du savon, et ce qui importe le plus, du soleil, et au besoin du feu... mais la semence ne périra pas !
|
|
Enfin les misères dernières s'évanouissent déjà. Ce qui y contribue pour beaucoup, c'est l'ouverture de quatre ou cinq bistros dans le village, et avec ça la paye du dernier prêt : treize francs vingt, pour un soldat de 2ème classe. Il n'en faut pas tant pour tourner un malheureux qui sort des enfers. En temps ordinaire, une conscience est achetée pour un verre, rien d'étonnant à présent. Et puis il y a l'ivresse des permissionnaires qui versent le vin d'adieu, les un cinquante qu'il coûte. Voilà trois jours que les trois quarts des hommes sont sans raison. J'en rigole par force de temps en temps, mais ça devient écoeurant. Aussi je recherche un coin à l'écart pour être un instant en dehors de cette mentalité d'hommes désoeuvrés ou résignés et être un instant avec vous, avant d'être moi-même atteint par la contagion ! La retraite russe ne me garantit pas des pires conséquence !...
|
|
Pourtant je puis réagir encore aujourd'hui ! J'en ai besoin si je veux répondre à mon courrier d'hier : six lettres ! par ordre d'affection :
Édouard, Mme Bey, Mme Besançon, Albert Genin (qui est à l'hôpital), Louis (le gendarme) et
Melle Oudin à qui j'avais demandé l'adresse de son frère et qui me gratifie d'un affectueux baiser, ce qui m'honore beaucoup, ne m'ayant vu qu'une fois !...
|
|
Oh ! tous les jours le vaguemestre n'en a pas tant pour moi, je m'en voudrais de l'embarrasser mais ça aura été un sujet pour vous écrire aujourd'hui.
|
|
Peut-être aurez-vous la visite de Lanoix qui est en perm. Je viens d'apprendre son départ, et il est à Luxiol ; il cantonne à deux cents ou trois cents mètres de moi ! Il vous dira qu'il n'a pas eu le temps de me trouver avant de partir... Ne l'embarrassez pas pour moi ! J'ai déjà trouvé des copains plus intelligents que lui. Je le laisse pour ce qu'il est ! Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
le 9 septembre 1917
Chers aimés,
|
Il est trois heures du soir. Je rentre de vêpres. J'aurai prié pour vous tous sans doute. Car si le soleil de la Marne va jusqu'à vous, l'âpre attachement des biens de la terre qui vous accable ne vous permet pas de penser à fêter la Sainte Vierge en ce jour. Et puis si les gens de Verne avaient fait un stage comme moi au bois d'Avocourt, sans doute que le courage leur manquerait pour arriver à ne rien laisser perdre de ce que Dieu leur envoie et penseraient (les gens) peut-être plus à lui... Enfin je ne cherche pas à approfondir, à chacun ses compétences sans doute. Seulement vous allez dire que je viens dévot. Voici ce matin j'ai préparé avec des copains un petit extra, des frites, une omelette, une salade, un café... Pour deux cinquante oh ! pas grand chose, ce que le dernier des "poilus", un peu réservé, peut s'offrir en un dimanche passé à la campagne. Une coopérative nous donne le vin à un dix. L'église nous voisine, et me voilà de retour des vêpres, ce qui me rappelle d'agréables souvenirs. Je finis cette journée de parfaite tranquillité à vous expédier cette feuille et à vous adresser à tous un affectueux baiser. Louis.
|
|
Je vais expédier
l'autre feuille à Édouard. J'entends le canon qui le protège dans sa
tranchée.
|
le 13 septembre 1917
Chers aimés,
|
Si je ne donnais que des réponses à vos nouvelles, on pourrait me classer parmi les défenseurs de la crise du papier... Vos dernière datent d'il y a dix jours. J'en conclus que vous n'allez pas laisser perdre un brin de ce que la pluie vous a envoyé comme regain. Mon pauvre Henri il faudra que tu te promènes partout, et puis toutes ces raies à retourner, qui est-ce qui va à la charrue chaque matin ? Et puis les pommes de terre à arracher, enfin tout ce que ces fraîches nuits de septembre vous procurent de moisson à rentrer et que ce beau soleil d'automne vous promet de rentrer dans de bonnes conditions ; à condition que celui de la Marne (le soleil) aille jusqu'à vous, j'aimerais bien en avoir confirmation de ces suppositions ?... Toutes ces pensées viennent à mon esprit presque chaque jour lorsque je fais une ballade dans les champs après la soupe du soir. Seulement ici ce n'est plus la même façon d'opérer. Pas, ou presque pas de regain à rentrer, à part quelques prairies artificielles, les seigles sont déjà germés, seulement ici un hectare se sème comme dix ares chez nous,et tout au semoir. La terre se remue sans difficulté, mais n'est pas de si bonne qualité que dans la Meuse, un mélange de plâtre. Mme Besançon me dit qu'elle a tout de suite trouvé le "Jalons" qui me repérait, peut-être n'avez-vous pas eu le temps d'en faire autant. C'est dommage que nous soyons trop éloignés des coteaux champenois, nous pourrions goûter du raisin qui abonde cette année, parait-il. Nous les apercevons au nord-ouest, mais c'est tout.
|
|
Tout ce bavardage vous édifie sur ma situation présente qui contraste beaucoup avec la situation générale. Nos ministres envieraient mon sort dirait-on !... Les boches disent que la paix peut se faire... Les Russes vont prendre Petrograd... Quel dommage que je n'ai pas quelques talents intellectuels, je ferais concurrence à Molière !... En attendant la fin de la scène, presque chaque jour les secteurs subissent et sont victimes d'un feu roulant dont je perçois le bruit dans le lointain, vingt à vingt-cinq kilomètres.
|
|
Comme passe-temps je suis affecté aux exercices de signaleurs, étude de l'alphabet "Morse" !... Où sont mes aptitudes de "bouif" qui n'ont aucun succès au 255.
|
|
J'ai eu l'honneur de recevoir une paternelle lettre de Mr. Fourgeot, il compte être libéré prochainement.
|
|
Rien de plus intéressant. Affectueux baisers. Louis.
|
le 15 septembre 1917
Cher Édouard,
|
Je n'emploierai certes pas la traditionnelle formule : "c'est avec plaisir que j'ai reçu hier ta bonne grande lettre du 9", car elle m'a plutôt procuré une certaine révolte, à part la satisfaction de te savoir en sécurité.
|
|
A quoi bon te répondre puisque tu connais d'avance ma pensée ?
|
|
Permets-moi de te dire qu'il aurait mieux valu que tu ailles au front il y a trois ans. Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Ta tête dans ta musette... Naturellement tout le monde n'y reste pas, sans ça il y a longtemps que la guerre serait finie. J'ai remarqué qu'un million d'obus ne suffisaient parfois pas à tuer un homme ; pendant
vingt-cinq jours peu se sont écoulés sans que j'ai des éclats ou de la terre sur le corps. Comme tué à ma Compagnie je crois qu'il n'y eut que le caporal d'ordinaire qui prit trop de gaz.
|
|
Comme la guerre peut-elle finir ? Avec des apôtres de Vilson tels que toi. la patrie n'est pas une religion. Le sacrifice des anciens martyrs était justifié. Quant à celui qui t'anime, n'est-il pas le résultat des savantes manœuvres des exploiteurs ? Qui ont de tout temps existé et existeront toujours. Toi-même tu me l'as démontré. Et puis je crois que nous n'avons pas à chercher à avoir une contrition parfaite, c'est plutôt le rôle de nos fameux dirigeants qui essayent à présent de se rejeter la responsabilité l'un sur l'autre.
|
|
Je suis persuadé que si Vilson ou toi (tu vas rire mais je ne te mets pas en parallèle) aviez subi
voilà trois ans le supplice de certains "poilus" vous ne vous opposeriez pas à une idée de paix présente. Lui, son attitude s'excuse, mais je me demande si mon frère jouit de toutes ses facultés mentales. Je ne croyais pas qu'il existait encore des victimes atteintes de ce mal qui fit tant de ravages en 1914.
Voilà pourquoi il aurait mieux valu que tu connaisses la misère depuis le début. J'ai pour combattre les arguments de Vilson le pressentiment que le peuple allemand a suffisamment souffert pour reconnaître qu'il est dupe lui aussi des criminels exploiteurs qu'on le force à servir.
|
|
Assez dit pour aujourd'hui. Peut-être trouveras-tu une confusion dans ma critique, mais elle t'édifiera sur ma parfaite tranquillité présente qui continuera sans arrière regret. Ton frère qui t'embrasse. Louis.
|
|
T'ai-je dit que j'avais une paternelle lettre de Mr. Fourgeot, il compte bientôt rentrer. Hier j'ai eu la surprise de la visite de Jeannin qui restera au D.D.
|
le 16 septembre 1917
Chers aimés,
|
Encore un dimanche aussi confortable qu'un troupier au repos puisse désirer, dans un petit village, comme celui qui m'a vu naître et qui peut-être me verra mourir. D'abord le beau temps nous favorise toujours ; ma petite lessive de ce matin sera pliée ce soir. Oh ! je ne suis plus le paquet de boue sortant des boyaux de bois d'Avocourt, à peine si je salis mes chaussures à présent. Vous ai-je dit mon emploi du temps ? Mes aptitudes de cordonnerie n'ayant aucun succès au 255ème je suis affecté à la signalisation optique, d'où étude de l'alphabet Morse. Je ne suis plus en âge d'étudier, surtout avec des jeunes de la classe 17, mais c'est un petit filon pendant la période que nous passerons ici.
|
|
Avant-hier j'ai eu la surprise de la visite de Jeannin. J'ai eu l'honneur qu'il me demande, étant venu ferrer ses chevaux depuis le D.Dre qui est au moins à sept ou huit kilomètres de nous. Enfin il m'a surpris et contenté, nous avons cassé une croûte ensemble, la première en tête à tête ; c'est la distance entre
Épernay et Verne qui nous vaut ça... Il aura sans doute la chance de voir la fin de la guerre étant garanti pour ses quatre enfants. J'aurais mieux fait de faire comme lui, au lieu d'aller à sa noce... Il m'a permis (Jeannin) de trouver un Beuret d'Uzelle que j'avais connu en Serbie.
|
|
Étant allé colleter hier soir dans des marais avec Beuret nous avons rapporté deux faisans, voilà l'objet d'une petite nouba ce soir.
Voilà comment on oublie les mauvais souvenirs et comment ne pas penser à la perspective de ce qui peut arriver à l'avenir.
|
|
Lanoix est rentré ce matin, il vient de me faire un peu le récit de son voyage au patelin. Malgré le ressentiment que j'avais gardé de son départ, il m'a fait plaisir, sans rien m'apprendre d'extraordinaire. Il m'a donné la même mission qu'à vous sans doute, au sujet des commissions que je pouvais lui remettre.
|
|
Hier j'ai eu des nouvelles d'Henri de Munans, il n'est pas bien loin de moi. Armand m'écrit aussi depuis les environs de Dunkerque, il est au 73ème, comme moi il n'est pas né sous une étoile perpétuellement favorable. Enfin une révoltante lettre du secteur 76 qui ne doit pas être bien loin de moi, m'arrive. D'après elle, tout ce qui se passe voilà trois ans est tout naturel, et supportable, et puis même si on y reste, c'est pour la patrie. Et puis pas même l'idée de paix ne doit être envisagée à présent...
|
|
Comment la guerre peut-elle finir d'après des sentiments pareils ? Passe encore pour Vilson, Guillaume et compagnie, mais ce n'est pas admissible pour les malheureux exploités.
|
|
Heureusement que vous n'avez pas le temps de réfléchir à tout ce qui se passe d'affreux et d'absurde sur cette pauvre terre. Chère maman votre carte-lettre du 11 arrive à l'instant, elle est trop courte, mais je vous en remercie et vous embrasse tous. Louis.
|
le 20 septembre 1917
Chers aimés,
|
La foire de septembre doit être belle et bonne aujourd'hui. Vous devez y avoir conduit de quoi faire de la place. Il est vrai qu'elle n'est pas limitée depuis le bout de Verdot jusqu'entre le tas de regain, s'il en reste encore quelque part, car sans doute que les vieilles routines rapaces du pays n'ont pas disparues avec la guerre. Quel dommage que je n'ai pas eu ma perm ces temps-ci, j'aurais revécu les quatre saisons 1917 parmi ce qui va n'être plus que souvenir de la vie que je me croyais destinée. Voilà trois semaines que bien des souvenirs des trente premières années de ma vie me sont revenus. Les premiers jours qu'il me fut permis de réfléchir, ces souvenirs me donnaient parfois l'illusion d'un rêve. Quel dommage que de fréquentes lettres ne soient pas venues plus souvent me remettre à la réalité. Je vous voyais dans mes nombreux loisirs quotidiens aux diverses occupations de la journée, mais personne pour prendre le temps de faire le secrétaire. Ah ! ce diable de temps, dire que voilà trois ans que je fournis en moyenne deux heures de travail sur vingt-quatre.
|
|
Lulu m'a fait part de sa résurrection au pays. Il me dit que les regains n'avancent pas vite par le mauvais temps. Et puis voilà le vingt septembre, il va y avoir autre chose à faire ? Le blé rend-il ? Henri me dit qu'à Munans jamais il n'avait vu aussi médiocre moisson en blé.
|
|
Ma lucidité d'esprit me permet encore ce babillage aujourd'hui. Mais je crois que sous peu je ne vais plus avoir une aussi grande facilité de réflexion. Les beaux jours sont courts. Nous sommes en préparatifs de départ. Demain les autos vont nous reconduire à la danse. L'étoile polaire doit nous guider. Nous ne devons pas aller bien loin dans cette direction avant d'enfiler les interminables boyaux où la vie de privations, de fatigue et de danger va recommencer.
|
|
Si cette nouvelle période d'incertitude me ramène encore une fois à l'arrière, je ne désespère pas vous revoir pour la fin septembre.
|
|
L'espoir et la confiance accompagnent tous les baisers que je vous adresse à tous. Louis.
|
le 26 septembre 1917 9h
Chers aimés,
|
Je viens de casser
la croûte. Pour une fois du pain assez bon, ayant encore un peu de
beurre d'Isigny à dix sous le kilo que j'avais acheté avant de
monter, Oh pas un kilo, mais 194 grammes pour deux sous. J'en suis à
ma correspondance. Je n'ai pas grande réponse à faire, surtout à
vous... Cependant depuis dimanche que je ne vous ai pas écrit, il me
semble qu'il y a huit jours. Voici quelques jours qui me semblent
longs partant de ce temps superbe, qu'il me serait facile de vous
écrire une grande lettre tous les jours, si j'avais quelque chose à
vous dire ou à vous répondre. Dites-moi au moins si vous avez le
temps de me lire et si mes lettres vous arrivent ? Trouvez-vous
peut-être que je vais user tous mes sous en papier à lettre ? Tant
pis encore pour celle-ci. |
|
Vous ai-je dit que comme filon j'avais chopé un sac de quatre cents cartouches, quinze kilos environ, en supplément à porter comme pourvoyeur de fusil-mitrailleur. Mon pauvre Julien, tu ne connais pas cette faveur, tu es de la vieille école... Je n'ai plus comme arme qu'un révolver avec huit cartouches à l'instar des officiers... L'honneur est équivalent, quant à la paye elle est remplacée par le poids supplémentaire, trente-cinq kilos. Aussi fus-je courbatu deux jours pour avoir mis quatre heures à faire douze kilomètres. C'est ça l'allégement du fantassin. Quel dommage que nous n'ayons pas les centaines de kilomètres de pistes Macédoniennes à faire, je pourrais espérer l'hôpital à bref délai. Mais ma fatigue ne parait plus, je me porte même à merveille, après avoir passé trois nuits à dormir dans une sape boche prise au mois d'avril dernier. Et puis je crois qu'il n'y a pas trop de vermine. J'ai renouvelé ma paillasse avec une brassée d'herbe sèche que les gens de Vaudesincourt ne viendront pas chercher.
|
|
Nous sommes encore en deuxième ligne, avec deux fusils-mitrailleurs et trois camarades nous sommes en batteries contre les avions dissimulés dans quelques petits buissons tondus par la mitraille ; les journées sont plutôt longues, c'est pourquoi j'ai tant de loisirs pour écrire. Hier les boches nous ont bien fait entrer dans une sape par un petit arrosage à la mode; mais c'est un petit jeu en comparaison de ce qui se passait dans la Meuse, ça durera t'il ? Sans doute que non puisque les grands patriotes trouvent qu'il n'y a pas encore assez de victimes...
|
|
Je ne vous parle rien que de la guerre et vous n'avez même pas le temps d'y penser. Si vous vouliez que nous causions un peu de ce gros tas de regain que je me représente vaguement ; l'envie de ramasser par ces beaux jours tout ce que les pluies de juillet vous ont procuré.
|
|
Chère maman vos petits veaux vous laissent-ils du lait ? Si oui vous trouverez des petites boites en fer blanc pour m'expédier un peu de fromagère et de beurre de temps en temps, en petit colis non recommandé.
|
|
Qu'est-ce que font vos locataires ? Ont-ils une cheminée. Et Jules Curty est-il encore là ? Si oui, bien le bonjour de ma part.
|
|
Je m'arrête pour aujourd'hui, la soupe va venir. Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
le 28 septembre 1917
Chers aimés,
|
Je vous écris si souvent, et vous si rarement, qu'il me semble qu'il y a un mois que je ne sais plus si vous êtes morts ou vifs. Mais vous avancerez que vous êtes un peu égoïstes, que vous gardez tout le nouveau qui vous arrive pour vous, sans m'en envoyer un petit brin. Est-ce que chaque jour vous n'auriez pas quelque chose à m'apprendre de plus intéressant qu'un journaliste ? Je vois bien que la guerre ne vous a pas rendu encore philosophes : vous n'avez pas le temps. Pensez-vous qu'il y a des millions d'hommes comme moi, qui n'ont rien à faire qu'à penser chaque jour à ce qu'ils pourraient apprendre sur ce qui se passe parmi ceux qu'ils aiment. Moi j'ai la faveur de pouvoir y penser presque toute la journée, tant le secteur est calme. Quel contraste avec celui du bois d'Avocourt où je croyais perdre la tête.
|
|
Je sais bien que la guerre est si longue qu'il faut bien se résigner à faire deux sociétés distinctes, celle qui est restée au pays et celle qui est obligée de partir. Mais le sort de cette dernière à besoin de rester en contact avec l'autre. je vous ai déjà dit qu'il me tardait bien que les veillées viennent ou au moins des démarches qui vous permettront de me consacrer quelques instants.
|
|
Je viens de casser la croûte, un petit bout de jambon et un peu de cancoyotte. C'est qu'il m'est arrivé hier matin ce pauvre colis, malgré la recommandation il a du voyager quinze jours. C'est honteux, la façon dont nous sommes servis pour nous faire parvenir nos colis. Enfin, tout n'est pas perdu, je suis encore content de l'avoir. Mais essayez voir de ne m'envoyer qu'une seul boite, sans la recommander, j'en ai déjà vue qui arrivait comme une lettre dans trois jours. Ne pouvant cuire le jambon ici ne m'en envoyez plus.
|
|
J'ai des nouvelles d'Édouard du 22, s'il était à coté de moi il serait enchanté de son séjour. Nous ne sommes pas bien loin l'un de l'autre, trente kilomètres à vol d'oiseau, mais cependant pas assez pour espérer nous rencontrer. Hier je lui ai demandé s'il n'allait pas aller un de ces jours en permission.
|
|
N'avez-vous pas encore vendu la "Julie" ?
|
|
Au revoir et affectueux baisers. Louis.
|
le 29 septembre 1917
Chers aimés,
|
Encore une lettre aujourd'hui. Il est vrai que hier elle était au crayon et ce matin j'ai pris la peine de sortir mon encrier.
|
|
Oh ! cette grande lettre de lundi dernier m'a trop fait plaisir pour que je ne vienne pas vous remercier au plus tôt chère maman. Je l'ai eue hier après-midi et mon plus fort travail ce matin est de vous répondre après avoir fait un brin de toilette (ce qui est une faveur dans les tranchées) et déjeuner au beurre. Ah ! ce beurre Raguin il est encore meilleur que celui de Normandie.
|
|
A ce que vous me dites ce n'est que huit jours au lieu de quinze qu'aurait mis mon colis à m'arriver, seulement la cancoyotte était déjà bien moisie.
|
|
J'ai enfin repris contact avec vous tous. Je vous vois par cette belle semaine, la trouvant trop courte pour rentrer toutes les patates. Le tas sera-t-il plus gros que l'année dernière ?
|
|
Il parait que nous allons aller un peu à l'arrière des batteries la semaine prochaine, peut-être pourrai-je aller jusqu'à Mourmelon.
|
|
Je ne veux pas vous raser tous les jours avec quatre pages, je garde l'autre feuille pour un de ces jours et vous embrasse tous affectueusement. Louis.
|
le 2 octobre 1917
Chers aimés,
|
Représentez-vous l'immense plaine de Champagne, presque plate malgré certains monts minuscules dont se sert le Communiqué pour désigner certains secteurs. Le sous-sol extrêmement crayeux, les innombrables tranchées ou boyaux ainsi que les nombreux bouleversements provoqués par les obus en font l'aspect d'une région aux neiges éternelles. Ce sol presque stérile n'est que la suite de l'immense Camp
(?) de Chalons. |
|
L'aurore du siècle du progrès : ce XXème en avait fait surgir de nombreuses plantations de pins qui en certains endroits avaient déjà la désignation de bois ou forêt. Hélas ! Trois ans de bombardements ont considérablement éclairci certaines régions de ces plantations à la veille d'être productives. Par contre ces régions ont acquis par le fait de la guerre une animation extraordinaire. Tous les services de l'arrière y sont installés, des cités qui travaillent ou vivent sans la moindre apparence, en raison de la dissimulation souterraine qui les garantit à la fois des yeux et des obus de l'ennemi.
|
|
Vous devez sans doute m'avoir situé d'après les indications que je vous ai fournies. C'est sur le seuil d'une des cités précitées que je vous trace ces lignes dans la région au nord de Mourmelon. Nous y sommes arrivés cette nuit à deux heures. Notre sape est assez confortable. C'est la ligne de feu pour les artilleurs de certaines batteries lourdes, pour la "biffe" c'est la situation en réserve, presque le repos pour huit jours, avant d'aller en première loge où les mètres se mesurent avec l'ennemi. Une coopérative à proximité m'a déjà permis de changer un billet ce matin pour remplir le bison, deux litres à un vingt. C'est dommage que l'eau n'est pas abondante, par ce beau soleil ce serait facile de noyer les poux et dissoudre le plâtre qui nous envahissent.
|
|
Et vous, n'allez-vous pas en désirer de l'eau ? Il me semble que la terre va être sèche pour faire germer le précieux grain. Seulement j'ai espoir que sa rareté va être un facteur qui contribuera à ma délivrance ! Amen...
|
|
Léon Pastif m'envoie depuis Besançon une grande lettre... creuse... Une plus intéressante m'arrive du 208ème par un copain du 235. Une carte d'Édouard m'annonce une grande lettre lorsqu'il aura tué ses poux... car il descend au repos en date du 27. Enfin un petit paquet de noisettes m'est expédié, en souvenir du jardin que j'ai défriché au Plateau, en m'annonçant la reprise des classes.
|
le 5 octobre 1917 18h
Chers aimés,
|
Je ne vous écris pas si souvent que la semaine dernière. C'est que je n'ai pas toutes mes journées de loisir comme aux tranchées où je n'avais qu'à observer les avions. Ici nous sommes plus tassés, on ne peut réfléchir tranquillement, et puis on nous occupe, nous allons au travail de nuit ou de jour : toujours de la terre à remuer, la craie nous transforme en plâtriers, il faudrait avoir la blouse.
|
|
Je viens de recevoir votre lettre de lundi chère maman, en rentrant pour la soupe à cinq
(?) heures, comme je peux avoir des bougies je vais consacrer une partie de la soirée avec vous. Une petite planche à coté de mon "plumard" me sert de table. Oh ! pour moi je n'ai pas grand nouveau à vous apprendre. Nous sommes ici encore pour quelques jours avant d'aller reprendre les tranchées.
|
|
Seulement, voici la fin des beaux jours sans doute. Le vent de ces jours derniers nous a procuré une bonne douche hier soir au travail de nuit. Mais c'est la guerre, une averse de plus ou de moins... quand elle n'est pas envoyée par les boches, c'est un détail.
|
|
Ce retour du mauvais temps vous est plus funeste qu'à moi pour le moment sans doute. Mais vous devez déjà avoir rentré le plus gros par ce beau temps. Et puisque vous me dites que vous allez vite vous dépêcher de m'écrire chère maman, avant d'aller aux Cailloux, car Madeleine regarde si vous arrivez, il ne doit plus en rester à présent. Peut-être la pluie sera t'elle la bienvenue pour vous, pour rafraîchir la terre ?
|
|
Je vais avoir de quoi m'occuper à la cave lorsque je pourrai avoir mes dix jours de perm. A moins que je ne fasse comme les jeunes "Tourtereaux" de Verne...
|
|
Que vous dire des affaires financières d'Édouard, ne connaissant pas la situation de ses créanciers ? Comme lui, je perds irrésistiblement l'acharnement des biens de cette vie, devenue incertaine pour moi
voilà trois ans !... |
|
J'ai eu des nouvelles de mon ancien ami Palmyre. Rentré lui aussi d'Orient. Il compare sa situation à la mienne pour dans quelques temps.
|
|
A titre d'encouragement nous venons de recevoir ce soir tous les effets d'hiver qu'il nous est possible d'emporter. Malgré cela, acceptez le baiser d'espérance de votre Louis.
|
le 7 octobre 1917 16h
Chers aimés,
|
Est-ce pour hâter la victoire ? Mais à peine ai-je le temps de marquer mon dimanche, ne serait-ce que le temps de vous consacrer quelques instants. Pourtant du fond de ma sape, à la faveur d'une bougie de trois sous, ça me serait si agréable. Je n'ai même pas profité de l'arrêt des pendules cette nuit pour faire la grasse matinée. Au contraire ces soixante minutes furent consacrées à nous faire produire un supplément de travail cette nuit, à remuer de la terre ou plutôt de la craie, à faire un boyau. Je rentre de faire des réseaux de fil de fer barbelés portatifs pour les premières lignes. Avec ça, il n'y fait pas chaud,
voilà deux nuits qu'il gèle. J'ai endossé le tricot qu'on m'a remis.
Ça ne va pas être le rêve un de ces jours aux A.P. Mais c'est la guerre ! Pendant ce temps, la jalousie fait découvrir les hauts faits d'armes de nos bons dirigeants !...
|
|
J'attends ce que ce sombre dimanche va nous permettre de me communiquer, et vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
|
Bien des choses à la tante jeudi.
|
le 10 octobre 1917
Chers aimés,
|
J'en suis à mon neuvième jour de notre situation en réserve. Elle ne fut pas de tout repos. Beaucoup de travaux de jour ou de nuit. Mais néanmoins la situation serait tenable sans beaucoup de danger. De temps en temps du "pinard" à un vingt-cinq, avec des bricoles : beurre, fromage, etc, on pouvait passer de bons moments le soir, quand nous pouvions avoir des bougies. Avec des couchettes assez confortables à trois ou six sous terre je dormais assez bien.
|
|
Mais notre rôle n'est pas de rester bien longtemps tranquille. Nous allons remonter ce soir en première loge pour dix-huit jours parait-il. Si les boches me permettent de redescendre je pourrai envisager la date de ma perm. Il y en a une vingtaine à partir avant moi à la Compagnie.
|
|
Dans cet espoir je vous embrasse tous bien fort. Louis.
|
|
J'ai eu des nouvelles de Mr. Fourgeot m'annonçant avec les bonnes paroles sortant de son bon cœur sa libération prochaine. Henri de Munans m'a écrit aussi, mais j'ai déjà dû vous le dire dimanche. Au revoir (Hortense).
|
le 13 octobre 1917 7h
Chers aimés,
|
En août je vous fis la cruelle et affreuse description de ma situation. Septembre fut pour moi une villégiature. Mais hélas ! que me réserve octobre ? Je vous ai dit que je remontais en ligne pour dix-huit jours.
Voilà trois nuits de passées à tirer en moyenne huit heures de guet dans un trou d'obus ! Le jour, c'est du superflu. Je n'ai pas l'ouie bourdonnante sans cesse sous l'effet du feu roulant comme pour l'attaque de Verdun. Mais la nuit noire, le vent, la pluie me mettent dans un piteux état ! Je suis dans la région des coups de mains fréquents, la saison est propice. Que me réservent les nuits prochaines ? Et la perspective de l'hiver ! La fatalité funeste serait une délivrance...
|
|
Les fusées éclairantes me permettent de me rendre compte des bombardements qu'a subi le "Teuton".
|
|
Après plusieurs jours d'inquiétude une carte d'Édouard m'annonce un changement de régiment, de région, mais je n'ai aucun détail sur le motif ou le but de ce changement. Peut-être êtes-vous mieux renseignés que moi ? Et quelle va être la récolte en blé en 1918, vu l'hiver au premier octobre ? J'attends quelques bonnes lettres et vous embrasse bien fort. Louis.
|
le 16 octobre 1917 10h
Chers aimés,
|
Ah ! oui chère maman, vous m'aviez promis une réponse régulière, j'y croyais à moitié ! Je n'ai même pas reçu ma lettre hebdomadaire de la semaine du premier au huit. C'est presque un résumé bimensuel qui m'est arrivé hier. Encore vous a t'il fallu rabioter sur les heures si rapides d'un jeudi. Oh ! je ne vous fais pas de reproches, j'étais déjà si content de vous lire. Tant que je le pourrai, ça ira bien, aussi je sors sur le bord de mon trou pour venir vous le dire.
|
|
Le petit mandat ne sera pas trop embarrassant mais j'aurais pu m'en passer. Je vais le donner, si on veut, afin qu'il vous retourne si les boches me mettent la main ou autre chose sur la tête cette nuit. Et puis vous ignorez que je gagne ces jours-ci 1,45 par jour, on me donne dix-sept sous et le reste est versé au pécule. J'ai bientôt vingt-cinq francs sur mon carnet, bravo !...
|
|
Je vois que vous avez été renseignés comme moi au sujet des changements d'Édouard. Je n'ai toujours pas de détails, une carte m'annonce encore une autre adresse et c'est tout. Peut-être l'aurez-vous quand cette lettre vous arrivera ?
|
|
Vous n'avez aucune arrière-pensée à avoir en rencontrant la mère de Dago. Je ne lui ai fait semblant de rien. Je lui dis bonjour à l'occasion comme d'habitude. Maintenant que sa mère ou lui pense ce qu'il voudra de moi ce n'est pas ça qui me tient en éveil huit heures par nuit.
|
|
J'ai de la chance en venant vieux, les premières places me sont toujours réservées. Je n'avais encore pas eu l'honneur de voisiner les boches d'aussi près. J'espère que ceux qui me liront ne vont pas me jalouser, par là les amateurs de "tenir jusqu'au bout". J'en suis à ma sixième nuit à coucher dans mon trou d'obus, encore six. Tous ceux qui y passent n'y restent pas, malgré tout ce qui leur est destiné : balles, obus, torpilles, grenades. C'est la pluie ou la gelée blanche qui m'ont le plus embarrassé jusqu'ici. Le rhume est venu puis est reparti, le sommeil n'est plus aussi invincible que les premiers jours. L'habitude, quoi ! Vivement la bronchite, les pieds gelés ou la blessure filon ! Tels sont les meilleurs souhaits à adresser au "poilu". Mais auparavant je désire faire un stage aux tranchées, encore douze jours, après la perm sera toute proche.
|
|
A une carte-souvenir une réponse de Marie Coulon m'apprend sa villégiature à Scey, et ses préparatifs pour la noce. Frédo me fait part de ses amitiés. Henri m'annonce son affectation au 133ème Territorial. Peut-être pourrai-je le voir à la descente des tranchées.
|
|
Je laisse encore quelque chose à vous dire pour la prochaine et vous embrasse tous. Louis.
|
le 20 octobre 1917
Chers aimés,
|
Hier de bonnes nouvelles de toutes parts : votre lettre de dimanche soir chère maman, une d'Édouard et une carte du Quai. En général ce sont des condoléances, des encouragements pour affronter les dangers des nuits passées au petit poste. C'était la dixième mais comme l'imprécision militaire est toujours de règle, des ordres devaient déranger l'emploi du temps projeté. Nous sommes relevés par un autre régiment et ce matin je vous trace cette lettre après avoir un peu reposé en sécurité dans une profonde sape en réserve. Comme celui d'Édouard il parait que mon régiment va être dissout ! A part les inconvénients des marches à faire résultant du changement cela m'est égal, je ne puis être placé plus bas. Je ne sais au juste quelle sera ma nouvelle affectation. Mais cela va déranger mes calculs quand à la date de ma prochaine perm, de quelle façon ?...
Édouard me dit qu'il pourrait m'attendre, mais que lui répondre, peut-être l'avez-vous à l'heure présente ? Je n'espère plus le rencontrer. La lettre m'indique qu'il est au pays de la Ninie
(?) de ma tante, mais il y a longtemps que je suis désorienté sur les traces de cette personne si jamais j'ai su où elle était.
|
|
Chère maman votre lettre est remplie de la désolation où vous plonge le mauvais temps, je suis surpris vu le beau temps du mois de septembre. Frédo me disait qu'il avait bientôt fini. Je déchire cette feuille et vous enverrai l'autre prochainement. Bons baisers. Louis.
|
le 5 novembre 1917
Chers aimés,
Me voici toujours dans mon trou où il me semble que je suis condamné à rester à perpétuité. Il est deux heures du soir. L'heure est propice pour tenir mon crayon, meilleure que ce matin quand j'avais des glaçons à la moustache. Si les boches ne pensent pas plus à moi que moi à eux, ils me laisseront quelques instants avec vous.
Ma chère maman, depuis avant-hier je possède votre carte de mercredi soir. Elle est remplie des angoisses maternelles que vous cause notre triste situation, à nous deux
Édouard. Hélas ! vos angoisses et mes plaintes ne modifient en rien la marche des événements. Et je ne puis encore pas vous annoncer une amélioration aujourd'hui. Cette nuit sera la quatorzième au P.P. C'est très dur pour le malheureux comme moi, qui ai dix heures de veille chaque nuit ! Il parait que nous en avons jusqu'à lundi soir.
|
Édouard me reproduit une phrase de ses chefs : les grandes passions tuent les petites. Elle est bien de circonstance pour moi. Le secteur est assez calme, sans apparence d'attaque semble t'il, l'aménagement assez confortable, aucun officier n'a lieu de se plaindre, ni de former un rapport de
fatigues, ainsi la période de P.P. peut s'étendre à dix-huit jours sans inconvénients. Le chef est bien, tout doit être bien, sans tenir compte de la longue série de nuits très fraîches qui vont me frigorifier les jambes. Le besoin de dormir me rend la tête lourde, la crasse ou la vermine me dévorent la peau, et ma nature de poilu hirsute me gratifie d'une barbe qui se retourne contre ma peau comme une brosse de chiendent. Oh ! l'apparence bourgeoise que j'ai pu vous produire se fait payer cher. Néanmoins la santé a l'air de vouloir tout dominer. Je lui aide du mieux que je peux. Nos cuisiniers peuvent nous rapporter du pinard de temps en temps et de quoi ne pas manger son pain sec : beurre ou fromage, nous avons la soupe chaude. Si les boches ne me repèrent pas d'ici lundi, tout ceci sera encore vite classé comme souvenir.
|
|
Hier j'ai fait, dans les mêmes conditions qu'à vous, une longue lettre à
Édouard, je le jalouse de la faveur qu'il a eu de recevoir un colis. Le mien étant sans doute recommandé attendra ma descente des tranchées. La garantie qui le protège n'épargnera que sa forme ! Je ne suis vraiment pas favorisé par les envois. J'espère me consoler demain ou après à la lecture de la grande annoncée de dimanche, qui me transportera un instant parmi vous. Cette pleine lune vous aura obligé à ne plus quitter la grange, à cinquante sous vous devez toujours gagner votre vie et l'avoine du "Noirot".
Ça doit bien lui aller le manège ? Est-ce que tous vos blés ont pu germer avant ces gelées-ci ? Il me semble que novembre fut assez favorable.
|
|
Qu'y a-t-il de neuf à Verne ? Avec une grande feuille comme celle-ci et la nuit à quatre heures j'espère tout savoir. J'espérais toujours avoir la description du portrait du cavalier de Madeleine ? Allons ma belle, il ne s'agit pas rien que de savoir travailler avec force, consacre-moi quelques lignes de temps en temps, je serai content et tu ne t'en repentiras pas. Qu'est devenu Jules ? Mes plus chaudes amitiés et un baiser à la Marie ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à moi.
|
|
Je vous dis au revoir pour aujourd'hui, la terre gelée m'oblige à battre la semelle, je viendrai vous dire bonjour demain matin.
|
|
Jeudi 6. Rien de plus nouveau qu'une agréable surprise hier soir : la fertile carte de samedi mon Henri, merci. Mon colis arrive à l'instant. Les lettres partent, je ferme ma lettre, au revoir et bons baisers. Louis.
|
le 9 novembre 1917
Chers aimés,
|
Je commence cette feuille aujourd'hui, bien qu'elle ne veuille s'acheminer vers vous que demain. Mais il faut savoir profiter des moments que l'on peut avoir, en même temps que du rayon de lumière qui me permet de voir les lignes car je n'ai que la bougie que j'ai emportée de Verne et qui est bientôt brûlée.
|
|
Je ne me rappelle plus ce que j'ai déjà pu vous dire depuis que je vous ai quitté. Cependant aujourd'hui je me sens l'esprit un peu plus calme. J'ai pu un peu dormir cette nuit, je n'eus pas trop de service, environ six heures. Inutile de vous dire que ma journée bisontine fut vite passée. Mme Besançon, qui sans avis m'attendait à la gare m'emmena me débarrasser au Quai où j'ai dîné. Je n'eus pas le temps de voir mon copain Palmyre, étant à la Cité. J'eus plus de chance à Mourmelon. Vous recevrez la carte commune de nous deux Henri. Vous savez que je n'ai retrouvé ma Compagnie que hier matin, jeudi.
|
|
Dois-je avoir la cruauté de vous dire qu'à l'heure présente nous sommes tous consternés : une torpille vient d'éclater. Dans l'escalier d'une sape voisine, produisit l'effet d'un coup de mine. Tout sauta, matériel et occupants ; des débris de quatre cadavres sont déjà retirés des décombres, quatre ou cinq blessés ou brûlés ont pu s'échapper ; maintenant pour qui la prochaine ? Demain je joindrai une carte à ma feuille avant de vous l'expédier. Louis.
|
le 11 novembre 1917
Chers aimés,
Reverrons-nous jamais ces anciennes fêtes du village ? Au bout de quatre ans de guerre le doute est permis. En 1914, par patriotisme j'en fis volontiers le sacrifice. Saint-Martin 1918 me rappelle une pénible journée dans une gorge sauvage du Vardar où j'eus la bonne fortune de rencontrer le regretté Marius qui me donna mieux que de la brioche, du pain car j'avais faim. L'an dernier je me trouvais heureux dans mon lit d'hôpital à Salonique. Ce matin comme les joyeux noceurs de Verne, j'ai la tête lourde mais c'est d'avoir veillé six heures cette nuit à me fatiguer la vue pour ne rien voir dans la nuit noire. Que Saint-Martin de 1918 daigne nous grouper à une joyeuse fête au village !
le 14 novembre 1917
Chers aimés,
|
Enfin la vie m'est revenue. Depuis que je vous ai quitté, j'ai pu un peu me reposer cette nuit. Je n'avais pas encore pu délacer mes chaussures ni mouiller mon linge de toilette depuis que je vous ai quitté. En ce sens j'ai eu un intervalle pendant ma permission, mais bien des copains n'avaient pas revu de maisons ni fontaines depuis le 20 septembre.
|
|
A deux heures et demie ce matin nous sommes arrivés dans les casernes de Mourmelon. Je commence par vous en faire part avant d'entreprendre mon nettoyage. Lorsque je serai un peu en ordre je pourrai avoir les idées un peu plus claires et vous donner quelques causeries un peu moins banales.
|
|
Je crois que nous sommes toujours au moins ici pour huit jours. J'irai revoir Henri qui est tout proche. J'ai déjà reçu une carte d'Édouard depuis Verdun.
|
|
Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
|
le 16 novembre 1917
|
|
Chers aimés,
|
|
Comme je serais heureux de vous apprendre ce que je deviens, surtout quand la vie m'est permise comme à présent, si j'avais la satisfaction, l'encouragement d'avoir une correspondance suivie avec quelqu'un qui m'est cher. Où veux-je rechercher une affection qui daigne partager mes peines et prendre part aux quelques jours de joie ou plutôt de tranquillité qui me sont permis. Je vous ai renseigné sur mon retour avec tout ce qu'il y avait de lugubre dans le séjour aux A.P. Puis mon retour à l'arrière, cette vie de caserne qui m'est permise. Je serais heureux le soir sur mon lit de pouvoir passer quelques minutes de la soirée avec vous, à commenter ce que vous pourriez m'apprendre et qui est encore tout frais à ma mémoire : ces semailles, cette prune à distiller, cette noce, enfin un tas de choses qui dicte non pas l'éducation, mais l'affection. Cependant voilà quinze jours bientôt que je vous ai quitté, et pas un mot pour moi. Tous les jours j'espère entendre mon nom aux lettres, mais vainement, une secrète désillusion m'attriste. Je m'étais adressé à Mme Raguin pour avoir plutôt un certificat qu'on m'a réclamé, mais rien. Pourtant j'ai une carte de Mme Besançon en date du 13, trois jours après, je ne suis pas si loin que ça...
|
|
Enfin je me suis consolé aujourd'hui en passant un bon moment avec Henri. Nous avons mangé ensemble à midi, nous sommes à peu près à mille cinq cents mètres l'un de l'autre. il a reçu une lettre d'Édouard, de Munans, de Louis. Vous dire tout ce que nous avons raconté serait un peu long. Il a perdu en changeant de régiment mais j'envie son sort : à peu près en sécurité, il travaille à l'abri à fabriquer des réseaux de fils de fer barbelés, il se plaint, mais il ne lui faut que de la patience.
|
|
Vous me direz où est Jeannin si vous le pouvez, je l'ai cherché mais n'ai même pas pu trouver sa trace. L'appel va sonner, je vous dis bonsoir et vous embrasse tous bien fort. Louis.
|
|
le 19 novembre 1917 10h
|
|
Chers aimés,
|
|
J'arrive de tuer le temps en attendant la soupe, en préparant du crin végétal pour des matelas.
Ça vaut mieux que les P.P. Pourvu que ça dure !
|
|
Je veux un peu réparer la lettre désolante que je vous ai faite samedi. Hier je n'ai pas eu le temps. Je suis heureux de vous dire pourquoi ? D'abord, rassurez-vous je possède tout ce que vous m'avez adressé ainsi que le certificat que j'avais demandé à Mme Raguin.
|
|
Chère maman je viens de lire et relire cette fertile lettre de la Saint-Martin. Oh ! que de temps elle a mis pour m'arriver ! C'est fatal, une carte banale m'arrive dans trois jours, une lettre désirée en met huit. Mais je suis contant tout de même, cette lettre me donne l'illusion d'une prolongation de perm de huit jours. Elle a été bien remplie, selon vos intentions ; que vous êtes heureux ! et cela me fait oublier les mauvais jours. J'aurais bien aimé avoir un petit brin de la noce par un récit de l'un ou l'autre de vos invités, mais une lamentable situation n'a pas influencé sur une nature, comment dirai-je ? peut-être un peu égoïste, non, plutôt indifférente, par suite très négligente...
|
|
Cette distillation, ces jambons à découper, ces reproches de Mme Bey à la lettre d'excuses que je lui ai adressée, ces remords de n'avoir pas revu mon ami Postif, ni Frédo, une demande de mon emploi du temps en perm par
Édouard, me disent que j'ai mal employé ma dernière permission. Ah ! ces semailles que j'ai si peu d'espoir à moissonner, pourquoi m'ont-elles pris quelques instant de vie permise ? Ah ! j'en perds bien d'autres de journées. A la prochaine je ferai mieux. Quant à Mme Bey, il ne m'était pas commode de la trouver au Lycée, ce n'est pas le Quai ou l'Helvétie où j'ai vu
Melle Poutignat, je n'ai pu aller le soir jusqu'aux Vielles Perrières, seulement j'appuyais mes excuses sur un court instant à Besançon et vous lui avez dit sans doute que j'avais passé un jour à Besançon...
|
|
Tout ceci sont des souvenirs vécus atténués par une bonne journée de hier, en compagnie d'Henri. Voici les faits : seize mois de séjour à Somme-Suippes l'ont laissé en relation intime avec une famille sérieuse, honorable (et inévitablement aisée) du pays. Il était invité à leur rendre visite hier. Nous en sommes environ à douze kilomètres. L'accompagner ferait l'occasion d'une ballade agréable pour les deux. L'inhumation de Dormois au cimetière de Suippes me fournit l'occasion de demander un laissez-passer (car il n'y a pas de perm) pour rendre visite à la tombe d'un "cousin".
Ça réussit à merveille et nous voilà partis à travers l'immense camp de Chalons par un temps agréable. Le plaisir de la conversation nous amena sans que nous nous en doutions à proximité du cimetière militaire "immense" de Suippes. Le service spécial d'entretien nous renseigna si bien que nous trouvâmes la tombe de Frédéric assez facilement. Je vais transmettre ce soir à Mme Raguin avec mes remerciements le récit de ma visite avec les indication qui peuvent les intéresser, car j'ai remarqué qu'aucune visite affectueuse ne lui avait encore été faite en comparaison de certaines tombes chargées de couronnes. D'une façon générale toutes les tombes sont entretenues par les ordres du service d'une façon satisfaisante, contrairement aux impressions qu'eut
Édouard en rendant visite à la tombe d'Octave, à Verdun ça peut différer. Mais jamais le règlement ne sera inspiré, ou ne pourra égaler les sentiments et les actes affectueux.
Après le pèlerinage, nous nous rendîmes chez les amis d'Henri, et l'accueil le plus chaleureux nous fut réservé. Cela s'explique assez facilement pour qui connaît la sympathique nature de notre cousin.
|
|
Nous avons passé une soirée de famille pourrait-on dire, en compagnie de la mère de quatre enfants dont une grande fille déjà et un fils de quinze ans, le père est mobilisé aux tracteurs agricoles. A part quelques marmites intermittentes, c'est une famille qui a l'air heureuse, aisée, et par suite intelligente (puisque la misère engendre la bêtise) enfin j'ai apprécié et profité de l'occasion étant "Mr. le cousin" de Mr. Girard.
|
|
A onze heures du soir le train nous ramena à Mourmelon où nous avons regagné chacun nos "plumards" sans drap, où néanmoins six heures ce matin sont venues trop vite me réveiller.
Je vais continuer mes matelas cet après-midi. |
|
Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
|
Merci mon cher Henri de ta carte du 15 avec ses paroles affectueuses et distinguées ! Ce n'est pas la dernière, n'est-ce pas ? Embrassez la tante jeudi pour moi.
|
le 22 novembre 1917 12h
Chers aimés,
|
Les malheureux collègues qui nous ont remplacés ont dû trouver ces neuf jours derniers plus longs que nous sans doute, aussi vont-ils guetter autant à l'arrière qu'à l'avant, dès la nuit tombante ce soir, si quelques bruits se font entendre parmi les "cailleboulis"
(?) des boyaux annonçant la relève tant désirée ! Comprendrez-vous vaguement, au moins, quelles minutes angoissantes l'on passe aux derniers moments avant de quitter ces régions infernales ? Peut-être ! Mais il faut les avoir vécues pour s'en rendre réellement compte. Les deux tiers des mobilisés même les ignorent... La prose mélancolique d'Édouard à l'occasion de la Toussaint ne justifie t'elle pas mes lugubres récriminations ? Il serait bien souhaitable qu'il eut persisté à m'adresser des sentiments contradictoires à ce qu'il pouvait qualifier de pessimisme, d'idées noires ou même anarchistes, de son frère.
|
|
A présent, autour de moi c'est le branle-bas des préparatifs pour la nuit. Le voyage sera difficile en raison de la pluie qui n'a pas cessée hier toute la journée, détrempant tout. Mais si nous ne sommes que trempés par la sueur, nous serons à demi consolés. J'ai profité de ma dernière soirée hier pour boire une bonne bouteille avec Henri dans un petit coin tranquille ; il a déjà fait connaissance avec une Dame à Mourmelon-le-Petit, cousine de ses amis de Sommes-Suippes.
|
|
Vos dernières nouvelles sont de vendredi 16. Sans doute que ce soir, un petit résumé de dimanche soir me sera remis. Vous devez sans doute achever de tout ranger vos instruments à l'abri, ainsi que le bois en prévision de l'hiver et aussi de la pourriture.
|
|
Peut-être aussi est-ce demain que vous allez faire les charcutiers ? Il me le semble. Aurez-vous des chaînaux ? Pour faire marcher au sec les interminables tours que doit exécuter le "Noirot", car il est temps d'enlever les précieux grains de la dent des souris. On s'aperçoit que les stocks ne sont pas forts. La boule diminue toujours de volume !... On ne peut plus trouver de rabiot...
|
|
Mes quatre pages sont remplies de balivernes, il ne me reste qu'à vous embrasser affectueusement. Louis.
|
|
Il parait que nous ne resterons pas longtemps en ligne, on parle de la relève de la division.
|
le 25 novembre 1917 14h
Chers aimés,
|
Me voilà dans l'escalier de ma sape, comme un oiseau en chambre cherchant du coté de la lumière, ce qui me permet de passer quelques instants de ce dimanche avec vous. Il n'y a plus rien à récolter maintenant, pour vous c'est le repos hebdomadaire sans trop de souci du temps qu'il fera demain. Les cuisinières ont dû avoir l'embarras du choix pour accommoder à toutes les sauces tous les débris que vous aura fourni votre gros cochon, car je suppose que vous avez dû l'immoler cette semaine si vous ne voulez pas manger plus longtemps votre pain sec. Une petite carte d'Henri dans le milieu de la semaine doit m'arriver aujourd'hui. Probablement que je n'aurai des détails précis que ce soir par la veillée que maman va me consacrer.
|
|
Mon petit colis est-il en route ? Il ne serait pas de trop aujourd'hui : tous les vivres de la journée furent la proie des flammes dans la cuisine de la Compagnie qui se trouve un peu en arrière dans une tranchée. "On resserrera d'un cran", comme disent les "poilus", il y a les biscuits et le singe dans le sac...
|
|
Nos voisins d'en face sont toujours aussi mal plaisants, ils ne ménagent pas leur "camelote". Et puis le mauvais temps a l'air de revenir. Les sept à huit de nuit à tirer ne sont pas bien intéressants. Nous avons au moins une bonne sape, avec des couchettes pour s'allonger quelques instants.
|
|
Melle Poutignat m'écrit une longue lettre où comme d'habitude il y a un brin de politique. Le nouveau pilote national ne lui inspire pas confiance, il ne veut encore pas nous débarquer au Quai de la paix, me dit-elle : ce n'est pas encore l'homme du peuple qu'il nous faut... Une bonne grande lettre du Quai de mercredi m'arrive aussi, mais conçue en d'autres termes : l'adjudant n'écrit pas... Le sergent est suspect, ses écrits sont censurés... et un tas de souvenirs.
|
|
J'attends des nouvelles de Verdun, la boue gluante doit immobiliser un peu les correspondances, sous ce rapport le plâtre champenois vaut mieux. Hier j'ai fait une lettre à Mr. Fourgeot. En souvenir de mon voyage de dimanche j'ai reçu un mot aimable des amies d'Henri. En ces régions la moindre affection est toujours très appréciable. Au revoir et bons baiser à tous. Louis.
|
|
Vous ne m'avez pas dit si Augusta traînait toujours l'aile ?
|
|
Lundi 8 heures, je vais fermer cette lettre commencée hier, la nuit a été assez bonne mais pas très chaude. Je vais dormir, bonjour et au revoir.
|
le 29 novembre 1917 7h
Chers aimés,
La nuit fut belle mais très longue, dix heures de service sur quatorze !... Cependant avant de prendre un peu de repos, je vous trace ceci, car cela fait trois déjà jours que je ne vous ai rien adressé. C'est plus de temps qu'il n'en faut pour que ce plaisir me soit enlevé. Seulement hier, j'ai consacré huit pages à
Édouard en réponse à une prose encore plus grande qu'il m'avait dédiée. Comme remerciement il trouvera ma lettre bizarre. Mais pour réussir à me rallier à ses principes il choisit mal ses moments. Je lui fais remarquer que les plus beaux discours, sincères et justifiés, ne produisent pas beaucoup d'effet sur une âme brisée par trois ans de souffrances morales et physiques presque continuelles. Enfin, notre influence est minime sur la décision qui guide notre destinée, mais c'est avec plaisir que je reçois ses sincères recommandations ou invitation à espérer toujours, même au sacrifice de ma vie et que je me plais toujours à contredire.
Je croyais pouvoir vous remercier sur la bonne qualité de vos produits qu'Henri m'annonce. Mais comme je ne suis pas favorisé pour les envois, ce sera pour un autre jour. Il aurait fallu que je ne sois pas dans un endroit où les chemins sont si étroits. Au revoir et affectueux baisers. Louis.
le 2 décembre 1917
Chers aimés,
|
Dois-je me plaindre et me lamenter ou m'estimer heureux de pouvoir profiter d'une bougie et d'un moment de loisir pour vous tracer ceci sur mes genoux, accroupi sur ma couchette ? Puisqu'il faut savoir se contenter des rares instants de plaisir que la destinée nous accorde, je me réjouis de cette faveur qui m'est permise encore aujourd'hui. Ce sera la grâce qui m'est accordée pour sanctifier ce dimanche et vous en faire part.
|
|
Je viens de finir la dixième nuit de petit poste avec dix heures environ de veille, claqué
(?) ! Et quel genre de veille : Je vous laisse le soin de le deviner. Souvent l'absorption des sens et la crainte du danger dominent les ravages des intempéries. Dire qu'il y a des gens qui se plaignent de veiller un malade, ou bien quand l'intérêt commande, comme par exemple de veiller une jument, je me rappelle l'avoir fait. Un "canard" nous amenait ici pour quelques jours mais il a dû se noyer et faire place à un autre qui nous place ici pour dix-huit jours. Nous sommes comparables à une bête de somme de laquelle on tire parti jusqu'à épuisement complet !...
|
|
Les lettres ou les phrases d'oubli ou d'indifférence à mon égard que je vous adresse ne produisent pas beaucoup d'effet car malgré ma situation de sacrifié que je puis paraître, tant que je me trouve entre deux mondes, quelques moments lucides me permettent de constater que vous ne m'avez rien adressé, ni dimanche, ni lundi, ni mardi, car j'ai eu hier à cette date une gentille lettre de remerciements de Mme Raguin. Peut-être obtiendrez-vous des circonstances atténuantes si vos lettres vont rejoindre ma grillarde qui a dû s'égarer dans les innombrables boyaux champenois où l'on n'y voyage que la nuit.
|
|
Affectueux baisers. Louis.
|
le 5 décembre 1917
Chers aimés,
|
Il y a deux heures que je vous ai expédié une lettre faite hier en guettant dans mon trou. Depuis j'ai déballé une grosse boite, et ma foi, elle vaut bien la peine que je brûle une bougie en vous consacrant cette feuille de mauvais papier.
|
|
Oh ! je ne m'étonne plus qu'il ait mis quinze jours pour m'arriver ce colis ! Il n'était pas de mesure pour passer par d'autres étroits boyaux. Mais plutôt désigné pour quelque embusqué confortablement installé.
|
|
Quant à la qualité de ses produits, je me charge de faire l'embusqué pour l'apprécier. L'affectueuse vigilance qui l'avait confectionné la garantit de toute avarie. La cancoyotte et la viande ne sont plus de première fraîcheur mais leur présence en ces régions leur acquiert une valeur inestimable. Mon copain et voisin de lit qui est producteur de Champagne, avons eu comme dessert les deux poires qui faisaient le bon poids, qui ont mieux fait ressortir la bonne qualité de la prune. En un mot, je suis enchanté de mon colis duquel je désespérais. Puisse t'il en être ainsi de la délivrance désirée.
|
|
Et ma foi, puisque j'ai le temps et le courage je vous reproduis ce que me dit malicieusement
Édouard au sujet du sien : "Je songe qu'Ésaü devait être aussi de bonne pâte pour manger ses lentilles sans crève-cœur. Tout velu qu'il était il avait bon caractère. Et dire que nos cadets comme Jacob ne sont pas heureux de leur sort avantageux et sont prêts à oublier les épreuves qui leur sont épargnées."
|
|
Je ne suis pas susceptible comme ton parrain mon Henri et reviens sincèrement avec toi par la carte que tu m'as adressée samedi soir : tu ne dois pas être encapuchonné comme moi tous ces matins-ci de vieille lune pour retrousser tes deux cents gerbes. Tu me dis bien que le rendement est bon, mais je suis encore assez compétent pour qu'il ne soit pas superflu de me fixer des chiffres... Mais ce serait pousser à la guerre que de vouloir le vendre douze sous. C'est presque aussi coupable que de souscrire à l'emprunt !... Je suis heureux de constater que vos affaires vont pour le mieux. Si l'espoir du retour était aussi noir pour moi que le présent, le désespoir serait près de vous gagner.
|
|
Voici les lettres : deux cartes bisontines, Montrapon et le Quai. Quand vous recevrez ceci, je serai près de pouvoir me reposer en sécurité, lundi soir je crois. Dans cet espoir je vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
|
Mes affections à la tante jeudi.
|
le 9 décembre 1917
Chers aimés,
|
Encore un beau dimanche ! Comme tous ceux qui se passent dans ces régions voilà le quatrième hiver. Il est dix heures, je rentre de faire trois heures de faction, en attendant la soupe je vous consacre quelques instants. Pas des moments de joie assurément, ils n'existent pas ici où il me semble que la comparaison est juste, en se croyant entre la terre et l'enfer, c'est-à-dire le purgatoire.
|
|
Vivre dans des terriers, sinon être exposés à chaque minute à être pulvérisé ou déchiqueté. Circuler dans des boyaux étroits que le dégel transforme en marécage, veiller par tous les temps dix heures dehors et par nuit,
voilà à peu près l'emploi de mes dix-sept derniers jours. Mais je crois que cette dix-huitième sera la dernière. C'est un record. Sans doute l'intervention américaine qui soulage le service ! Je crois qu'il se passe actuellement d'autres interventions qui peuvent être plus funestes ! Nous devons traverser une triste époque dans notre histoire. Pitié ! pour les victimes ! Quelle consolation de pouvoir encore confier sa misère à ceux qu'on aime !
|
|
Heureusement que j'ai pu me procurer des bougies pour q'un brin de vie humaine me soit permise dans les moments disponibles. Lire les journaux ou écrire une lettre et recevoir quelque chose à la distribution des lettres
voilà ce qui me dit que je suis encore un être humain. Je vais avoir aussi le plaisir de faire une tartine de cancoyotte ou de grignoter une noisette (la fiole est vide...) ce qui me transportera un instant loin d'ici !... Si je fais des frais de bougies (cinq ou six sous par jour) je fais des économies en savon, je me suis rasé déjà une fois depuis que je vous ai quitté ! Pour un "poilu" je suis un peu là.
Voilà mes quatre pages en bavardage incohérent mais qui traduit tout ce que je vous offre d'affectueux. Mes baisers à tous. Louis.
|
le 12 décembre 1917
Chers aimés,
|
Oh ! des gâteries auxquelles je n'étais pas habitué ! deux grandes lettres qui me furent adressées le même jour. L'une dictée sous l'influence débordante d'une révolte maternelle. Oui ma chère maman je l'ai eue votre lettre de vendredi, adressée en partie pour les embusqués de la censure, mais ils n'ont eu garde de l'ouvrir. Heureusement qu'une partie de votre courroux était infondée, qu'il se sera en partie apaisé en apprenant la réception de mon colis. Puisse t'il en être ainsi pour toutes les autres questions présentes !...
|
|
Quant à la tienne mon cher Julien, ton patriotisme forcé ne te permet pas d'être aussi expansif. L'inévitable égoïsme humanitaire t'englobe dans son œuvre néfaste, ce qui te ferme les oreilles sur les plaintes des malheureux. Oh ! Tu n'es pas responsable, je ne t'accuse pas, mais reconnais que c'est la majorité des individus de ton cas qui sont la cause de la continuation du fléau ?
|
|
En Russie c'est le même égoïsme qui a subjugué les dirigeants actuels, mais le résultat est opposé à celui qu'on nous force à atteindre, et c'est en cela qu'il est admirable. C'est bien sublime de sacrifier sa vie pour défendre sa patrie, mais c'est abominable de forcer ses semblables à marcher au supplice ! Ta lettre néanmoins est remplie de choses qui me seront toujours chères ! Je croyais que les monotones et absorbantes occupations vernaises t'avaient paralysé le moyen d'exprimer ta pensée. Mais cette fois tu m'as gratifié mieux que d'intimes et affectueuses secrètes pensées et je t'en remercie sincèrement. Je te souhaite bonne chance pour tes voyages bisontins en perspective qui ne manqueront pas d'être agrémentés par des visites au Quai.
|
|
Deux jours de repos dans un camp connu, une métamorphose due aux outils du coiffeur, une bonne douche et une désinfection complète me font arriver à ma dernière feuille sans que je vous parle de ma situation personnelle qui oublie déjà le deuil des souffrances dernières. Mais je crois qu'il ne faut pas envisager un avenir bien brillant. J'ai eu ces jours une bonne lettre de Gouhélans, de Montferrand, de Georges, de Lulu. De quoi m'occuper dans mes loisirs ! Ce veinard de Georges a envie de passer l'hiver au chaud.
|
|
Hier soir je croyais aller surprendre Henri, mais comme moi, il n'est pas au terme de ses misères. Un ordre les a envoyés tenir les tranchées de deuxième ligne. Maigre riposte aux divisions allemandes qui se concentrent devant nous. Rien de plus pour aujourd'hui que mes affectueux baisers à tous. Louis.
|
le 15 décembre 1917 18h
Chers aimés,
|
Tout me conseille pour vous faire une bonne lettre ce soir. Je serai en avance pour ma journée de demain dimanche.
|
|
L'entête de cette feuille vous indique que je profite encore des douceurs que l'arrière procure aux rescapés qui redescendent des tranchées !
|
|
J'occupe un des camps provisoires que la guerre a créé à coté des casernes de Mourmelon. La place ne manque pas dans l'immense camp de manœuvre champenois. Nos baraques sont meilleures pour une villégiature d'été que pour garantir du froid. Nous avons bien des poêles mais pas de bois. On y dort encore pas trop mal, enveloppé dans deux couvertures sur une paillasse qui laisse parfois traverser le grillage de nos couchettes.
|
|
Afin d'exciter l'amour-propre qui reste en nous, l'une de nos baraques est érigée en "Foyer du soldat". Chaque soirée elle est chauffée, de nombreuses tables éclairées à l'électricité, du papier à lettre pour écrire, des jeux pour se distraire ou des livres pour lire.
|
|
Vous voyez ce que j'ai choisi et la plupart des copains font comme moi.
|
|
La journée d'une pureté sans nuages fut occupée à faire des "Ribards" aux réseaux barbelés portatifs. Mettre mes sabots en rentrant et manger la soupe m'ont amené à la minute présente qui me trouve avec vous. Oh ! si cela durait ainsi jusqu'au bout. Quel patriote je serais ! Mais en entendant un feu roulant à quinze kilomètres d'ici, avec la perspective d'en recevoir autant un jour prochain, cela ternit les prévenances dont nous sommes l'objet.
|
|
Des reconnaissances aériennes nombreuses, des mouvements de troupes inaccoutumés sont des indications significatives.
|
|
Ma feuille est remplie en égoïste, sans même vous remercier de votre bonne lettre de dimanche soir chère maman.
|
|
Néanmoins j'attends le résumé de cette semaine passé à la grange. Peut-être demain aurai-je des nouvelles de ton élève Henri. Mes condoléances à ce pauvre Zidor, et mes baisers à tous ceux que j'aime. Louis.
|
le 18 décembre 1917 18h
Chers aimés,
|
Huit jours de repos après mes dix-huit jours de P.P. et une santé malheureusement très bonne, C'est plus qu'il n'en faut pour me remettre. Aussi demain soir à cette heure aurai-je trente et quelques kilos sur le dos suivant la longue file indienne à travers les interminables boyaux, à la recherche de la sape que nous devons occuper.
|
|
Aussi je profite de cette dernière soirée pour vous adresser encore une fois une partie de la détente qui m'est permise, profitant de la confortable installation à ma disposition.
|
|
Mon Henri, j'ai reçu ce soir ta carte de jeudi. Que vous dire des rigueurs de l'hiver qui s'annoncent sérieuses ? La petite couche de neige a l'air de vouloir bien tenir par la bise qui souffle. Nos légères baraques ne sont plus trop chaudes, en ce sens les souterrains vaudront mieux. Nous n'aurons pas eu grand travail ces jours-ci, le soin de remettre en ordre nos affaires et de nous nettoyer. Des revues de cheveux ou de boutons pour lesquels on voit plus de galons que pour le service aux P.P. Dimanche j'ai fait une petite ballade aux "Madelons" de Mourmelon que les obus ne parviennent pas à dénicher.
|
|
Peut-être vous avais-je dit que j'avais fait connaissance d'une dame à Mourmelon-le-Petit (je suis au Grand) par l'intermédiaire d'Henri. Une corvée m'amena ce matin devant sa porte, par le temps qu'il fait l'occasion fut belle d'aller lui dire bonjour et m'esquiver en même temps. Elle m'offrit à déjeuner, et je passai un moment avec elle. C'est appréciable de trouver en ces régions quelqu'un qui vous offre un coin de table près d'un bon feu. Ajoutez-y le plaisir enfantin procuré par
Melle Poutignat par le colis gratuit de Noël contenant des bonbonneries et un flacon d'alcool de menthe, et vous comprendrez que c'est le cœur un peu en place que je vous dis bonsoir et vous embrasse tous bien fort. Louis.
|
|
Cette fois nous devons monter en réserve. Dago doit bientôt rentrer. L'aurez-vous vu ?
|
le 21 décembre 1917
Chers aimés,
|
Mon "foyer" a changé de décors. Il n'est pas construit d'après le même plan que celui des jours derniers. C'est une de ces habitations préhistoriques que le siècle du progrès a remise en actualité, et celle-ci n'est qu'un échantillon des résultats obtenus par la grande cause qui nous immortalisera à jamais ! Quand donc ces pauvres humains voudront-ils se rendre compte que toutes leurs puissances réunies ne peuvent les conduire qu'à la poussière d'où ils sortent !
|
|
Je ne veux pas vous traiter un sujet au dessus de ma compétence. Mais ces quelques mots vous prouveront une certaine sérénité d'âme partant d'un minuscule "poilu". C'est que rien pour l'instant ne vient trop troubler les innombrables réflexions que donnent les circonstances présentes.
|
|
Ma situation en réserve n'a pas l'air de vouloir être trop dure, surtout si le calme apparent se prolonge. Seulement au bout de huit jours je ne sais pas à quoi nous allons ressembler. Nous sommes comme des renards dans un trou enfumé. Nous avons bien des "brasero" mais pas de braise... Ce qu'on appelle le système D. nous amène à dévaster des vieilles sapes russes. Mais avant de faire sentir leur chaleur les planches que nous brûlons nous suffoquent, car l'air et la lumière ne nous arrivent que par l'escalier de sortie.
|
|
Ces quatre pages de phrases creuses sont tout ce que je puis vous apporter de bonheur en ce jour de Noël. J'y joins mes plus affectueux baisers. Louis.
|
|
Hier des nouvelles d'Édouard du 16.
|
le 23 décembre 1917
Chers aimés,
|
Ma chère maman, je réservais une grande feuille pour répondre aujourd'hui à ce que vous m'auriez dit dimanche soir. Mais rien n'est venu. Peut-être n'ai-je eu que de secrètes pensées ?
|
|
Cette carte me suffit pour vous faire part du rien de nouveau à signaler. Notre situation en réserve nous exempte du P.P., c'est appréciable par ces nuits claires et cette neige de décembre. En est-il de même à la grange ? Dans l'espoir de l'apprendre, je vous dis au revoir et vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
|
Je n'ai pas revu Dago.
|
le 25 décembre 1917
Chers aimés,
|
Noël ! Noël ! Cri d'espérance. Espérance que le monde entier attend comme le Messie au temps jadis.
|
|
L'évocation d'autres Noël qui ne laissaient pas prévoir celui-ci m'oblige à vous consacrer ces quelques lignes. Ce sera la plus douce satisfaction qui me sera permise en souvenir de cette douce évocation.
|
|
Où sont-elles ces soirées de "Réveillon", ces marrons traditionnels, ce quart de vin chaud qui préparait les cordes vocales à l'exécution des leçons à réciter pendant l'office célébrant la naissance du "Sauveur". Que ces souvenirs sont pénétrants lorsqu'ils sortent des lieux qui sont tantôt écumants ou tantôt le lieu d'un silence qui vous inspire des pensées ou des souvenirs pénétrants. Et quelle satisfaction pour moi aujourd'hui de pouvoir vous transmettre un peu du bonheur que ces souvenirs me procurent. Je me console en pensant que cette période d'A.P. pourrait m'être encore plus défavorable. Nous n'avons pas de service de nuit à prendre. J'ai même pu exposer mes chaussures cette nuit au "Petit Jésus", mais il ne doit pas supposer que les hommes soient aussi bêtes de venir loger dans des trous où la fumée sort comme par le trou d'un volcan, aussi j'ai remis mes brodequins ce matin sans rien dedans. Mais puisque c'est la guerre, peut-être n'est ce qu'un retard ? Ou bien a-t'il tout versé à l'ordinaire qui, parait-il sera amélioré aujourd'hui. et puis je ne suis pas à la misère, mon sergent m'a payé un quart de vin chaud hier soir avec un morceau de lapin, un permissionnaire, un marc, en me disant que mon pays Lanoix était rentré avec lui. A-t-il quelque chose pour moi ? Un autre copain vient de m'offrir un cuisseau de poulet. Vous voyez que nous ne sommes pas encore bien malheureux, le souci de se bien soigner et de se chauffer, en attendant que les "Tancks" boches viennent chercher la signature de paix que Vilson garde derrière un réseau de six mille kilomètres d'eau. Oh ! Là il est bien tranquille pour rédiger des manifestes qu'il a copiés en étudiant l'histoire des anciens grecs, sept à huit siècles avant J.C. Heureusement que ma feuille s'achève et ne permet plus que de vous adresser mes plus tendres baisers. Louis.
|
|
Le 167 a l'air d'avoir plus de repos que nous. Mon cher Henri, je t'ai réexpédié hier un livre qu'Édouard m'avait fait parvenir afin que les sentiments qu'il développe me placent quelques instants au dessus de ma misérable situation. Mais ce n'est que de la théorie approfondie, admirable, mais qui n'exclue pas la réalité pratique.
|
le 28 décembre 1917
Chers aimés,
|
Voici sans doute ma dernière lettre cette année. L'évocation de l'anniversaire des anciens souvenirs me laisse d'heureuses pensées. N'avais-je pas il y a un an l'heureuse perspective d'un retour vers la France. Aussi est-ce peut-être pour enrayer le danger d'une trop grande ivresse qu'un adroit pickpocket me souleva mon porte-monnaie ?...
|
|
Sur mon carnet de route, le
premier jour de 1917 fut inscrit en pleine mer avec cette interrogation : où me trouvera la Saint-Sylvestre ? dois-je regretter cette année mémorable qui m'a encore mieux fait connaître l'horreur des temps qu'il nous faut subir, mais par contre m'a procuré la satisfaction des affections qui m'avaient fait défaut plusieurs années, ce qui est appréciable.
|
|
Cependant la même réflexion me viendra à l'esprit un de ces jours, en fixant les réseaux de fils de fer barbelés qu'il me faudra observer !... A quand la fin de ces angoissantes perspectives d'avenir ? Mourir pour la patrie est le sort le plus beau ! Surtout s'il est précédé d'un martyr de plusieurs années.
|
|
Ce soir nous allons relever les premières lignes, mais la compagnie est en réserve, pas de P.P. pour cette froide période qu'il nous est permis de passer un peu mieux que les autres, grâce aux gâteries des affections qui sont derrière nous. Les copains ont presque tous eu quelque chose. On a essayé de nous offrir un peu d'extra à l'ordinaire. Pour ma part je vous ai dit je crois, que
Melle Poutignat m'avait envoyé le petit colis gratuit. Mme Besançon m'en adresse un recommandé : mandarines, marrons glacés, raisins, bonbons... comme un collégien... tout ça c'est bon pour le soldat. Mais rien n'égale le "foudroyant" que tu m'avais annoncé mon cher Julien, et que Lanoix m'a fait parvenir hier.
|
|
Ajoutez-y le plaisir de lire votre bonne grande lettre de dimanche soir chère maman, et une aussi affectueuse de cette pauvre tante qui vieillit, il me semble, et vous ne serez pas surpris que je vous adresse, le cœur à moitié content, ce qu'il renferme de meilleur. Louis.
|
|
Il est encore question pour nous d'un repos, ou déplacement.
|
le 1er janvier 1918
Mes chers,
|
Le "Père Janvier" nous apparaît ce matin sous son épais et froid manteau blanc ! Il semble oublier que la férocité humaine oblige des millions d'êtres à passer la nuit dehors ; s'il eut pu prévoir ces atrocités sans doute qu'à la création il nous aurait fait revêtir de chacun une épaisse peau fourrée à l'instar des animaux sauvages.
|
|
A mon réveil j'ai cherché une figure affectueuse pour y déposer le baiser qu'une pieuse tradition nous permet en ce jour. Mais hélas ! voilà la quatrième fois que ce bonheur m'est refusé ? Me sera-t-il jamais permis ? Le calvaire qu'il nous faut gravir n'est pas atteint !
|
|
Il ne m'est pas seulement permis en ce jour de trouver une consolation dans un affectueux entretien avec ceux que j'aime par l'intermédiaire de la poste.
|
|
Jugez de ma stupeur lorsque brutalement une lettre de Somme-Suippes m'apprend la mort d'Henri !
|
|
J'ignore complètement où et comment cet irréparable malheur s'est produit. Il me faut l'autorisation de mon colonel pour quitter les A.P., aller prendre les renseignements qu'un douloureux devoir m'impose.
|
|
Je vous donnerai d'autres détails dès qu'il me sera possible. Vous devez vous rappeler que cette famille de Somme-Suippes fut le lieu où ce pauvre Henri m'emmena dernièrement.
|
|
C'est le cœur bien gros que je viens avec vous pleurer la perte de ce regretté et inestimable Henri. Louis.
|
le 3 janvier 1918 20h
Chers aimés,
|
Je suis exempt de
travail de nuit ce soir, et vous consacre une partie de ma soirée.
Que ma situation aux A.P. ne vous tienne pas trop en souci. Malgré
les rigueurs de l'hiver ces dix-huit jours se passeront d'une façon
supportable, en y comprenant toutes les affections qui m'arrivent de
l'arrière en ces jours de tendresses particulières. Aujourd'hui
j'avais toute une brassée de souhaits : Jules Curty y joint
l'annonce d'une perm de quinze jours avant son nouveau départ pour
le front. Melle Poutignat ne s'est pas mise en retard. Mme
Besançon m'évoque une soirée de vacance au Plateau à la faveur de la
lumière du poêle par l'intermédiaire de ses deux filles. Enfin jugez
de l'agréable surprise de profiter de la faveur d'une main qui s'est
servie de la plume pour mettre à mon adresse quelques paroles
affectueuses, faveur qui ne m'est pas permise une fois l'an.
|
|
Fallait-il
qu'une situation relativement bonne fut obscurcie par
l'irréparable destinée qui vient de nous enlever ce cher
Henri. |
|
J'ai pu
hier accomplir le douloureux devoir de prendre les
renseignements sur sa mort et les envoyer à sa chère épouse
éplorée. C'est le 20 novembre qu'il fut frappé d'un éclat
d'obus. Blessé mortellement à une heure du soir il expira
dans une ambulance à onze heures de la même soirée. Son
lieutenant partagea son sort par le même projectile. Il est
enterré à Mont-de-Billy, à environ sept ou huit kilomètres
de Mourmelon-le-Petit. Je n'ai pu hier me rendre sur sa
tombe, mais espère pouvoir accomplir plus tard ce
pèlerinage. Une délégation de sa compagnie prit part aux
obsèques où une élogieuse allocution fut prononcée sur les
cercueils. J'ai vu une superbe couronne offerte par sa
compagnie qu'on devait porter sur sa croix aujourd'hui.
|
|
J'étais
assez indécis pour envoyer tous ces détails à sa femme hier.
Cependant j'ai jugé utile de ne rien lui cacher, puisque sa
mort remontait déjà à douze jours auparavant. Ce coup ne lui
sera pas plus douloureux que l'angoissante incertitude où
elle était, car il lui écrivait chaque jour. |
|
Je crois
vous avoir dit que c'est par l'intermédiaire de ses amis de
Somme-Suippes que j'ai eu connaissance de cette cruelle
nouvelle. |
|
Je termine
en pleurant avec vous la perte de ce cher Henri qui est
regretté de tous ceux qui le connurent. |
|
Affectueux
baisers à tous. Louis.
|
|
Nous serons relevés ces jours-ci, je crois.
|
le 6 janvier 1918
Chers aimés,
|
A l'annonce de la mort de ce cher regretté Henri je devine le redoublement d'anxiété que je vais vous causer. Je suis sûr chère maman que vous allez passer encore une plus longue après-midi avec moi. Moi je prends l'avance et commence la journée avec vous, à part les deux heures de faction que j'ai prises ce matin à faire des kilomètres dans la tranchée pour me réchauffer les pieds. C'est l'avantage d'être en réserve chère maman, je ne suis pas cloué dans un trou aux Petits Postes, ne pas osant battre la semelle afin de paraître mort à l'ennemi d'en face qui nous guette. Nous sommes en deuxième ligne voilà deux jours après avoir été en troisième des neuf premiers du séjour, séjour qui doit s'achever ce soir. Et puis c'est l'éternelle répétition. Mais cette fois nous n'aurons je crois qu'un demi repos par là, dans des sapes sous bois où les obus tombent souvent. Oh ! ma chère maman le danger ne me sera même pas épargné durant ces neuf jours. "Nuit calme" ou "secteur calme" ne veulent pas changer de formule pour les quelques victimes quotidiennes qu'il peut y avoir, comme celle qui nous plonge dans la tristesse aujourd'hui. Ceux qui nous gouvernent, qui veulent l'Alsace, qui souscrivent à l'emprunt, en un mot tous ceux qui vivent en arrière de la zone dangereuse ont signé notre propre condamnation.
Ça marche en nous faisant croire que nous sommes des héros ou que ceux qui reçoivent l'argent boche sont des traîtres, et les autres qui aujourd'hui ont recours aux dollars américains sont les libérateurs de l'humanité. Tout ça, des formules qui sont les armes de l'égoïsme, la jalousie ou l'ambition, vices héréditaires de tous les chefs des peuples, qui aboutissent à la destruction de ces derniers. Ceci est de la psychologie d'après ceux qui se croient l'esprit mieux cultivé que d'autres. Mais résignons-nous et ayons confiance en celui qui se place bien au dessus de notre misérable planète, et qui doit rendre un jour la justice équitable. Affectueux baisers. Louis.
|
le 9 janvier 1918
Chers aimés,
|
A force d'accumuler pendant des années tout ce qu'un pays possède en bras et matériaux, l'autorité militaire a réussi à exécuter des travaux gigantesques même à proximité des lignes.
|
|
C'est dans un tunnel souterrain qu'on nous a ramené après dix-huit jours d'A.P. reposer du sommeil du juste. Tous les 420 de Krupp peuvent tomber sur nos têtes sans nous émouvoir. Aussi, les pieds délivrés, sans me soucier de la dureté de mon sommier en planches, roulé dans deux couvertures je viens de passer douze heures, et vous envoyer par delà la tourmente de neige mes premières pensées de ce jour.
|
|
Ici, la fusion terrestre nous envoie la chaleur, c'est beaucoup préférable sous ce rapport que les baraques glacées des camps de l'arrière. Alors que la crise du pétrole sévit partout, je peux vous tracer ces lignes à la faveur d'une lampe électrique. Ici non plus pas de restrictions, le pain, le vin, la viande, le tabac arrivent quotidiennement. Une coopérative assortie fournit le supplément et l'extra à ceux qui ne se contentent pas de l'ordinaire. Ainsi hier matin j'en suis revenu avec le bidon plein, une demi-livre de beurre, 2,25, un camembert, 1,70 et du papier grand format dont voici un spécimen.
|
|
J'aurais grand besoin de trouver un lavabo, mais cette installation n'existe encore pas ici pour le moment. N'allez pas divulguer ma lettre au public, les demandes pourraient affluer pour l'autorisation d'un séjour au tunnel du Mont Sans Nom. Si toutefois le cas se produisait vous pourriez prévenir les intéressés de prendre le boyau étroit qui y accède et d'avoir la tête casquée, et le masque prêt à adapter, car les artilleurs boches nous prennent pour un nid de guêpes et sans cesse nous mettent en furie en agaçant notre trou.
|
|
L'on ne peut pas nous laisser neuf jours dans l'oisiveté. Aussi hier soir nous fûmes conduits creuser une tranchée à proximité des premières lignes. Nous eûmes quelques rafales de mitrailleuses, mais le plus horrible fut d'essuyer de cinq à huit heures une tempête de neige qui ne nous permit pas d'ouvrir les yeux. Afin de ne pas tous devenir un bloc glacé on nous ramena dans notre souterrain, du travail point de fait, mais le compte-rendu fondé
(?), c'était l'essentiel. A ce soir la même perspective.
|
|
Ce qui ajoute encore plus de tristesse et de cruauté à ces horreurs c'est que je suis à proximité de l'endroit où tomba ce regretté Henri il y a vingt jours. Vous savez peut-être qu'il était au pied du "Téton". La pauvre Marie profite du nouvel an pour dissimuler son inquiétude en m'adressant une carte de circonstance. Il me semble qu'Henri lui avait caché son ascension aux tranchées. Elle ne doit plus rien ignorer à présent, la pauvre, je lui ai écrit le 2, peut-être le savait-elle déjà par la même voix que moi !
|
|
Voilà mes grandes feuilles épuisées, mais je ne finirai pas... Hier les vœux d'Édouard en date du 13
(?) en même temps que ceux de Georges, qui semble avoir trouvé un sauveur dans le paludisme. Mme Besançon me dit que ma carte du nouvel an a mis huit jours à lui arriver. Ma pensée vous porte mes baisers à l'heure présente, neuf heures. Louis.
|
le 12 janvier 1918 18h
Chers aimés,
|
Je change plus souvent de logement que de métier. J'ai quitté mon tunnel pour venir dans un autre souterrain qui m'était déjà familier. Mais ici encore je touche l'indemnité de combat, c'est vous dire que de temps en temps les grosses marmites nous encadrent, pas moyen de sortir sans casque ni masque... Toute la journée je fis le mineur avec le génie, charger des wagonnets dans une galerie et les pousser vers la sortie. Mais la Champagne n'est pas le pays noir mais le pays blanc, de la craie et toujours de la craie, heureusement car pas de temps ni d'eau pour se laver. Me voici donc sur ma couchette dans un petit coin à moi, avec une bougie pour compagnie en train de lire mon "courrier". Oui, mon courrier, quatre lettres qui me font passer le meilleur moment de la journée. Une lettre qui me revient n'ayant pu trouver Georges, une carte de condoléances de Besançon, et deux lettres censurées, l'une affectueuse et sentimentale de ce bon père Pastif, écrite sous l'impression triste que lui causa le départ de Léon au 47ème d'Infanterie et enfin la quatrième, écrite par l'indéfinissable influence que seule procure l'amour maternelle.
|
|
Oui ma chère maman, l'affreuse rigueur de souffrance qu'il nous faut endurer ne s'attaque pas seulement au sens physique, elle permet encore de retarder la transmission des consolations et des encouragements d'une mère à son enfant. La censure a gardé votre lettre de dimanche au moins deux jours puisque j'ai déjà une carte du 9 depuis Besançon. A ce sujet, quand parfois votre esprit de révolte peut se détendre sous votre plume, il n'est pas nécessaire de mettre votre adresse expéditrice, même au risque de perdre une lettre. Nous n'y sommes même pas contraints, une nouvelle fantaisie pour mieux nous connaître et par suite mieux nous conduire. La liberté est comme une fosse aux lions, elle n'a pas plus de deux pieds de large.
|
|
Je croyais me rendre ces jours-ci sur la tombe de ce cher Henri quoique j'en suis à douze ou quinze kilomètres. Mais mes chefs en ont refusé l'autorisation en raison d'un départ imminent. Vague motif qui fait ressortir l'indifférence et la dureté de cœur de ceux qui ne sont pas directement intéressés et qui sont heureux de faire ressortir la puissance et la supériorité que leur donne le règlement par l'attribution de galons, même en invoquant un pieux motif comme j'en ai un.
|
|
Je remercierai Melle Damotte de sa générosité que vous pourrez me faire parvenir. A propos vous m'aviez signalé l'envoi d'un billet ces temps derniers, mais rien ne m'est parvenu. Je ne suis pas à sec grâce à ma paye, mais avec toutes les perfections de la guerre moderne, nous avons des coopératives presque jusqu'en première ligne et vu les prix, un bleu ne rend pas souvent la monnaie, mais par contre permet à ma santé de résister, avec regret parfois, à toutes les rigueurs de la saison, et de pouvoir vous embrasser tous comme je vous aime. Louis.
|
le 15 janvier 1918
Chers aimés,
|
Je continue à braver avec succès les intempéries et les gros obus boches grâce à la confortable sécurité de ma sape moderne.
|
|
Depuis quelque temps les bruits les plus fantaisistes circulent sur une nouvelle affectation. Nous allons probablement voyager ces jours-ci. Et dans la crainte de ne pouvoir vous faire une longue lettre demain je veux tracer ces quelques mots aujourd'hui en y joignant tout ce que mon cœur a de plus affectueux. Louis.
|
|
Je vous joins des lettres des amis de ce regretté Henri qui m'ont appris la fatale nouvelle et qui témoignent l'estime et l'attachement qu'il laissait parmi tous ceux qui le connurent.
|
|
Dimanche soir, je me suis plu à rendre visite à ses copains de compagnie ainsi qu'à cette dame de Mourmelon, parente à ses amis de Somme-Suippes. Tendres baisers. Louis.
|
le 18 janvier 1918
Chers aimés,
|
Un ciel de janvier supportable aujourd'hui, des nuées d'avions qui font la manœuvre, pas grand travail à faire à part le nettoyage des mes effets et de mes armes, vingt kilomètres à l'arrière, c'est plus qu'il n'en faut pour remonter le moral.
|
|
Je croyais avoir une étape à faire ce matin, mais il n'en est rien. Est-ce en raison de la boue, je ne pense pas ? Mais il est fort probable que je vais changer d'adresse encore une fois.
|
|
Telle est ma situation dans la baraque que j'occupe depuis avant-hier. Et où est venue me trouver ta lettre écrite il y aura huit jours ce soir mon cher Julien. Bien que je sois forcé de ne plus être avec ce qui vous occupe tant, ta récapitulation m'a vivement intéressée. Ce sont les graines secondaires qui sont le plus remarquables par leur quantité et leur valeur : 9 ddl
(?) de trèfle ! Je suis surpris; je le serai moins en attrapant l'énorme cochon par là dans un mois peut-être, mais il faudra un couteau spécial pour lui trouver l'artère aorte !
|
|
En venant ici, il faisait mercredi un vent à prendre nos casques, mais par contre il aura débloqué la Liatte
(?) et maman aura pu vendre son beurre jeudi.
J'ai peut-être omis de vous dire que ce cher Henri avait eu la carotide coupée. Je me suis éloigné de sa tombe sans pouvoir y porter un bouquet. J'ai demandé des détails à l'aumônier de l'ambulance sur ses derniers moments, j'attends une réponse. Quant à Dago, je l'ai vu avant de venir ici. Il y avait deux mois que je n'avais pas eu l'occasion de le rencontrer, mais puisqu'il m'avait remis mon paquet, c'était l'essentiel. Ma marraine Pélagie ainsi que Suzanne R. m'ont gratifié d'une gentille réponse à mes souhaits. Je vous joins ceux de Mr. Fourgeot et vous embrasse. Louis.
|
le 20 janvier 1918
Chers aimés,
|
Il est très tard : sept heures du soir. Cependant à la pensée que vous m'avez fait une grande lettre aujourd'hui chère maman, je ne veux pas être ingrat et veux réagir avant de m'endormir. Aujourd'hui l'étape ne fut pas trop dure, après trois jours de repos nous sommes revenus dans des régions connues. Nous ne pouvons pas quitter la craie. Mais sans une certitude bien assise en ce qui concerne notre avenir, jusqu'à nouvel ordre c'est toujours le 334 qui me désignera. Je suppose qu'il y aura un grand remaniement de divisions et des mouvements de troupes qui pourraient retarder les correspondances. Ce n'est pourtant pas nous qui pouvons entraver les plans des
États majors. Pourvu qu'ils attendent quelque temps avant de nous affecter à une nouvelle formation, cela ne presse pas de reprendre les A.P.
|
|
Eh ! bien, je pense bien que vous n'allez plus vous plaindre de la neige. Voici quelques jours qui sentent le printemps et qui ont dus vous débarrasser des plus grosses accumulations de neige. Je ne sais pas ce que nous aurons encore à endurer comme mauvais temps. Mais je ne crois pas m'être trop plaint à ce sujet. Encore rien, pas seulement un petit rhume, moi qui rêvais un bon lit d'hôpital pour mon hiver ! Pas moyen de quitter sa culotte une seule nuit... Cependant, je m'estime encore heureux pour cette nuit. Je vous écris sur mes genoux étant assis sur une paillasse où je vais ronfler toute la nuit à poings fermés, et ma foi si cela continue, vous pourrez vous rendre compte à la prochaine que je ne vous bourre pas le crâne, oh ! je ne m'en fais pas ! Avec les préparatifs qu'il faudra subir avant d'avoir la paix, nous en avons encore pour quelques années !... Est-il permis d'avoir un espoir quelconque ? C'est à se demander pourquoi nous sommes sur la terre ? Si ce n'est pour être au service d'habiles exploiteurs. C'est encourageant aussi pour vous de travailler comme des mercenaires, pour être obligés de livrer vos denrées aux inquisiteurs.
|
|
Aujourd'hui je fus écoeuré de voir un régiment italien planter des piquets pour réseaux dans de superbes champs de blé ou de seigle. Les propriétaires de ces cultures doivent être aussi encouragés que moi qui ne suis pas surpris de tout ce qu'on demande de nous comme service, en pensant au soutien que nous devrions avoir, mais qui fut envoyé sur la "Piave". Et puis tous les scandales qu'on nous dévoile sont encourageants : "Versez votre or". Les auteurs de ces alléchantes formules ont leurs coffres-forts à Florence ou ailleurs...
|
|
Il faudra que je m'arrête si je veux que la censure vous laisse parvenir mes plus affectueuses pensées et mes tendres baisers à tous. Louis.
|
|
Tenez-vous au gros tabac, cher papa, je pourrais en collectionner quelques paquets pour la prochaine.
|
le 23 janvier 1918
|
"Un bienfait n'est jamais perdu". L'occasion de prouver ma reconnaissance pour la gentille carte que tu m'as adressée pour mes étrennes, s'est rencontrée aujourd'hui grâce à ma situation à l'arrière.
|
|
Que ce gros baiser soit le gage de toute mon affection fraternelle. Louis.
|
le 24 janvier 1918 19h
Chers aimés,
|
Je viens de finir mon repas du soir avec une bonne tartine de cancoyotte, oh ! de la bonne ! Je crois qu'elle est encore chaude tant la boite fermait bien. Dans un instant je vais me coucher, en savourant une petite gorgée de ce crû du pays, ce pays ignoré qui vaut mille fois la Champagne avec sa réputation mondiale. Il ne me reste qu'à remplir ce grand format, et je serai quelques instants complètement loin de cette Champagne qui n'a offert à ma vue depuis quatre mois que de la craie et quelques pins chétifs.
|
|
Cependant, il faut que je vous dise ce qui me retient en Champagne ou ma raison d'y rester, malgré mes voyages prévus. Oh ! les voyages ne m'hypnotisent pas, et j'aime autant être ici qu'ailleurs, j'y ai peut-être des avantages pour remplir mes journées, à l'instar d'un territorial, à creuser des tranchées, oui, des tranchées à l'arrière... la censure ne me permet pas de vous dire pourquoi il faut toujours et encore des tranchées. Enfin la craie n'est pas trop dure, c'est l'essentiel pour l'instant, avec ça l'hiver a l'air aussi loin qu'il avait l'air terrible. Par ces beaux jours je me demande où tu vas fagotter mon Henri ?
|
|
J'ai pu hier me rendre sur la tombe de ce cher Henri. J'en suis à huit kilomètres, il m'a fallu l'autorisation de mes chefs car à l'arrière on ne trouve que la boue et les gendarmes qui vous demandent votre laissez-passer. J'avais ma journée, j'ai pu en passant à Mourmelon prendre des fleurs artificielles pour achever de décorer la tombe de ce regretté disparu. Ce n'est pas sans avoir le cœur gros que j'ai récité un "De profondis" pour le repos de son âme. Des cœurs comme le sien sur terre doivent avoir les premières places au ciel ! Aussi lui fut-il permis de se présenter à Dieu avec l'aide nécessaire. J'ai vu l'aumônier qui l'assista à son arrivée à l'ambulance ; il me confirma, l'aumônier, qu'Henri avait sa pleine connaissance quand il lui offrit ses services, mais dans un état de faiblesse qui ne lui permit pas de se rendre compte de la gravité de sa blessure, il s'est éteint tout doucement. Il était gravement blessé derrière la tête et à la poitrine. Malgré la tristesse de ce voyage, j'ai la satisfaction d'être agréable à sa femme en lui faisant part des derniers moments de son cher Henri. Hier soir j'avais une lettre de remerciements de la Marie.
|
|
Maintenant, puisqu'en cette vie il faut tout accepter, voici l'heureuse perspective des permissions qui revient. Le tour va recommencer, il est établi, j'ai le numéro 27, il parait qu'en raison de la période de repos ou d'arrière, il va en partir un fort pourcentage, peut-être irai-je plutôt que je ne puis le supposer, à moins que le régiment ne soit dissout comme on peut s'y attendre. Je suis presque à sec, ici plus de paye de tranchées, dix sous d'éclairage par jour, avec un bleu il y a à peu près pour quatre voyages à la
(illisible), 24 sous le "pinard", 38 le camembert, 52 le beurre, l'ordinaire fournit souvent des biscuits et du singe. Me voilà joli... C'est la guerre... Ayez pitié de moi. Bons baisers. Louis.
|
le 31 janvier 1918 19h
Chers aimés,
|
Ce cachet n'est pas apposé pour vous créer de l'inquiétude mais une justification d'une situation appréciable. L'admirable organisation de l'arrière est faite pour fournir le plus de détente possible aux loques humaines descendant des tranchées ! S'il n'en était ainsi, il y a longtemps que la guerre serait finie ! Mais hélas ! Les offensives de toutes natures sont prévues et conjurées. Espérons que celle organisée par la ration du pain sera efficace... Ces quinze jours de beau temps ont permis de conjurer celle que les boches préparent, nous avons pas mal de réseaux de barbelés dans ces régions qui commençaient par m'être familières, en souvenir du long séjour que j'y ai passé, de ce regretté Henri et des relations que j'y avais créées.
Mais comme cela arrive souvent en ces temps imprévus, tous ces souvenirs seront bientôt vieux. Je vous trace ceci dans le brouhaha des préparatifs de départ. Nous allons partir cette nuit. En exécution à ce que je vous laissais pressentir. Quelle direction et quel but ? Comme toujours rien de certain. Il est fort probable que cela changera l'itinéraire et la date de la perm. Je vous renseignerai dès qu'il me sera possible. Le vaguemestre ne me communique pas grande réponse à vous faire, à part une carte d'Armand, en instance d'un départ à Salonique, depuis le 84 à Brive.
|
|
Bonsoir et bons baisers à tous. Louis.
|
le 2 février 1918
Chère Mad,
|
Ces quelques lignes ajoutées au bas de la grande lettre de maman il y aura demain huit jours valent bien cette carte d'un sou que j'ai achetée hier matin au débarquement à la gare.
|
|
Une petite étape à pied nous a amenés coucher sous les tuiles d'un patelin de la "cambrousse" des environs, mais cela vaut mieux que les Petits Postes de ce soir. Je te dirai si les boches de l'Argonne sont aussi méchants qu'ailleurs.
|
|
A une autre fois. Mes meilleurs baisers, ainsi qu'à ceux qui me liront. Louis.
|
le 2 février 1918 13h
Chère Maman,
|
Puisque Mad va vous apprendre que je suis au P.P. vous ne serez pas surprise que je vous adresse cette feuille aujourd'hui ; peut-être que demain je n'aurai pas tout le confort désirable. Je n'ai pas l'intention de vous attrister, mais j'estime qu'il est préférable de vous écrire avec franchise que d'agir en secret comme l'avait fait ce regretté Henri, qui avait épargné à sa Marie l'inquiétude de le savoir aux tranchées. Au jour fatal l'angoisse fut sans doute terrible !
|
|
Le changement de région, notre numéro de secteur devient 222. Cela n'est pas fait pour activer les correspondances. Votre grande lettre de dimanche m'arrive à l'instant. Son préambule raffiné est digne d'un littérateur, son caractère commercial, digne de l'admirable énergie d'une mère de soixante ans par ses enfants de trente.
|
|
Ma chère Mad, j'aimerais te voir inspirée de cette succession naturelle à l'exemple de ma nouvelle amie de Somme-Suippes qui a ton âge.
|
|
Chère Maman, la longueur des correspondances ne permet pas d'entreprendre par écrit des questions comme ceux auxquelles vous faites allusion. Vous me demandez des réponses que je vous ai faites il y a bientôt quinze jours, et pour lesquelles il faut faire des efforts de mémoire pour s'en rendre compte. Quant à l'objet de votre lettre, il donne lieu à réflexions. Que pouvons-nous envisager avec des temps si incertains que ceux que nous traversons, surtout moi qui vit comme une machine
voilà bientôt quatre ans, et de ce fait perdant tout bon sens et toute énergie. Mais je ne suis pas seul, heureusement. Et puis, est-il permis de se demander la valeur de ces billets ? En tous cas la grande tempête actuelle n'augmente pas la solidité de leur crédit. Et elle n'est pas calmée !
|
|
Pour aujourd'hui je n'ai plus qu'à vous faire part de mes affectueux baiser à tous. Louis.
|
le 6 février 1918
Chers aimés,
|
J'en suis à mon quatrième jour de P.P. Que vous dire de mon nouveau secteur ? C'est la guerre comme partout, avec tout ce qui la caractérise de fatigue, de privation et d'incertitude.
|
|
Cependant je viens un instant avec vous, avec une sérénité d'âme convenable. La grande habitude permet de surmonter machinalement tout ce que le service exige, qui n'a rien d'anormal. A condition de ne pas sonder la situation au point de vue psychologique, et aussi vu l'état satisfaisant de ma santé, je puis vous dire le laconique : ça va bien.
|
|
Afin d'agrémenter ou prolonger la causerie, je puis ajouter que je regrette les abris de mon ancien secteur. Ceux-là étaient profonds, d'où une sécurité relative, et chauds pour l'hiver. Tandis que le sol de l'Argonne ne permet que des "Cagnias" superficielles et humides.
|
|
Je crois que les boches n'ont pas l'air de vouloir être trop méchants et la température non plus, ce qui me permettra de ne pas être trop détérioré pour l'unique et prochain espoir : la perm. Les premiers permissionnaires du deuxième tour sont seulement partis ce matin. Je serai retardé dans mes premières prévisions.
Édouard me fixe un rendez-vous pour le 15 mars. Je trouve que c'est un peu loin, et il doit fixer la date maxima. Enfin pour si peu que je sois retardé et lui avancé je nourris encore l'espoir d'une rencontre. Sur ce je vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
|
Nous n'avons plus de numéro de P.P. attitré ; je vous avais donné 222 mais à présent on nous offre le numéro 48 qui nous rappelle le souvenir de ce cher Henri.
|
le 10 février 1918
Chers aimés,
|
Vous aussi chère maman vous étiez du nombre des femmes qui avaient l'air de s'être entendues pour venir me distraire dans ma solitude le même jour. Je me suis amusé à comparer les différents sentiments qui caractérisaient chacune de ces gentillesses. Ils étaient assurément bien différents. Les cartes de mes amies bisontines ou la lettre éplorée de Marie de Munans ne pouvaient pas être inspirées par le même sentiment que le vôtre.
|
|
Maintenant, avec laquelle est-ce que je trouverais le plus facilement le plus long sujet d'entretien comme réponse ? Inutile de vous le spécifier. Car en développant certains petits détails de la vie quotidienne que certains appelleraient une lettre de "bleu", ou des niaiseries, ceux-ci trouvent toujours bon accueil dans un cœur maternel. Il n'y a donc que les niais et les sots qui disent qu'ils n'ont rien à écrire. Je sais bien qu'il faut que ce soit en raison des circonstances actuelles pour qu'il me soit permis parfois de m'engager dans des questions philosophiques, que j'aurais accueilli en d'autres temps par ces mots "On voit bien qu'il a le temps". Oh ! certainement que j'ai le temps. Je suis assis sur ma couchette enveloppé dans mes couvertures et malgré sept heures de faction cette nuit, je commence ce dimanche avec vous. J'éprouve du plaisir à vous tracer ces grandes feuilles et j'ose croire que vous leur ferez bon accueil.
|
|
Voilà huit jours que je suis à cette place. Vous pouvez croire que je connais le trou que j'occupe sept heures de nuit et trois de jour. Ces longues heures par ce ciel bas et sans lune occupent plus l'ouie que la vue. Rien d'anormal ne m'est encore parvenu, seules quelques rafales de mitrailleuses troublent le silence impressionnant. A part le froid des pieds, la température ne laisse pas trop à désirer; on peut de temps en temps se faire apporter quelques bidons de pinard pour noyer les idées noires, qui n'égalent jamais la couleur du pain
voilà quelques jours. Je suppose que nous allons redescendre un de ces jours, car nous ne sommes ici que provisoirement, il m'en tarde car j'ai ramassé des "totos" sur des paillasses qui furent propres il y a quatre ans ! Vivement que tous les civils en aient aussi ! Puisqu'il me semble que c'est un des buts de guerre à atteindre ! Il vaut mieux peut-être que je change de sujet puisque toute vérité n'est pas bonne à dire.
|
|
Je n'ai rien à ajouter à mes prévisions pour ma perm, je compte sur le retour de ceux qui sont partis par là après le 20.
Édouard me conseille de ne pas l'attendre. Marie d'Henri m'adresse des remerciements pleins de larmes, elle me convie si possible aux prières d'offerte, pour la fin du mois.
|
|
Clausse Alfred me fait part de sa perm et Léon Pastif ses impressions sur son nouveau régiment.
|
|
Chère maman votre lettre carte dernière ne me suggère pas de réponse particulière, à part mes affectionnés baisers à tous. Louis.
|
|
334ème d'Infanterie 13ème Compagnie P.P.51.
|
le 12 février 1918
Chers aimés,
|
Quel dommage qu'il n'y ait plus de neige ! J'aurais pu revêtir la tenue fantassin hier soir pour faire une patrouille dans les fils barbelés. Cela aurait toujours été une façon de sanctifier ce Carnaval 1918 ! Mais je n'ai eu que le doux souvenir de ces bons carnavals du bon vieux temps : quand, après ne plus pouvoir avaler de beignets, je me laissais habiller par la mère Bailly, ou plutôt sa petite fille...
|
|
Je vous avais annoncé je crois une prochaine descente aux tranchées mais il n'en est rien, nous sommes encore partis pour la semaine, peut-être davantage, et nous n'aurons encore pas dépassé le record ! Cela ne doit avoir aucune importance aux yeux de ceux qui dictent les ordres. N'avons-nous pas des mines superbes, presque pas de malades, une température exceptionnellement douce, un secteur calme, aucune perte. C'est le raisonnement logique de la dernière intelligence galonnée. Donc c'est tout naturel que nous restions aux P.P. J'espère que la descente sera une première étape vers l'objet de mon principal souci.
|
|
Mon cher Henri, j'aime à croire que tu vas bientôt me consacrer une veillée qui me permette d'être un instant loin de questions militaires, ou morales en découlant. Toi qui aimes tant reposer tes occupations physiques par d'autres intellectuelles, les sujets ne doivent pas manquer. Ce serait une préparation vers ce que je pourrai bientôt constater. Baisers affectueux. Louis.
|
le 12 février 1918
Chers aimés,
|
Quelques heures avant l'aube, la relève des tranchées est venue ce matin nous remplacer. Une étape de sept à huit kilomètres nous a acheminés dans un camp abrité par un des nombreux ravins de l'Argonne. Un petit affluent de l'Aisne va nous permettre le nettoyage qui s'impose par quinze jours de tranchées.
|
|
Ce n'est pas ce matin que je me suis beaucoup crotté, avec cette bise qui nous a brusquement rappelé que nous étions encore en février nous procure quelques avantages. Mais j'appréhende les nuits prochaines à passer dans la baraque glacée qui nous abrite juste contre la pluie. Seulement un espoir prochain domine les morsures du froid ! Il parait que le départ du prochain tour, dont je fais partie, aura lieu le 22 ! Donc vendredi prochain. Voyez-vous que j'arrive avant cette lettre ! Non, car je ne pourrais probablement débarquer que samedi soir.
|
|
Tous ces jours j'ai eu quelque chose. Jeudi je crois, vos affections, par le laconique résumé d'Henri ainsi que deux billets bleus qui me furent apportés aux P.P. Vendredi, ma prose maternelle hebdomadaire m'arrivait. Hier, j'ai eu une carte du Quai, partie mercredi soir.
|
|
Qu'allez-vous me dédier aujourd'hui chère maman ? Il y a huit jours vous étiez inspirée par toutes les révoltes morales que vous impose l'état actuel ! Cela répond un peu aux vœux des "poilus" qui ne voient pas le moyen d'en sortir avant qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur. Une légère et excusable satisfaction se manifesta à l'annonce de la randonnée des Gothas sur Paris ! Y en avait-il des colonnes sur les journaux ! Quand pour un "Coup de Main" les obus tombent sur les tranchées comme la grêle, il n'y a de place sur le journal que pour deux lignes, pour le faire connaître ! Assez dit là-dessus pour aujourd'hui, cela ferait le sujet d'un volume.
|
|
Au reçu de la carte d'Henri, j'espérais mettre encore une fois ma blouse pour la foire de mars, mais c'est trop tard. Ce petit veau que j'ai sevré avant de partir a rempli son rôle, et moi pas encore le mien... Il y a bien encore un de ces étalons à conduire à la foire ? Je n'en ai encore pas entendu parler, et un tas de choses à mettre en long, en travers, mais qui valent la peine d'un voyage. Mes baisers devancent cette heureuse perspective. Louis.
|
|
Cher papa, j'espère avoir le plaisir de vous apparaître dans une apparence non de contrebandier, mais d'accapareur !
|
le 12 mars 1918
Chers aimés,
|
Retrouver tout ce que la vue rencontre qui est exclusivement militaire produit toujours une certaine réprobation dans l'esprit du permissionnaire qui vient de quitter tout ce qu'il aime et ce qui lui permet d'avoir une aussi longue patience. La vue des organisations défensives, tout ceci ajouté aux fatigues d'un voyage de vingt-quatre heures en chemin de fer, produit toujours une certaine confusion, une sorte d'hébètement dans l'esprit du plus insensible des poilus. C'est ce qu'on appelle je crois le cafard. Je m'étais pourtant bien promis de ne pas l'avoir, de repousser cette horrible bête ! Mais quel est le mortel qui puisse surmonter les forces invisibles qui nous régissent, plus puissantes que les engins destructeurs nés de l'odieuse guerre ?
|
|
Cependant voilà déjà deux nuits pendant lesquelles j'ai mieux dormi que dans le plus moelleux lit de l'hôtel de la Couronne, aussi le Cafard est-il parti en terrasser d'autres et me laisser la sérénité d'âme complète pour passer un instant avec vous.
|
|
J'ai eu la chance de retrouver mon régiment dans la baraque d'un camp, cela vaut mieux que le trou d'un P.P. Ma gare de ralliement m'a réexpédié vingt kilomètres environ plus à l'ouest. Nous allons au travail, je n'ai pu vous faire une lettre pour le courrier de hier, aussi je vous trace ceci ce matin avant de me lever car nous allons partir pour la journée. Je crois que la longueur de ma perm ne sera pas trouvée trop exagérée. J'ai rattrapé mon copain en route comme je le prévoyais.
|
|
Et vous, comment s'est passée la fin de votre journée ? Peut-être me l'avez-vous déjà écrit ? J'espère mon cher
Édouard que tu prendras connaissance de ceci avant ton départ et que tu auras ta part des baisers que j'adresse à tous. Louis.
|
le 15 mars 1918 16h
Chers aimés,
|
Il me semblait que je devais recevoir un petit mot de consolation aujourd'hui. Mais encore rien qu'un mot du Quai me disant que les Vernois avaient repris le train de quatre heures trente après un court arrêt au Quai.
|
|
Cependant, voilà déjà huit jours que cela s'est passé et il me semble qu'il y a un mois !
|
|
Cette permission qui a tant tenu de place dans mon esprit n'est déjà plus que souvenir. Que puis-je espérer maintenant ? Je n'ose m'arrêter trop longtemps à ces mauvaises pensées
qui sont notre lot, mais j'ai beau chercher que je ne trouve rien qui me permette de surmonter les cruelles déceptions interminables qu'il me faut continuer à subir !
|
|
Je suis parmi vous pour contribuer à faire les préparatifs de départ d'Édouard. La tristesse du retour succède presque sans interruption à la joie de l'arrivée ! Oh ! que ces temps d'épreuves sont durs ! Mais tout espoir n'est cependant pas perdu et je vais essayer de réagir, m'appuyant sur l'affection que j'ai puisée parmi vous et que vous entretiendrez le plus souvent possible !
|
|
Pour cela il n'est pas nécessaire de me faire chaque jour une ennuyante lettre littéraire, mais n'est-ce pas de l'affection que de me faire part de vos occupations journalières ? Malgré l'indifférence apparente que cette abrutissante vie me force de faire supposer, je suis toujours par la pensée parmi vos absorbantes occupations. Je vous suis, parmi la pensée des envieux, par ce réveil du printemps ! Mon Henri, es-tu content de ne pas avoir le souci de couper le bois des Mollards ?... J'attends ta juste critique à l'occasion, à ce sujet ?
|
|
Pour moi, je ne veux pas aujourd'hui te faire la critique sur le sujet de mes occupations journalières, j'aurais peur de me laisser entraîner à des excès dans ma plume. Chaque jour le Decau nous conduit assez loin aux travaux de défense. La Champagne va devenir invulnérable. Aujourd'hui je suis resté comme homme de garde dans le camp que nous occupons. Ce qui m'a permis de vous tracer cette lettre que je complète par mes plus affectueux baisers à tous. Louis.
|
|
Hier soir j'ai assisté avec envie au départ de Lanoix parmi vous.
|
le 19 mars 1918 19h
Chers aimés,
|
Saint-Joseph nous a ramené la pluie. Pour moi cela m'a valu une légère humidité en revenant du travail à quatre heures. Par contre, j'ai tout le loisir pour vous faire une lettre ce soir, puisque la pluie ne permet pas de sortir de la baraque. Me voici donc sur l'espèce de table à l'odeur caractéristique, tout entier avec vous. Mais il faut que le plaisir soit absorbant pour dominer le brouhaha indescriptible qui règne autour de moi : jugez, nous sommes toute la compagnie dans la même baraque. Aussi par les beaux jours est-il préférable de se cacher dans un coin pour savourer avec sérénité quelque affection spéciale. Mais hélas ! ce bonheur ne m'est pas souvent permis ! Cependant j'arrive à un âge où l'isolement devient funeste, surtout par les longues heures de rêveries que donne le métier militaire. Ici rien n'absorbe l'esprit, rien qu'un semblant d'occupation lorsque l'on redoute un reproche.
|
|
Tous les matins à neuf heures le Decauville nous conduit au travail pour nous ramener à quatre heures du soir. Alors c'est l'heureuse perspective de lire quelques consolantes lettres. Pour quelqu'un d'insensible, nous n'avons pas l'air des affligés pour avoir besoin de consolations, pas trop fatigués, en sécurité et la faculté de pouvoir se procurer le nécessaire, cela semble l'idéal du troupier. Oui, mais moi, je ne suis pas né pour être troupier, et à force de réagir pendant quatre années de guerre, cela devient insurmontable ! Aussi ai-je besoin de distraction. Mais hélas ! depuis que je vous ai quitté, pas un signe de vie ? C'est très dur. Vous avez de la chance de ne pas avoir le temps d'écrire. Si absorbant ou dur soit-il, ce mangeur de votre temps, il ne peut pas être aussi fatigant et funeste que les longues heures d'oisiveté qui me dévorent le cœur.
|
|
Voilà que j'ai écrit mes quatre pages sans m'en apercevoir, heureusement, car je n'ai rien de nouveau à vous apprendre, mais avant de vous embrasser, je vous fais part du cordial accueil que j'ai reçu dimanche après-midi chez mes nouveaux amis à Somme-Suippes, j'en suis à dix kilomètres en chemin de fer. Louis.
|
le 26 mars 1918
Chers aimés,
|
Je vais quitter les abords de cette église pour me rendre aux tranchées. Comme un abandonné, j'ai le cœur gros !... Vous en avez néanmoins mes plus affectueuses pensées et mes plus tendres baisers. Louis.
|
le 1er avril 1918
Chers aimés,
|
Mon communiqué avec le R.N.S. sera mon poisson d'avril qui ira vous trouver trop tard. Mais vous montrera le village que j'occupe, dont il ne reste plus que les chats qui sont venus nous tenir compagnie.
|
|
Je vous ai écrit hier matin par la pluie, mais le soleil a répondu à la bienveillance de mes chefs qui nous ont laissés libres, et qui ont permis à Lanoix de m'apporter mon colis. Son volume l'a rendu sans doute prévenant. Mais je fus heureux de pouvoir en son honneur (au colis) passer un jour autrement que les autres. C'est pour vous faire part de ce plaisir que j'ai aujourd'hui l'occasion de venir encore vous embrasser. Louis.
|
Pâques 1918
Chers aimés,
|
Cette pluie qui semble obscurcir l'heureuse fête doit nous être envoyée afin de laver la tache sanglante qui macule les plaines de la Somme !
|
|
J'ai encore aujourd'hui le plaisir de commencer ma journée avec vous. Ce matin nous sommes libres, encore étendu dans une couchette je vois la pluie qui obscurcit la lumière qui nous vient de ce beau jour. Je vais donc vous tracer ceci afin de vous l'expédier aujourd'hui.
|
|
Les boches nous ont envoyé quelques œufs de Pâques ce matin. Si c'était sur quelques jolies Parisiennes vous le liriez en grandes lettres... Mais nous, c'est notre destinée, alors rien de surprenant. Mais je n'ose me plaindre, si je pense aux milliers de malheureux qui sont concentrés sous la mitraille et passent la nuit dans la boue, sans avoir grand chose à manger sans doute. Mon cher Julien, ce doit être pire qu'en 1914. Et il ne serait pas surprenant que ce soit mon lot dans quelques jours.
Édouard y est-il déjà ? Son silence commence à m'inquiéter.
|
|
Hier, j'ai eu le plaisir de lire la lettre de votre Bregillotte. La naïve description de la première journée passée parmi vous est vraiment intéressante. L'avez-vous encore ? Le beau temps ne vous a sans doute pas permis de vous occuper beaucoup d'elle. Il me semble que vous devez déjà avoir bien avancé l'avoine ?
|
|
Chère maman vous ne m'avez pas fait part des suites et des commentaires qui ont eu lieu après notre marché. Il est vrai que le beau temps qui a régné depuis que je vous ai quitté et vos multiples occupations ne vous laissent pas beaucoup de loisir pour vous faire attention aux cancans !...
|
|
Je n'ai pas grande reconnaissance pour la photo (?). Comme toujours, l'éclat attire l'attention. Une belle tunique fantaisie attire la lumière de l'appareil. Suis-je à coté de vous par charité ? Ou suis-je là comme une violette : le symbole de la modestie ?...
|
|
Voici les permissionnaires qui rentrent. Ils ont du courage, allez. Je sais que Lanoix est revenu aussi, mais sa compagnie est encore aux P.P. Il trouvera sans doute le moyen de me faire parvenir mon colis. D'après les renseignements que j'ai reçu, j'ai réussi à faire placer un entourage sur la tombe d'Henri.
|
|
Plus qu'à vous embrasser tous comme je vous aime. Louis.
|
le 3 avril 1918
Mon cher Édouard,
|
Je viens de faire
une lettre de circonstance à ce cher Mr. Fourgeot qui, mieux que nos
dirigeants, sent la meurtrissure et l'angoisse de nos âmes !
|
|
Rien de
changé encore pour nous. Toute latitude pour jouir par
l'oubli, avec le fruit de l'heureuse Pâques que tu m'as
adressée. Merci et bons baisers de ton frère Louis.
|
le 10 avril 1918
Mes biens chers,
|
Chaque jour le communiqué est attendu avec une certaine curiosité d'autant plus animée qu'en ce que chaque intéressé y trouve plus ou moins d'intérêt personnel. Il n'en est pas de même à la distribution des lettres. Là, sous chaque enveloppe se trouvent des lignes personnelles, d'intimité ou d'intérêt. Aussi ce n'est plus par passe-temps ou par curiosité que l'on attend l'arrivée du vaguemestre mais avec une impatience fiévreuse dominée par des sentiments parfois impénétrables ! Il y en a qui ont le privilège d'avoir leur communiqué personnel chaque jour, quand le service est régulier. Moi, après huit jours de déception quotidienne, j'ai eu la joie d'avoir une petite carte-lettre hier. La vôtre du 5 chère maman, qui n'a mis que trois jours de voyage. Quand je dis : petite, je ne vous fais pas de reproche, je sais bien qu'en chauffant le four vous n'avez pas le loisir de tracer comme moi deux pages pour ne rien dire. Mais je suis sûr que vous préférez mon bavardage à quelques mots laconiques qui vous laisseraient dans l'anxiété. Et puis, je ne veux pas utiliser une feuille de papier à lettre pour vous dire : rien de nouveau à signaler ! c'est une formule de service.
|
|
Peut-être avec ce mauvais temps persistant aurez-vous plus de loisir pour me dire que votre cuisine est bien lavée, car il ne doit pas y avoir que les boyaux de l'Argonne qui regorgent d'eau ? Cela ne m'a pas beaucoup gêné. Mes quelques heures de service de nuit ne m'ont pas conduites dans de trop mauvais chemins, et puis, toujours dans la voie de l'amélioration, nous avons des imperméables !
|
|
En tout autre cas, je vous chargerais de faire part de mes condoléances à vos voisins. Mais puisque ce deuil est pour eux une délivrance désirée, leur doit-on des félicitations ? Je crois qu'il vaut mieux s'abstenir. Enfin, à l'occasion faites-lui part de mes salutations, et vous vous aurez mes affectueux baisers. Louis.
|
|
Léon Pastif me dit q'il est encore du coté de Verdun. Les Bregillottes ne m'ont pas récrit, qu'en avez-vous fait ?
|
le 11 avril 1918 19h
|
Moi qui suis le sujet de tant d'anxiété je continue à être tranquille et même privilégié ! Puisque j'ai eu le plaisir aujourd'hui de lire votre fertile et affectueuse lettre de dimanche soir. Avec mes tendres baisers ceci vous porte une part de la joie qu'elle m'a procurée. Louis.
|
le 13 avril 1918 18h
Chers aimés,
|
Me revoici sur la table d'un "Foyer du soldat". Le même que celui que j'ai quitté il y a bientôt deux mois pour aller vers vous !
|
|
Un ordre inattendu nous a amené ici ce matin, non loin de nos tranquilles tranchées après un séjour de dix-sept. Les bruits les plus contradictoires circulent à notre sujet. Nous sommes toujours sans affectation normale. Il ne serait pas surprenant que l'intercalement d'unités américaines vienne nous faire prendre une nouvelle formation, nous sommes dans l'attente d'ordres à ce sujet. En ces moments critiques cela fait vite. Mais j'ai ce soir encore le loisir d'être longuement avec vous. Peut-être que demain il ne me le serait pas permis.
|
|
Cette après-midi, j'ai reçu une carte d'Édouard, écrite depuis dimanche, elle ne soupçonne aucun changement le concernant. Le joli "Poisson" expédié de concert avec la Marie m'est arrivé en même temps, mais censuré ! Je viens d'apprendre que Lanoix était évacué pour les oreillons, le veinard, quinze ou trente jours d'hôpital en ce moment valent mieux que l'Alsace et la Belgique !
|
|
Dernièrement, Édouard me disait que lorsque l'on écrit pas souvent l'on perd le fil des idées ou des pensées. Cela est vrai. Mais il y a des exceptions, votre lettre de dimanche soir 7 le prouve chère maman. Je ne pouvais m'expliquer pourquoi, vous ne m'aviez pas reparlé des affaires importantes en cours lors de mon départ. Mais c'était pour mieux me renseigner à l'aide de documents précis. Les frais d'acte ne sont pas si élevés que j'aurais cru, c'est moins de dix pour cent. Je ne puis guère commenter d'ici cette grosse question familiale qui s'évanouit devant l'avenir personnel qui m'est réservé prochainement ! C'est avec joie que j'ai pris connaissance de ce que vous aviez fait : la vente des futaies, la réception des amis de Julien, qui furent ainsi que vous, victimes de leur imprévoyance. Vous allez sans doute me faire demain le lamentable emploi de votre temps par ce mauvais temps persistant. Mais encore une fois, ce n'est qu'un léger inconvénient, en comparaison des malheureux réfugiés, encore plus ahuris qu'en 1914 !
|
|
Nous avons aujourd'hui reçu nos étrennes. Vous savez que notre grand patron nous gratifie suivant nos mérites, mais avec de la monnaie puisée dans ses immenses gisements inépuisables !
|
|
Comme je ne puis pas percevoir mes timbres ici, ce n'est pas prudent que je conserve mon carnet. Je vais le confier à la poste. Quoi qu'il puisse m'arriver vous pourrez toujours le toucher, tôt ou tard.
|
|
J'espère que la poste marche mieux à présent. Le désarroi de ces temps derniers n'est plus si affable
(?), s'il existe encore, et que les pensées qui finissent cette feuille ne mettront pas trop de temps à vous parvenir.
|
|
Meilleurs baisers à tous. Louis.
|
le 17 avril 1918
Chers aimés,
|
Quel dommage chère maman, que vous ne veniez pas à Bezac plus souvent ! Il me semblerait que vous n'êtes pas éloignée de moi. Votre souvenir du Quai était déjà en ma possession hier. Mais là, vous étiez trop gênée pour entrer dans les confidences de votre voyage, et j'attends un supplément d'information. Est-ce que le train du soir ne marche plus, que vous avez dû coucher ?
|
|
Samedi soir, quand je vous faisais ma lettre, je ne vous soupçonnais guère en voyage en vous annonçant le mien. Vous me croyez déjà dans la fournaise sans doute. Eh ! bien il n'en est rien ! Dans le métier les manœuvres semblent être dans le but de nous déjouer. L'étape de dimanche ne nous a pas conduit trop loin. Je suis dans un camp connu, sans grande occupation en attendant les décisions de nos chefs. Je crois que nous sommes destinés à boucher les trous qui se font dans l'Ouest. Une fraction de mon régiment est déjà partie reconstituer le régiment de mon vieux copain Oudin. Il m'écrivait dernièrement qu'il attendait le choc, étant en liaison avec les Anglais.
|
|
Il parait que nous allons avoir avec nous les fameux Américains. Il y en a dans notre voisinage ! Mais ce sont les noirs affranchis que le sort replonge dans l'esclavage ! Ah ! ce sera comme chez nous, les rois du fer et de l'acier ne tiendront pas les tranchées !...
|
|
Le soleil porterait t'il le deuil de l'affreuse hécatombe actuelle ? Il continue à rester voilé, à votre grand regret sans doute. Que mes affectueuses pensées dissipent un peu votre mélancolie. Louis.
|
|
A mes tendres baisers à tous je joins ceux de ce cher Mr. Fourgeot que j'ai vu hier.
|
le 20 avril 1918
Chers aimés,
|
J'en suis à mon sixième jour d'inaction, pour ne pas dire d'oisiveté. Il est huit heures et je ne suis encore pas levé. C'est de la paresse, l'héritage fatal que lègue l'armée. Cependant la fraîcheur de ce jour me commande de rester enveloppé dans mes couvertures sous lesquelles j'ai les pieds chauds pour vous tracer ma lettre sur mes genoux. Le matin de ce jour m'offre une campagne du mois de décembre, d'un givre éclatant. C'était à prévoir après la journée d'hier avec ses giboulées et la pleine lune de cette nuit. 1918 aura une lune rousse désastreuse ! Désastre qui n'empêchera pas ceux que la bêtise humaine provoque. Ce repos que nous avons semblait être le prélude d'un grand assaut à supporter. Il n'en est rien pour ces temps-ci. Nous allons retrouver le secteur calme précédent, en compagnie des américains noirs. Situation enviable en ces temps.
|
|
Pour parfaire la complète tranquillité de ma situation présente j'ai des nouvelles nombreuses et fraîches de toute part.
Édouard s'obstine sans trop de regret à rendre inviolable son secteur de Lorraine. Les amies bisontines m'ont dépeint la journée d'il y a huit jours, avec l'arrivée des pommes de terre ! Détails mieux précisés par votre lettre de lundi chère maman, arrivée hier. Vous devez être navrés par ces contretemps, il me semble qu'il y aura beaucoup de dégâts ici, l'année a l'air avancée. Je pense aux gens de Gouhélans qui auront encore une année de déception. Mais vous ne remplirez pas beaucoup de tonneaux non plus. Mon pauvre Julien, pas de prétexte pour aller voir les filles Page ! Je vous vois remettre en mai les plantations de pommes de terre. Vous ne m'avez pas dit chère maman, pas plus qu'Henri, si vous aviez fait de dressage de bœufs ou d'étalon ?
|
|
Vous vous proposez d'aller faire l'huile vers "José", ce qui me rappelle cet attirant Munans ! Mais hier j'avais une bonne lettre de Marie, pour me remercier encore de que j'ai pu faire pour Henri. Elle a enfin reçu quelques effets personnels ainsi que la médaille militaire. Elle a toujours l'air aussi inconsolable ! Je n'ai plus eu de nouvelles de nos amis de Somme-Suippes. Peut-être supposent-ils qu'il n'y a plus de moyen de correspondre avec moi. L'heure de la soupe va approcher, je vais cacheter ma lettre en vous souhaitant bon voyage si vous allez à Fontaine demain, où mes affectueuses pensée vous suivront, avec les tendre baisers à tous. Votre Louis.
|
le 25 avril 1918
Chers aimés,
|
Hommes 40. Chevaux 18.
|
|
Cette inscription, si longtemps indifférente mais si bien justifiée voilà quatre ans, m'a fait subir toutes les horreurs de son application hier. Sous une pluie battante une marche de dix kilomètres ne réussit pas à me mouiller autant que la charge à transporter !
Écumant de sueur sous des effets trempés d'eau, j'occupais 1/40 de place d'un wagon pendant douze heures. En partance d'une petite gare champenoise, j'ignorais la direction que je prendrais. Même pas moyen de s'orienter par un temps aussi brumeux. L'engourdissement physique joint à un abrutissement moral me plongèrent dans une demi léthargie que le signal "halte-là" du clairon de service vint secouer ce matin à une heure ! "Tout le monde descend". Trois kilomètres de marche avec huit courroies sur la poitrine suffirent pour mouiller encore une fois la peau, et pour m'amener dans un petit village où il me fut permis de m'allonger un peu sur des fanes de haricots dans une grange. Ici, pas de blessures de guerre aux maisons comme je suis habitué d'en voir. Mais il parait que nous sommes dans la Meuse, non loin de Bar-le-Duc ! Je croyais débarquer quelque part de l'autre coté de Paris ! N'importe, je m'endors du sommeil du juste. A mon réveil à neuf heures, une petite rivière m'appelle à faire un peu de toilette. Il parait que c'est l'Onain ! Me voici donc à vous tracer ces lignes en attendant d'être affecté dans un nouveau régiment, afin de boucher les trous d'une division d'infanterie qui sort de fournaise. Peut-être que demain je vous donnerai ma nouvelle adresse. Aujourd'hui je vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
|
Hier sur le quai d'embarquement l'on m'a remis votre lettre de vendredi 19. En même temps qu'un mot d'Édouard ! Nous sommes encore bien éloignés l'un de l'autre.
|
le 26 avril 1918
Chers aimés,
|
C'est aujourd'hui, par une longue étape, que je viens d'arriver dans mon nouveau régiment. Nous sommes les bienvenus, quatorze jours de bataille dans l'Ouest ont creusé bien des vides.
|
|
Nous sommes tous disloqués dans différentes compagnies. De ce fait nous allons être privés de correspondance quelques jours, si elles ne sont pas perdues. C'est pour atténuer cette privation que je m'empresse de vous envoyer mon adresse suite à ma lettre d'hier.
|
|
A part la fatigue, je n'appréhende rien de fâcheux dans ma nouvelle situation, pour l'instant du moins. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
|
165ème d'infanterie, 1ère compagnie, P.P. 129.
|
le 28 avril 1918
Chers aimés,
|
Chère maman, qu'allez-vous me dire par ce dimanche de fin avril qui ne fera pas exception à cette interminable série de jours sombres ? Je ne suis pas prêt de le savoir. Vous allez encore vous adresser au 336 où je n'existe plus. Je change plus souvent d'adresse que de métier ! Malgré un régiment nouveau, des nouveaux chefs, de nouvelles figures, de petites habitudes de détails changées, l'ensemble est toujours basé sur les règlements que je connais
voilà douze ans ! Tout le Bataillon est disséminé dans deux régiments parmi les rescapés de la grande bataille. Ma nouvelle division d'infanterie prit part aux premiers jours de l'attaque. Les récits épiques de ceux qui y ont pris part laissent une autre impression que ceux que vous reproduisent les journaux. Mon cher Julien, tes exploits vieux de quatre ans pâlissent devant l'horreur des procédés actuels d'attaque : l'intoxication a atteint tout le monde jusqu'au Colonel, au moins dix fois plus d'artillerie grâce à laquelle avance le flot boche, que l'on ne peut endiguer que jusqu'à épuisement des munitions. Peut-être vas-tu soupçonner en lisant mes lignes un excès de mon esprit pessimiste ? Mais je suis sûr qu'à présent les Parisiens doivent évoluer en ce qui concerne leur opinion sur la formidable et kolossal puissance boche.
|
|
J'ai suivi mon chef de section, un jeune lieutenant corse, ainsi que quelques camarades. J'ai envoyé une carte à Lanoix, à Luxiol, qui, s'il rejoint sa compagnie ira au 141ème.
|
|
Je ne veux pas recommencer une autre feuille, ce sera pour plus tard si je remonte aux tranchées comme il en est déjà question. Mon changement retardera peut-être l'échéance fatale qui doit me livrer dans la fournaise ! Dans cette petite satisfaction, je viens tous vous embrasser comme je vous aime. Louis.
|
le 2 mai 1918 9h
Chers aimés,
|
Vingt-quatre heures de voyage à pied ou en chemin de fer viennent de m'amener dans le secteur immortel complètement éreinté.
|
|
Nous montons en ligne ce soir, mais avant de me reposer je veux essayer de vous faire parvenir ceci. Je ne veux pas que vous soyez aussi abandonnés que moi. Vos dernières nouvelles vont avoir demain quinze jours. Des êtres nés pour une destination comme la notre n'ont pas besoin de tant d'attention. Aussi le vaguemestre attendra t'il qu'il ne vienne plus rien à l'adresse du 334, pour n'avoir qu'une seule recherche à faire. Ah ! si j'étais déserteur, je serai plutôt retrouvé !...
|
|
Je vous gribouille ceci à l'entrée de notre abri, assis dans un trou d'obus. Le spectacle qu'offre la nature ici est impossible à décrire. C'est un souvenir qui date de la lutte féroce d'il y a deux ans. Les trous d'obus sont aussi nombreux que ceux que vous faites dans vos champs pour planter vos pommes de terre !
|
|
Dans les bois, les arbres sont comme des squelettes lugubres en cette époque parce qu'insensibles au réveil de la nature.
|
|
Que me réserve cette terre qui recouvre tant d'ossements humains ? Je crois qu'elle me fera meilleur accueil qu'en août dernier, cette fois je connaîtrai la rive opposée. Ce matin au petit jour, j'ai passé non loin de la tombe d'Octave. Quand je le pourrai je lui porterai un bouquet.
|
|
Je vous quitte par un beau soleil qui en même temps qu'il diminuera l'épaisseur de boue dans mes boyaux va vous aider à travailler demain, car aujourd'hui vous aurez assez à faire de rapporter le papier représentant vos vieux "Boulo"
(?) !... Mais je réclame les étrennes car il était difficile à conduire à la bascule, il y a six ans. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
le 5 mai 1918 8h
Chers aimés,
|
Ma feuille hebdomadaire ne peut encore vous donner aucune réponse puisque je reste isolé du monde ! Des copains plus favorisés ont déjà des enveloppes à la nouvelle adresse. Chaque distribution ajoute une déception de plus à ma silencieuse anxiété.
|
|
Un coup d'œil sur le terrain qui m'environne semble expliquer l'abandon où je semble plongé. Ces quelques jours de beau que nous venons d'avoir furent le signal de l'envolée des aviateurs, tandis que pour moi c'était le signe d'un enfouissement souterrain où la fraîcheur saisit d'autant mieux que le soleil est ardent à l'orifice. Mais ce matin la pluie tombe avec cette odeur d'escargot et de mousseron qui me transporte en pensée aux Vignottes ou à la Citadelle !... Mais en réalité j'occupe une casemate voisine de celle qui fut la gloire et le sauveur de l'héroïque défenseur du Fort de Vaux. Peut-être avez-vous lu dernièrement son rapatriement. Je n'ambitionne pas son renom immortel mais seulement la faveur de son petit chien qui ne l'a pas encore quitté, même en captivité.
|
|
J'ai fait le tour des ruines du Fort encore occupé, et qu'une grêle cent fois répétée de 420 n'a pu enfoncer. Mais tout le coteau qui le porte ainsi que les voisins semblent être le fruit d'une récente irruption volcanique, à la terre stérile, où tout ce qui emporte le matériel de guerre s'y rencontre déchiqueté. Ose t'on penser que pendant quatre mois des êtres ont vécus sous un pareil cataclysme ? De nombreuses petites croix marquent l'emplacement présumé de débris humains. Ceux-là sont des privilégiés ! Combien n'ont pas même eu la "Croix de bois" comme nous disons vulgairement ? Il n'est pas rare en nettoyant les boyaux de sortit par un coup de pioche un bras, une jambe mélangé à de la ferraille ! Ma description est peut-être déplacée, mais elle n'est pas exagérée. La vision de ces lieux permet de se demander quel génie infernal peut animer des êtres humains capables d'ourdir et d'exécuter un aussi exécrable travail. Que d'horreurs se cachent sous ce mot de guerre !
|
|
Voilà le milieu où le sort m'a jeté pour l'instant. Mon service n'est pas pénible. Je ne suis pas cette fois en P.P., mais section de réserve, ce sera pour dans quelques jours. Pour l'instant le secteur est assez calme, quelques coups de main peuvent être à redouter mais je ne crois pas que l'ennemi recommence l'assaut de cette terre qui lui coûte si cher? Ces jours derniers, par ce beau temps, ses grosses batteries ont arrosé les forts et les P.P. où nous avons eu hier quatre victimes à la compagnie. Des camarades encore inconnus, mais d'une jeunesse regrettable, renfort de la classe 18. Pauvres gosses, au bout de deux jours de tranchées !
|
|
Il ne m'est guère possible de trouver quelque chose pour vous laisser sous une bonne impression. Pas de Coopé, pas de pinard, pas de journaux, pas de lettres. Mais puisque ces privations s'expliquent par une affectation nouvelle et trop rapide, j'espère en une prompte réparation et me console en pensant que je pourrais être plus mal et aussi en vous embrassant tous tendrement. Louis.
|
le 6 mai 1918 8h
Chers aimés,
|
Afin de dissiper un peu la mélancolie transpirant dans ma lettre de hier, je lance ces quelques lignes à sa suite.
|
|
C'est que mon état d'âme a évolué par la lecture de votre bonne lettre du 30 chère maman, malgré sa teneur remplie d'indignation !... Je ne sais quand j'aurai connaissance de ce que vous aurez pu me dire durant quinze jours.
|
|
Rien de plus pour ne pas ternir les bonnes dispositions dans lesquelles je vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
le 8 mai 1918 6h
Chers aimés,
|
Malgré l'heure matinale il y a longtemps que je suis levé. Vous ne serez pas surpris puisque vous savez que "les braves n'ont pas d'heure". Vous n'ignorez pas que cet épithète ne s'adresse pas à moi. Cependant je peux qualifier acte de bravoure l'énergie qu'il m'a fallu hier soir pour venir dans mon gourbi. Je crois vous avoir dit que j'étais en section de réserve. Nous sommes occupés principalement la nuit venue au nettoyage des boyaux ou au transport du matériel et des munitions là où les voitures ne peuvent aller. En un mot : homme de peine. Dieu seul connaît toutes celles que je supporte ! Donc, hier soir, ayant encore des kilomètres de boyaux à parcourir, un orage épouvantable remplit les boyaux de deux pieds d'eau, tout en ne nous permettant de nous guider qu'à tâtons ou à la faveur des éclairs. Vous n'aurez pas de peine à imaginer l'état dans lequel je me suis couché. Je me suis contenté de remplacer ma chemise, n'ayant qu'un seul caleçon. La charge de cartouches ne me permet pas de porter mon rechange de linge. Mon sac est à Verdun au magasin. J'étais presque impatient de continuer une corvée ce matin à trois heures et demie pour me déraidir et me sécher. C'est donc un peu potable que je fais cette lettre en rentrant, après le jus, le casse-croûte (fromage) et la niole. Mon nouveau régiment ne me laissera pas mourir de faim. Tout ce bavardage qui pourrait se résumer sur une carte par la banale formule : je vais bien !
|
|
Mon Henri, tes lignes toujours affectueuses, parfois intéressantes, n'ont pas le don d'aller vite. Ta dramatique carte du 20 avril est enfin venue me faire comprendre un passage de la lettre de maman du 1er mai et son sens indigné. Allez-vous prendre exemple sur mon parrain ? Ce serait plutôt mon rôle ! Cela ferait le sujet d'une grande lettre, et j'ai coupé ma feuille...
|
|
Les dernières nouvelles d'Édouard pressentaient son acheminement vers la bataille. Mon changement prolonge mon incertitude sur sa situation. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
le 11 mai 1918
Chers aimés,
|
Il est sept heures. Debout depuis trois heures tout le monde est libre après avoir pris le jus et le casse-croûte (fromage, sans oublier la gniole, espèce de rhum réconfortant qui est réglementaire pour chasser l'insomnie due aux interminables veillées des A.P.). Tout le monde ai-je dit est libre, et une grande partie "roupille" avec sécurité sous dix à douze mètres de terre. Nous sommes dans une casemate d'avant guerre. Cependant il y a toujours quelqu'un qui veille, principalement pour les attaques aux gaz, ce cruel et invisible ennemi qu'un barrage subit peut déclancher inopinément. Oui mais je suis là, le masque prêt à mettre et prêt à prévenir les copains qui me confient la garde de leur existence en toute confiance ! Cependant depuis ma douche de l'autre jour, je dois être à mon quatrième matin d'un brouillard intense, on ne s'apercevra pas du printemps cette année, et puisqu'à quelque chose malheur est bon, je n'ai pas grand danger à craindre un bombardement. Je peux donc sans trop enfreindre les règles du service prendre mon papier à lettres et tracer ces lignes sur une caisse à grenades. Qui sait si demain je pourrai le faire ? Ce soir nous allons relever les copains qui sont en ligne
voilà neuf jours. Voilà longtemps que je ne connais pas les longues factions au P.P., depuis février c'est calme et les nuits sont courtes, j'espère que cela ira.
|
|
Chère maman j'ai eu hier soir à sept heures votre lettre écrite dimanche où vous me faites le plaisir de me rappeler mes jours d'innocente jeunesse en guise de porte-bonheur, en ce 1er mai. Je vois Julien avec son petit sourire d'orgueil rapportant ses trois cents balles ! Mais les temps actuels lui empêchaient d'égaler le bonheur qui nous fit prendre le chemin des écoliers en revenant de Clerval, vous rappelez-vous chère maman ? Et puis l'objet de sa fierté ne valait pas grand cou du "Picotte", à plus forte raison le modèle de la Rosette, le "Raincy". Mon cher si tu avais eu autant de kilos que nous, tu aurais joint un billet de trois cents à ton tas !
Ça va te ramener la tête en avant, çà, hein ! Mais pas tant que la mienne qui ce soir fera le bout d'un arc sous la charge et la boue !
|
|
Le papier est cher, je déchire mes feuilles trop grandes sans pouvoir commenter le restant de votre lettre que je ne comprends qu'à moitié. Le 334 garde ce que vous aviez d'intéressant à me dire. Avec le temps je crois tout connaître. J'ai eu de vieilles cartes du Quai, ainsi que d'Édouard en date du 30 avril. Mais depuis où est-il ? Je n'ai encore rien de lui à ma nouvelle adresse ? Si je réserve une aussi petite place pour mes baisers, ils n'en sont que tant plus meilleurs. Louis.
|
le 15 mai 1918 8h
|
Un soleil de plomb m'accable dans l'encoignure de la tranchée où je suis blotti. Dois-je le repousser, cet astre bienfaisant qui va un peu sécher la boue où je suis forcé de croupir et qui va vous permettre de planter enfin quelques pommes de terre ? Il ne m'est guère possible d'aller à l'ombre ici, l'herbe même ne pousse plus. Là-bas au loin, où sont dissimulées les batteries boches les quelques arbres qui restent lancent lamentablement leurs branches mortes vers le ciel. Donc, je supporte le soleil réchauffant le casque et qui les mois prochains me brûlera les oreilles. Il ne faut pas que ma tête dépasse le parapet de la tranchée, une "saucisse" boche d'en face observe et si quelques mouvements ou rassemblements étaient signalé, les gros obus pourraient retourner ce qui reste des batteries devant Damloup, pour la centième fois peut-être !...
|
|
Cette mince feuille ne va pas me permettre d'être bien longtemps avec vous aujourd'hui mais puisque vous n'avez pas le temps de vous occuper longuement avec moi je vous envoie ceci en échange des secrètes pensées qui m'arrivent depuis quelque champ du "Bas de la fin". Et puis avons-nous encore du beau temps pour quelques jours ? Ce matin, il y avait une fraîcheur qui me glaçait les pieds, immobilisés pendant quatre heures dans mon trou.
|
|
Mes vieilles correspondantes ne me parlent pas de la réception de mon carnet de pécule. M'a-t-on soustrait mes timbres ?
(illisible) vous embrasse. Louis.
|
le 22 mai 1918
Chers aimés,
|
Il est huit heures. Je viens d'être relevé de mon poste de guet. Ce n'est guère la peine que j'aille m'étendre sur ma couchette. D'ailleurs nos cagnias ne sont guère hygiéniques par ces beaux jours. La fraîcheur saisit quand on entre dedans et puis comme parfum une repoussante odeur laissée par la trace des souris qui pullulent, ainsi que les rats. Seulement l'instinct de conservation nous fait aimer cette demeure où l'on croit pouvoir reposer en sécurité. Presque tous les copains dorment, juste dehors, le service de surveillance nécessaire. C'est que nous sommes des êtres presque exclusivement nocturnes. Les nuits courtes d'à présent nous occupent sans répit, travail ou garde, d'où le besoin urgent de dormir le jour. Je ne sais si mes paupières alourdies vont me permettre de tracer ces grandes feuilles que je vous destine. Me voici dans l'encoignure de la tranchée, à l'abri du soleil et surtout masqué de la vue des "saucisses" boches. Je suis bien tranquille, seuls quelques coups de canon au loin ou quelques bruits de moteurs aériens.
|
|
Je vous ai déjà décrit le décor qui m'entourait et qui finira par me laisser un souvenir de ce mois de mai qui va couronner mon trente-troisième anniversaire ! Il aura ceci de caractéristique en ce qu'il va me priver de la vue ou du contact immédiat de la verte parure naturelle que donne ce beau soleil. N'avoir à respirer que l'air chaud de la tranchée et le contact de la boue durcie me fait regretter le plaisir de vivre en cette époque. Ce n'est sans doute pas pour calmer cette nostalgie qu'on nous a emmené cette nuit à la campagne. Mais j'ai éprouvé un plaisir à passer une partie de la nuit couché dans les hautes herbes. Je précise : nos postions dominantes et le terrain marécageux des parties basses ont fait reculer les boches assez loin de nous, plus d'un kilomètre par endroit, aussi rien à craindre des engins de tranchées ou même des coups de mains, en face de nous s'entend. Mais les Français ne peuvent pas rester inactifs. Aussi toutes les nuits il y a des patrouilles qui sortent. Ce fut mon tour hier soir. Il reviendra souvent avec mon nouveau régiment. Nous voilà donc partis explorer les ruines du célèbre petit village d'en face où pas une hutte à porcs ne subsiste. Les orties, les chardons y trouvent un prodigieux développement, je vous envoie une tige d'anis qui m'est tombée sous la main. Dans deux ans les traces des ruines disparaîtront sous la verdure. Cela me rappelle le sort du pays le plus arriéré de la terre, la Macédoine actuelle ! Pauvre France ! C'est ainsi qu'un peu plus loin je mis en batterie mon fusil-mitrailleur, couché dans les chardons, sur les pentes d'un trou d'obus. Trois ou quatre heures j'attendis le "fauve" qui ne sortit pas de son repaire ! Pas si bête, il attend que son naïf ennemi s'enhardisse, jusqu'à ce qu'il soit à portée d'un coup de sa griffe. Quelques victimes payeront la gaffe qui subira un temps d'arrêt jusqu'à ce que les Dieux du jour en condamne un autre !... Voilà le résultat que j'en déduis. Cependant quand la lune se fut couchée, je rentrai poursuivi par le petit jour, content d'avoir goûté un peu des merveilles du mois de mai !
|
|
Vous tous chers aimés qui vivez parmi ces merveilles sans vous en rendre compte, allez-vous trouver que j'use beaucoup de papier pour ne rien dire ou que je la
(?) perds ? Pas tout à fait ! Mais je ne suis plus le même. Vous dire ce que je suis n'est pas commode à expliquer. Vous le comprendrez par cette petite description. C'est le résultat de ces nuits entières passées dans la crainte, le découragement, le souvenir qui forme toute une confusion d'idées, de réflexion, et que j'aime écrire quand j'ai la sérénité d'âme comme aujourd'hui. Certain que vous ferez bon accueil à cette lettre banale je n'ai plus qu'à la compléter par mes affectueux baisers. Louis.
|
|
Les sujets ne me manqueraient pas pour développer encore de nombreuses pages. Soit sur
Édouard dont la poste retient les envois, soit sur vos occupations que je devine, soit sur la "calèche", soit sur mon jambon que j'ai mangé crû, soit sur la saucisse qui sera meilleure, non, toute la journée de suffirait pas. En attendant contentez-vous de ceci, qui n'est qu'un échantillon des pensées de votre Louis. Mes amitiés à Georges qui m'a écrit. Ainsi que mes vœux de bonne santé pour sa Dédée.
|
le 26 mai 1918
Chers aimés,
|
Je peux encore commencer mon dimanche avec vous ! Quels dimanches de mai ! Parmi les innombrables trous d'obus qui, plus on les connaît, plus on y découvre de choses horribles. Sans se déranger le long des pistes ou sentiers, il est facile de reconstituer un squelette humain ! Souvent, une jambe se trouve encore enveloppée dans une bande molletière, indique un Français, si elle est dans une botte, on dit : tiens, voilà un Boche. Un autre a encore le sac au dos. Pauvres mères ou épouses, vous pouvez attendre les disparus ! Chose plus horrible encore : des hommes sans nom cherchent et trouvent quelques pièces d'argent là où est marqué l'emplacement de la poche de ces malheureux ! Oh ! le beau champ d'honneur ! Par endroit, le mois de mai réveille quelques énormes chardons, parure de l'immense Nécropole. Mon régiment y a laissé sa part il y a deux ans et dernièrement encore dans le charnier actuel. Moi qui ai hérité du numéro, il parait que je vais être obligé de porter à la place de ces squelettes ce que la fourberie humaine appelle la gloire ou l'honneur réservé aux braves ! Braves, ils sont plus que des Martyrs, car ceux- ci, s'ils acceptaient les supplices et la mort, avaient au moins un idéal : la foi. Tandis que parmi ceux d'aujourd'hui, si quelques-uns ont la foi, c'est dans l'espérance d'une vie meilleure, mais pas dans la cause pour laquelle ils sont immolés ! Je m'égare un peu, je voulais vous dire que nous allions avoir la Fourragère, honneur qui ne m'encourage guère, c'est pour cela qu'il me faut passer le mois de mai avec trois heures de sommeil sur vingt-quatre heures. Je commence par fatiguer, j'ai mal aux yeux. J'ai quitté les P.P. hier matin pour venir en réserve deux kilomètres en arrière, dans le même casemate que j'étais précédemment, mais corvées, travaux presque toute la nuit ; il est six heures, il faut aller aux cuisines jusqu'à dix heures, on m'appelle déjà, j'en ferai le moins possible, mais pas de repos ni de liberté. Passe encore pour les petits Normands de la classe 18, mais pour moi, j'en ai au dessus des épaules. J'ai plus fait de travail ici dans un mois que dans les six précédents ! Nous allons avoir mon ancien Colonel, peut-être cela changera t'il ?
|
|
Je ne croyais pas vous faire ainsi une lettre et vais vous quitter dans la consolante pensée de ce que je pourrais être, là-bas, au milieu des gaz ou de la grêle de fer et de feu. Cette horrible perspective me permet de vous embrasser avec un calme convenable. J'ai eu ma lettre de lundi à son jour, c'est-à-dire vendredi, chère maman, j'attends une suite intéressante. Louis.
|
le 29 mai 1918
Chers aimés,
|
Maman ! C'est un nom dont la douceur est infinie et l'homme reste jeune même lorsque les années passent, tant qu'il a le doit, tant qu'il a la joie de dire à un être vivant : Maman ! Ce passage littéraire qui m'est tombé dernièrement sous les yeux semble comme une invite pour amener un peu de cette joie, pour fêter mon trente-troisième anniversaire. N'est-il pas de circonstance ? et ne dois-je pas offrir une partie de cette joie à celle de qui je la tiens, puisque cette faveur m'est permise ? Et puis, n'êtes-vous pas, chère maman, l'unique être sur la terre qui j'en suis sûr évoquera aujourd'hui ce souvenir que moi-même j'ignore, vieux de trente-trois ans ?
|
|
La guerre ! Cette grande éducatrice, comme elle est parfois qualifiée ! Ce titre est parfois applicable, allez-vous penser de certaines de mes lettres. Je m'en rends compte moi-même par l'évolution que je remarque. Simplement les grandes rêveries, la réflexion inévitable par des nuits entières de veille permettent l'expression de sentiments que votre vie absorbée par le maximum de vos forces physiques ne permet pas. Quand donc mes occupations ne me permettront-elles plus ces rêveries de poètes pour lesquelles je ne suis pas né ?
|
|
N'est-il pas préférable que je vous entretienne de conversation banale que de lugubres récits qui feront augmenter l'anxiété dictée par votre affection, surtout quand le communiqué vous précise les régions qui m'intéressent. Le bombardement intense en date de ce jour m'a seulement obligé de rentrer cette nuit à minuit, avec le masque aveuglant que j'ai gardé jusqu'à trois heures du matin. Ce n'est rien, je crois que nous n'avons que des diversions pour échelonner le plus possible nos forces disponibles. Il n'en est pas de même partout. Allons-nous avoir des évènements décisifs ? J'en doute encore, si ce n'est à part les victimes.
Comme les beaux jours d'à présent font regretter et ressortir le charme de vivre en cette saison. Charme qui semble n'être le lot que de quelques privilégiés !
|
|
Comme la verdure doit recouvrir le sol à présent, en vous donnant en même temps pas mal de travail. Pourvu que ce travail ne vous absorbe pas trop et vous permette de consacrer quelques instant à celui qui a tant besoin de distractions et qui vous embrasse tous comme il vous aime. Louis.
|
|
J'ai une carte d'Édouard du 20.
|
Pentecôte 1918
Chers aimés,
|
Jeudi, sans que je sois trop surpris, l'on me remet mon petit colis et le montant de mon mandat. Avec plus d'impatience j'attendis ce Vendredi pour avoir ma causerie du dimanche qui ne devait pas manquer. Ce fut en vain. Avec une petite moue mélancolique il me fallut ajourner le plaisir habituel à vingt-quatre heures plus tard. En effet ce retard s'expliqua nettement avec une aussi volumineuse enveloppe dans des boyaux aussi étroits.
|
|
Chère maman, j'ai l'âme un peu en fleurs pour ce charmant jour de fête. Vous aurez semé un peu de cette luxuriante végétation qui orne votre paradis terrestre en devinant l'aridité de la terre brûlée par les obus, de la boue durcie par ce soleil retrouvé qui forment le décor du purgatoire prématuré qu'il me faut subir ! En reconnaissance vous aurez la satisfaction de penser que je suis de cœur avec vous pour la petite fête de famille que vous avez en projet, et que ce cœur là ne sera pas voilé d'un crêpe, comme tant d'autres hélas le sont !
|
|
Chère maman, combien me faudrait-il de feuilles pour commenter vos six pages ? Il me semble superflu, déplacé même de raviver le sens des soumissions auxquelles vous êtes soumis. Vous aimez me les exposer, comme moi-même je le fais en ce qui me concerne. Et, curieux phénomène de notre nature, nous aimons, nous sommes avides d'apprendre ces confidences qui ne peuvent que nous attrister. C'est qu'elles vont directement blesser une âme aimante. C'est cet amour qui nous donne la force et l'espoir de supporter toutes nos épreuves. Ce sont ces épreuves qui vos attristent ainsi que ceux qui vous entourent, chère maman, qui vous donnent l'énergie de vos soixante ans !
Énergie qui parfois défend le désespoir d'envahir mon existence de trente-trois années ! J'aborde un sujet qui se comprend mieux qu'il ne s'explique : "Fiat voluntas tuas" me disait ce résigné d'Édouard l'autre jour.
|
|
En date du 8 j'ai de lui une carte de Normandie, il n'y a pas d'illusion à se faire, il marche vers la fournaise ! A-t-il comme moi la cruauté de vous l'avouer ? Cette perspective me laisse très inquiet pour passer mes longues nuits calmes. Cette dernière m'appesantit les paupières qui se ferment, mais n'empêchent pas mes affectueux baisers d'aller jusqu'à vous. Louis.
|
le 2 juin 1918
Chers aimés,
|
Voici la troisième lettre que je vous trace sans rien avoir reçu de vous.
|
|
Ma grande lettre hebdomadaire devait venir hier, mais pas de courrier ! Peut-être sera-ce pour ce soir. Cependant j'ai eu vendredi une lettre de Munans et même une carte Bisontine de mardi, pourquoi n'aurais-je pas la vôtre, chère maman ? Je ne veux pas sanctifier ce dimanche sans vous adresser cette feuille puisqu'il me l'est encore permis ! Je m'épouvante à l'avance quand viendront les jours qui me priveront de cette douceur, et de l'isolement qui me privera des vôtres. Ce pauvre
Édouard doit comme à moi vous en fournir l'exemple : sa dernière carte est du 20. Les récents événements ne sont pas de nature à donner grand espoir à ce sujet, mais à nous résigner à une grande patience ! Pour moi, rien n'est encore de nature à donner grande inquiétude. Au lieu d'une relève après un mois de tranchée, aurons-nous sans doute une reprise de P.P. jusqu'à nouvel ordre. A l'heure présente, ce serait téméraire de se prononcer avec certitude sur les jours prochains !
|
|
Mon camarade d'Amathay, Vésigneux, vient de rentrer de perm (il devait y être à Pâques !...), me remettait un billet de cinq francs. D'après mes causeries, il a fait connaissance avec Louis de Munans en allant faire signer sa permission. Il dépend de sa brigade. Vu la vie chère, la solde de gendarme et la nature de mon cher cousin, je ne puis commenter ce geste d'affection !... Pas plus que l'énormité des événements en cours.
|
|
Je désire qu'au plus tôt mes affectueux baisers à tous aillent diminuer votre inquiétude légitime. Louis.
|
le 3 juin 1918
|
Je complète ma feuille de hier par cette petite carte. La distribution du soir m'a fourni une multitude d'idées qui furent un baume réconfortant. J'en ai déduit que j'avais été gâté huit jours auparavant par la concentration d'affections puisées à des sources différentes. D'abord votre grande lettre habituelle chère maman, qui ne demande ni éloge ni remerciement, écrite en même temps qu'une autre, symbole de la plus pure union fraternelle. Qu'il est heureux ce pauvre de se placer en dessus de ce qui est l'invincible tourment perpétuel de la pauvre humanité. Où est-il à présent, lui qui d'une âme sereine envisageait tout ce qui se joue de dramatique à cette heure ? Minutes angoissantes, n'ayez pas une trop terrible réalité !...
|
|
Je vous avais dit avoir une lettre de Munans, de ce même jour 27 mai, j'avais aussi une petite lettre de Marcellin de L. Toute cette aubaine me dicte le plaisir de vous
(illisible) embrassant.
|
le 5 juin 1918
Chers aimés,
|
Je viens au matin de ce superbe jour de juin me réjouir avec vous de l'heureuse aubaine qui arrive à
Édouard. Hier soir j'apprenais son affectation à la Compagnie de Dépôt. Inutile de souligner l'importance qu'il y a de rentrer dans une formation à l'arrière, en ces heures critiques. Ce fut pour moi, comme pour vous, le soulagement d'une inquiétude justifiée, en regard des multiples dangers parmi lesquels je le croyais exposé. Hier matin je lui avais destiné quelques lignes empreintes d'un sentiment d'adieu, justifié par l'adresse de l'expéditeur, comme si cette lettre devait subir le sort de tant d'autres !
|
|
Lui qui acceptait et envisageait d'une âme sereine toutes les horreurs de l'horrible carnage pour lequel il se préparait ! Que nous ne savons guère la façon dont notre destinée est tracée ! Nous ne pouvons pas chanter victoire, mais remercier Dieu de cette grâce momentanée en lui demandant la force d'affronter les épreuves futures, puisque notre destin n'est qu'une série successive d'espérance et de déception, en un mot : la lutte pour la vie !
|
|
Je vais lui destiner la moitié de cette feuille, puisque je n'ai pas le temps de vous remplir quatre pages avant l'heure de ma faction.
|
|
Je réoccupe le P.P. que j'avais quitté dix jours auparavant. Je ne pense pas être inquiété plus que précédemment. Malgré la vie rustique qui m'est imposée outre mesure, je n'ai lieu que me réjouir d'être désigné pour la surveillance d'un point stratégique important, ce qui me retiendra sans doute davantage qu'ailleurs. Situation appréciable pour l'heure, je m'en console avec vous, ce qui me permet aujourd'hui un heureux baiser à tous. Louis.
|
le 9 juin 1918
Chers aimés,
|
Malgré ma nuit blanche, comme toutes les autres, j'ai quatre heures de guet à assumer. Le temps de faire les repas, de faire un peu de toilette, d'être à sa correspondance pendant la journée, et ne va bientôt plus nous être permis de dormir. Eh ! bien Messieurs les huiles, j'écrirai en dépit du règlement puisque vous ne voulez plus nous donner une minute de répit !...
|
|
Je croyais que cette nostalgie du service allait perdre de sa fureur. Mais elle augmente toujours pendant cet interminable séjour aux A.P., la fourragère de nos officiers l'indique. Nous ne sommes encore pas affublés de cet embarras, mais cela ne doit pas tarder maintenant que c'est officiel. L'honneur de cet insigne nous a valu deux quarts de vin !... Que n'obtiendrait-on pas avec du vin ? A ce prix on achète bien des consciences.
|
|
Je vais essayer de me placer plus haut que cet esprit de contradiction, de révolte, qui m'oblige à prendre mon crayon pour vous tracer ma lettre étant en sentinelle. Les sentiments qui m'animent pour être avec vous en ce dimanche surmontent ces petites misères qui ne sont qu'une poussière sortant de l'ensemble qui nous accable ou nous menace. Le malheur unit. Cela devient de plus en plus évident. Pourrions-nous supporter un poids pareil si nous avions encore à combattre l'horreur d'une lutte intestine ? Mais quel réconfort dans vos sublimes lettres, chère maman, qui se trouvent remplies pour n'avoir rien dit, dites-vous ! Il n'y a rien en effet pour la multitude d'indifférents à l'esprit superficiel. Moi-même, je ne suis pas compétent pour en déduire tous les sentiments qui peuvent se dégager d'une inspiration maternelle ! Mais qu'importe, j'en ressens tous les bienfaits. A tel point que ces souffrances physiques deviennent pour moi un malaise enfantin.
|
|
Je l'aie eue à son jour, c'est-à-dire vendredi, votre estimée de lundi. Il me semble que même les grands travaux ne vont pas me priver de ces gâteries auxquelles vous m'avez habituées, chère maman. Cet interminable soleil va vous donner des instants disponibles. Il y a quinze jours que la Marie de Munans me parlait déjà de foins. Et je te vois aujourd'hui mon cher Henri, ne pas du tout avoir une pensée de pitié pour la pauvre humanité, étant complètement absorbé par les derniers coups d'œil ou les tours de clef à donner à la "Deering" qui glissera sans peine demain sur la terre durcie. Je crois que c'est le moment d'avoir des couvreurs et de placer les chaînaux au prix de revient fabuleux !
|
|
Je croyais que vous vouliez me reparler de la tante, chère maman ? Et encore de ce qu'était devenu mon carnet à pécule que je vous avais adressé il y a longtemps. Ne l'auriez-vous pas reçu ? Tous les copains ont un avis de réception. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer de l'argent, je suis suffisamment pourvu encore pour l'instant. Nous sommes à peu près approvisionné. Nous pouvons avoir du vin à un sou, j'ai acheté hier un fromage pas trop mauvais, et pour l'ordinaire, sans être raffiné, ne laisse pas trop à désirer. Croiriez-vous que hier j'ai bu le "Champagne" en compagnie de Guinchard qui me l'a apporté en venant nous voir et faire passer un agréable moment. J'arrête ma nomenclature de bien-être qui contraste trop avec l'esprit du début de ma causerie, ce qui pourrait aussi peut-être vous faire justifier l'opinion de certains gens d'arrière qui prétendent qu'on est mieux au "Front" qu'ailleurs, mais ne font pas la moindre démarche pour y venir, ou y faire venir les leurs !
|
|
Dimanche dernier, Marie Coulon m'a gratifié d'une sentimentale et gentille quatre pages ! La guerre ne répond sans doute pas à tous ses désirs non plus ! Je crois qu'on va venir me remplacer pour manger la soupe, je vous quitte puisque je n'ai plus que la place pour vous embrasser tous tendrement. Louis.
|
|
Je me doutais un peu du sort de mon copain Oudin, un bataillon du 331 est allé remplacer le sien qui s'est fait cueillir en gros. Il m'avait écrit encore la veille remonter à la bataille le 29 mars. Souvent j'envie son sort. Lulu ne m'écrit plus. Où est-il le bonjour aux siens !
|
le 12 juin 1918
Chers aimés,
|
Je me dis : voilà déjà le 12 juin ! Malgré la course effrénée de cette misérable existence je viens couper mes trop longues semaines par ce petit billet qui, s'il ne trouve pas trop d'embûches en route, ira vous trouver dimanche.
|
|
Si ce soleil continue vous n'aurez sans doute le temps de m'accorder quelques minutes pour la lecture de cette feuille qui vous dira que rien d'anormal ne m'est encore survenu.
|
|
Je suis de nouveau aux P.P. J'ai passé la nuit dans un trou d'obus, environné d'engins de destruction qui voilà quatre ans ne m'ont servi encore que deux fois je crois : le 13 août 14 et 27 septembre 16, sur le Poulgares, deux escarmouches direz-vous ?
|
|
Hier les boches nous ont envoyé par ballonnet un paquet de journaux, celui des Ardennes. J'en ai saisi à peu près le sens. Mais rien de spécial ni d'actualité, simplement l'opposé des doctrines prêchées par notre bonne presse voilà quatre ans. Figurez-vous que vous sortez de deux réunions politiques où furent exposés deux opinions adverses. Sans parti pris, votre approbation ira vers l'orateur qui aura su apporter le plus de domination, d'hypnotisme sur l'auditoire par son discours.
|
|
Ici, c'est la réunion des politiciens de chaque peuple qui réussit à gouverner ceux-ci, de la façon la plus odieuse pour le service de ses ambitions. C'est l'éternel fléau humanitaire qui ne réussit pas à atténuer mon inébranlable affection. Louis.
|
le 16 juin 1918
Bien chers aimés,
|
Je ne suis pas encore des mieux disposés pour vous faire ma causerie hebdomadaire. Pourtant j'espère que l'affection qui m'anime dominera la rancœur qui m'accable voilà quatre ans. Comme me dit
Édouard, toujours opposé à ma mentalité : "Avec ton âme en bonnet de nui". En effet et plus je vieillis plus il s'enfonce mon bonnet. Non plutôt plus je change, plus je perds : votre saison active vient de commencer mais moi je l'ai commencée au 1er mai, et elle quand ? Je ne veux pas énumérer la série de ces tracasseries que je vous ai déjà laissé entrevoir. Mais ce matin après quatre jours et quatre nuits dans un trou aux P.P. sans dormir, nous venons, ma demi section, un sergent respectable, deux cabos, deux gosses de la classe 16, un peu à l'arrière pour dormir d'un œil, mais la consigne est de fournir deux sentinelles de jour pour garder ce petit poste, nous sommes sept hommes, des déshérités comme moi, dont deux de la classe 1898 ! Cela nous fait chacun cinq heures à rester au soleil pour garder je ne sais quoi, ce sergent et ces deux pauvres petits cabos qui n'en peuvent plus. Un jeune deux galons qui commande la compagnie donne des ordres, le plus souvent dans les fumées de Bacchus, parait-il ! Mais nous ne souffrons encore pas assez ! Le geste de mon parrain est encore trop rare !... Je m'arrête, ne vous épouvantez pas ! Mais il me semble qu'il vaudrait mieux que je sois seul sur la terre. Il serait temps de mettre un frein à l'excès des actes ambitieux et égoïstes qui deviennent toujours de plus en plus tyranniques. L'asservissement des barbares ne peut pas être plus funeste ! Mon Dieu ayez pitié de nous !
|
|
Cependant cette exaltation s'apaise vite après la lecture que je viens de faire de votre entretien de lundi, chère maman. Comment ne pas persévérer dans cet espoir qui vous anime au seuil de vos soixante ans ? Vous qui êtes l'âme de l'"oasis bourdonnante" comme dit Mme Besançon, qui me transmettez secrètement la pensée et les actes de chacun.
|
|
Il y a longtemps que l'on ne pense plus à ces trois voitures de trèfle qui laissaient poindre une pointe de regret dans votre lettre de lundi. Les quelques nuages humides sont juste venus semble t'il pour vous permettre de remplir vos quatre pages et même les marges. Aujourd'hui serai-je aussi favorisé ? tout au plus. Il y aura encore une voiture à enlever pour achever certains coins. Mais que cela doit sentir bon à la grange avec une qualité pareille. Cela doit l'emporter sur le regret de voir mourir les avoines du Bout de Verdot !
Édouard m'a déjà fait part de ses condoléances pour ces mêmes avoines. Vos blés vont-ils beaucoup souffrir ?
|
|
Cette température exceptionnellement fraîche, très froide la nuit (nul n'a pu mieux l'observer que moi) est bien l'indice d'une période sèche.
|
|
Je ne fais pas allusion aux graves événements du jour. Leur énormité touche à peine l'individualisme personnel. J'ai fait une lettre de condoléances au père de mon copain Oudin. Il m'avait encore écrit la veille de son entrée dans la bataille fin mars. Mais quel est le plus à plaindre de lui ou de moi.
|
|
J'ai su doublement que le sergent n'avait pu aller à Besançon comme il l'avait un peu promis. Sans doute assailli par ses foins. Si ce temps là dure il pourra sans doute disposer d'un dimanche prochain, moi peut-être en septembre ! En attendant je vous embrasse tous aujourd'hui affectueusement. Louis.
|
le 18 juin 1918
Mon cher Édouard,
|
Chaque fois que j'apprends que ce que je t'adresse a fini par te rejoindre, je constate que ce que je puis te dire pour être un peu intéressant devrait partir du même principe qu'une lettre du nouvel an qui te rappellerait que certains débuts d'année me trouvent encore vivant !
|
|
Ne vas-tu pas être maintenant un peu stagiaire pour épargner de vains efforts de mémoire qui me rendront un peu plus intéressant. Je sais bien qu'une banale lettre de "poilu" de 2ème classe, à part l'affection fraternelle qui l'anime n'est qu'une poussière parmi l'énorme et pitoyable misère que tu rencontres à travers ta course dans notre beau pays de France.
|
|
Tiens, je te fais part des confidentiels préparatifs de départ sur la route de l'exil de ma nouvelle petite amie de Somme-Suippes. Jusqu'ici ils n'ont pas eu lieu d'être exécutés. Je lui ai fait hier mes humbles vœux de soutiens moraux.
|
|
Eh ! bien, mon cher, si tu perds la mémoire dans tes nombreux déplacements, à moi il me faut des efforts pour m'y retrouver dans l'affreux boyau que je parcours jour et nuit depuis le 2 mai. Je ne veux pas entrer dans les détails de service qui me font exécrer le silence apparent du secteur célèbre. Pour le silence j'en rends grâce aux boches qui ont pas mal à faire ailleurs. Mais l'absurde mentalité de mes chefs qui, par des ordres donnés souvent parmi les vapeurs de Bacchus, me clouent des nuits entières au P.P. ou aux fils de fer barbelés, sans rendement de travail d'ailleurs, et qui le jour en guise de repos réparateur m'octroieront cinq ou six heures de guet en dehors des corvées régulières et des petits instants personnels.
|
|
Le manque de repos finit par me devenir aussi lourd que mes plus pénibles épopées Macédoniennes. Il est vrai que je me rends compte que j'ai eu la chance de tomber dans le plus mauvais bataillon du régiment, le commandant un vieux rasoir à trois galons. Ex : alerte tous les jours à deux heures et demie, un commandant de compagnie à deux galons, imberbe, qui en rajoute encore au programme journalier. Représente-toi les fatigues, l'humiliation de ton frère qui n'obéit qu'à des enfants, des cabos de la classe 15,16, même 17, qui ne peut plus faire société avec les jeunes alcooliques normands de la classe 18, et tu n'auras pas de peine à comprendre sa mentalité révoltante qui voudrait voir Paris et toute sa clique un peu humiliés à leur tour ! Ceci n'est pas une réplique aux nobles sentiments que tu m'as déjà exposés et qui ne sont que la base théorique de la cause sacrée pour laquelle j'aurais à cœur de combattre. Mais c'est impossible, trop de mauvaise foi, d'égoïsme ont précédé à ma destinée.
|
|
Et puis je ne t'ai pas parlé des brochures que les boches nous envoient, mais sans effet sur mes convictions, ni des réflexions que me provoque l'action américaine en contraste avec la résistance irlandaise. Ce sera pour une autre fois. Je clos ceci par mes affectueux baisers. Louis.
|
|
Le ciel à l'air de vouloir accorder une trêve aux gens de Verne, indispensable pour le sauvetage des avoines du Bout de Verdot !
|
le 19 juin 1918
Chers aimés,
|
Cette feuille qui vous justifiera de la régularité de mon emploi du temps est le meilleur indice qui puisse vous dispenser d'inquiétude à mon sujet. Il y a bien cette surcharge de service que je vous ai déjà signalée plusieurs fois. Toutes ces nuits sans dormir ne peuvent jamais être compensées par quelques heures de repos en plein jour, toujours plus ou moins tranquilles. Enfin la grande habitude y supplée et la crainte d'être encore plus mal fait toujours accepter le sort aux malheureux. Aujourd'hui nous avons quelques distractions, quelques nouvelles verbales qui arrivent de l'intérieur : un renfort nous arrive, trente ou quarante hommes par section. Beaucoup de rescapés d'Orient comme moi viennent du 44. Un copain d'escouade du 235 que j'avais quitté avant de partir pour l'hôpital, puis un pays, un nommé Cédoz de Fontaine que je viens d'entrevoir et que je ne puis encore apprécier. Puis enfin Lanoix qui parait-il, est dans une compagnie de mon bataillon. Vous voyez que l'on a vite fait de renouer des relations.
|
|
Comment s'effectuent vos foins ? Il me semble que vous devez déjà en avoir une bonne partie. Voilà quelques jours que le temps tient plus du mois de septembre que des chaleurs de juin, mais cela permettra aux avoines du Bout de Verdot de ressusciter ? Vos dernières nouvelles sont du 10, comme c'est déjà loin. Et je ne compte guère sur des nouvelles à mi-semaine. L'accablement de la surcharge de travail prime quelques lignes banales aux êtres chers qu'un trop long exil prive de détails minutieux. Je repousse cette mauvaise mais logique pensée pour vous laisser dans l'impression de mes affectueux et tendres baisers à tous. Louis.
|
le 23 juin 1918
Chers aimés,
|
Me voici dans un confortable foyer du soldat comme vous l'indique l'origine de cette mince feuille.
|
|
"Heureux indice pour vous faire ma lettre du dimanche allez-vous dire" ! Pas tout à fait. Ma salle casematée sous une couche épaisse de ciment sent encore trop la guerre. Malgré la neuvième heure de ce beau jour de juin, j'ai recours à une suffisante lumière électrique. C'est que je suis blotti dans un fort. Je précise : avant-hier j'ai quitté le boyau que je parcourais nuit et jour depuis le 1er mai. Malgré la pluie fine qui a fini par rejoindre l'humidité de la chemise due à la charge du chargement, j'éprouvais une légitime satisfaction à mesure que je rapprochais de la lugubre nécropole Meusienne. Mais là encore, tout respire dévastation et danger, si bien que les sapes souterraines sont préférables à la sécurité des troupes aux nombreuses casernes éventrées voisines. J'espérais quelques jours de repos où il serait permis de courir un chemin qui ne se mesure pas au centimètre. Mais déjà j'approuvais que nous n'avions qu'un chargement de secteur avec un autre régiment de la D.I. J'ai profité du voisinage du cimetière immense pour reconnaître la tombe d'Octave. En route j'avais recueilli en hâte un bouquet. J'eus assez de peine à retrouver la petite croix que deux ans ont déjà à moitié consumée et que les herbes commencent à cacher.
|
|
Mon temps était limité, arracher l'herbe, attacher mon bouquet pendant que j'ai récité un "De profundis", fut tout de que j'ai pu faire pour ce cher, victime de son fanatisme. Je suis encore navré de voir l'abandon où se trouvent les cinq mille petites croix. Certains cimetières sont assez bien entretenus mais pas celui-là. En particulier, j'ai eu honte de constater que la croix que je cherchais semblait appartenir à la mémoire d'un inconnu. Surtout que le rang auquel il appartenait l'a fait placer au milieu d'autres officiers aux tombes décorées, mais lui, pas la moindre couronne. S'il y avait eu encore des magasins en ville je lui en aurais placé une.
|
|
J'ai fait part de ma visite à la cousine Berthe.
|
|
C'est depuis les sous-sols du Fort où ce regretté a trouvé la mort et où je suis venu hier soir que je vous embrasse tous affectueusement. Louis.
|
le 25 juin 1918
Chers aimés,
|
Chère maman,
Votre carte-lettre du 21 consolatrice vient de m'arriver, chère maman ! Sous l'empire de ses bienfaits je vous en remercie de suite. Cela me dédommagera un peu de la peine que je vous ai causée en vous écrivant dans une crise de misère.
|
|
Confortablement installé dans ma caserne souterraine je vous dois cette feuille dès ce soir. Quel contraste entre l'esprit qui m'anime à l'heure présente et celui qui dirigeait ma plume quand je vous ai tracé cette grande lettre qui vous a tant attristée ! Je ne me souviens plus le texte exact. Mais vous savez qu'il faut peu de chose pour influencer l'âme des malheureux ! Je ne suis guère plus favorisé, mais quelques jours de tranquillité après tant de fatigues ont suffit pour me remettre un peu dans une situation acceptable. Nous sommes en réserve sans grande occupation, le secteur est calme, cela nous permet le repos dont nous avions tant besoin. Après trois jours de ce régime les anciennes fatigues ont disparu. Je n'ose dépeindre ni envisager combien ce bonheur de courte durée est précaire. A peine le droit de se rendre compte si nous sommes à midi ou minuit, la vie est relativement heureuse dans ces souterrains où on n'a droit qu'au minime soleil de lumière ou de chaleur qu'a trouvé la science humaine, et ce à proximité d'une rage féroce et terrible qui peut surgir d'un moment à l'autre. mais puisque nous vivons et semblons être créés pour cette éternelle perspective de crainte, je vous embrasse tous, sans trop redouter la réalité si elle doit se produire. Votre Louis.
|
|
Je croyais vous dire autre chose que ces banalités, mais ce sera peut-être pour demain soir. Bonne nuit, il est dix-huit heures.
|
le 26 juin 1918
Chers aimés,
|
Je ne voudrais pas désobliger le correct Américain qui offre du papier à lettre à tous ceux qui veulent honorer la salle mise à la disposition des correspondances. Il est six heures du soir, les clients ne manquent pas, beaucoup n'ayant comme moi pas grand chose à dire. Au bout de quatre ans de stage le métier est forcément acceptable. Quand il n'est pas insupportable il n'y a pas grand chose à dire. Il m'a bien fallu rester toute la nuit alerté, avec les cartouches sur le ventre, mais nous ne sommes pas sortis et puis presque toute la journée à se reposer cela a suffi par rattraper le sommeil manqué.
|
|
Je viens d'apercevoir le soleil par une meurtrière. Cela me transporte plus près de vous. La course de cet astre nous importe tant ! J'ai bien votre résumé de dimanche chère maman, mais votre dernier
a déjà dix jours, depuis je n'ai plus la notion exacte de la température. Je vous ai déjà dit ce que je l'avais trouvée froide pendant mes séjours au P.P. Mais ici dans mes souterrains elle est suffocante. Jour et nuit je reste en bras de chemise. Cependant il m'a semblé que le soleil n'avait jamais eu l'ardeur nécessaire aux foins. Où en êtes-vous ? Vos Russes peuvent-ils y suppléer ? Je ne pense pas, surtout si ce sont des Sibériens ! Avez-vous le temps de constater l'évolution de la Grande Guerre : les richesses de votre terre exploitée par les Russes pendant que vos fils défendent et tombent... mais glorieusement ! à la frontière !...
|
|
Enfin, pourvu que les chaînaux, ou autre chose... ne laissent pas à désirer !... Ces pauvres paysans donnent volontiers leurs fils au Dieu de la guerre, mais se font criminels si l'on veut leur soustraire leurs bœufs ! Pauvre humanité. Je vais envoyer une lettre-carte à Lulu qui, après un long silence ne m'apprend pas grand chose d'intéressant. Bons baisers. Louis.
|
le 28 juin 1918
Chers aimés,
|
Voyez-vous un des bienfaits de mon séjour au Fort célèbre ? Je suis plus près de vous, j'ai découvert un service postal chez les territoriaux qui part à deux heures du matin, le nôtre part à treize heures chaque jour. Cette aubaine m'invite à continuer ce soir votre entretien de dimanche, chère maman. Aurez-vous le temps ? Pas tant que la semaine dernière et j'espère bien que vous n'allez pas me reparler du foin de la noue Graugnat ! Heureusement que ce coin tout près vous a épargné bien des kilomètres. Mes rares sorties me font apercevoir le retour du beau temps. Vous n'allez pas en être fâchés. Mais que sont les humbles occupations en comparaison des gigantesques évènements actuels ? Peu de chose semble t'il. Cependant c'est la réunion innombrable de ces intérêts particuliers qui font l'enjeu de la lutte mondiale. Et ma foi, elle devient compliquée par son ensemble que nous ne pouvons que nous borner à échanger que ce qui nous touche personnellement ou tout proche de nous.
|
|
Je reviens donc à votre affectueuse et intéressant lettre, chère maman, puisque j'ai la joie de ne pas vous offrir aujourd'hui mes lamentations habituelles. Ma détente continue dans mon confortable souterrain. Repos presque complet, d'où loisirs et distractions abondantes. La meilleure est celle que je prends chaque soir à faire par-ci par-là un brin de correspondance.
|
|
Mais voilà que je me demande dans quelle tenue vous allez vous orienter chaque jeudi vers la ville pour être digne de votre équipage ! Mais l'accoutrement approprié ne permet pas de tenir un gros panier sur la place pour gagner quelques sous !... Vous vendrez en gros !...
|
|
Il faut bien que je plaisante pour arriver à vous accorder mon approbation, inutile puisque c'est fait. Cependant, vous ne soufflez mot de la grosse question : le prix d'achat correspondant avec l'état de la calèche. Il est vrai que pour moi cela n'a pas beaucoup d'importance, pourvu que l'impression soit favorable à mon arrivée en gare ! Mais hélas ! il y a bien un semblant de reprise de perm et qui me semble bien précaire. Le deuxième tour n'est pas achevé et je ne suis pas le premier du troisième. Espérons, puisqu'il le faut. En effet Dago m'a rejoint, il est à la 2ème compagnie mais pas au Fort actuellement, nous nous verrons comme auparavant à l'arrière. J'ai dû vous dire qu'un Cédoz de Fontaine était à ma section même.
|
|
Je redoute le dénouement fatal du conseil de guerre de Vesoul. Peut-être aurai-je une lettre demain. Il faut que je vous quitte, je dois faire réponse à une gentille lettre de Léa Pastif. Tendres baisers à tous. Louis.
|
le 30 juin 1918
Chers aimés,
|
Il est midi. Pas un nuage au ciel. Une brume légère et fraîche. Autant de marques par ce soleil de juin qui indiquent l'activité que vous déployez en ce jour. Moi qui semble t'il était né pour partager, diriger même ces pénibles et absorbantes occupations, je ne vous assiste que par la pensée dans une méditation profonde, longue, silencieuse, indéfinie suivant ma volonté par de longues heures de loisir.
|
|
Est-ce par esprit de contradiction que je vous suis, voilà pourtant la quatrième année contre ma destinée qui pourtant en décide bien autrement ? En partie sans doute. Le mauvais esprit est toujours là prêt à nous offrir ses services quand on lui fait appel, principalement quand le sort lèse trop mes intérêts. En ce sens, c'est bien là mon cas, ce qui n'exclut pas l'état précaire de ma sécurité personnelle par ma situation périlleuse, surtout en ce moment.
|
|
Cependant ce ne sont pas ces considérations de regret ou de crainte qui m'attachent à vous malgré la distance et les jours. Il est un sentiment plus fort, plus doux et plus impérieux que vous n'avez pas de peine à deviner ? C'est en vertu de cet amour que je trouve la force et l'espoir d'espérer toujours, et sans doute l'inspiration de pouvoir causer longuement aujourd'hui avec vous, tout comme pour suppléer aux affections écourtées que vous pourrez m'adresser chère maman.
|
|
C'est toujours en vertu de cette tendre affection que vous trouverez intéressant de lire mes banales et monotones lamentations, malgré la rapidité des trop courtes heures de ces beaux jours.
|
|
J'ai tout le temps voulu pour vous tracer cette lettre et pourtant pas assez de courage pour en faire une autre. Tous les copains. Pas d'autres bruits que le bourdonnement des mouches. Pourtant je me trouve dans un des coins le plus infernal entre tous par le bruit et l'horreur et qui ne semble vouloir perdre ses droits à ces abominables fonctions qu'à regret.
|
|
C'était à prévoir. La rançon d'une semaine de tranquillité dans ma forteresse sûre, humide et ténébreuse, a exigé ses droits à partir de hier soir.
|
|
Je n'eus pas de peine avant de venir ici de me représenter le décor de mon futur paysage. Par la fréquence de son nom dans le communiqué, je me doutais fort que du pauvre bois il ne reste même plus les racines des arbres séculaires.
|
|
Les autres régiments de la D.I. y ont subi dernièrement plusieurs coups de main, c'était à prévoir que notre tour viendrait. M'y voici donc, blotti sous une tôle qui ressemble à une écumoire. De la crête d'en face les observateurs boches peuvent signaler mes mouvements. Ceux-ci n'auront lieu qu'après neuf heures du soir. Il faudra bien aller chercher un peu à manger et à boire. Pour une longue journée je n'ai que deux quarts de pinard, du pain et un bout de viande pris dans un sac. Je n'ai pas eu la précaution de me munir hier avant de venir, je suis déjà tant accablé sous le poids des cartouches et un fusil de neuf kilos. Mais ce soir, je crois qu'il y a une corvée pour les commissions à la Coopé. Pour 2,25 j'aurai 220 grammes de beurre salé ! Mon pain sera moins sec, c'est encore le plus économique. J'espère bien que nous trouverons de l'eau aussi pour demain. Ah ! quel secteur ! Avec un bombardement et de la boue dans les boyaux, j'aurais le même tableau qu'au mois d'août à Avocourt.
|
|
Heureusement je crois que ce régime ne durera que six ou huit jours. Et encore nous sommes compagnie de réserve. A d'autres l'honneur des places de première classe. Enfin si les Boches n'ont pas la manie de nous attaquer ou de savoir qui nous sommes, ce ne sera rien qu'une page de gloire de plus à mon actif !...
|
|
Je crois qu'Édouard avec ses "loups" était un peu plus à gauche. Il y a huit jours que je n'ai rien de lui et encore je n'avais qu'un de ses bizarres signes de vie.
|
|
Les gens de Verne n'ont guère le temps de s'occuper de la guerre, pas plus que ceux de Hyèvre ou Cuse, de Saint-Pierre et Paul aujourd'hui, mais j'avais demandé l'adresse de Jules à la Marie, sans l'obtenir. J'aurais pu lui envoyer un mot. Que fait-il ? Et Georges, est-il toujours convalescent ? J'attends toujours l'épilogue du drame vernois. J'ai appris l'accident de tram Bisontin, le même que celui qui nous a promené à Saint-Fergeux, chère maman, et qui coûta la vie à la femme de mon copain Nonotte.
|
|
Mon fournisseur de feuilles à l'estampille américaine n'est pas ici ; par économie je cesse mon entretien en disposant sur ce papier un tendre baiser à chacun. Louis.
|
le 3 juillet 1918
Chers aimés,
|
Toujours cette saison froide en plein été. Depuis ce matin le ciel est couvert favorisant la fraîcheur du vent du Nord. Il est midi et ma foi, je n'ai pas besoin de chercher l'ombre dans l'escalier de ma sape ; j'endurerai bien les quelques éclaircies qui viendront percer les nuages.
|
|
Est-ce en raison de cette température que j'ai à mon tour attrapé la grippe ! Un rhume de cerveau voilà trois jours avec ses inconvénients.
Édouard me dit être pris lui aussi par la grippe universelle. Chez nous on attribuait cette épidémie à la chaude température qu'il nous a fallu subir à Douaumont, mais il existe d'autres causes qu'on aura beau chercher, comme à l'origine de chaque malheur, sans pouvoir l'éviter. Mais encore cette fois-ci, cela n'aura pas grande influence sur la durée des hostilités.
|
|
Et la durée des foins s'en ressentira t'elle ? Si vous n'êtes pas plus atteints que moi, vous n'aurez même pas le temps de me le dire.
|
|
Voici le quatrième jour que ma grippe coïncide justement avec mon ordinaire, je n'ai pas fait grand mal il y a un instant à la marmite de riz pâteux cuit depuis hier soir et qui servira encore ce soir. Un pas trop mauvais bout de viande a eu assez de mal à descendre mais un bout de saucisse valait beaucoup mieux. Ah ! comme une "manne céleste" au milieu du désert, telle fut la destinée de votre colis, chère maman ! Seulement aviez-vous laissé votre viande aux mouches, la boite était pleine d'"asticots" qui n'osaient pas mordre sur le salé. Je n'ai rien de perdu et j'ai pu faire cuire mon jambon par le cuistot des officiers qui eux ne se passent pas du régime liquide et chaud, nous nous sommes au sec !... Mais bien plus sec était encore ce que les Boches ont reçu au Bois des Courrières hier soir. Mais sans doute que pour ne pas perdre l'habitude de ces lieux infernals ils vont nous rendre la monnaie de la pièce un de ces jours.
|
|
Hier j'avais un petit mot de la cousine Berthe, une formule de politesse en réponse de la visite de faire-part que je lui avais faite sur la tombe d'Octave.
|
|
Je vous quitte pour aujourd'hui en vous réservant mes plus affectueuses pensées que je scelle par un tendre baiser à chacun. Louis.
|
le 7 juillet 1918
Chers aimés,
|
Oh ! quel beau dimanche ! comment le sanctifiez-vous ? Il me semble qu'il doit y avoir encore quelques voitures de "rapiôles" soit Sous Guette où le terrain est solide ou aux Mollards où il doit être brûlé. Je ne dois guère me tromper puisque mardi dernier il restait encore pour quatre jours à Henri à ajuster ses lames !
|
|
J'ai eu hier votre carte à l'encre rouge chère maman. Aujourd'hui il me semble que l'insatiable cadette ne va pas vous tourmenter pour vous empêcher de prendre une autre couleur qui m'en dira plus long. Quoi m'apprendre pour ne pas me parler de foins ou autres banalités secondaires, allez-vous peut-être penser ? Non vos travaux ne sont pas une banalité, si vous les faites vous avez un idéal, une satisfaction qui l'emporte sur la fatigue qui vous semble parfois exagérée. Comparez donc votre journée de sueur aux cinq heures de nuit et onze à quatre ce matin qu'il m'a fallu expier comme chaque jour d'ailleurs avec une occupation où le moindre effort révolte tous mes sens. Vous direz, il faut bien faire quelque chose pour passer le temps, mais c'est là un raisonnement à l'adresse d'un animal. Non le travail n'est passe-temps qu'en ce qu'il a un but, un objectif qui vous donne de la satisfaction, de l'espoir, ne serait-ce que la foi d'espérer des jours meilleurs par une sécurité au moins relative. Mais placer du fil de fer au risque de tomber sous les incessantes rafales de mitrailleuses, et penser qu'on vous fait passer voilà le troisième mois presque toutes les nuits dehors en vue d'une attaque brusquée, alors ce sera facile de vous rendre compte de la mentalité de celui qui ne s'illusionne pas à faux de sa triste situation. Situation qu'il n'est pas permis de s'éterniser dans de pareilles conditions. Qu'ai-je donc fait Grand Dieu pour que mon sort tombe sur un aussi triste lot ?
|
|
Peut-être ferais-je mieux de vous reproduire mes actes comme on raconte une histoire au lieu de vous exposer les réflexions ou le résultat où ils peuvent me conduire, ce serait sans doute moins lugubre. Mais vous le savez bien, c'est une faveur qui ne m'est pas permise. Et j'ai beau chercher ce que certains, parfois avec raison, trouvent dans ce qu'on appelle : je ne m'en fais pas, ce n'est pas commode à trouver. D'ailleurs cette sérénité d'âme n'existe pas dans l'entourage de ma condition.
|
|
Il y aura un an demain, le 8, je chargeais du foin en Saussoye avec une perm de vingt-quatre heures que j'avais gagnée avec huit jours de boite, faisant suite au baptême de Fontenelle.
|
|
Cependant j'étais à moitié satisfait. Je n'ose envisager l'espoir qui m'anime à l'évocation de ces heureux anniversaires. Par T.S.F. il parait que les Boches ont remis la partie en Champagne. Qu'en adviendra t'il ? De la ruine et des deuils assurément, une nouvelle suspension des perms, c'est secondaire. Le tout va être camouflé par de lumineux articles de presse à l'adresse des américains et ainsi s'achèvera le quatrième tour de la planète qui roule avec elle la gloire et les ambitions des privilégiés en même temps que la misère et le désespoir des déshérités.
|
|
Par l'intermédiaire de Mr. Fourgeot Édouard m'apprend l'épilogue du drame vernois, vieux de quinze jours. Les détails m'auraient intéressé puisque j'ai qualité pour en déduire des réflexions à double sens que je ne puis exposer aujourd'hui. Jusqu'à ce soir je crois, je suis encore aux A.P. d'où je vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
le 10 juillet 1918
Chers aimés,
|
Depuis dimanche que je vous ai écrit cela ne fait que deux jours sans être avec vous spécialement. Cependant il me semble qu'il peut en y avoir déjà huit par les diverses variétés qu'a subies ma situation. Rien d'extraordinaire ni d'inquiétant mais toujours une surenchère de service :
|
|
Après huit jours d'A.P. dans le secteur redoutable, pour cette fois il n'y a eu que mon "ventre" qui a pu redouter de ne rien avoir à manger, ou pas grand chose. Mais il y a encore des crans à ma ceinture ! Donc dimanche soir c'était la descente par sept à huit kilomètres de boyau pour venir dans une sape confortable se refaire par sept à huit nuits de tranquillité relative au moins. Mais juste le temps de se nettoyer un peu, de prendre une douche dans l'établissement des casernes voisines en grande partie démolies et les gradés partent reconnaître un nouveau secteur à reprendre hier soir. C'est peu de chose à refaire le "barda" et se l'endosser après six ans de répétition. Seulement les ressorts du mécanisme commencent à fléchir par un excès de production !
|
|
Me revoici donc, sous une tôle de P.P., en train d'être mieux qu'à la guerre grâce à la confidence de cette feuille de papier. Rassurez-vous, ici c'est le secteur "pépère", joignant celui que j'ai occupé pendant cinquante jours précédemment. Ici les boches ne nous feront pas tant de mal que les Français, un excès de service très mal compris ne nous donnera que très peu de repos, une affaire d'habitude dans mon nouveau régiment !... Je ne veux pas commencer mon interminable série de lamentations pour être plus étendu sur la joie de la petite fête qui m'est arrivée hier. Une grande quatre pages du vendredi ! Quoi de meilleur qu'une surprise pareille ? Rien pour moi assurément. J'ai commencé par en savourer les délices, avant de prendre connaissance de la coupure de la "Dépêche". Ces deux colonnes de journaux n'ont fait que confirmer ce que je soupçonnais avec tristesse. Mais ce qu'il faut en déduire ne se trouve pas dans la perte des deux victimes de la grande guerre qui se perdent dans l'immensité de la catastrophe, comme le petit point de vue Serbe, mais bien dans l'esprit tyrannique dans lequel fut rendu la sentence, en dépit des vœux et de l'espoir de l'opinion publique. Un éloignement vers un meilleur esprit de pacifisme ne peut qu'exciter la haine en même temps que la crainte et aigrir les cœurs.
|
|
Heureusement que celui qui animait votre main chère maman était d'une autre inspiration, ce qui m'a fourni le baume procurant la joie, l'espoir et l'amour que vous porte ce tendre baiser à tous. Louis.
|
|
Dans une deuxième enveloppe je glisse ce "journal" qui mieux que moi peut vous apprendre ce qui peut m'intéresser et me distraire. Hier aussi j'ai eu une lettre d'Édouard. Vos demandes d'avis, chère maman, pour vos transactions de chevaux m'intéressent mais trouvent un faible appui auprès de moi. Au revoir.
|
le 14 juillet 1918
Chers aimés,
|
Voilà, puisque vous vous y êtes mis à deux pour me gâter il y a huit jours, cela me vaut le plaisir de vous adresser encore une enveloppe aujourd'hui. Seulement j'emploie la deuxième personne du pluriel sur cette grande feuille qui contient tout un envoi collectif de sentiments filials et fraternels. Cependant je suis tenté chère maman de vous faire une grande causerie avec une adresse personnelle ! Ce serait peut-être un moyen efficace d'activer d'une façon manifeste des affections qui restent trop secrètes ! Je devine les réflexions que va suggérer cette provocation : on dirait qu'il devient enfant ou bien qu'il ne se rappelle plus des fatigues du métier et du peu de loisir qu'il procure ? Puisque la maman s'en charge, il me semble que c'est suffisant, on voit bien qu'il n'a rien à faire qu'à écrire !... etc... Il y a quatre ans, plus que tout autre j'aurais tenu pour irréfutable ce raisonnement. Mais vous savez que les temps ont changé. Une grande évolution du corps et de l'âme succède au vent de destruction et de rage qui souffle sur le monde. L'éducation et la routine acquises au petit village natal ne font que mieux contraster par leur obstination. Heureusement qu'il ne vous a pas été permis de remarquer ce contraste comme moi par une expérience qui reste encore indéfinie par sa durée et sa rançon ! Je m'arrête pour ne pas m'égarer dans une question psychologique qui pourrait ne pas vous paraître bien claire. Et encore aujourd'hui c'est à tous ceux qui me liront successivement que je m'adresse personnellement.
|
|
Vous allez dire : "il ne dit pas grand chose de nouveau" comme ces naïfs lecteurs de journaux, ignorants ou indifférents, qui trouvent le communiqué trop monotone ou trop maigre. Rien de nouveau ! Et dans deux mille ans l'histoire apprendra encore que nous avons vécu une année sans précédent, et c'est de la lettre d'un des acteurs de ce drame que vous direz qu'il ne dit rien de nouveau, à part l'esprit d'affection que vous pourrez en déduire, mais cela c'est du personnel, comme un secret qu'il est superflu de livrer à une voisin curieux et indifférent.
|
|
Mais est-ce que la fête nationale de 1918 ne sera pas mémorable ? Est-ce qu'elle ne fournit pas déjà le sujet d'une grande lettre même pour le plus borné des poilus à l'imagination creuse et vide d'événement à reproduire ? Rien que la carte du menu du jour a fait le tour des P.P. hier soir. Les cuistots ont réquisitionné toutes les boites et campements possibles pour loger le supplément à l'ordinaire : hors-d'œuvre ou confiture, le tout arrosé d'une ration double de pinard. Le traditionnel mousseux et son cigare ne peuvent pas manquer ce soir. Il faudra bien que j'allume aussi pour avoir bonne contenance !... Voilà dix heures, afin de ne pas être en retard pour assister à l'arrivée triomphale des produits culinaires je vous embrasse tous un peu vite, mais bien affectueusement. Votre Louis d'Or !
|
|
J'ai eu une lettre de mon ami Léon hier, il m'a voisiné sans que je le sache, a pris la piquette à Château-Thierry, mais n'a pas encore pu avoir de perm depuis qu'il est reparti, au nouvel an. Georges m'écrit aussi depuis les Rousses. Lulu depuis la Champagne. J'ai envoyé mes condoléances à Maria Dadane. Mes marges n'en veulent plus. Au revoir.
|
le 17 juillet 1918
Bien chers,
|
Dès lundi matin l'infernal roulement de la canonnade à notre gauche faisait pressentir la reprise tant annoncée. La nouvelle fut confirmée le soir par l'annonce d'une nouvelle suspension des perms. C'était à prévoir. Pour nous, pour vous, pour le monde entier voilà le plus intéressant. Qu'en adviendra t'il ? Les journaux d'hier ne pouvaient encore rien laisser prévoir. Cependant par radio il parait que les Boches n'auraient pu déboucher. C'est l'essentiel. Le sacrifice des milliers de victimes restées sous l'avalanche de fer reste secondaire.
|
|
Quoi d'étonnant qu'un poilu soit tué au bout de quatre ans de guerre ? C'est presque un privilège d'avoir vécu ce temps, au milieu de tant de dangers. C'est l'absurde mais naturel raisonnement, plus ou moins manifeste de ceux qui dorment tranquillement à l'arrière.
|
|
Il y a un an, j'étais sur le Quai de la Viotte, attendant le train de huit heures trente qui devait m'emmener en renfort. Comme les copains, une gaieté forcée triomphait de la tristesse qui n'aurait pas manquée d'être arrosée de larmes si j'avais pu trouver un endroit solitaire. Ce souvenir vivace m'attriste encore aujourd'hui par la confirmation de ses légitimes et redoutables perspectives.
|
|
Cependant si je m'abaisse à un sort plus funeste que le mien, je puis trouver pire. A part le mois d'août et Bois redoutable, je n'ai rien supporté d'impossible. Le plus dur dans l'ensemble fut pour moi le constant refus ou la résignation forcée d'un sort pour lequel il me semble que je n'étais pas né ! Je sais bien que si ma condition comportait quelques avantages qu'il m'aurait été possible d'obtenir, la résignation serait plus douce. Mais il en est tout autrement, il me faut supporter toute la charge maximum qu'un être puisse subir. Je n'approfondis pas davantage cette douloureuse constatation puisque notre destinée n'est pas uniquement entre nos mains, je m'en réfère à Celui qui excelle en justice, même en faisant la part de chacun !...
|
|
J'ai fait une lettre hier à ce cher Léon. Quoique n'ayant pas la facilité d'exprimer librement sa pensée par écrit, nous sommes bien frères d'armes par l'analogie de nos peines, qui pour lui se double d'une plus grande privation de perm, depuis le nouvel an qu'il est parti. Je crois que pour lui le regret est pénible d'ajourner indéfiniment le bonheur projeté de s'unir avec celle qui lui a promis son cœur ! Le déclin de la vie qui me menace à brève échéance n'est pas sans m'inquiéter un peu, si Dieu m'accorde de longs jours, mais quand on n'a pas frisé la chance ou l'occasion de près le regret est moins pénible !
|
|
Vous allez rire ? Faites-le avec moi pour cette allusion ! Ce sera pour votre dimanche, la moisson va vous permettre encore quelques distractions mais voici quelques jours qui sont du mois de juillet.
|
|
L'affection de mes baisers aussi. Louis.
|
|
Mon cher Henri, j'attendais de toi quelques détails sur la récolte des foins ? La quantité, la qualité, la marche de l'attelage et de la Deering, les promesses de la moisson ? Enfin un entretien affectueux et fertile comme tu en es apte. J'espère que rien n'est perdu et te remercie d'avance. Louis.
|
le 21 juillet 1918
Bien chers aimés,
|
Chère maman, vos quatre feuilles ne sont pas assez grandes pour me dire tout ce que ma curiosité voudrait savoir. Elles contiennent généralement l'expression de toute l'affection familiale et le résumé de vos principaux travaux. J'ai fait appel à d'autres mains que les vôtres pour avoir des détails supplémentaires, peut-être avec un peu de patience serai-je entendu. C'est ainsi qu'aujourd'hui où je suis particulièrement avec vous ma pensée s'égare et ne sait où vous trouver, pourtant vous ne changez pas de secteur ou du moins vous êtes toujours dans un secteur connu, mais je peux m'y tromper, faute de renseignements. Voilà, je ne sais pas où en est l'état de vos moissons. L'année peut être avancée par la sécheresse. Le Parterre peut être déjà sur le flanc. Je croyais revoir ce blé que j'ai semé dans de si mauvaises conditions, il ne doit point y en avoir de couchés cette année. Avec une machine, Henri en aurait pour trois jours. Il vous faudra balancer du matin au soir pendant quinze jours et faire vite car l'avoine du Haut de Verdot va crier misère. Je m'embrouille dans toutes ces suppositions et pour l'instant êtes-vous peut-être encore en demie fête comme il y a huit jours. Pour vous, point besoin d'être une journée nationale, à moins que vous ne fêtiez le succès de nos armes !
|
|
Chère maman, j'espère que notre glorieux mutilé ne vous a pas laissé trop longtemps dans l'inquiétude ? Pour un subventionné de l'État, c'était pour lui le plus élémentaire des devoirs de manifester en l'honneur de Marianne ! J'ai reçu une carte de Marguerite B. me disant qu'il y avait plusieurs jours que sa maman malade n'avait pu descendre faire une classe. Julien l'a t'il vue ?
|
|
Que vous dire de l'atmosphère de four qui nous accablait hier dans nos boyaux ? Ici dans nos P.P. nous n'avons pas de repos, il nous faut nous abriter sous des tôles comme des niches à chien en ces jours brûlants, on ne peut même pas y rester, pas une goutte à boire, que le vin chaud qui arrive des cuisines. Heureusement qu'un peu de brouillard est tombé ce matin. Du repos, c'est comme la perm, c'est suspendu. Jadis, je me plaignais de faire dix-huit jours de P.P. comme nos ancêtres de la guerre de 70. Voilà quatre-vingt dix jours que je n'aurai pas reposé trois nuits entières. Quelques sommeils de deux ou trois heures par jour et c'est tout, sur une planche encore. Pourtant nous devons être classés comme troupes de repos. Sera-ce nous qu'on va lancer à la poursuite de l'ennemi afin de récolter le fruit de tant de sacrifices ? La réponse ne laisse pas de doute. De telles organisations qui n'ont pour but que la destruction, les souffrances, les regrets et l'inévitable misère ne sont pas dignes d'avoir un fruit pour objectif. C'est pourquoi je reste persuadé qu'aucun des camps adverses ne pourra le cueillir.
|
|
Affectueux baisers à tous. Louis.
|
le 24 juillet 1918
Chers aimés,
|
Comme tout est calme autour de moi ! Si ce n'étaient les réseaux de barbelés qui comblent le ravin, les boyaux qui y aboutissent de chaque coté, les grands arbres morts dont certains gros foyards lancent lugubrement leurs branches vers le ciel, les gros tas de terre marquant l'entrée des souterrains, et les petites croix d'un champ de morts voisin, je ne me croirais pas en guerre. Me voici dans le même ravin qui m'a vu débarquer le 1er mai. En l'époque, la multitude des trous d'obus m'avait donné une vision d'épouvante. Mais depuis la végétation a un peu cicatrisé les plaies de cette terre affreusement bouleversée et ayant encore l'air fumante. Une petite visite au cimetière ne m'a donné aucun nom connu, cependant des numéros de régiment familier y figurent, comme la plupart ils ont déjà deux ans, date de l'horrible hécatombe !
|
|
J'aurais peut-être mieux fait de commencer par vous dire que j'avais quitté le P.P. pour venir en réserve. Oh ! Pas loin, et sans avantages de sécurité ni de repos. Dans ce sens, c'est le petit poste le plus avantageux quand ça ne barde pas. Ici je bénéficie de la proximité de la cuisine, d'une bonne source et surtout de la Coopé. Ah! Ah ! les civelots qui n'ont pas de pinard, dites-leur qu'il abonde ici à 0,95 ! Cette explosion de moquerie égoïste m'est suggérée par votre carte chère maman qui se lamente sur la rareté et la cherté du précieux liquide. Veuillez m'excuser, votre revanche ne manque pas d'occasion et puis en compensation de cette mauvaise pensée, mes regrets affectueux n'en sont pas moins sincères. Vous m'avez fourni un motif de plus pour vous faire ce babillage aujourd'hui où ma pensée se précise sur ce que vous suggère ce mauvais temps qui se met décidément à la pluie. J'ai reçu la douche ce matin en rentrant du travail à quatre heures. Ces nuages bas venant de l'ouest ne répondent pas aux exigences des champs dorés qui attendent la cueillette. Dois-je me réjouir ou regretter l'heureux anniversaire qui me donnait à vous d'une façon inespérée, comme une faveur avant de me livrer à l'horrible accueil que me réservait l'affreux Bois d'Avocourt ? Hélas il ne vous faudra pas cinq râtelots cette année ! Je me console de ce regret à l'heureuse et providentielle évocation, vieille de vingt ans, qui nous donnait l'un des appoints qui nous permet aujourd'hui de mieux supporter les si dures épreuves. Il est loin chère maman et largement démenti, ce regret d'avoir encore à bercer cette petite pleureuse, il y en avait déjà assez !... Elle ne pleure plus maintenant, pourvu qu'elle ne crie pas trop fort !... Comme le temps est trop précieux maintenant, attendez-moi pour fêter cette conscription privilégiée à qui j'adresse spécialement mes excuses et mes compliments en l'honneur de ses vingt ans. Pour l'occasion tous mes sentiments affectueusement compris dans un tendre et fraternel baiser. Louis.
|
le 28 juillet 1918
Bien chers aimés,
|
Quel sujet aborder pour sanctifier avec vous ce jour de repos ? Repos forcé pour vous par la pluie bienfaisante, repos habituel de tous les jours pour moi. Je me réjouis déjà à la pensée qu'un loisir va me gratifier d'une causerie un peu prolongée et variée et peut-être de la part d'une main à laquelle je ne suis pas habitué !... J'ai consacré l'autre jour quelques lignes au sujet de ce vingtième anniversaire qui ne manquera pas de trouver un sujet de réflexions privilégiées en ce jour favorable. Il ne s'arrêtera pas seulement à l'heureuse contemplation de ton épanouissante jeunesse ma chère Mad, mais il se reportera encore dix ans plus loin !... Hélas ma chère Berthe, chaque anniversaire à présent est, pour toi comme pour moi, la regrettable constatation de l'éloignement de la jeunesse et la course vers la vieillesse ! Je m'arrête sur ce sujet, peut-être aurai-je vos impressions synonymes. Peut-être sera-ce de la part de ce paysan qui, malgré l'émanation ammoniacale de ses innombrables brouettes de fumier et le monotone et assourdissant bruit de la faucheuse, son manque d'apparence de santé rebondissante de chair grasse, cache une cervelle volumineuse, au point de discerner tout ce que son état et sa condition demande de perfectionnement et par quels funestes entraînements elle est compromise. Ce n'est pas derrière des dessous pareils que l'on découvre le paysan rabougri et bourru auquel la modestie fait allusion, mon cher Henri. Et crois-tu que ce savant genre d'excuse puisse trouver une indulgence ? Allons donc, c'est plutôt une allusion manifeste adressée à la naïveté d'un partenaire !... Cependant le bonheur procuré par ta longue diatribe a bien surpassé mes méchantes réflexions en me donnant l'heureuse illusion que ce paysan arriéré n'a employé cet habile subterfuge que pour être plus longtemps avec moi, en me laissant l'unique regret de la rareté de ses faveurs.
|
|
Tu vois mon cher Henri, une petite causerie comme la tienne permet le tracé d'une grande feuille sans s'en apercevoir, étant inspiré par une douce affection, seul trésor qui est à notre disposition et qui permet l'achat des nombreuses fatigues et obstacles à surmonter.
|
|
Au sens propre, je ne vous ai rien dit encore d'intéressant. Pour moi, c'est l'essentiel. En guerre, l'intéressant, c'est le rôle des journalistes. En ce sens, tous les badauds sont satisfaits : ça marche bien ! On les aura !... Les immenses cimetières !... Je m'arrête, en vous exposant le particulièrement intéressant qui me concerne, qui se borne à exécrer cette vilaine pluie que j'ai endurée hier soir de neuf à douze heures en charriant des piquets. Jusqu'à trois heures ce matin repos pour tout les copains, pendant que je veillais à la porte de la sape (c'était mon tour) de trois à cinq, même travail sous la pluie. A part les P.P. c'est mon invariable emploi du temps, on attrape quelques heures de repos dans la journée à part les occupation indispensables. Néanmoins ce régime est très dur. Peut-être touche t'il à sa fin. Irons-nous à brève échéance prendre part à des fatigues plus sérieuses ?
|
|
Hier une carte m'apprenait le rôle des "Loups du Bois-le-Prêtre". Édouard n'aura pas resté longtemps en sécurité, puisqu'il est à la 10ème compagnie.
|
|
Je termine par ce que j'ai de meilleur, mes plus tendres baisers à tous. Louis.
|
le 31 juillet 1918
Bien chers aimés,
|
Je suis sûr que vous n'avez pas comme moi le temps à cette heure, la quatorzième, de passer une heure à griffonner une feuille de papier. Quel beau temps pour rentrer les moissons ! Si vous avez eu la température Meusienne, deux grands jours de pluie, samedi et dimanche, et ces deux derniers jours pour abattre quelques vingt ou trente cartes sans trop de chaleur, je n'attends de vous que de secrètes pensées. Mais puisqu'il est en mon pouvoir de partager un peu avec vous cette rude journée, je ne puis faire moins que de vous dédier quelques encourageantes paroles. Que ne puis-je le faire autrement !
|
|
Je ne veux pas le faire avec une prose de sentimentale lamentation, ce genre d'intimité n'est plus de mode après quatre ans d'existence. Nous sommes tous de plus en plus surpris par l'évolution des événements. Qui aurait pu croire ou même supposer qu'un peuple et même tout le monde entier aurait pu supporter quatre années de guerre, et encore combien avec, sans crier famine ? En somme, il n'y a que des restrictions supportables qui n'occasionnent que de petites récriminations insignifiantes. Cependant voilà quelques temps que notre ration de pain se borne à une distribution de galette qui n'a rien de fameux. Et vous, j'ignore le genre de soumission qui vous concerne à ce sujet ?
|
|
Toujours dans mon ravin en réserve, mon genre de vie ne fait que m'abrutir de plus en plus. Je ne puis sortir de cet état que lorsque je prends une feuille de papier à lettre où je déverse le trop plein de mon indignation, ou en suivant ma pensée en des lieux plus cléments. Vous allez peut-être croire que je suis comme certaines personnes de votre connaissance qui se plaignent par habitude. Eh ! bien je suis volontaire pour les Tanks ! C'est vous dire l'attrait que je trouve ici. Mais je ne crois qu'on accède à mes désirs, nous sommes trop nombreux.
|
|
Voilà plusieurs fois qu'Édouard se plaint de la rareté de vos nouvelles. Je crois que la faute en incombe à la pénurie du service postal dans sa région où ce service doit être relégué au second plan.
|
|
Je n'ajoute rien à mes plus affectueux baisers à tous. Louis.
|
le 2 août 1918
Chère petite soeur,
|
Évidemment, le plaisir de trouver l'occasion de te témoigner un peu d'affection n'avait pas pour objectif la possession d'une aussi jolie carte ! Néanmoins, je te sais bon gré du charmant résultat obtenu, tant au point de vue du bon goût dans le choix de la carte que, et surtout dans la parfaite expression de tes sentiments reconnaissants et affectueux. Mais ne crois-tu pas que tant d'effort et de bonne volonté ne sont que l'accomplissement d'un devoir auquel tu n'aurais pas voulu manquer. Et ce devoir c'est moi qui te l'aurais imposé ?
|
|
Cependant te voilà grande fille. Je n'ai plus rien à te commander, aussi je ne te donne que des avis pour le plus grand bien de ton inexpérience. Je l'attendais un peu, ta carte. Mais crois-tu que mon plaisir n'aurait pas été plus grand avec une carte beaucoup moins chère mais inattendue !...
|
|
J'espère que tu m'auras compris, et cette petite morale m'est suggérée par cette (trop inattendue, celle-ci) lettre qui m'arrive en même temps que ta carte.
|
|
Sans que je lui demande une deuxième fois, la sœur de mon ancien copain me gratifie de la lettre ci-jointe. Elle est bien aimable. Mais tu n'auras pas de peine à découvrir le double sens de sa lettre ; comme bien d'autres, elle redoute la coiffe de Sainte-Catherine (tu n'en es pas encore là). En s'efforçant de son mieux pour écrire, elle réussit presque à être ridicule. Quel contraste avec la culture de Maria. Ce que tu as pu apprécier. Vous allez, tu vas dire que je suis méchant mais je voudrais te prévenir contre pareille occasion. Si maman disparaissait subitement : réfléchis à ta situation et crois aux légitimes et sincères recommandations de ton frère Louis.
|
|
Tu diras à maman qu'elle aura sa lettre dimanche, pour ne rien changer aux habitudes. J'attends mon colis et termine en t'embrassant comme je t'aime.
|
|
Je sais bien que vous me lirez jusqu'au bout, même s'il y a beaucoup de gerbes à rentrer quand ce bavardage vous arrivera. Que diriez-vous si je vous traçais quatre phrases, comme Lanoix en a reçues hier : "Je réponds à ta lettre qui nous a fait plaisir. Lido et Baffet sont blessés. Tout le monde va bien. Je t'embrasse". C'est maigre, n'est-ce pas ? Et vous diriez comme "Quillo" de Trouvans... Cependant je m'arrête en pensant à une réflexion de Mme Besançon : "vaut mieux laisser ses lignes vides que les remplir en médisant !"
|
|
Je voudrais revenir un peu à votre lettre d'il y a huit jours, chère maman, à vos petites affaires qui vous prennent toutes vos forces physiques, même morales ! Moi aussi, ces dernières me font défaut par leur grande consommation. Cependant je ne perds pas tout à fait le Nord : je trouve 23 Ddl de seigle pour cent gerbes c'est au dessus de la moyenne, que 142 francs
(?) pour un veau de quinze jours ce n'est pas excessif, d'après le nouveau barème social. Ce n'est pas si Kolossal que
trois mille francs qui représentent la valeur du Noirot ! Avec ça, je pourrais louer une auto. Ce serait plus pratique pour faire les grandes courses. Il y a peut-être une amélioration avec le mois de mars à ce sujet mais ça ne fait rien !... Et puis je constate que l'"Oasis bourdonnante du numéro 18" ne perd pas de son activité.
|
|
Et puis en consolation aux funestes conséquences de la sécheresse je me représente une abondante production en graines de trèfle cette année, que vous n'allez pas négliger, j'espère. J'espérais vous quitter en assez bonne disposition, en compensation pour mes huit pages : cependant je ne puis le faire sans vous exprimer le regret que j'éprouve à attendre outre mesure votre envoi du 18, chère maman. Il se pourrait qu'un "glouglou" révélateur ait tenté la gourmandise criminelle de quelque peu scrupuleux employé
du service postal. |
|
Ce petit regret n'atténue nullement les tendres baisers que je vous adresse à tous. Louis.
|
|
Dites à la Marie que j'ai toujours le temps de penser à elle ! Que devient Emma ? Rappelez-moi à son bon souvenir.
|
le 4 août 1918
Bien chers aimés,
|
Encore une journée maussade au grand regret des Vernois. Si rien ne m'attachait à ce regret pour moi cela me serait bien égal, mais je ne puis être insensible aux fluctuations de la température qui pour vous sont capitales en l'époque. Je croyais la moisson plus avancée que votre lettre d'il y a huit jours me l'apprend, chère maman. Il est vrai que tout ce qui a rapport à la terre cette année ne m'arrive que par l'écho de vos lettres. Pensez donc depuis le 1er mai que je vis presque exclusivement dans la zone restreinte d'un boyau qu'il ne m'est permis d'escalader que la nuit. Aussi vous pouvez être persuadés que le printemps et l'été de cette année m'apparaissent d'une singulière façon.
|
|
Heureusement que le papier à lettre et le service postal assurent une liaison inappréciable entre notre existence et celle qu'un invincible espoir nous permet d'aspirer. Je voudrais déjà savoir ce que vous allez me dire cet après-midi, chère maman ! Mais il me faudra attendre jusqu'à vendredi. Que c'est long ! Figurez-vous que parmi votre bonne volonté et votre maternelle affection, je me trouve lésé en comparaison de certains copains que je jalouse secrètement. Je mets à part les hommes mariés ! Mais combien je vois d'hommes des pays envahis (dans mon régiment ils sont nombreux) recevoir chaque jour une lettre de leur marraine ! ceci n'est qu'une remarque et je sais bien que ne puis comparer votre situation à celle de la plupart de ces dernières qui souvent profitent de la venue du poilu pour faire une excursion à la montagne, aux bains de mer ou en tous cas le promène chaque soir au cinéma ou au théâtre. La perm est plus récréative que celle des gros proprios de Verne !
|
|
Une drôle de lettre que je vous fais aujourd'hui. Enfin c'est une façon de causer qui m'oblige à prendre une autre feuille.
|
le 5 août 1918
Chers aimés,
|
Quelques instants après vous avoir expédié mon petit bavardage hier, j'ai eu en fin de journée votre petite carte fantaisiste, chère maman, d'autant plus précieuse qu'en ce qu'elle fut écrite en vitesse au commencement d'une rude journée !
|
|
Pour moi, prendre une feuille pour vous remercier de ce bonheur, le seul qui me soit permis, est une faible rançon que je ne voudrais pas devoir plus longtemps.
|
|
D'autant plus que cette joie est déjà loin, vu que depuis hier j'ai changé de résidence. A la nuit tombante mais par une pluie battante, j'ai suivi le boyau qui longe le ravin hospitalier que j'habitais depuis quinze jours. Le ravin, le même qui conduit la voie ferrée vers l'Est, mais à l'abandon depuis quatre ans a son issue gardée par les casques à pointes en face desquels est établi mon P.P. La haine que nous nous gardons n'est pas à redouter vu la distance et le fil barbelé qui nous séparent ! Bien plus ennuyeuse est la boue du boyau qu'entretient ce temps brumeux et qui pour nous pourrait se changer en désastre ! Mais il ne faut pas anticiper sur les faits inconnus ni les grossir par des perspectives pessimistes. D'ailleurs, ce n'est pas la pluie qui empêchera les joyeux ébats du rejeton de la "Frasette", ni la prospérité de l'orphelin cueilli chez Machin. Heureuse et curieuse coïncidence. J'avais écrit et convié la tante à remonter la Boussenotte avec moi, à la prochaine perm. Ces bonnes intentions ont devancé mes désirs.
|
|
C'est sous ces heureux auspices que je vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
le 7 août 1918
Bien chers,
|
Comme j'ai pu vous paraître d'un bavardage excessif ces jours derniers, j'ai l'intention de m'imposer une petite restriction aujourd'hui. Cependant, si la poste marche normalement peut-être serez-vous un peu content de recevoir cette feuille dimanche. Et puis, ce retour du soleil, en séchant un peu ma capote et la boue gluante, surtout ici dans ce sol compact, en même temps que le ciel éclaircit un peu les idées. Celles-ci d'ailleurs ne sont troublées par aucun événement mais un peu seulement par la maudite pluie de ces jours derniers.
|
|
Je croyais remplir quatre pages en vous parlant de mon colis mais il n'y a plus qu'à en faire son deuil.
Édouard, en date du 31, évoque les souvenirs de 1914 qui sont plus vivaces pour Julien que pour moi. Il doit être en première ligne.
|
|
Je complète mon envoi par ces deux cartes que je trouve que c'est dommage de passer par les flammes. Vous voudrez bien les ranger pour moi. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
|
En allant à la soupe ce matin, Lanoix m'apprend que Barraud Alfred est amputé d'une jambe. Un de ses copains laitier à
Épernay (?) est amputé de deux doigts et d'un œil deux jours après ma relève aux Courrières. Heureuses libérations ! Préférables au contingent de la classe 80 !
|
le 10 août 1918
Bien chers aimés,
|
Ce n'est pas mon jour habituel pour vous faire une lettre. Mais puisque j'ai pu puiser hier à deux sources successives le baume réconfortant, je ne saurais me mettre en retard pour venir vous en apprendre tous les bienfaits. Et puis j'en ai tout le loisir. Ayant été relevé des A.P. cette nuit, ce jour est pour moi un changement dans mes occupations comme pour vous le passage de la faux à la pioche par exemple. Je suis toujours militaire, peut-être davantage, mais moins en danger. Des sapes profondes creusées sous les ruines d'un petit village au pied d'un fort de l'enceinte immédiate nous abritent. Nous allons aller aux douches cet après-midi dans l'ancienne installation d'une des casernes non loin d'ici, quelques bâtiments ne sont pas complètement éventrés. Qu'adviendra t'il de nous ? Je l'ignore encore. Les autres bataillons sont encore en ligne dans le secteur redouté où j'ai passé huit jours il y a un mois. Peut-être y retournerons-nous. Ou bien allons-nous partir à la poursuite de l'ennemi que les journaux vont nous apprendre ce soir !
|
|
Mon cher Julien, est-ce en vertu de la haute valeur de l'expression de ta pensée qu'elle se manifeste si rarement ? En tous cas, je fus très confus d'en recevoir un écho personnel et recueillir en même temps l'opinion que tu as de l'incessante lamentation qui trace la marche de ma situation. Naturellement, c'est de la rage philosophique que d'accepter un sacrifice, ce que nous ne pouvons éviter. Mais tel n'est pas le cas pour les malheurs présents, et les accepter c'est les encourager ; c'est ton cas, ce qui n'est pas digne d'éloge, quant à les subir, c'est le mien, de cas, qui devrait avoir droit à la commisération qui ressort de ton affection. Crois-tu qu'il y ait bien loin de ta mentalité avec celle de ce rustique qui aurait volontiers donné son fils à ce grand courant général et qui devient criminel dès qu'on lui ravit son bœuf ? je m'arrête, je n'ai pas l'intention de te convaincre par écrit et dois aussi un petit mot à l'adresse de maman, qui en dehors de son amour maternel serait plus près de la réalité que toi. Elle ne fut pas comme toi depuis sa jeunesse hypnotisée par les attraits nickelés de ces principes qui ont et conduiront toujours les peuples aux pires calamités qui n'épargnent pas même les Grands du jour, fut-il un innocent Malvy !... A peine la place pour envoyer mes tendres pensées à tous ces artisans de la moisson, qui vont dire que je ne dis pas grand chose, mais qui sauront apprécier la chaleur de mon baiser. Louis.
|
Assomption 1918
Bien chers aimés,
|
J'espérais en ce jour de fête pouvoir vous faire une petite causerie avec une sérénité d'âme permise par les douceurs du repos. Mais ce dernier a pris fin hier soir où il m'a fallu remonter en ligne. Pour moi, j'ai eu une petite pointe de regret, j'espérais sanctifier un peu ce jour de Marie avec le concours de l'aumônier qui était déjà venu dimanche dernier nous apporter quelques paroles de réconfort dans un souterrain. Il y a longtemps que cela ne m'était pas arrivé, aussi je garde un agréable souvenir de ces quelques jours de délassement. Dans une époque aussi mouvementée (et en pleine moisson) cinq jours d'oisiveté sont appréciables, à tel point que je ne savais que faire du soir au matin. Depuis le temps que je ne connaissais que quelques heures de somme, tel un garde-malade qui ne veut pas quitter le chevet d'un être cher.
|
|
Me voici donc, non pas dans mon secteur tranquille, mais dans celui que je vous ai déjà décrit, avec tous ses décors lugubres où j'avais déjà passé huit jours. C'est l'étoile polaire qui fut le point de direction dans la marche de hier soir, cela ne vaut pas le soleil levant.
|
|
Est-ce pour justifier mes sombres pronostics ou pour fêter le 15 août les boches sont en train de faire un arrosage complet des nombreux ravins de la région, sans toutefois nous avoir repéré particulièrement. Ces pauvres ravins, qu'y cherchent-ils, depuis deux ans passés qu'ils sont cultivés par le fer et le feu ! Enfin j'espère qu'ils se calmeront un peu et que je resterai sous la trajectoire du sifflement des marmites. Pour quelques jours je resterai assez loin des premières lignes, deux ou trois kilomètres en réserve, et n'aurai pas à redouter les restrictions du ravitaillement nocturne des P.P. en cette région. Peut-être aussi, il en est question, aurons-nous une relève générale qui nous donnera un grand repos. Mais cette fois avec embarquement. Pourrons-nous revoir des (civelottes) comme disent les poilus ou des (gonzesses) enfin autre chose que la dévastation ou la ruine. Mais ce repos sera significatif. Nous devons être troupes fraîches depuis avril, presque sans pertes !
|
|
Oui ! Mais peut-être pourrait-il des fois me procurer le bonheur de la perm ! Ah ! Cette chère perm ! Le troisième tour est commencé, avec deux mois de retard. On nous les promet abondantes, tellement que dans vingt jours mon tour arriverait ! Je n'ose à peine y croire, tellement elles subissent d'anicroches. Je n'oublie pas que des copains s'étant faits annoncer pour Pâques sont arrivés pour la Trinité ! Je sais bien que maintenant nos garanties ne sont plus à la merci de l'ennemi. Enfin espérons encore et toujours !
|
|
Ce pauvre Pastif me fait part de ses misères, qui sont faciles à comprendre étant toujours sur la Vesle, sans aucune perm. Beaucoup plus heureux,
Édouard me gratifie de huit pages, sans oser me dire tout son enthousiasme à cause de mon accueil qu'il devine.
|
|
Je ne remplis pas l'autre feuille afin que ma lettre parte aujourd'hui, l'agent de liaison m'attend, j'aurais cependant bien aimé compléter ma lettre en me portant parmi vous, et tout ce que ce beau soleil me dit de vous. Je compte sur une lettre demain, et vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
le 18 août 1918
Bien chers aimés,
|
Il est midi ! entre le Fort immortel et le bois lugubre le calme est impressionnant ! Contrairement à ces jours derniers les boches conservent leurs munitions. Est-ce en raison du frais brouillard qui nous est revenu depuis ce matin ? Cela se peut. Le repérage n'est pas aussi exact que par temps clair. Et puis ces pauvres ravins en ont assez. La ferraille y est plus abondante que la terre. Plus je connais ces coins, plus la lutte qui a dû s'y passer m'apparaît terrible. C'est une merveille de se rappeler comment nous (pas moi) avons pu reprendre en si peu de temps ce qui avait tant coûté de pertes à l'ennemi. Mais aussi combien de petites croix en marquent le prix et combien de malheureux n'en possèdent point. C'est sans doute en raison de la férocité dont furent témoins ces régions qu'elles semblent être condamnées en un désert qu'entretient un bombardement régulier. C'est sans doute en raison aussi de la valeur et de la sécurité de ce matériel d'artillerie que je dois la longueur de mon séjour ici. Cependant il semble vouloir bientôt toucher à sa fin. Je ne pense pas remonter jusqu'aux petits postes et déjà nous recommençons à veiller à la sécurité de nos chaussures et bagages.
|
|
Où allons-nous villégiaturer huit ou dix jours ? A ce sujet les "canards" vont leur train, de la cuisine au fond de la sape !... Quant au motif de ces voyages, il ne laisse aucun doute !... Me laissera t'il auparavant le bonheur d'aller jusqu'à vous ? Ce serait prématuré de l'affirmer dès aujourd'hui.
|
|
Cependant ma pensée s'y trouve déjà et cherche à m'apprendre ce que vous faites : pas grand chose me semble t'il. Plus rien d'urgent ne doit vous ravir quelques instants de repos après une période si bien remplie. Il me faudra attendre jusqu'à vendredi pour avoir la certitude de ces consolantes nouvelles, à moins qu'en son jour de fête la Vierge ne m'ait procuré ou permis un petit entretien. Je garde ce petit espoir et vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
|
En date du 12 Édouard m'envoie un petit mot avant de monter aux P.P. du coté Soissons. Grisé par les derniers événements il ne trouve rien d'autre à me faire part que son optimisme débordant. Mon ami Palmyre est pas mal remonté lui aussi par son poste de secrétaire au recrutement de Belfort. Il est auxiliaire
(?), cela vaut mieux que bouif en Alsace.
|
le 21 août 1918
Chers aimés,
|
Toujours dans l'attente du départ, les jours me deviennent longs dans mon ravin sauvage. Cependant c'est sans doute la dernière lettre que je trace pour vous. Je vous enverrai un prochain message écrit sous un ciel plus clément mais sans doute où je n'aurai pas les loisirs si sereins qu'ici. Voilà huit jours que nous sommes en repos pourrait-on dire si ce n'était notre situation en réserve, prêts à bondir en cas d'attaque. Le commandant de compagnie, un jeune lieutenant sans éloge, pour ne pas médire, et en perm, d'où le bénéfice d'un relâchement dans le service. Aussi je crois bien que j'ai rattrapé tout l'arriéré de sommeil qui m'avait tant manqué. C'est vous dire, avec toute sa valeur, la banale mais significative phrase : "Je vais bien !"
|
|
Que vous dire pour agrémenter ce petit entretien ? Les journaux vous renseignent mieux que moi sur l'heureuse évolution de la guerre. Dans ma zone calme, les obus y passent presque journellement. Mais nous avons eu notre part avant-hier. L'un deux tombant à quelques mètres devant nos "cagnias" nous fit rentrer jusqu'à ce que la hausse fut changée. Mais tant que ce n'est pas un feu de barrage ce n'est rien, la terre est si grande !
|
|
Quel beau soleil pour répondre aux désirs des stratèges aux mains desquels nous appartenons. Aujourd'hui pas un nuage au ciel, à part les flocons innombrables qui marquent l'éclatement d'obus des batteries antiaériennes. Ce qui n'empêche pas les évolutions des rois de l'air ! J'arrête mes descriptions qui pourraient fausser mon opinion guerrière, que vous connaissez.
|
|
Vous ne m'avez pas encore trop blâmé le désolant tableau que trace la sécheresse. Cependant ces incendies continuels qui sont signalés presque dans toute la France sont significatifs. Je sais bien que l'année n'est pas compromise puisque il y a du foin pour l'écurie et du grain pour le restant de la maison. Mais hélas, les regains ne tiendront pas une grosse place, et il me semble que les officiers de la réquisition seront les bienvenus dans les écuries.
|
le 25 août 1918
Bien chers aimés,
|
La petite carte-souvenir partie à votre adresse hier ne m'empêche pas ma principale sanctification du dimanche.
|
|
Midi ! La cherté du pinard n'a pas empêché les libations depuis le matin ! Aussi les manifestations sont bruyantes et avinées dans les cantonnements. Vous ne serez donc pas surpris que je vous trace ceci, assis sur une tombe du cimetière du petit village hospitalier. Je ne pouvais choisir un lieu plus recueilli pour être sans distraction avec vous. Vous n'allez même pas vous en formaliser n'étant pas plus superstitieux que moi ! Tenez voici même l'âge de mon compagnon souterrain, X décédé le 17 mars 1874 à l'âge de 85 ans !...
|
|
Aujourd'hui ici, je célèbre ma fête en solitaire, à moins que le vaguemestre ne m'apporte un compagnon en fin de journée !... La température est idéale, un orage bienfaisant ayant rafraîchi l'atmosphère brûlante, ce qui fut appréciable pour faire les quarante kilomètres d'auto qui nous ont déposés ici, et encore pour faire les quinze à vingt kilomètres qu'il faudra s'appuyer ce soir à pied pour rejoindre la gare d'embarquement. J'apprécie aussi ce beau dimanche qu'il m'est permis de sanctifier doublement. L'église nous voisine, je ne pouvais pas me refuser d'entendre la messe du prêtre soldat de ma compagnie, parmi l'assistance des fidèles des villages voisins. Peut-être n'êtes-vous pas si favorisés que moi aujourd'hui ? Cela ne m'a pas empêché de faire ma petite lessive ce matin que je viens de rentrer bien sèche. Est-il permis à un poilu de donner de meilleures nouvelles, assurément non ? Ajoutez-y la satisfaction réciproque qui me fut procurée hier par votre lettre de dimanche dernier, chère maman, et je ne puis faire autrement que de répondre à vos maternelles exhortations.
|
|
Les perms vont toujours tout doucement, depuis le 10 août cela fait de zéro à vingt-trois de parti, moi j'ai le numéro quarante-trois !... Je viens de donner mon paquet de tabac à un copain qui va partir pour l'Aveyron. Je ne puis collectionner dès à présent cher papa d'ici quinze jours, j'ai trop à voyager et trop d'incertitude. Mon copain de Fontaine, Cédoz vient de rentrer de perm, il me dit qu'il ne reste plus guère grand chose à récolter à part les pommes de terre qui seront belles. Pourrai-je gagner ma vie quand j'irai à mon tour ? D'ici quinze à vingt jours il n'y aura plus rien à faire. Je pourrai toujours aller aux champs !
|
|
La tante me dit qu'il faut vous envoyer une dépêche afin que la calèche soit au train et qu'il fait bon dedans !... Mais n'allez pas partir tout de suite, je ne vous donne encore pas l'heure ni même le jour, mais seulement mon espoir persistant; mon copain de Saint-Fergeux est ou va partir incessamment. Il fut avantagé dans son tour dans une compagnie autre que la mienne. Moi, j'accepte ma chance habituelle et vous embrasse tous tendrement. Louis.
|
|
Édouard ne me souffle mot de la sienne non plus, il y a autre chose à faire dans ses coins. J'attends de ses nouvelles, ses dernières datent du 15 ! Je n'ai plus le motif de remplir une autre feuille. Et plus que la place stricte pour
vous embrasser tous comme je vous aime. Louis.
|
le 24 août 1918
|
En souvenir du petit village Meusien, témoin des yeux ahuris qui regardent des arbres, des maisons, des hommes ou des femmes desquels ils n'avaient plus aucune notion. Mais cela se paye à raison de deux sous le litre de pinard. Les spéculateurs regrettent le Bois des Courrières où il n'était qu'à un sou. Moi je ne regrette que ce court séjour qu'il me faudra quitter demain soir, mais qui n'atténue en rien mon tendre baiser à tous. Louis.
|
le 27 août 1918
|
Puisque le départ imprévu du train n'a pas permis l'expédition de ma carte, je la rafraîchis aujourd'hui par cette feuille. Oh ! Il fait meilleur écrire que hier, si ce n'était mes yeux fatigués qui demandent le sommeil. Bien à l'ombre dans le bosquet qui orne une des riches fermes de Brie, non loin des bois qui t'ont
(?) délivré mon cher Julien ! |
|
Jamais je n'avais vu des tas de gerbes aussi épais ! Et de l'avoine de un mètre cinquante. Pauvres petites gerbes Meusiennes de cinquante centimètres qui me rappelaient Fontenotte ou le Bout de Verdot. Mais tout le monde ne peut pas jouir du jardin de la France ! Pas même le rapace et ambitieux boche ! Déjà ici du barbelé coupe ces superbes pièces de terre, il y en a de 1914 et 1918. Au nord, le roulement du canon me rappelle que je ne suis pas venu ici en amateur ! Peut-être les autos qui doivent me conduire à proximité de ce bruit sont-elles déjà commandées ! Alors, au revoir et à plus tard les miroitants projets de la prochaine perm. Il ne faut pas se leurrer sur un repos en cette saison. Notre tour est venu de prendre part à l'œuvre sérieuse. C'était prévu. Je vous récrirai probablement depuis les A.P.
|
|
Pour aujourd'hui je vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
|
Le vaguemestre a dû nous perdre en route, nous ne le voyons plus.
|
le 29 août 1918
Chers aimés,
|
Une journée de marche à pied ou en camion et me voici dans la Somme.
|
|
Nous nous préparons à l'action, cartouches et singe à profusion, qu'en adviendra t'il ? Le canon fait rage. Mon cher Julien, je crois que je vais faire repasser les boches le fameux front sur lequel tu te rabattais en 15, mais à présent il n'y a pas tant d'eau.
|
|
Une carte sans explication me donne l'adresse d'Édouard à Orléans. Il me tarde d'avoir les détails et la nature de sa blessure. Vous irez le voir, chère maman. J'ai eu aussi une avalanche de vœux affectueux à l'occasion de la Saint-Louis. Je ne peux exprimer toute la reconnaissance qui en découle.
|
|
J'espère que ces vœux seront exaucés. Je vais monter avec confiance et espoir. J'ai dit à
Édouard qu'il me réserve un lit et à vous je dis au revoir et vous offre un de mes meilleurs baisers. Louis.
|
le 30 août 1918 19h
Chers aimés,
|
Malgré ce mauvais papier américain où l'encre fait tache, vous serez un peu rassurés en reconnaissant mon écriture. D'après mon billet au crayon de hier matin, vous êtes en droit d'être inquiets sur mon sort. Voilà deux jours que je suis l'arme au pied, prêt à partir sur un ordre qui n'est pas encore venu. Mais il n'y a rien de perdu, et il ne m'est pas permis d'écrire ce que je pense de cet ajournement. Mais il se pourrait bien que le communiqué vous annonce la danse qui se prépare pour moi, avant le reçu de cette lettre. Vous pourriez bien être quelques temps sans que je ne vous envoie ou ne receviez quelque chose de moi, vous devinez les difficultés d'écrire parfois, ainsi que le retard imposé aux lettres en ces moments. Et si quelque malheur m'arrivait, un camarade quelconque vous écrira la vérité au plus tôt. Rien à présent n'est de nature à surprendre, il faut s'attendre à tout être prêt d'avance à réagir contre la pire des catastrophes. Sage est celui qui d'un malheur en conjure un second !
|
|
N'allez pas croire d'après mon opinion et mon esprit souvent indigné que je vous fais des recommandations dans un instant de suprême résignation désespérée. Je pars ou partirai avec une confiance tranquille d'au revoir.
|
|
J'ai eu ce soir à lire toute une brassée de billets réconfortants. C'est vous qui m'apprenez la nature de la blessure d'Édouard, qui a l'air rassurante. Je suis surpris qu'il ne me le dise pas.
|
|
Je vous joins la paternelle lettre de Mr. Fourgeot que vous rangerez, pour mon retour. Marie Coulon me gratifie d'un aimable petit mot, ainsi que Mme Besançon, toujours malade.
|
|
Rien d'autre que mon bonsoir et mes tendres baisers. Louis.
|
le 31 août 1918 9h
Chers aimés,
|
Depuis deux heures que je suis prêt à partir, et toujours rien. C'est ainsi la guerre. Défense d'enlever l'équipement, de s'éloigner, à plus forte raison de prendre le temps de faire la soupe ou d'aller à la rivière pour un peu se nettoyer. L'on ne mange pas grand chose, l'on ne repose pas et l'on ne fait rien. A force de vivre l'illusion de son dernier jour on fini par croire qu'il ne viendra pas. Mais je ne m'y trompe pas et ne veux pas vous tromper. La mise au point de l'œuvre qu'il nous faut accomplir n'est sans doute pas achevée et notre action n'en est que retardée. Sera-ce pour ce soir ? Peut-être. Je reste persuadé que l'Armée Mangin fera parler d'elle. Ce matin sur notre gauche, le feu roulant marchait grand train. Nous ne voyons plus de journaux mais je suis sûr que leurs en-têtes continuent à entretenir l'enthousiasme de l'arrière. Qu'importe le nombre de petites croix qui font de la terre française un vaste cimetière !...
|
|
Ceci rattrapera peut-être ce que je vous ai écris hier soir. Mais qu'importe, puisque j'ai le temps de causer aujourd'hui avec vous. Peut-être demain ne pourrais-je pas le faire malgré que c'est dimanche. Et puis j'ai oublié de glisser la lettre de Mr. Fourgeot que j'annonçais. Cela me donne un double motif de sortir mon crayon pendant que mes copains s'allongent n'importe où et n'importe comment.
|
|
J'ai déjà relu ce matin vos deux lettres des 26 et 27 chère maman, qui m'ont un instant transporté au Paradis, puisqu'ici c'est l'enfer où je vais entrer ! Néanmoins, je m'intéresse beaucoup à ces doubles attelages de chevaux, l'un fauchant, l'autre labourant pendant que vous me transmettez la pensée de tous. Vous direz à Mad que je n'oublie pas sa prévenance à l'occasion de la Saint-Louis.
|
|
Je ne sais plus si je vous ai dit la surprise pour la même occasion que me réservait notre petite Victoria. Je n'ai pas eu le temps en route d'acheter des cartes de convenances pour répondre à ces gentillesses.
|
|
Rassurez-vous chère maman, sur l'état de mon porte-monnaie, vous savez peut-être que chaque jour de tranchée rapporte vingt sous supplémentaires et que je n'y manque pas souvent. Et puis
Édouard supplée à l'état de vie chère par des mensualités régulières. Et l'état d'incertitude dans lequel je me trouve n'autorise pas des précautions superflues, ce serait plutôt ridicule. Il me reste à vous embrasser tous comme je vous aime. Louis.
|
le 4 septembre 1918
Bien chers aimés,
|
Tout ce que j'avais pu vous décrire des horreurs de la guerre à Verdun était un souvenir presque vécu. Mais me trouver précipitamment parmi les ruines fumantes des villages démolis, au milieu du vacarme assourdissant des innombrables batteries ou des nuées d'avions, côtoyer des morts ou des blessés, vivre dans un nuage de poussière soulevée par les interminables convois d'autos, harassé de fatigue par d'interminables déplacements, et naturellement rien à se mettre sous la dent autre que la ration de l'ordinaire et je ne suis pas encore au régime des biscuits ! Et n'ai encore pas goûté le sifflement des balles et des obus ! Mais cette préparation subite après avoir frisé les douceurs de la perm m'avait un peu affolé. D'où la révélation et l'inquiétude prématurée que je vous ai causée dès que je me suis rendu compte du rôle nouveau dans lequel je suis entré.
|
|
Mais vous voyez que j'ai encore eu le temps de faire mon testament ! Oh ! je ne peux donner encore aucune garantie sur l'avenir. Notre tour n'est pas encore venu, je ne suis qu'un peu ressaisi et suis heureux de vous en faire part. Cela tient en bonne partie à la grande nuit de repos que je viens de prendre en toute sécurité dans une grotte solide. Tu dois connaître ça mon cher Julien, tu utilisais les mêmes abris il y a quatre ans.
|
|
Assez parlé de guerre. J'aimerais mieux parler de ce qui se passe autour de vous. De ce temps là, vous n'allez pas avoir pour bien longtemps à récolter. Vous avez sûrement de l'hébergeage à céder avec vos deux ou trois maisons. Vous ne dites rien de vos deux locataires, sont-ils encore là ? Aurez-vous des prunes cette année ? Tous les Normands et Bretons de mon entourage signalent l'absence totale des pommes cette année. D'où la cherté du cidre. Par contre, je suis sûr qu'il y aura du vin à Gouhélans ! Il ne me sera donc pas permis de vivre parmi les produits de la terre cette année ! Je crois que la blessure d'Édouard n'est pas inquiétante. Pourvu qu'elle ne soit pas remis trop tôt.
|
|
Vous aurez sans doute connaissance du petit boniment que j'ai fait hier à ma chère Marraine. Mes lettres doivent mettre du temps à vous parvenir, mais mes tendres baisers à tous n'en sont pas moins affectueux. Louis.
|
Sous la tente, le 8 septembre 1918
Bien chers aimés,
|
Trois jours sans vous écrire cela va vous paraître en peu long, je le reconnais. Rassurez-vous, rien de plus nouveau n'a motivé ni empêché un mot urgent. Et toujours en vue d'atténuer le poids à traîner je ne me suis pas embarrassé de papier à lettres et durant ces longues journées de répit que je viens de passer je suis obligé d'en faire un emploi parcimonieux. Oh ! pas à votre égard, pour ça j'en trouverai toujours. Mais bien de mes correspondants s'en ressentiront. Et puis hier j'ai consacré une feuille à
Édouard en réponse à une lettre qui a mis deux jours à m'arriver. Il fait si bon de répondre à des nouvelles fraîches. Je croyais augmenter ma causerie dominicale en répondant à un supplément à votre carte pressée de lundi chère maman, mais rien n'est venu, pourtant elles viennent vite ici les lettres, un jour plus tôt qu'à Verdun !
|
|
Toujours en réserve, je ne connais pas la date de notre participation à l'attaque. Ce sont les autres régiments de la D.I. qui tiennent les lignes. Notre tour viendra avant la paix. Pour nous, sont réservées les grosses marmites empoisonnées par les gaz. Heureusement que ces derniers jours furent tranquilles pour me reposer un peu. Le régime mouvementé après quinze jours consécutifs m'avait anéanti. Avec les trente et quelques kilogrammes à endosser, il ne me faut pas aller bien loin pour tremper la chemise, ce qui m'arrive combien de fois par jour ? Et rien pour changer. La tenue d'assaut supprime même la veste. Mais la grippe y trouve un gîte confortable. En y ajoutant quelques gaz les boches font prendre le chemin de l'hôpital à de nombreux copains. Moi je vais un peu mieux.
|
|
Ce sont là de petits détails que les bleus confient à leur maman. Mais qui se répètent pour la septième année sur mon pauvre organisme. Je m'épouvante sur les résultats d'un tel martyr. Mais qu'importe mes légitimes lamentations et celles de quelques millions de sacrifiés, l'opinion est au comble de l'enthousiasme ! J'ai assez de misères sans m'étendre sur celles qui se déroulent sur ma route : partout l'horrible spectacle des combats récents avec tout ce qu'ils laissent sur leurs traces. Bienheureux quand on n'a pas à réagir contre l'odeur suffocante de chair en putréfaction que l'on n'a pas toujours les temps d'enfouir profondément et qui reste ainsi. Pas un coin de bois qui ne soit haché par la mitraille ou de gros arbres coupés par un seul obus. Ces pauvres villages reconquis, pas une maison debout.
|
|
Je ne veux pas tout vous dire aujourd'hui, j'espère avoir encore le temps plus tard. Il faut que je fasse une réponse à Georges qui me fait part de son voyage à Verne et a appris par vous ma nouvelle situation. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
le 9 septembre 1918
Chers aimés,
|
Cette simple feuille pourra peut-être prendre des raccourcis appréciables et vous rassurer plus tôt sur ma situation sans changement et... assez bonne. Mon cher Henri, en fin de soirée j'avais hier ta lettre-carte du 3 à laquelle je n'ai pas grand commentaire à ajouter.
|
|
Je viens de faire une petite lettre à Victoria de Fontenelle, j'envoie une carte à
Édouard et vous embrasse tous. Louis.
|
|
Mes amitiés au "Gros".
|
le 11 septembre 1918
Bien chers aimés,
|
Je viens d'essayer de faire un petit repos. Mais le bout de viande cuit depuis hier n'a pas voulu descendre. Je n'avais plus qu'à manger mon bout de pain sec afin de boire mon quart de "pinard". Lui, le pinard va toujours. Alors je me décide à faire une petite lettre, il me semble que ça ira mieux. Je ne sais pas comment elle vous arrivera ni quand, car pour sortir d'ici ce n'est pas commode. Le chemin de la victoire est comme celui du paradis !...
|
|
C'est ce chemin que j'ai pris avant-hier soir, après vous avoir adressé une carte. Me voici en scène, mais pas en première. Les boches sont bien encore à quatre ou cinq cents mètres. J'ai seulement leurs obus qui joints aux nôtres font un roulement et un sifflement ininterrompu. Comme pour marquer notre mise en action, la pluie s'est mise à tomber dès notre départ et hier toute la journée. Tout ce que je possède fut littéralement trempé, et je me surprends à trouver du papier à lettre qui soit encore utilisable. C'est donc la capote ruisselante que je me suis mis à creuser un trou individuel dans une de nos anciennes tranchées. Le sifflement des obus et des balles dominait la fatigue et le dégoût de remuer une terre qui devenait du mortier. Mais à tout prix il me fallait un trou pour éviter d'être mitraillé par les avions dans la journée ! Et la pluie tombait toujours ! Si bien que me petite pelle-bêche ne trouvait plus que de l'eau à déplacer et moi je devenais un morceau de boue mouvante, ainsi que mes camarades. Cette nuit je fus de soupe, ce qui m'a permis de me déraidir un peu. Le soleil étant revenu aujourd'hui achève de nous ressusciter. Si bien que j'ai le courage de vous communiquer mes misères. Néanmoins, j'espère malgré tout sortir de mon bourbier, peut-être pas trop bien disposé, mais suffisamment pour vous prouver que mon cœur reste celui de
votre Louis.
|
le 19 septembre 1918
Chers aimés,
|
Le courage me manque plus que le temps. Aussi cette carte vient à l'aide du désir de vous envoyer un mot, une grande feuille me serait trop embarrassante.
|
|
J'ai quitté le trou voisin du boche sans avoir pu le déloger à coups de grenade, mais sans prendre le chemin de l'arrière. Après une nuit très noire à voyager, perdu sous une douche de pluie et de sueur, je me sèche dans un abri en ciment, entassé au milieu des camarades. Il me semble que mes membres vont se paralyser complètement. Les grosses marmites ébranlent la profondeur de mon souterrain et obligent les groupes, la plupart blessés, de Franco-boches à rechercher l'entrée de mon abri.
|
|
Mon cher Julien, un souvenir de Altkirch me revient avec le tien qui date des premiers jours de 1914 ! Le voisinage et la vue de tes anciens copains ou mieux de ton ancien numéro de régiment me rappelle le jour où je te cherchais. Le tableau n'a pas changé, des mines effarées, déroutées, découragées comme je le suis actuellement, mais avec l'invisible puissance qui fait durer la guerre : l'espérance. Je garde celui de la relève proche et vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
le 21 septembre 1918
Bien chers aimés,
|
Je viens de recevoir chère maman l'écho de votre voyage à Baume du mardi 17, qui comportait la livraison du "Villers-le-Sec" acheté en l'occurrence. Le plaisir de recevoir cette simple carte-lettre dans le fond de mon terrier me procure un plaisir qui me fait prendre une grande feuille pour y répondre de suite.
|
|
C'est qu'un petit brin de soleil m'a rendu un peu de courage qui était renfermé avant-hier sous la charge de ma capote pleine d'eau et de boue ! Sans parler de ma chemise pleine d'autre chose, après avoir été trempé combien de fois par l'eau et la sueur, sans en avoir d'autre pour changer ! Ah ! ces détails de la gloire à la Mangin ! Non je n'ai pas trop de cette grande feuille pour vous transmettre mon indignation inspirée par vingt jours de bataille ! Une accalmie forcée me permet ce débordement de misères que je suis heureux de pouvoir confier en un lieu accueillant ! Dois-je m'estimer heureux de pouvoir encore le faire ? Combien de camarades ne peuvent plus le faire ? Depuis mon Colonel qui fut tué jusqu'à mon caporal tué à mes cotés, combien en est-il resté ? Pour ne citer que les têtes de marque. Mon Colonel de bataillon et celui de compagnie furent blessés, mon adjudant tué, mon sergent blessé. Jusqu'à mon inséparable Lanoix, duquel je n'ai pu avoir d'autre renseignement que celui de disparu (mais ne jetez pas une alarme prématurée, je n'ai pu encore que rencontrer quelques hommes de sa compagnie absolument indifférents). Un homme est si peu de chose ! J'ai vu des Français dans la plaine tués depuis plus de quinze jours ! Et dire que je ne puis encore pas vous apprendre une relève certaine.
|
|
Cependant je ne crois pas que nous allons encore attaquer, cela se calme plutôt de notre coté, mais la résistance s'affirme en face. Il en coûtera cher pour aborder le fameux Chemin qui n'est plus qu'à un bond. Ma Division a progressé depuis que nous sommes ici d'environ quinze kilomètres, mais quelle conquête : un désert !
|
|
C'est sur cette petite boutade joviale que je vous quitte et vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
le 22 septembre 1918
Bien chers aimés,
|
Saint-Maurice me permet un réveil supportable ce matin ! Sans toutefois me promettre que je monterai le "Chemin Neuf" avec dix sous en poche comme jadis pour aller le fêter à Tournans, ce soir !
|
|
Cependant il me donne la force de retrouver ma plume et mon encre pour vous adresser cette feuille en ce jour. Ce plaisir, cette faveur vous revient bien un peu en partie chère maman, puisque votre petit envoi a réussi à me parvenir, je vous dois bien ceci en supplément à ce que j'ai confié hier au ravitaillement. Le tout en bon état, je n'ai pas encore goûté à la târe
(?), dans un instant je ferai une entrée au jambon dans mon déjeuner, ce sera aussi la sortie.
|
|
En guise d'encouragement on vient de nous annoncer la relève des P.P. par nous ce soir. Environ deux ou trois kilomètres plus avancés que nous ne sommes. Ils veulent donc tous nous exterminer avant la relève ! Pauvres Français, nous avons de la chance, grâce à l'intervention américaine. Enfin cela suffit, il y a trente et quelques millions de badauds français qui se figurent que l'armée boche est en déroute ! Tant pis pour le million de martyrs sacrifiés qui geignent dans leur trou.
|
|
Je ne suis pas surpris, je sais ce que c'est, et espère bien tout de même redescendre encore cette fois. Mais à quand la perm espérée ? L'échéance en est encore retardée à une date indéterminée contrairement aux habitudes financières.
|
|
Je vous joins ce que Mme Besançon m'a fait connaître au sujet de sa demande hospitalière. Ni vous, ni elle, chère maman, n'êtes assez explicite afin que je comprenne le sens de sa demande qui doit vous être présentée sous certaines conditions que je ne puis deviner. A présent la question doit être tranchée. Je ne puis qu'y accéder et vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
le 24 septembre 1918
Bien chers aimés,
|
Je n'avais pas l'intention de vous adresser mon petit communiqué aujourd'hui. Son caractère miséreux dure depuis trop longtemps pour être répété bien souvent. Mais puisque votre bonne lettre de vendredi l'est arrivée ce matin chère maman, je me décide à vous en accuser réception et traçant ceci pour le confier au cuisinier ce soir.
|
|
Cette encre violette avec son symbole que vous me reproduisez comme préambule m'ont fait trop plaisir pour que je ne vienne pas en causer un peu avec vous. Pour une maman qui se dit en enfance, la conversation est encore assez intéressante et vaut la peine d'entamer. D'ailleurs vous avez encore la confiance de toute la maison puisque vous me renseignez si bien sur le rôle de chacun. Je vois que vous n'avez pas encore donné les cochons à Brepson
(?)... |
|
Encore un peu, c'est vous qui m'auriez appris le sort de Lanoix. Il fut quitte le jour de l'assaut. Tandis que moi, il me faudra endosser toute la série des jours sous la mitraille. Heureusement que vos bonnes lettres me parviennent, car c'est moi qui viendrait en enfance. Toute la journée sans oser sortir de mon trou de peur des avions. Je suis en soutien des P.P. sous une tôle à coté de mon ami Cédoz de Fontaine, tous mes anciens du 334 sont dispersés.
|
|
Tous les soirs un rapport arrive avec le ravitaillement, il parait qu'on parle de relève le 28 ! Les totos auront atteint le maximum de production ! Je n'en ai encore pas trop, mais une tête qui ferait envie à un éleveur d'angora. Enfin j'aurai eu le bénéfice d'une savonnette. J'espère être plus chanceux que le fils de Fancho, encore quelques jours à me rouler dans le sable farineux, afin que les obus ne s'arrêtent pas à l'entrée de mon trou et nous pourrons vivre encore quelques jours heureux.
|
|
Au revoir et bons baisers à tous. Louis.
|
|
Édouard me donne rendez-vous pour les premiers jours d'octobre. Vous allez vous mettre à semer par ce temps superbe. Et les patates, vous ne m'en parlez pas. Enfin, je verrai.
|
le 27 septembre 1918
Chers aimés,
|
Il y a huit jours que vos dernières nouvelles me sont parvenues ou plutôt me furent expédiées et il me semble que j'en devrais bientôt avoir d'autres. Malgré leur origine paysanne qui m'apprendra où en est l'arrachage des pommes de terre, j'y trouverai plus d'attrait que dans le pompeux communiqué Américain ou Salonicien.
|
|
C'est bien la répercussion de ceux-ci qui me fait croupir dans mon trou depuis le 1er septembre sous une avalanche de mitraille. Chaque jour un copieux feu de barrage nous est servi avec obus toxiques. Il faut endosser le masque presque chaque soir. Ceux qui ne seront pas touchés seront empoisonnés ! Il y en a souvent qui sont évacués pour des brûlures de gaz. Mais moi, pas de danger, je semble être blindé contre toutes épreuves ou plutôt condamné à subir le supplice jusqu'au bout ! Je m'habitue au régime du ravitaillement nocturne. Nous sommes quatre survivants à mon escouade, nous réagissons contre la misère. Avec de l'alcool nous chauffons un peu le jus et les légumes qui nous arrivent la nuit assez régulièrement. Heureusement nous avons chacun un litre de vin par jour et une petite ration de "gniole". Malgré la fraîcheur de certains matins et les suées prises, il faut croire que la vie en campagne est recommandée ; j'espérais qu'à l'aide des gaz ma bronchite m'aurait délivré mais elle s'éloigne plutôt, si bien que lorsqu'une bonne toilette m'aura métamorphosé je pourrai vous apparaître dans un état potable. Mais il en faut de la patience. Encore rien de précis pour cette relève qui doit bien arriver si Mangin ne veut pas tous nous faire passer sur des brancards.
|
|
Cher papa, je collectionne déjà quelques paquets de "Perlo". J'en aurais déjà bien un sac s'il ne fallait pas déménager si souvent et si je n'avais pas la crainte de m'embarrasser pour le "Roi de Prusse" ce qui pourrait bien arriver à la moindre petite réaction d'en face, deux ou trois cents mètres d'écart et cela y serait. Mais cela n'a pas l'air d'être pour aujourd'hui et vous dis à une autre fois en vous embrassant tous comme je vous aime. Louis.
|
|
Cette nuit j'ai eu une lettre de la Marie d'Henri, qui m'apprend que la grippe fait souffrir tout Munans, mais ne me confie pas ses relations avec le père Girard !!!
|
le 28 septembre 1918
Chers aimés,
|
Malgré l'enveloppe que j'ai confiée hier soir au "cuistot" il me semble que je dois vous en adresser une autre aujourd'hui. D'abord pour vous remercier de mon volumineux courrier de hier qui m'a été remis à trois heures ce matin. Votre lettre de dimanche, chère maman, à l'encre couleur du jour et le gentil mot de Julien en date du 23 sur lesquels je m'abstiendrai de vous faire les réflexions qu'elles m'ont suggérées pour m'étendre plus longuement sur ma situation. Après cinq jours sous les obus nous fûmes relevés pour venir sur le front des 75 en réserve, là il faut encore avoir soin d'éviter les obus toxiques, mais pour un "bitou" c'est la pause, il en tombe cent fois plus en première ligne, sans compter le restant. Bien mieux j'apprenais le départ d'un permissionnaire qui me cédait le numéro 3 à la compagnie ! Si bien que je me croyais déjà dispensé de vous l'apprendre. A quoi bon puisque j'allais peut-être partir ce soir ou demain. Mais pendant que je me débarbouillais auprès d'une belle eau, ce matin à huit heures, la première fois en trois semaines, tout le monde reçoit l'ordre de se tenir prêt à partir !!! Jugez de mon nez ? Il parait que les boches se replient, tout le monde doit avancer ses positions. J'ai par hasard vu l'en-tête d'un journal de hier. La débâcle partout chez nos ennemis !!!
Ça ne m'étonne plus que les perms soient reléguées à l'arrière-plan, d'où l'utilité de vous confier mes espoirs et mes craintes. Cependant il me semble que je peux m'attendre à partir d'un jour à l'autre puisqu'elles ne sont pas suspendues. Quand et comment vous arriverai-je ? Je n'en sais rien. Une fois que j'aurai mon papier, à nous le bonheur. Je vous dirai demain ma déception s'il y a lieu, dans le cas contraire je ne vous écrirai plus avant de vous embrasser tous comme je vous aime. Louis.
|
le 23 octobre 1918 13h
Mes chers,
|
C'est la grand'halte ! La roulante vient de nous réconforter en y joignant quelques quarts de pinard que les civelots nous donnent à prix fabuleux : 50 sous à 3
(?). Par un beau soleil ce matin nous avons mis sac au dos et nous voilà à nouveau partis sur les dures routes pavées, celles qui m'ont acheminé vers vous dernièrement.
|
|
Allons-nous là-haut retrouver notre ancien patron ? Peut-être. Mais il faut quelques jours encore. D'ici là, sera-ce la paix ? Peut-être...
|
|
J'ai eu un petit mot du 19, chère maman. J'attends celui de dimanche. Au revoir. Bons baisers à tous, y compris
Édouard qui sera là. Louis. |
le 25 octobre 1918 13h
Chers aimés,
|
Je suis fatigué ! Beaucoup plus qu'aux jours derniers, même après avoir versé le dernier sac de pommes de terre à sept heures du soir. C'est qu'au troisième jour de marche avec environ soixante-quinze kilomètres, mes pauvres jambes ont les muscles tendus, sans parler de mes épaules meurtries. Et puis ici plus que des ruines, pas de pinard à part les deux quarts de l'ordinaire. C'est plus qu'insuffisant ! Enfin, puisque je dois vider le calice jusqu'au fond. Déjà l'infernal bruit résonne à mes oreilles. Celui-là sera plus efficace pour la paix que les éloquentes réponses à Vilson. Je serai sans doute bientôt sur la scène du théâtre de la victoire, là où se joue la grande tragédie ! Mais vous avouerez que je n'ai pas tort d'envier le sort des spectateurs, depuis le temps que je suis acteur et que je ne suis que figurant, il me semble que je devrais céder la place aux artistes !!!
|
|
Je vais changer de sujet car je n'ai pas le temps d'être bavard ce soir. Cependant l'eau de la rivière immortelle m'a remis un peu d'aplomb. Serait-elle magique cette eau ? Rien de surprenant, depuis le début de la guerre qu'elle voit sur ses rives se dérouler des choses tragiques.
|
|
Chère maman, je constate que vous n'avez pu écrire un petit mot dimanche. Toujours ces multiples occupations sans doute, malgré la disparition de la grippe. Cependant si vous avez eu les beaux jours que j'ai observés dans mes voyages il me semble que le plus gros doit être fait.
|
|
En attendant la confirmation détaillée (grâce à votre secrétaire) de ce que vous faites et même de ce que vous pensez, je vous embrasse tous comme je vous aime, et vous dis bonsoir avant de m'endormir dans un des sous-sols solides du pays des carrières. Louis.
|
le 30 octobre 1918
Bien chers,
|
Rien à faire aujourd'hui qu'à s'installer se remettre des fatigues de la dure journée de marche d'hier. Vingt-cinq à trente kilomètres nous séparent de la vallée paisible où nous avons passé la journée dans la béatitude de ces superbes journées d'automne. Ici, à la douceur de la température s'ajoute l'agrément d'une nature intacte des méfaits de la guerre qui a revêtu son dernier costume avant d'entrer dans la saison morte. Imaginez un des abords de l'immense forêt de Saint-Gobain que l'envahisseur a abandonné sans combattre, et vous devinerez qu'il y a pas mal de baraquements pour nous abriter convenablement. Je viens donc de couper une botte de fougère pour jouir d'une bonne nuit à la place d'un boche sur un des grillages qu'il n'a pu emporter.
|
|
Quelle analogie y a-t-il entre notre situation et la capitulation autrichienne ? Pour vous, elle peut paraître excellente, enviable pour quelques-uns qui me liront. Cependant le feu roulant qui nous réveilla avant l'aube ce matin n'est qu'à moitié rassurant, regrettable pour les malheureux qui appuient par leur sang les conditions que la redoutable Allemagne va être obligée d'accepter.
|
|
Je crois pouvoir vous écrire encore avant de remonter.
|
|
Ces lignes
seront peut-être en retard pour être en votre possession
vendredi. Mais mes pensées et mon cœur seront en union avec
vous pour ce beau jour d'espoir de la Toussaint 1918.
Affectueux baisers. Louis.
|
le 3 novembre 1918
Bien chers,
|
Le poêle ronfle à être rouge sans pour cela diminuer en rien la valeur de l'immense forêt avec ses superbes foyards. Ce n'est pas pour combattre la température douce que nous avons, mais plutôt pour sécher le linge qui pend au plafond de la baraque et l'humidité qu'apportent les brodequins par suite de la pluie de hier. En effet ce 2 novembre fut brumeux ; "comme pour mêler ses larmes à la tristesse de ce jour des morts", selon la parole de l'aumônier à la grand'messe de neuf heures. C'était sans doute pour faire le pendant de son allusion sur la pureté du ciel le jour de la Toussaint, pendant le sermon de la messe en plein air ! Oh ! ici, ce n'est plus comme à Verne, aucune excuse pour ne pas prendre le temps de sanctifier ces jours mémorables. J'y trouvais tous les anciens copains, car le régiment est groupé, entre autres l'ami Guinchard.
|
|
Ce matin je fus un peu paresseux, mais il n'y avait pas l'attrait de la parole éloquente de l'aumônier, parti aux autres régiments de la D.I. Je supplée à cette sanctification par ma lettre du dimanche.
|
|
J'éprouve d'ailleurs la légitime satisfaction qui ne doit pas tarder à devenir de la joie délirante par l'annonce de la capitulation successive de nos ennemis. Par T.S.F. nous savons depuis hier que nous n'avons plus que l'Allemagne à qui il reste d'accepter nos conditions, ce qui ne peut tarder puisque Guillaume a fait ses malles !
|
|
Néanmoins, nous avons l'ordre de nous tenir prêts à partir. Ce sera sans doute pour demain matin, le canon nous appelle encore par là-haut.
|
|
Rien d'autre pour aujourd'hui. La joie de la délivrance augmente l'affection de mes baisers. Louis.
|
le 6 novembre 1918
Chers aimés,
|
Comme la guerre doit être belle le soir au coin du feu, à lire les pages et les articles interminables sur l'heureux résultat de ces années de misères et de sacrifice ! Elle est en effet plus belle (la guerre) que sur la scène du théâtre où elle se joue, car elle subit une rude lessive avant de vous arriver. Représentez-vous le troisième jour de marche, ou mieux de poursuite à travers une mer de boue qu'éclaircit sans cette la pluie fine, les routes défoncées et tout ce que les boches laissent d'écoeurant dans leur fuite précipitée ; les villages ne sont pas trop détruits mais tout le mobilier jeté dehors ou cassé, les boches ont la spécialité d'abolir les literies pour le plaisir de crever les édredons semble t'il, de la plume partout. Mais des habitants je n'en ai vu qu'à Crépy, ils doivent être refoulés du coté de la dernière sous-préfecture de l'Aisne. Je ne tarderai pas à être fixé.
|
|
Il m'arrive bien un peu de l'enthousiasme de l'arrière, mais la pluie, la boue et surtout la fatigue me refroidissent beaucoup. Enfin mon cher secrétaire vigilant, puisque tu m'annonces une glorieuse Saint-Martin, entre toutes, je veux bien le croire et l'espérer, cela me donnera des jambes. En attendant je confie à ce papier une grande distribution de baisers. Louis.
|
|
Dorénavant les correspondances pourraient bien être en souffrance, ne vous en tourmentez pas outre mesure.
|
le 9 novembre 1918
Bien chers aimés,
|
C'est l'époque des jours de joie qui viennent enfin prendre la place de ces années d'inquiétudes et d'angoisses. Je ne voudrais pas profiter en égoïste de ces heures de bonheur qui souvent pour nous sur ces longues routes boueuses n'en demeurent pas moins très pénibles ; je viens vous en faire part avant d'aller défiler en l'honneur de ces populations délivrées qui nous reçoivent avec délire.
|
|
Je ne peux pas vous apprendre l'ensemble des événements libérateurs, les journaux me devancent de plusieurs jours et moi-même je les ignore.
|
|
Nous ne talonnons plus les boches de près, cela nous vaut d'être éclaboussés par les interminables convois, mais en revanche nous allons avoir les acclamations de la petite sous-préfecture ! Elles ne seront pas assez chaudes pour sécher la chemise qui collera sur les reins ! Pourvu qu'un peu de paille y supplée en attendant les draps que vous me préparez. Louis.
|
|
Vous ai-je fait part de la mort de mon copain Lasinger de Saint-Fergeux, tué à Laffaux ? J'ai rencontré le fils Lefranc de Blarians, il a l'air comme moi : un homme à tout faire.
|
le 10 novembre 1918
Bien chers aimés,
|
Voilà qu'il est nuit et je n'ai pas encore fait une lettre du dimanche. Aussi je réagis un peu pour ne pas faillir à ma douce habitude car j'en suis un peu honteux, surtout que je n'ai rien fait aujourd'hui. Une forte gelée blanche m'a fait faire la grasse matinée, ce qui consiste à s'enrouler et s'endormir après avoir pris le jus, si bien que j'ai juste eu le temps de faire une toilette avant dix heures et ma foi après, le soleil m'invita par sa chaleur à faire un tour aux hameau voisin avec les copains d'escouade. C'est qu'au hameau voisin il n'y a pas de soldats, nous le savions ! Et voyez-vous, ici c'est à celui qui a des Français ! Les pauvres rescapés ont bien vu les premiers soldats de ma D.I. qui poursuivaient les derniers boches mais ils veulent en loger pour un peu soulager leurs malheurs en nous confiant leurs interminables récits de souffrance : une jeune fille de dix-huit ans m'emmène chez sa mère qui me saute au cou pour m'embrasser ! Depuis quatre ans qu'elle m'attendait, moi ou un autre ; je retrouve les copains retenus chez un vieux paysan et ses quatre filles qui avaient déterré du cidre et de la gniole pour fêter la libération avec nous. Les demoiselles nous ont reconduits jusqu'au cantonnement qui a l'honneur de loger les Français.
|
|
Vous ne serez pas surpris d'après ceci que la nuit m'a surpris sans que je puisse vous consacrer une heure pour vous raconter ceci qui n'existait pas. Mais rien n'est perdu puisque me voici sur une table et une lampe dans la cuisine de mon asile hospitalier qui m'abrite depuis deux jours.
|
|
Nous allons sans doute repartir demain ; mais je renonce à rattraper les Boches qui, d'après le son du canon sont au-delà de la frontière. Mais ce qu'il nous ont fait faire des kilomètres, et que l'Aisne est grand, j'en ai usé des brodequins. Cela nous fait déjà dix jours de marche, et par quel temps. Mais je suppose bien que sous peu une gare et un train boches vont nous emmener faire la police à Berlin, en attendant la signature de la paix.
|
|
Que mes baisers vous aident à saigner le veau d'Or pour la fête de la Victoire. Louis.
|
le 11 novembre 1918
Bien chers aimés,
|
Comment vous exprimer ma joie et celle qui fait battre les cœurs du monde entier presque !
|
|
Les derniers coups de canon viennent d'être tirés ! Cela me semble impossible ! Pourtant je ne rêve pas, c'est la réalité. Dès le réveil ce matin la bonne nouvelle était officielle. Oh ! inoubliable Saint-Martin 1918, quel jour béni tu nous apportes !
|
|
Ah ! Quand vous me dites qu'il n'y a plus de Saint-Martin ! Voici le plus grandiose qui ait jamais existé ! Faites la brioche pour dimanche, invitez les amis, je serai de cœur avec vous. De mon coté, s'il m'est permis de trouver une région plus privilégiée que celle-ci où le cyclone destructeur n'a laissé que la misère, je, nous allons célébrer la victoire. Je ne pense pas cependant abuser du bonheur de la vie puisque la perspective de la vie nouvelle apparaît avec les devoirs qu'elle impose.
|
|
J'attends de vos nouvelles qui me semblent bien en retard avec les événements. Je vais aller à la soupe. Au revoir et bons baisers. Louis.
|
le 18 novembre 1918
Bien chers aimés,
|
Vous êtes inexorable chère maman, vous ne vous occupez pas du format de mon papier ni des circonstance que j'ai pour les remplir, il vous faut les pages pleines.
|
|
Eh bien ! aujourd'hui j'espère y arriver, les circonstances s'y prêtent malgré que j'ai de la peine à tenir une plume, et les quelques flocons de neige qui tombent ne vont pas beaucoup me réchauffer les doigts, sans parler de mes pieds que je ne sens plus. Et puis quoi vous dire ? Si je vous confie mon état de fatigues je vais presque être écouté et tourné en ridicule par la plupart de ceux qui me liront. A ce sujet je crois vous avoir édifié par ma feuille de samedi. Et puis aujourd'hui ma sérénité d'âme me permet d'être un peu moins découragé.
|
|
Comme le petit Jésus je voisine l'âne et le bœuf pour le troisième jour, mais il parait que pour demain on doit nous préparer encore vingt-cinq à trente kilomètres à faire.
|
|
Que se passe t'il parmi vous en ce jour de gros cheveux ? Moi j'ai célébré Saint-Martin par douze heures de paillasse. Nous sommes presque sans lumière. C'est une bonne occasion pour se rattraper des longues veillées aux P.P.
|
|
J'ai seulement eu hier votre lettre de dimanche dernier, chère maman, elle a mis le temps. Merci de vos détails qui ne manquent pas de m'intéresser doublement puisque l'avenir me permet de coopérer aux mesures prises en conséquences. Les labours auront pris fin par la gelée qui doit vous atteindre et il n'y aura pas eu lieu de dénommer un berger pour la journée d'hier. Mais la fourche n'en sera pas plus chaude à la grange.
|
|
Je suis surpris de l'impolitesse de Melle H. qui m'avait assuré vous revoir après la Toussaint... C'est en reconnaissance de mon voyage...
|
|
En attendant un petit commentaire sur la résurrection de la Saint-Martin et sur les déplacements de votre secrétaire qui me laisse tomber, il ne me reste plus qu'à vous embrasser avec la douce perspective d'un au revoir. Louis.
|
|
Qu'avez-vous fait de la grippe et de ses suites ? Vous semblez ne plus rien vouloir garder de bon en vendant le Noirot et les deux bœufs !
|
le 20 novembre 1918
Chers aimés,
|
Encore une demie feuille qui sera suffisante pour vous communiquer mes impressions sur ma nouvelle installation.
|
|
Avec l'agrément qui la caractérise, une nouvelle étape m'a amené ici hier soir dans un nouveau village. Je crois que c'est la fin des grandes manœuvres (c'est ainsi que l'on peut appeler le résultat des déplacements que nous effectuons voilà un mois) ou bien encore le circuit de l'Aisne touche à sa fin, en attendant une décision sur notre avenir. A ce sujet les bruits les plus divers circulent sur notre affectation ; tantôt nous allons embarquer pour les bords du Rhin avec auparavant un tri des vieilles classes, dont je fais partie, etc... Mais tout ceci n'est qu'au conditionnel. Attendons tranquillement les faits que j'accepte volontiers mais à condition que l'on ne vienne plus jalouser mon sort lorsque je suis exaspéré par une ballade de vingt-cinq à trente kilomètres avec autant de kilos, surtout par un adjudant qui n'en a jamais fait l'essai !
|
|
Cependant je fus heureux ce matin de lire les lignes de ce même adjudant qui regrette ses trente jours de convalo ! Mais je suis sûr que lorsqu'il connaîtra à fond l'entourage de ses projets à venir, il aura quelques petites déceptions. Les mêmes que celles que j'éprouve dans l'étude de mes paysans libérés : je remarque que généralement il n'y a que les réfugiés qui sont à plaindre sincèrement.
|
|
J'espère que malgré les difficultés du ravitaillement le vin de la Victoire n'aura pas fait aussi défaut sur votre table dimanche que parmi nous. J'en attends la confirmation et vous adresse par un soleil idéal mes affectueux baisers. Louis.
|
|
La Marie de Munans m'avait déjà fait part de votre visite. Georges m'adresse ses amitiés depuis Pontarlier sur un lit d'hôpital. Mon cher
Édouard m'en voudras-tu ? Merci de ta carte de Vesoul. J'ignorais la mort de ton ami Ravenet.
|
le 1er décembre 1918
Bien chers aimés,
|
Il est onze heures. La soupe est déjà mangée qui s'est terminée par le café et la gniole SVP mais qui fut précédée par l'invariable menu : soupe grasse, bœuf bouilli (une petite portion) et l'inépuisable riz au gras. Le pain K arrive régulièrement. Le pinard est plus capricieux, deux, trois, quatre quarts dont deux à titre remboursable ! Pour la somme de fatigues dépensées dans nos séjours sédentaires cela peut suffire. Mais c'est rudement monotone pour fêter la victoire !... Et ma foi, pour trouver quelque chose de varié parmi les nombreuses devantures de la ville cela est impossible. On ne rencontre que des mains tendues pour recevoir ce que nous avons de trop. Et puisque je suis là j'ai encore la salive à la bouche par l'énumération faite par
Édouard des "yeux" qui avaient la brioche de la Saint-Martin, sous la patiente impulsion d'Augusta. Je ne pense plus à celle-là mais plutôt à celle que je compte manger au nouvel an, pendant mes vacances de vingt jours qui pourraient bien coïncider avec ce brillant début d'année si rempli de belles promesses. Mais en attendant une petite boite de beurre qui ne craindra pas la longueur du voyage, en compagnie d'un peu de cancoyotte ou d'un de vos camemberts seraient les bienvenus pour casser la croûte avec mon pain K en rentrant de faire l"École du soldat", ce qui ne va pas tarder si nous devons séjourner ici. C'est d'après des bruits de cette nature que je vous fais cette petite commande. Tant pis pour l'éventuel contre-ordre, si fréquent dans notre métier.
|
|
Drôle d'entretien que je vous consacre aujourd'hui. Pourtant j'avais l'intention de commencer par vous dire que je venais de rentrer de la messe en ayant fait partie du chœur à la tribune. Combien ces quelques instants ont évoqués en moi les douceurs méconnues de l'ancien temps. Ici la ville compte deux paroisses. Nous sommes cantonnés au "Fourneau" qui signifie quartier populeux (ou mieux pouilleux) mais tout neuf avec cinq ou six mille ouvriers sans ressources, parmi des usines dévastées et auxquels il faut autre chose que la gloire des héroïques combattants victorieux que nous pouvons leur apporter.
|
|
Vous devez savoir qu'il s'agit de la ville de Fourmies (Nord) à proximité de la frontière. Vous me direz si la censure vous permet de me situer parmi l'immensité des régions où vous pouvez me supposer. Je ne serais pas fâché d'attendre la libération ici, j'aurais encore plus de satisfaction qu'à Cologne par exemple.
|
|
Plus guère de place pour m'occuper un peu de vous. Mais je n'en ai guère de motif. Vos dernières nouvelles ont eu hier huit jours. J'attribue cette impossibilité aux absorbantes journées de battage des premiers jours de la semaine. Mais j'attends en compensation la rédaction d'un long journal. C'est dans cet espoir que je vous embrasse tous comme je vous aime. Louis.
|
le 3 décembre 1918 18h
Bien chers aimés,
|
Depuis deux heures que la petite lampe à essence brûle et il n'est que six heures. J'ai déjà lu tous les articles du journal de hier. Les copains jouent aux cartes sur une autre table plus grande que la mienne où mon voisin, un Breton, fait une lettre à sa femme.
|
|
Je ne puis encore pas me coucher pour le réveil de sept heures demain matin. C'est alors que je pense à votre lettre de vendredi dernier chère maman, où vous me dites que mes pages vous empêchent de dormir le soir. Heureuse coïncidence, le plaisir de les remplir va éloigner mon sommeil vers une heure plus favorable.
|
|
J'ai déjà mis sous enveloppe pour vous à midi la "Liaison". Mais ceci sera pour le sac du vaguemestre demain.
|
|
Voici le huitième jour que nous sommes dans l'ex-cité du fil. C'est un record. Je ne me souviens pas d'avoir fait mon lit si longtemps à la même place. Je n'ai pas lieu de m'en plaindre puisque j'ai pris la place d'un malade Boche, avec cette seule différence que je ne crains pas de salir mes draps qui sont formés par ma toile de tente ! Cela durera t'il ? Comme d'habitude l'inépuisable série de canards incertains et variés. En attendant il n'y a guère qu'à se faire du "lard" en vue de la reprise des hostilités pour la petite guerre à Verne. Le "Pinard" commence par nous retrouver. Hier c'était le "Champagne" de la Victoire. Une bouteille de "limonade" à quatre !...
|
|
Je change de sujet pour ne pas médire plus longtemps. D'ailleurs mon papier va s'épuiser sans que je réponde à votre fertile lettre, chère maman. Sans parler des pierres qu'envoie dans mon jardin mon cher frère... Tranquillisez-le ! Dites-lui qu'il y aura toujours quelques peuplades sauvages à pacifier pour assouvir ses instincts féroces !!! Mais pourquoi mon cher n'as-tu pas toujours été au coin du feu, dans un fauteuil, comme tu me le dis. Mais avoue que pour porter le maximum de brisques ton carnet de pécule accuse un petit nombre de jours octroyant l'indemnité de combat ! Avoue que tu fus un privilégié de la guerre, tout en recueillant une cuirasse de gloire. Je m'en réjouis avec toi, et suis prêt maintenant à recevoir tes attaques, non plus en marge d'une affectueuse lettre maternelle, mais en plein front. Peut-être pourrai-je dans cette nouvelle tactique acquérir la "Croix" qui m'a toujours évité... Le papier est rare !
|
le 6 décembre 1918
Bien chers,
|
Chaque jour je vais soulager le sergent vaguemestre à rapporter ses sacs remplis de lettres ou de colis qui sont distribués au bataillon. C'est un (le sergent) Breton de la classe 98 qui inspire confiance par son grand âge et à qui revient cet emploi. Cela me procure l'occasion de faire ma ballade quotidienne parmi les objectifs qui me semblent les plus attrayants. Pour ce soir ce sera vers une usine où parait-il, se trouvent un dépôt de munitions boches qui me fournira de quoi alimenter ton souvenir que tu as rapporté avec tes trous de balle, mon cher
Édouard. |
|
Le brouillard s'est dissipé pour laisser au soleil le pouvoir de joindre son éclat aux fêtes et aux disciples de Saint-Nicolas.
|
|
Mais avant de me mettre en route, je remplis cette feuille qui grossira le volumineux courrier quotidien qui part chaque jour. Ce sera une petite consolation dans la peine que j'ai chaque jour de charrier des tas d'intimités mais d'où pas souvent hélas ! ne sort une enveloppe à mon adresse. A part cette regrettable déception, les jours s'écoulent dans une douce et grasse petite vie tranquille parmi la nouvelle existence qui est rendue à nos populations libérées qui sont comme nous un peu hébétées de retrouver la paix, après avoir vécu sous les exigences de la domination allemande.
|
|
Nous en avons déjà entendu des récits à ce sujet et sous des interprétations variées. Pour tout le monde c'était la soumission sans discussion et sans explication. Mais l'occupation était faite naturellement suivant la bonne ou mauvaise volonté de l'habitant, à la moindre récrimination c'était la prison ou l'amende, prétexte pour soutirer tout l'argent en même temps que le matériel des régions envahies.
|
|
Mais le point le plus comique et le rôle le plus important fut naturellement rempli par le sexe féminin ! Surtout ici, dans une population ouvrière où la moralité est secondaire et le scandale public. La jalousie et la rivalité étaient excitées par le bien-être qui était entre les mains de l'oppresseur qui pouvait à sa guise satisfaire ses caprices à ses fantaisies. Mais à présent il y a les suites qui permettent les revanches et les amères désillusions du pauvre malheureux qui rentre en permission exceptionnelle ! Ah ! oui, elle est parfois exceptionnelle, une permission semblable qui déchaîne une guerre plus dure que celle qui est en train de s'éteindre. Ma
(?) lettre aussi est exceptionnelle. Mais peut-être m'accuserez-vous seulement d'être bavard et accepterez-vous le baiser final qui remplit cette marge, en vous renvoyant à la suite, pour dimanche sans doute. Louis.
|
le 8 décembre 1918
Bien chers aimés,
|
A la gaieté des jours brumeux l'Immaculée Conception a apporté en son jour de fête l'incomparable splendeur du soleil. Aussi après lui avoir ce matin adressé les vieux cantiques d'usage, la pureté du ciel et des chemins m'invite à faire mon tour en ville ou à la campagne. Déjà les chambres se vident, tout le monde a fait un brin de fantaisie ou plutôt de toilette. Les rudimentaires habitudes de la vie des tranchées disparaissent facilement, surtout dans la vie oisive qui nous est permise et par l'inévitable aspiration au bien-être dont tout le monde saurait bien profiter si les nécessités du travail ne venaient pas l'entraver.
|
|
Je reviens à mes projets de ballade que je fais précéder de cette petite lettre afin qu'elle vous arrive avec sa régularité habituelle. Mais j'en suis toujours à me demander si la censure permet d'inoffensives indiscrétions vous permettant de me situer et combien de temps mettent mes lettres à vous arriver, mais c'est en vain ! Vous écrivez si rarement ! Pourtant quelles excuses avez-vous maintenant ? L'état de sécurité ! Mais précisément, l'entretien est plus facile dans la joie actuelle qu'il ne l'était dans ces temps derniers où vous étiez en droit de vous demander si votre adresse n'était pas faite à un mort. Mais voilà les mauvaises habitudes, on dirait que le service postal ne fonctionne que certains jours ou pour des motifs spéciaux.
|
|
Je m'arrête car vous allez dire que je ne dis pas grand chose de nouveau ! Mais pour moi c'est l'expression détaillée du bonheur de la délivrance qui est beaucoup plus important que les récits ou les descriptions exécrables auxquels je fus soumis ici longtemps.
|
|
Ces natures de corresp. (?) me plaisent tant que je terminerai cette feuille en vous faisant part de l'indicible bonheur auquel j'ai pris part hier soir. Quand je suis fatigué de lire le journal parmi les furieuses parties de cartes et la suffocante fumée des pipes de la chambrée, je vais en attendant les neuf heures du soir, passer quelques instants en compagnie des concierges d'une fabrique de tissus : un vieux de soixante-quatre ans et sa compagne de soixante ! Vous devinez l'analogie que j'ai pu en déduire ? Avec cette différence qu'au lieu d'être entourés par six rejetons de leur progéniture ils ont leurs deux fils parmi les armées françaises, deux logis de dragons dont les dernières nouvelles dataient de 1914. Mais hier à la nuit, voici l'arrivée d'Arthur le plus jeune qui annonce la prochaine de Gustave, l'aîné, qui est officier de cuirassiers à pied, qui va venir aussi pour trois jours. Vous dépeindre cette scène, ce n'est pas de mon pouvoir. Ce sera sans doute le rôle prochain de quelques artistes dramatiques. Et puis ma feuille est pleine ; ce sera une deuxième édition au numéro de la "Dépêche". Si cette littérature vous plait, prenez exemple pour m'offrir un exemplaire et vous aurez pour vos peines un baiser égal à celui-ci. Louis.
|
le 10 décembre 1918
Bien chers,
|
Comme les gens rupins après ma toilette du matin je me mets à mon bureau pour la rédaction de mon courrier.
|
|
Afin de donner un peu de suite à mon édition irrégulière peut-être mais assez fréquente je fais suite à mon numéro de dimanche : après sa rédaction et ma ballade, le service m'appela à l'emballage des colis destinés au bataillon. J'eus l'agréable surprise d'en voir un à mon adresse. D'après ce que je savais, j'ai deviné un peu à l'avance de son contenu qui est le symbole de ma participation lointaine des douceurs de la maison mère ! J'eus en outre le plaisir de profiter du geste délicat qui n'a pas oublié de glisser adroitement la petite fiole contenant la précieuse liqueur. Un petit hommage aussi à la petite boite de cancoyotte qui sert à varier un peu plus présentablement la fin de mes monotones et courts repas.
|
|
Aucun avis d'envoi ne m'ayant prévenu de l'arrivée de cette aubaine je pressentais la longue bafouille que j'ai eue hier lundi d'autant plus intéressante qu'elle était à double combinaison.
|
|
Chère maman, vous avez beau avoir des érudits parmi vos descendants, c'est toujours votre partie la plus intéressante. C'est sans doute à cause de cette supériorité que vous revient la charge de rédiger sans cesse l'article de fond. Que la rapidité croissante des communications vous fasse prendre courage ; deux jours de voyage seulement. J'espère que vous allez profiter sous peu de la même faveur.
|
|
Peut-être pourrai-je profiter du même itinéraire vers la fin de l'année, nous avons l'air de vouloir stabiliser ici. Je ne jalouse pas l'accueil bienveillant qu'a pu vous faire Léon sur les Stasbourgeoises, celui des Fourmisiennes est suffisant.
|
|
Je suppose qu'Édouard et Henri auront fait bon voyage dimanche et que la Maillot-Cornet ronfle de façon à ne plus me laisser manger de poussière de vesce, je préfère celle de trèfle et vous embrasse tous en bénissant
(?) cette heureuse coopération. Louis.
|
|
Édouard sait-il où il retrouvera à peu près son régiment ? Pourvu qu'il soit en occupation rhénane, pour un peu le consoler !
|
le 13 décembre 1918
Bien chers aimés,
|
Je suis obligé de prendre une grande feuille pour compléter ma courte carte d'hier car la longue lettre que j'ai reçue hier m'y oblige. N'avez-vous pas, chère maman, trouvé moyen de me tracer quatre pages comme je les aime, comme nous les aimons, dans votre après-midi de dimanche. Après avoir expédié tout votre monde vers ses diverses destinations, ça a été mon tour d'avoir votre petit entretien. Rien de bien intéressant me dites-vous tout d'abord. Mais vous savez bien que tout ce qui se passe dans la vieille maison, dans le vieux trou qui m'a vu naître, doit m'intéresser jusqu'à la fin de mes jours. Les événements mondials qui m'en ont tenu éloigné si longtemps ne restent que secondaires. Et avec juste raison. Après avoir bien examiné les nombreux et variés aspects d'existence que j'ai déjà rencontrés c'est toujours vers le nid natal que l'on porte ses préférences, à part quelques cas naturellement qui pour la plupart n'ont plus chez eux l'attraction affectueuse qui m'avantage.
|
|
Je déraille un peu dans le but que je me proposais tout d'abord de répondre à votre lettre chère maman. Je me demande comment vos joyeux voyageurs volages ont effectué leur retour ? Dans de bonnes conditions j'espère. Le retour de Gouhélans pouvait être retardé en raison de la lune nouvelle qui allonge un peu ces courtes journées de décembre, surtout en la circonstance. Quant à celui de Besac, il pouvait être reporté d'un jour vu l'enthousiasme de nos glorieux mutilés, auxquels le Grand patron accorde largement sa reconnaissance dans l'enthousiasme de la victoire, c'était facile de manquer le train. Enfin, si les intéressés ne sont pas trop égoïstes peut-être aurai-je mes suppositions satisfaites et mises à point.
|
|
Voilà quelque temps que le Quai ne m'a fait parvenir que quelques nouvelles très irrégulières, d'après
Édouard, je l'attribuais au mauvais état de santé de Mme Besançon mais la petite coupure me laisse soupçonner des complications qui ne sont pas nouvelles dans les entreprises du Petit Homme. Néanmoins la réclame du journal ne me donne pas lieu d'entreprendre semblable spéculation !...
|
|
Rien de sensationnel en ce qui concerne mon séjour parmi les "Chtimies". La vie reprend peu à peu parmi la grouillante et pouilleuses population Fourmisienne. Surtout je ne sais d'où les articles garnissent les coins de vitrines des magasins que l'explosion a épargnés. Mais l'essentiel manque : les denrées alimentaires sont à peine suffisantes.
|
|
D'autre part la pluie ruisselle voilà quelques jours, sans égards pour mon service de vaguemestre. Mais grâce à un imperméable que j'ai "barbotté" l'humidité ne pourra atteindre ni atténuer les effets de mes tendres baisers à tous. Louis.
|
le 15 décembre 1918
Bien chers,
|
Invariablement je remplis mon emploi du temps qui ne varie pas voilà quelques semaines. Cela me parait exceptionnel en comparaison de la vie pénible et variée que j'ai si longtemps remplie.
|
|
N'allez pas croire que je ne sais pas apprécier la faveur qui m'est permise d'avoir pu jouir de ces heureux jours que l'on nous a si longtemps promis. Mais hélas ! ces belles promesses ont souvent fait place à l'incrédulité devant les énormes sacrifices qu'il m'a fallu surmonter pour dominer le désespoir qui souvent me terrassait.
|
|
Combien de fois, malgré moi ai-je laissé soupçonner ce désespoir parmi les lettres que je vous adressais ? Je savais bien la peine que je pourrais vous causer ! Mais quel est le malheureux qui ne trouve pas une consolation en confiant ses peines à celui qu'il aime ?
|
|
C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureux de pouvoir vous dédommager un peu en vous laissant une meilleure impression après chaque lecture des nombreuses pages que je vous consacre. Il n'y a pas longtemps chère maman, que vous faisiez part de vos craintes au sujet des accablantes fatigues que je vous avais confiées, même parmi l'enthousiasme de la fin qui se dessinait. C'est pourquoi je me demande parfois si une trop grande franchise ne mérite pas un frein ou une critique ?
|
|
Néanmoins, en vertu de ma trop grande franchise, je vous ai dépeint ma situation heureuse dont je suis gratifié depuis mon arrivée à Fourmies. Ce qui me permet de vous faire encore cette banale causerie qui révèle mon état d'esprit d'homme heureux, que j'essaie d'embellir encore pour vous l'offrir avec mon communiqué du dimanche.
|
|
Je n'ai pas l'attirance du soleil de dimanche dernier pour m'exciter à la promenade, mais par contre j'ai l'heureuse perspective de penser que dans quinze jours j'aurai mieux que la satisfaction de vous écrire : du 25 au 30 mon tour sera là ! Depuis 1913 que le bonheur de vous embrasser au traditionnel 1er de l'an ne me fut pas permis. Voilà les douces perspectives qu'il m'est permis de vivre à présent !...
|
|
En attendant, je suis gâté par vos prévenances. Après mon colis voici hier la rentrée de mon camarade Cédoz, rapportant consciencieusement la petite fiche qui a servi à célébrer sa rentrée, car il n'avait rien conservé que ce qui ne lui appartenait pas pour un voyage de huit jours, de part l'accueil chaleureux que vous lui avez témoigné, m'a-t-il dit.
|
|
Afin de ne pas exciter une trop forte jalousie par l'étalage de mon bien-être voici que la fin de mes pages vient y mettre un terme, en me laissant juste la place pour vous embrasser tous tendrement. Louis.
|
le 18 décembre 1918
Bien chers,
|
Si les Parisiens ont le temps des Fourmisiens le président Vilson n'aura pas beaucoup d'acclamations aujourd'hui : il fait un temps à ne pas chasser un chien dehors. Et si les régions de l'Est se sentent du vent de l'Océan, comme celles du Nord, vous ne regretterez pas l'argent que
Melle Damotte a mis dans ses chaînaux ! |
|
Je n'ai pas envie de vous faire quatre pages sur le temps qu'il fait ou sur celui que cette lune de Noël vous procure, je pourrai m'en rendre compte dans huit ou dix jours ! Cependant plus de grands récits de guerre à raconter. L'emploi du temps des troupes triomphantes est trop agréable pour l'offrir à des bouffeurs de poussière de vesce sans susciter un sentiment d'envie chez ceux-ci ! Et puis il serait trop long pour vous énumérer toutes les scènes cinématographiées qui furent offertes hier soir aux poilus de la garnison de Fourmies, et à leurs petites femmes... facultatives bien entendu ! Nous avons une grande salle des fêtes ou théâtre.
|
|
J'arrive enfin à l'objet de ma lettre et du certificat ci-joint que je juge utile de vous faire parvenir sans retard. Le Doubs, comme les autres département de France, doit profiter de l'augmentation de l'allocation qui pour vous doit être majorée de 0,25 avec un rappel depuis le 1er octobre. Pour justifier le droit des intéressés, il faut un certificat de présence à l'unité du militaire qui vous autorise à l'allocation. Voici le mien que vous devez joindre à la demande adressée au Maire de la commune.
|
|
D'ailleurs Mr. Raguin vous fournira des renseignements complémentaires s'il y a lieu. Avec mes remerciements présentez-lui mes amicales salutations ainsi qu'à toute sa famille.
|
|
Pour vous tous voici mes tendres baisers. Louis.
|
le 22 décembre 1918
Chers aimés,
|
Je suis tellement habitué à ma lettre du dimanche que je trouve ma plume pour vous adresser cette feuille, même au risque de la devancer dans mon voyage. En tous cas elle me sert d'avis de passage. Je pense partir jeudi. Je ne puis préciser le jour de mon arrivée qui peut varier facilement d'un jour, vu la lenteur des communications et parfois celle du délai de route que je puis prendre. En tous cas, je puis presque garantir que je vous embrasserai tous dimanche mieux que par l'intermédiaire de ma plume.
|
|
Mon cher Henri, je prends en considération l'honneur que tu me concèdes. Merci pour le plaisir que m'apporte ta lettre. Louis.
|
Orry-la-Ville le 24 janvier 1919
Bien chers,
|
Me voici encore dans la région de Creil. Au moment de partir ce matin pour Valenciennes, un contrordre nous retient jusqu'à demain après-midi ! Voyez la valeur des journées qui auprès de vous sont si parcimonieuses.
|
|
Il parait que nous allons faire partie d'une nouvelle D.I. dans la région de Liège.
|
|
Je viens de retrouver des copains qui comme moi partiront demain par Lille, Bruxelles, Louvain et Tirlemont. Parmi les interminables heures d'attente, voici pour vous quelques minutes de loisir que me procure un camp de permissionnaires d'où je peux vous adresser mes bonnes pensées et mes tendres baisers. Louis.
|
Aix-la-Chapelle le 28 janvier 1919
Bien chers aimés,
|
Le lieu d'origine de ma lettre va un peu vous surprendre. Encore plus le serez-vous quand vous apprendrez que je remplis cette feuille pendant qu'Édouard est appelé à ses fonctions de juriste auprès de la police criminelle de la ville.
|
|
Vous ayant envoyé une carte depuis Bergues dimanche, je reprends le cours de mon voyage afin de ne pas vous embrouiller. Donc dimanche un train pour Liège m'a véhiculé d'un bout à l'autre de la Belgique, soit trente heures dans un wagon sans lumière et sans feu ! Mais ayant repris ma cuirasse invulnérable, je ne pense pas subir l'influence funeste d'un voyage qui me procurera huit jours et huit nuits de chemin de fer dans des conditions très défectueuses, conditions qui ne furent même pas compensées par l'agrément que pouvait offrir à ma curiosité la vue d'un charmant pays en raison de la neige qui était tombée.
|
|
En route j'apprends que mon régiment appartenait à une D.I. qui se trouve aux environs de Düsseldorf ! Voyez ce que me réserve la fin de ma campagne. Je reprends donc hier soir à Liège ma route pour débarquer à deux heures du matin dans l'éblouissante gare d'Aix... Quelques instants de demi-sommeil dans la salle d'attente et me voilà parti avec un fidèle copain à la recherche de la prévôté de la 128ème D.I. Trois heures de trottoir me font faire la surprenante rencontre qui vient de finir par le dîner en compagnie des "flics" et la dégustation de la petite fiole de gniole qui était encore intacte.
|
|
Faute d'aliments je ne puis continuer ma lettre. Je vais continuer ma route ce soir et laisse un petit coin de cette page en blanc pour
Édouard, mais en réservant la place pour un baiser à chacun. Louis.
|
|
Vous représentez-vous bien ma surprise ce matin. Je sortais de ma chambre, je mettais le pied sur le trottoir, je jette un coup d'œil sur la grande place du Kaiser et j'aperçois not'Louis ! Je me suis frotté les paupières pour être sûr d'être éveillé. C'était bien lui qui me cherchait depuis l'aube dans la grande ville. Nous avons passé la journée ensemble. Je viens de le mettre dans un train direction de Cologne. Il est neuf heures du soir. Une journée encore à marquer d'une croix blanche. La guerre m'aura donné toutes les joies. Il reste juste cette fois celle du retour définitif. En attendant j'ajoute aussi un baiser à chacun.
Édouard.
|
le 3 février 1919
Chers aimés,
|
J'ai posé ma signature hier en vitesse sur le bas d'une carte depuis la table d'un hôtel de Cologne pendant le casse-croûte que j'y prenais en compagnie d'Édouard. Pour un dimanche c'est plutôt maigre surtout pour vous faire part d'un aperçu des voyages que j'effectue parmi les plus riches pays du monde.
|
|
Mais ce soir puisque me voici à la veillée chez mes hôtes j'ai toute la latitude nécessaire pour vous faire une lettre, ne risquant pas d'être distrait par les conversations de mes voisins, vu que je n'y comprends pas un mot.
|
|
Vous ayant écrit depuis Aix-la-Chapelle je ne me rappelle plus si je vous ai dit que j'étais à Grevenbrück, petite ville de quelques milliers d'habitants à environ dix kilomètres de Düsseldorf. Comme nous ne sommes que des permissionnaires sans aucunes fournitures, il nous faut pour la plupart chercher un lit pour ne pas geler dans le local qui nous est réservé, une espèce de théâtre.
|
|
Un brave homme (d'apparence toujours) m'emmène chez lui en me faisant comprendre qu'il pourrait me donner un bon lit. Depuis, je peux venir avec un copain me coucher chaque soir sans craindre le froid, nous avons même une bouillotte chacun et de l'eau chaude sur la table de toilette chaque matin à sept heures, le café nous attend à la cuisine quand nous descendons. Et ce n'est qu'un exemple parmi la généralité !
|
|
Qu'allez-vous penser des sauvages que nous sommes venus civiliser et qui chaque jour nous émerveillent par leurs méthodes ? Point besoin n'était que je vienne visiter une des plus belles villes de la puissante Allemagne pour être émerveillé. Partout un luxe de richesse et d'aisance. Je me demande si la misère ou la pauvreté existent dans ce pays. Je suis chez un ouvrier où tout brille. Les marmailles d'enfants sont pour la plupart tous bien tenus.
|
|
Lorsqu'on a visité les grandes villes, l'on est en droit de se dire qu'ils sont solides pour payer les frais de la guerre.
|
|
Rien qu'à sortir du train à la gare de Cologne, il y aurait de quoi visiter pendant une heure le merveilleux édifice qui permet le trafic et le confort dans une ville de sept cent mille habitants. Mais ce n'est rien à coté de la cathédrale qu'on trouve en sortant de la gare. C'est à rester en extase à la contempler soit à l'extérieur ou à l'extérieur.
Édouard étant arrivé à dix heures (moi à onze heures trente) a eu la bénédiction du Cardinal Hartmann. Quelques cent mètres à faire pour admirer le Rhin et ses ponts de quatre à cinq cents mètres. On peut traiter de Kolossal celui que Guillaume inaugura en 1912, où passent deux lignes de chemin de fer et deux de tramways. Heureusement que ceux-ci nous ont permis de faire le tour de la ville. Vous dire toutes mes impressions ne m'est pas possible. Contentez-vous de constater combien sera intéressante ma dernière période militaire ! Ce sera sans doute ma part de la Victoire. Il vous est facile de deviner combien je jalouse la facilité qu'à
Édouard à se faire comprendre parmi l'accueil sympathique que l'on peut trouver ici, mais comme il n'est pas égoïste, je me réjouis de ses avantages. D'ailleurs, je vais travailler aussi l'allemand sur l'opuscule que j'ai acheté !!!
|
|
Ce n'est pas ce souci qui m'a hanté cette nuit ! Mais plutôt l'annonce de l'événement qui est arrivé à Verne le jour de mon départ ! Je l'ai appris par
Édouard. Trop tard pour vous donner un avis qui serait superflu. J'attends anxieusement le résultat de la vente, en même temps que vos impressions sur l'écrémeuse, avec la note. Nous avons un temps propice pour le trèfle, qu'il daigne vous avantager en accompagnant mes tendres baisers. Louis.
|
le 7 février 1919
Bien chers,
|
Le soleil brille sur une petite couche de neige qu'il fait fondre à l'abri. Mais ce soir le temps clair va sécher vite les trottoirs de Grevenbrück. Les copains sont partis entasser des obus et moi je me suis esquivé pour venir chez mon hôtesse vous faire une lettre.
|
|
Depuis mon récit sur notre journée à Cologne c'est la vie du soldat s'esquivant le plus possible des légères corvées qui nous sont imposées. Cela nous est facile, n'étant connu de personne, cela ressemble à mon séjour au 60ème à Besançon. Le 165ème n'a pas encore paru ! Pauvres copains avec deux à trois cents kilomètres à faire en ployant sous le fardeau, cela va leur procurer un cuisant souvenir dans leur séjour sur les bords du Rhin. Moi, je bénis le hasard qui m'a épargné ce martyr ! Ce qui nous fait désirer principalement le régiment consiste à avoir des correspondances, or comme delà n'avance à rien de donner une nouvelle adresse il n'y a qu'à se résigner à cette nouvelle restriction. Cela est un peu dur, surtout en rentrant de permission.
|
|
Voilà un peu pourquoi j'ai pris hier le rapide d'Aix puisque j'ai la faculté d'atténuer cette privation. Parti d'ici à une heure j'étais au palais de justice à trois heures et demie. J'ai pris connaissance d'une lettre d'Henri du 28, mais qui ne m'a pas beaucoup laissé deviner vos intentions au sujet de la journée du 5. je reste perplexe en attendant lundi ou mardi la décision que vous aurez prise et qu'Édouard ne manquera pas de me transmettre.
|
|
Après avoir pris connaissance des nouvelles affaires juridiques d'Aix-la-Chapelle (la ville me devient familière) j'ai pu changer mon linge grâce à
Édouard et prendre un repas à la popotte des "flics" pour reprendre un rapide à sept heures.
|
|
A neuf heures trente mes hôtes m'attendaient avec un plat de pommes de terre rôties à la graisse et de la salade de betteraves, une bouillotte dans mon lit, sous un édredon, que pouvais-je faire de mieux en attendant sept heures ce matin que l'eau soit chaude dans ma cuvette et le café au lait lorsque je serai prêt !
|
|
Qu'allez-vous penser de l'occupation ? Est-ce que le mois de mars ne va pas arriver trop tôt pour mettre un terme à ces heureux jours ? Je vous laisse le soin de deviner ma pensée, vous dis au revoir et vous embrasse tous affectueusement. Louis.
|
Grevenbrück, le 9 février 1919
Chers aimés,
|
Par le beau soleil de ce jour une promenade nous est réservée : nous allons faire connaissance avec d'autres pays. On nous annonce dix à douze kilomètres plus au Nord. Sans sac ni fusil, ce n'est qu'une ballade pour notre dimanche. Le hasard me mettra t'il sur des gens aussi sympathiques que ceux que je vais quitter ? J'en doute. Inutile de vous dire que je regrette le bon lit qui me faisait narguer les nuits claires que nous avons voilà quelques jours !
|
|
Il est deux heures trente du soir, j'ai laissé partir le détachement à midi.
Édouard m'avait promis une visite pour aujourd'hui. Mais ici on ne travaille pas le dimanche. De ce fait les trains sont limités. A la gare je viens d'apprendre que je n'avais pas d'espoir dans le train d'Aix-la-Chapelle. Alors avec quelques retardataires comme moi, je vais essayer de retrouver mon cantonnement sans pouvoir même demander ni lire les renseignements.
|
Wickrach, le 10 février
|
Je n'ai pu achever ma lettre hier afin de ne pas errer seul parmi des gens d'aspect sympathique mais d'une sincérité peut-être douteuse. Me voici donc parmi ma nouvelle affectation à Wickrach, village de trois mille habitants à coté de Gladbach qui en a soixante dix mille, région de Düsseldorf. J'y suis arrivé à six heures hier soir où j'ai trouvé les copains dans une grande salle de cinéma où j'ai bien dormi sur une paillasse grâce au chauffage central.
|
|
Ce matin, nouveau cantonnement pour ces pauvres abandonnés du 165 que la D.I. affecte dans ses régiments en attendant la venue de nos compagnies qui se font désirer autant que le Messie ! Une nouvelle salle de cinéma est réservée pour les trente-cinq permissionnaires de notre bataillon, mais ici le proprio de l'hôtel n'est pas si rupin que son voisin, il n'a que des calorifères qui s'éteindront cette nuit ! En perspective du froid qui ne manquera pas ce soir j'ai déjà réservé la succession d'un sous-off du 128ème parti hier. Une belle petite chambre avec tout le confort moderne. Je ne puis vous détailler l'impression que me donnera mon nouvel hôte, il me faudra quelques jours d'observation.
|
|
Mais ici comme partout une organisation qui épate les Français, tout inspire la puissance et la richesse en général, à part les vivres qui font encore beaucoup défaut. La physionomie des gens dénote les privations qu'ils ont subies pendant la guerre, mais par contre l'occupation va leur laisser les économies des braves poilus et peut-être encore quelques souvenirs. Mais nous avons des ordres pour ne pas entrer en relation avec la population, mais... l'exemple d'abord !
|
|
Enfin dans trente jours la classe s'approchera, je pourrai être plus long que sur ce papier qui est surtout réservé pour vous apporter mes affectueux baisers. Louis.
|
Odenkirch, le 18 février 1919
Mes chers,
|
Je n'ai pas encore pu me remettre à ma correspondance régulière. Sans doute un effet funeste du bien-être que me procure l'avantage réservé aux conquérants. Il est vrai que vous n'avez pas lieu d'être inquiet sur mon sort comme aux mauvais jours, mais il me semble que je pousse la négligence jusqu'à me priver du plaisir de vous adresser un peu plus souvent mes impressions.
|
|
Les quelques lignes que j'ai ajoutées samedi sur le papier royal du palais de justice d'Aix m'ont excusé de ma lettre du dimanche. Hier je fus un peu ennuyé pour avoir la sérénité d'âme nécessaire pour faire une lettre qui n'est pas urgente. Aujourd'hui enfin, voici tout de même le régiment qui arrive à destination ! Au bout de trois semaines d'attente ! Mais quelle douce attente avec la douceur ou plutôt la satisfaction que j'ai trouvée et l'inestimable valeur de peines et de fatigues qui me furent épargnées de faire deux ou trois cent kilomètres ! Il me semble que ce parcours m'aurait réduit comme jadis la marche sur Monastir.
|
|
Me voici donc à ce soir installé dans l'une des vastes salles de cinéma comme l'on en rencontre fréquemment ici. Il m'a fallu quitter Wickrach pour venir à Odenkirch, deux kilomètres plus loin. C'est le cantonnement réservé à la 1ère compagnie. J'ai regretté à nouveau ma spacieuse chambre que j'ai eu pendant huit jours ainsi que les hôtes prévenants qui m'hébergeaient. Mais ici nous ne sommes pas nombreux, s'il me l'est permis cela sera facile de coucher dans un superbe lit où il y aura bouillotte le soir et eau chaude dans la cuvette le matin à sept heures ! En attendant la libération, ce sera toujours un petit dédommagement de mes misères dernières. La région est la même, partout des agglomérations agricoles et industrielles épatantes, avec une organisation exemplaire, un bien-être général remarquable, même chez les ouvriers avec la douzaine de moutards ! Mais hélas ! Les méfaits de la guerre se lisent sur tous les visages où se peignent les traces des restrictions. Encore maintenant je ne jalouse pas leur ordinaire qui consiste principalement en la pomme de terre à toutes les sauces et leur affreux pain noir qu'ils tartinent de mélasse. Vous devinerez sans peine les légions de gosses qui viennent au rabiot autour de la roulante.
|
|
Je croyais avoir un plus volumineux courrier en souffrance dans le sac du vaguemestre, mais puisque vous savez que je n'ai qu'à aller à Aix aux informations vous n'aurez rien lancé au secteur 47 qui vous parait hasardeux.
|
|
Quand j'aurai une réponse à cette lettre je ne serai pas loin de prendre le chemin du bazar à 52. c'est alors que je pourrai mieux que ce soir discuter avec vous, ce que quelques cartes d'Henri m'ont suggéré, au sujet de vos transactions. Voici pour ce soir mes lointains mais affectueux baisers. 165ème R.I. 1ère compagnie Secteur 47. Louis.
|
le 24 février 1919
Bien chers,
|
Comme cela n'a rien de surprenant pour un lundi matin, j'ai la tête un peu lourde. J'espérais pouvoir un peu chasser cette nausée par la lecture d'une lettre comme Henri m'en a annoncé une depuis le 12. Mais je n'avais dans le sac du vaguemestre qu'une lettre de ce cher Mr. Fourgeot à qui j'avais envoyé une pensée depuis Cologne avec
Édouard. |
|
Je vais néanmoins commencer la semaine avec vous après avoir fini la dernière avec
Édouard, hier soir à huit heures. Muni d'une permission je sui parti dès l'aube hier pour ne pas manquer l'unique train du dimanche qui pouvait m'emmener. La journée n'eut rien pour moi de particulier, sinon que de m'initier de plus en plus aux mœurs de la grande ville qui me devient familière. J'ai même pu avoir une idée des représentations théâtrales en Bochie en écoutant une partie de la "Veuve Joyeuse".
|
|
Comme moi, Édouard n'est pas riche en nouvelles de vous. La fièvre Vernoise accapare tous vos loisirs et par son hypnotisme tous ceux que l'avenir pourrait vous accorder ! Je ne veux rien vous conseiller encore aujourd'hui. ce serait superflu et surtout difficile sur du papier. Par écrit on ne peut donner que des ordres brefs. Alors ces pouvoirs ne sont encore pas en ma possession. Mes sept années d'abrutissement m'en auront peut-être privé pour toujours et accaparent encore aujourd'hui ma volonté. Je ne désespère pas cependant pouvoir m'y remettre sous peu. Je dois partir autour du 20 mars, peut-être avant. Malgré les agréments que je trouve ici, la date de la libération ne me frappera pas au même point qu'Édouard. Vous saurez peut-être qu'il doit rejoindre Arras les premiers jours de mars et compte partir d'ici samedi prochain. L'échéance de cette carrière qui lui fut plutôt douce le laisse très perplexe. Il appréhende les nouvelles fonctions qu'il devra remplir. Son cas n'est pas unique. C'est une des funestes conséquences de l'affreuse guerre, ou plutôt de l'exécrable métier !
|
|
Que vous apprendre encore, puisque je ne vous ai rien dit ? Une banalité se rapportant au temps doux que nous avons voilà huit jours. Pour preuve, ces perce-neiges fleuris dans le jardin du riche juif chez lequel j'ai une chambre, à proximité du cantonnement. La bonne m'attendait hier soir à dix heures trente pour aller se coucher.
|
|
Vous voyez que mon séjour se continue assez agréablement. La douceur de mes baisers à tous ne peut en être qu'augmentée. Louis.
|
Odenkirchen, le 2 mars 1919
Bien chers,
|
Si vous êtes aussi disciplinés que les innombrables foules de la région, vous aurez dormi une heure de moins que d'habitude cette nuit, en raison de l'avance de l'heure. Puisque nous sommes ici comme modèles nous devions être les premiers à observer cette règle obligatoire, mais n'empêche que je me suis trouvé dans mon moelleux "plumard" ce matin à huit heures croyant qu'il n'était que sept heures. Il n'en fut pas de même des milliers de fidèles qui n'ont pas fait comme moi et se rendirent à l'heure nouvelle à la messe du dimanche.
|
|
Mais comme j'habite à proximité d'une superbe église neuve j'ai pu me mêler à la foule à neuf heures. Pas moyen de s'asseoir ni de voir tourner une tête, même pendant la lecture d'un interminable mandement de carême.
|
|
Ma nouvelle famille étant vouée au culte israélite, fait je crois comme la majorité de cette caste : adore, la galette d'abord.
|
|
Vous pouvez avoir la même heure que les pays Rhénans mais avez-vous le même soleil ? Un superbe ciel sans tache qui avait recouvert le sol cette nuit d'une petite gelée. Mais voilà onze heures, les bourgeons vont s'éveiller sous l'action du soleil ; de même que les promeneurs dans toutes les directions. Si vous pouviez être dans un coin animé à observer tous les passants vous vous demanderiez si tous ces gens-là n'habitent pas les Champs-Élysées, tellement la tenue générale est impeccable et réservée. Ce ne sont que les ouvriers de la grande Allemagne ! Mais hélas ! il ne faut pas être grand observateur pour découvrir les traits d'anémie qui ressortent sur petits et grands : sous ces beaux pardessus, dans ces superbes logements il n'y a presque rien à se mettre sous la dent. Des bandes de gosses, parfois avec la mère viennent tendre la main pour avoir un bout de pain. Ce n'est pas sans jalouser un peu ma situation qu'ils apprennent que dans une ferme "Frankreich" il y a tout en abondance et que je vais pouvoir bientôt me remettre à l'œuvre.
|
|
En attendant je vais (afin que je n'oublie pas mon rôle tant que j'aurai l'habit) aller tirer vingt-quatre heures dans le poste de police du parc à munitions.
|
|
Édouard m'apprend hier la déception qu'il a eu lui aussi de ne pouvoir, faute de train, venir jeudi passer la journée avec moi et m'apporter un peu du produit de l'écrémeuse. J'ignore à cette heure s'il est en route pour la France.
|
|
Je croyais toujours avoir une de ces intéressantes lettres comme j'en fus si souvent gâté. Mais je vais commencer à croire que ce n'est plus la peine qu'on me communique ce qui a trait à ma destinée future.
|
|
Pourtant je mets toute mon affection dans ces banales pensées de ce dimanche. Louis.
|
le 5 mars 1919
Bien chers,
|
Ce n'est pas très encourageant de prendre une grande feuille sans avoir de motifs bien intéressants pour la remplir ou que l'on attende depuis un mois bientôt sans avoir de réponse régulière à faire. Cependant telle est ma situation et je désespère qu'elle se modifie. J'aimerais pourtant mieux vous entretenir de la gaie situation qui m'est réservée pour achever l'exécrable carrière, afin d'effacer le noir qui a été mon lot si longtemps et l'ornement funèbre de ma correspondance.
|
|
Néanmoins l'aurore de ce carême libérateur me prédispose à être un peu bavard.
|
|
Je n'ai eu que l'envie et l'eau à la bouche des beignets que vous aviez faits hier, chère maman, pour honorer le traditionnel carnaval. Avec un verre du "Noa" ils devaient bien descendre ! J'ai bien dit à la bonniche qui fait ma chambre d'en faire mais "Nix beurre, nix œufs" et puis le gros marchand de chevaux son patron, aurait fait des yeux sans doute.
|
|
Enfin, afin de marquer un peu ce mardi-gras, je me suis payé le voyage de Gladbach hier soir : dix kilomètres de tram pour rejoindre et visiter une ville de soixante dix mille habitants. Mais la pluie que nous avons eue, moi et deux copains, a déprécié l'agrément de contempler les magasins ou les immeubles, fringants neufs de la cité. Je note en passant que depuis Odenkirchen où je suis et qui a vingt mille habitants, pour se rendre à Gladbach l'on traverse la ville de Reytd qui en a quarante mille. Neuss n'est pas loin non plus avec soixante mille, enfin la région a son pompon avec Düsseldorf qui compte trois cent mille ! Pas étonnant que toutes ces bouches ne puissent pas être remplies, même au prix de deux cents marks les cent kilos de blé, cours actuel.
|
|
Mon marchand de chevaux paye de dix à quinze mille les bons. Amenez-moi le "Noirot"! Avez-vous vendu vos bœufs ? Le beau soleil de ce matin me suggère un tas de points d'interrogation en même temps qu'il imprègne les baisers que je vous adresse. Louis.
|
|
Je ne sais encore pas le jour exact de mon départ, mais en tous cas pas plus de quinze jours. J'ignore si
Édouard est parti, rien n'est venu me le confirmer.
|
le 9 mars 1919
Bien chers,
|
Je vous ferai sans doute encore une lettre du dimanche dans huit jours depuis Odenkirchen, mais cette habitude qui devient traditionnelle par sa longue durée ne va pas tarder à disparaître pour moi.
|
|
Je serai probablement définitivement parmi vous pour le troisième dimanche c'est-à-dire le 29. Je pense partir autour du 20 comme je vous j'ai déjà dit. Depuis ces jours-ci notre centre démobilisateur devient Metz au lieu de Arras. J'aurai sans doute encore de bonnes pauses à faire devant les interminables bureaux par où il me faudra passer, sans que je sache pourquoi. Enfin je ne m'en fait pas trop à l'avance, la température n'est plus à redouter pour occuper les abris de fortune et provisoires qui sont dans de déplorables aménagements, parait-il. Je ne sais encore sous quel accoutrement je vais vous apparaître. Si l'étalage des bazars à 52
(?) n'est pas trop dérisoire, il me semble que j'en aurai toujours pour mon argent.
|
|
En attendant me voici dans la salle à manger de mon patron errant, qui n'est presque jamais là. Son dernier-né qui a deux ans m'appelle papa. La mère n'est plus, c'est une grosse Joséphine de Westphalie qui assume et assure la direction de la maison. Voici une feuille de papier qu'elle m'a donnée pour que je la remplisse. Je croyais bien être de garde encore pour mon dimanche mais ce sera pour demain. Voilà quelque temps que nous avons pas mal de pluie, mais ce n'est pas bien gênant pour nous qui ne marchons plus à pied. Toujours les premières places gratuites en tram ou en chemin de fer.
|
|
Il me tarde d'avoir une suite à votre lettre chère maman, qui donne lieu à l'inquiétude au sujet des méfaits de la grippe.
|
|
Voilà mes quatre pages remplies pour n'avoir rien d'intéressant à vous dire d'autre que de vous faire sentir l'affection de mes pensées. Louis.
|
le 16 mars 1919
Bien chers,
|
La répercussion des tueries de Berlin se fait sentir jusqu'à nous. De crainte que l'inondation bolchevike ne franchisse le Rhin et vienne faire crouler les beaux palais qui nous hébergent, voilà que nous sommes consignés pour notre dimanche. Je ne vois dans cette mesure qu'une simple précaution qui nous vaut le prix de rester enfermés ou réduits à de courtes disparitions.
|
|
Cette légère soumission va me faire désirer encore plus fort la complète liberté prochaine. Voici sans doute ma dernière lettre du dimanche. Je dois me mettre en route samedi prochain. Je croyais partir plus tôt. C'est tout au plus si je serai là pour le 29. Enfin à quelques jours près.
|
|
J'ai eu le plaisir de lire votre intéressante carte du 10 hier soir. Elle me donne une vision du nouveau tourbillon dans lequel je vais me trouver prochainement.
|
|
Si vous avez le climat Rhénan, vous devez avoir déjà semé du grain. La semaine écoulée fut superbe. La végétation est lancée. De nombreux pruniers sont en fleurs. Cet agréable décor fait d'autant plus regretter les longues journées qu'il faut assommer
(?) dans ce métier. |
|
Jusqu'ici, je ne m'en suis pas encore trop fait avec les distractions que j'ai pu obtenir dans ces beaux pays et la facilité relative à se faire comprendre. Tous les soirs, je me perfectionne un peu avec les gosses de mon proprio ou la boniche, mais cela devient plutôt rasant à la longue.
|
|
Vous devez être renseignés sur l'incertitude d'Édouard qui va bientôt être classé comme un sans patrie ou sans famille. J'espère bien le revoir et le laisser à Aix samedi, à moins qu'il ne m'attende pour faire la rentrée avec moi.
|
|
Je ne vous dis rien de tous les détails que vous me résumez chère maman, pas plus que ceux qu'Henri me signale. Je n'y suis pas indifférent pour autant et les classe par ordre de réception. Mais il est superflu que je donne des ordres, et chez nous les avis ne se donnent qu'après une longue délibération où je serai admis sous peu. En attendant mon renfort, ne fatiguez pas trop vos grippés, et recevez mes affectueux baisers. Louis.
|
Aix-la-Chapelle le 20 mars 1919
Bien chers,
|
Pour justifier que je suis "Poilu" voici que je trace ma dernière lettre de guerre au crayon. Cette inconvenance ne me sera plus permise dans quelques jours quand j'aurai quitté l'habit.
|
|
Je pars sans doute samedi. Nous ne sommes que jeudi. Et ma foi, pour profiter des derniers moments d'agréments parmi les Boches voilà que ce matin dès les quatre heures j'étais debout pour venir passer la journée avec
Édouard. A sept heures j'étais à Aix-la-Chapelle où je suis venu réveiller l'hôte de l'avocat Cornely. Vous savez peut-être que c'est une nouvelle adresse. La joie de la journée fut un peu ternie par la neige qui tombe, et ma foi, après avoir fait les achats de souvenirs de fin de guerre, me voici en attendant la nuit sur le coin d'une table de toilette à vous communiquer nos pensées et nos gestes. Tenez,
Édouard se rase pour essayer un achat que je viens de faire.
|
|
Il ne faut pas que j'oublie de vous dire que hier, afin que je garde un peu de souvenir de militaire, j'ai pris part comme membre honoraire à la présentation du drapeau aux jeunes recrues de la classe 19. Et ma foi, afin que je sois présentable comme tout le monde, voilà qu'on m'a accroché une croix de guerre (pour avoir "fait la nouba" voilà deux mois), c'est plus commode que ces années dernières pour la décrocher, hein ?
|
|
Enfin me voilà complètement satisfait pour reprendre la vie civile. Je n'ai plus qu'à rentrer ce soir à Odenkirchen pour rendre demain mon fusil, obtenir un laissez-passer pour Metz et revenir ici samedi 22. Il est convenu que j'emmène
Édouard. Mais comme sa valise est trop grosse et surtout ses adieux touchants à faire, il doit attendre un jour. Les intéressantes cartes d'Henri que je viens de lire ne trouvent pas ici la place convenable pour y être commentées. Je croyais me remettre en main par la foire d'Avril, mais me voilà trop tard. Je suis assez tôt pour vous embrasser ce soir puisqu'il n'est pas nuit. Louis.
|
|
Nous avons passé une journée princière, notre dernière journée de guerre, à nous deux Louis. Il vous dit l'essentiel. Pour les détails, attendez que nous déballions la cantine. Pour un peu nous achèterions toute la ville. Je n'ai que la place de me joindre à Louis pour vous embrasser tous une dernière fois de loin.
Édouard.
|
Il n'est pas la place ici pour un post-scriptum qui dirait le destin difficile
puis tragique qui prit la suite de ces sept années pendant
lesquelles Louis fut si éloigné de sa terre. |

|
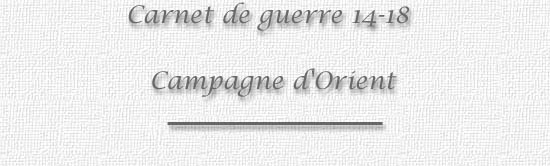
1916
 Nous sommes aux avant-postes (AP), nous dominons le
lac de Doiran, nous devons changer de secteur, le 1er mai. Le 176ème bataillon prend notre place, nous rejoignons le
régiment à
Enycal, en direction de l'est à travers la grande plaine par
une chaleur accablante, il faut gravir les côtes, deux nuis
blanches, le ventre vide, le soleil, la charge surhumaine à
transporter fait de notre marche une lamentable débandade,
nous rejoignons le 242ème, nous sommes dans un
vallonnement agréable, l'eau abonde, le sol mieux cultivé,
l'ombrage plus fréquent. Nous venons garer l'extrémité des
crêtes à l'est du lac de Doiran, en face les montagnes
bulgares, cette vallée fait partie du bassin de Kalicot, pas de
routes, il faut aménager les pistes, je vais au travail avec la
Compagnie. Le 6 mai nous prenons les AP, il faut faire sept
à huit kilomètres à flanc de coteau. J'ai une vue superbe de
Doiran et le lac ainsi que les principaux points qui furent les
témoins de notre campagne serbe. Le 8 mai nous sommes
relevés par le 5ème bataillon, nous venons en réserve à
Senevé où il y a des mouvements de troupes. Le 371ème, le 244ème
sont de passage. J'ai retrouvé ma caisse et m'installe dans les
ruines, le 15 nouveau déplacement de la Compagnie à Karamudli, préparer une piste sous la direction du Génie.
J'ai reçu un colis de Marcelin ; nous relevons les AP le 18,
grand grade au col de Popovo, nouveau colis de Verne ; la
chaleur provoque de nombreux orages. Nombreux sont les
Bulgares qui se rendent. Le 22 nouvelle ascension des côtes,
nous sommes en vue du fort de Dova-Tépé (Grèce) que la 114ème Brigade occupe, retour à Karamudli le 26, cette piste
passe au col de Baisili et doit être achevée pour la visite du
Général Sarrail qui doit visiter le fort de Dova-Tépé. Nous sommes aux avant-postes (AP), nous dominons le
lac de Doiran, nous devons changer de secteur, le 1er mai. Le 176ème bataillon prend notre place, nous rejoignons le
régiment à
Enycal, en direction de l'est à travers la grande plaine par
une chaleur accablante, il faut gravir les côtes, deux nuis
blanches, le ventre vide, le soleil, la charge surhumaine à
transporter fait de notre marche une lamentable débandade,
nous rejoignons le 242ème, nous sommes dans un
vallonnement agréable, l'eau abonde, le sol mieux cultivé,
l'ombrage plus fréquent. Nous venons garer l'extrémité des
crêtes à l'est du lac de Doiran, en face les montagnes
bulgares, cette vallée fait partie du bassin de Kalicot, pas de
routes, il faut aménager les pistes, je vais au travail avec la
Compagnie. Le 6 mai nous prenons les AP, il faut faire sept
à huit kilomètres à flanc de coteau. J'ai une vue superbe de
Doiran et le lac ainsi que les principaux points qui furent les
témoins de notre campagne serbe. Le 8 mai nous sommes
relevés par le 5ème bataillon, nous venons en réserve à
Senevé où il y a des mouvements de troupes. Le 371ème, le 244ème
sont de passage. J'ai retrouvé ma caisse et m'installe dans les
ruines, le 15 nouveau déplacement de la Compagnie à Karamudli, préparer une piste sous la direction du Génie.
J'ai reçu un colis de Marcelin ; nous relevons les AP le 18,
grand grade au col de Popovo, nouveau colis de Verne ; la
chaleur provoque de nombreux orages. Nombreux sont les
Bulgares qui se rendent. Le 22 nouvelle ascension des côtes,
nous sommes en vue du fort de Dova-Tépé (Grèce) que la 114ème Brigade occupe, retour à Karamudli le 26, cette piste
passe au col de Baisili et doit être achevée pour la visite du
Général Sarrail qui doit visiter le fort de Dova-Tépé.
Juin 1916
Nous relevons les AP le 3, la grande bataille de Verdun
redouble de violence, la jonction Russo-anglaise est faite.
Une grande bataille navale a lieu, le Général Sarrail prend
des mesures énergiques à Salonique ; sommes relevés le 11,
prenons place de la piste de Dova-Tépé. La chaleur est forte,
50°, les succès russes soulagent le frisson causé par
l'horrible tuerie de Verdun ; 20 juin rien ne change, même
AP, même chaleur ! Succès russes qui ont fait 170000
prisonniers. Une révolution exécutée par la menace des
cuirassés change la situation politique et militaire en Grèce.
Après quatre mois la bataille de Verdun redouble de
violence, nous perdons le fort de Vaux ; relève des AP le 27,
venons à Sari Doyambi. Ici la maison est achevée, on peut
avoir du vin à 1,20.
Juillet 1916
Reprise des AP le 4, le 8 j'assiste à la chute d'un aéro,
abattu par nos avions. L'appareil prend feu, en face de Dova-Tépé. Toujours la chaleur !
L'offensive de la Somme nous permet l'espérance ; le 9
nous revenons à Doyambi, les troupes devraient prendre un
repos de 10 jours en raison des grandes chaleurs. Les succès
russes continuent. J'ai pu voir Joseph Dornier et Gut qui
sont à Karandli avec la division, nous trinquons ! Le 14 au
matin nous relevons les AP au col de Popovo, nous occupons
un des nombreux pitons du versant nord, supplément à
l'ordinaire à l'occasion de la fête nationale. La chaleur
tropicale nous suffoque, on parle de 70° ! Certains jours, il y
a beaucoup de maladies parmi les troupes de plaine qui sont
sans ombrage, le jour, les mouches ! La nuit, les moustiques
! Enfin des nouvelles de France arrivent nous annonçant des
pluies persistantes qui compromettent les récoltes.
A l'occasion du 14 juillet, Melle Poutignat ne m'oublie
pas ! 23 juillet nous sommes relevé et venons travailler avec
le Génie au signal de Robowo, un contrordre nous ramène à
Doyambi, le lendemain repos pour raison sanitaire.
Des bruits de déplacement de la division circulent, le
30, orages qui rafraîchissent, je rends visite à Besson au 242ème.
Août 1916
Troisième année de guerre ! Est-ce possible ! Oh
cruelle et triste destinée !
Nous relevons les AP, le
1er secteur sud du lac de
Doiran avec Surlow et Patoras. Un peu de pluie, des bruits
d'attaque ont lieu, le 9 au matin, bombardement continu du
côté de Doiran, l'infanterie coloniale a peu avancé, notre
situation nous permet d'être les spectateurs ; 13 août,
deuxième anniversaire du Moulin de la Caille.
Les troupes Françaises, Russes, Serbes, Grecques se
croisent ici ; le 6 nous continuons la route Salonique-
Athènes qui depuis Véria s'élève à 1600 mètres en longeant
le flanc le flanc de la montagne sur 20 kilomètres, nous
faisons la majeure partie à pied la nuit pour venir camper de
l'autre côté de la montagne ; le 8 nouveau départ, la route
longe une vallée assez bien cultivée vers l'ouest direction
Kozani ; le 9 repos, le 242ème nous rejoint, je vois Clausse
de Vergranne !
Le 10 départ, à deux heures du matin nous passons
Kozani, ville de 12000 habitants en partie grecque (Véria est
turque), nous campons dans une vallée turque, direction
Kastoria, la route est ancienne, assez bien tracée ; le 11,
quatre heures du matin départ, nous côtoyons d'agréables
vignobles, on rejoint la vallée de Vatista ; le 12 nous venons
à Bogaco, le pont sur la Vistrica est enfoncé, nous longeons
la rive gauche. Le 13, départ en direction de Kastoria,
grande halte à Kuchani après avoir franchi la rivière avec de
l'eau jusqu'aux genoux. Le bataillon doit couvrir l'ouest de
Kastoria où se trouvent quelques postes ennemis, la
cavalerie les découvre, quatre coups de canon les font
replier, de même que la garnison de Kastoria, nous
franchissons de nouveau la rivière pour dormir dans un petit
village où les habitants effrayés n'osent sortir. Nous sommes
exténués après avoir fait cent kilomètres sans trêve, mal
ravitaillés. La région parcourue est assez riche, nous
sommes en Grèce. Le 15 nous venons troupes d'occupation à
Kastoria, 10000 habitants, sur le lac du même nom qui
l'enserre en fer à cheval, je peux avoir du vin, des œufs, du
poisson ; le 16 arrive le 242ème qui doit nous remplacer par
une de ces Compagnies, la 11ème à Besson. Le 17 nous
repartons avec le 242ème, nous faisons l'ascension très
pénible d'un col qui va de Véria à Florina par Kozani, ici la
route n'est plus carrossable, peu de ponts sont utilisables,
après trente kilomètres campement à Roula, j'arrive exténué,
je demande une visite, le médecin me déclare non-malade !
Il est vrai qu'il ne peut reconnaître que les nombreux
cadavres qui arrivent chaque jour.
Le 18, nous rejoignons le régiment qui a rencontré les
forces ennemies, c'est pour nous une consolation de mettre
un arrêt à ce voyage de vingt-trois jours après quatre cent
kilomètres environ, dont seulement quatre vingt-dix par le
train ; le 19, au somment d'un piton, les frissons et
vomissements m'obligent à coucher à l'infirmerie avec 40°
de fièvre, je suis renvoyé le lendemain, je reste avec la 212ème Compagnie. Le 21 ma Compagnie est à 1500 mètres
d'altitude qui domine le lac Presba en face des Bulgares. Je
la rejoins bien fatigué, il souffle un vent glacial ; le 22 au
matin l'ennemi attaque, ordre de nous replier ! Notre
position dans les rochers à cause des pertes ; cinq morts et
sept blessés, toujours des ascensions pénibles avec le sac.
Les nuits sont froides, le ravitaillement n'arrive pas ! huit
jours sans pain, nous sommes faibles !
23 septembre, nous venons renforcer la
21ème. Marche
très pénible, nuits très froides, il a gelé ; le 24 au matin les
Bulgares essaient de nous tourner, ils ont aperçu notre feu,
et celui des mitrailleuses les fait replier. Je rencontre Louis
Cardinaux, grièvement blessé, il était en position au
voisinage, il ne m'a pas reconnu ! Grimm a été tué par un
obus, son corps est resté aux Bulgares, Mémo a du être tué
le même jour. Nous nous replions le 25 au matin, mais un
contrordre nous ordonne de remonter aux crêtes, les
Bulgares à quelques pas !
Encore une journée sans presque manger, des morts
dans les ravins qu'on abandonne, on casse les fusils qui n'ont
plus de propriétaires ! Les malades, les blessés meurent par
faute de soins ! Pas de chemins pour les évacuer ni pour
nous ravitailler. Enfin le Régiment subi les plus affreuses
misères de la guerre, nous nous replions du côté de Florina ;
25 septembre au soir, nous pouvons un peu dormir ; le 26 un
peu ravitaillé ; j'apprends la mort de Louis Cardinaux à
l'infirmerie faute de soins, ainsi que d'autres blessés à
Zélova ; le 27 nous venons garder la vallée, tout est calme,
nous avons enfin de nouvelles de France, une carte d'Henri
du 3 septembre. La Compagnie compte dix-huit pertes,
hommes tués ou blessés, le Régiment environ cent cinquante
hommes. Nous gardons la vallée de Zélova, il pleut trois
jours consécutifs.
Septembre 1916
Le 3 nous venons relever une section de la
21ème
comme soutien la mitrailleuse, mais le soir ordre de rentrer à
Pusadori ; les Bulgares se replient, le 4 nous montons la
côte, bous sommes bombardés sur les anciennes positions
bulgares, à un mètre de moi un obus tue l'adjudant Robert et
un capitaine d'artillerie, il y a d'autres blessés, vingt
Bulgares se rendent. Le 6 je reçois un colis ; nous sommes
un petit poste mais la Compagnie va occuper le piton le plus
proche de l'ennemi qui est retranché à 1900 mètres. Nous
avons d'un côté le lac Presba et de l'autre la plaine de
Florina où la canonnade fait rage ; le 7 nous sommes relevés
par la 17ème Compagnie, le bataillon vient en arrière, nous
pouvons un peu nous nettoyer, ce qui ne fut pas permis
depuis trois semaines. Je suis toujours très faible et sans
appétit, des frissons, maux de tête, je me décide d'aller voir
le major, il ne m'a même pas regardé, m'expédie. Le
bataillon a eu quatre jours de repas. Nous avons enfin une
veste de drap et une deuxième couverture, ce qui met le sac
à vingt-cinq kilos. Nous venons relever la 5ème Compagnie à
deux heures du matin, j'arrive avec beaucoup de peine, après
quatre jours à faire le guet comme des renards dans les
rochers, la lutte d'artillerie est toujours très vive dans la
plaine. Nous avons un nouvel adjudant, St-Hilier !
Il fait un vent très fort, je ne peux pas travailler, je
vais à la visite le 17, jambes enflées (analyse d'urine). La
Compagnie doit remonter aux A.P. Je reste à l'infirmerie. Le
20 l'infirmerie descend à Buf par un chemin abominable, je
suis exténué ; le poste de secours s'installe dans la maison
commune qui est un beau bâtiment ; le 21, le major
reconnaît que j'ai de la bronchite, il neige, je reste ici
jusqu'au 30. Le 372ème relève le Régiment ; nous devons
partir, nous allons camper à côté de Klestina, la terre
humide m'enrhume, le major m'évacue.
Le
235ème est dissout, un bataillon au
242ème, l'autre au
260ème, ma Compagnie devient l
26ème au 260.
Octobre 1916
On m'évacue en ambulance sur Florina par un chemin
abominable, il fait beau, je vois Georges, je rencontre aussi
Joseph Bouvard infirmier et Jeannenot !
Le 3 je repars pour Exissou en auto, trente kilomètres
de chemins très mauvais, ensuite le train pour Salonique,
arrivé à 5 heures du matin harassé. Nous étions vingt-cinq
malades dans un wagon à bestiaux, après une halte à la gare
sous des tentes, des autos nous conduisent à l'hôpital ou
quinze à dix-huit mille malades sont logés sous des tentes ou
baraques, je suis à la chambre 12 de l'hôpital temporaire ;
deux jours au lait pour débuter mais l'ordinaire a l'air
suffisant. Le major est de Besançon, première semaine
d'hôpital, aucun colis, j'ai le cafard, c'est la Saint Martin (11
novembre) ! Le 18 nous changeons de salle pour une tente,
nouveau major, nouvelles têtes, toujours pas de lettres ! Le
19 nous apprenons la chute de Monastir puis la mort de deux
aviateurs à Salonique suite à un accident, des dégâts,
quelques tués, des blessés, pieds gelés à ma Compagnie. Des
prisonniers, Bulgares, Boches blessés deviennent nos voisins
de tentes ! Enfin une lettre du pays au bout d'un mois ; des
vieilles lettres, des colis m'arrivent. Je fais soigner mes
dents, on m'en arrache dix.
Décembre 1916
Je suis toujours à l'hôpital, cela va mieux. Les Boches
envahissent la Roumanie, de graves troubles ont lieu à
Athènes. Le 12 j'apprends la mort de Marius, je trouve
Georges à l'hôpital, je reçois un colis de Melle Poutignat, j'ai
mal aux reins et suis très faible ; le 19 un départ d'évacués
pour la France : Montenoise très faible et Petit de
Sombevaux partent. 25 décembre : la croix rouge nous offre
à chacun un petit paquet. J'entends la messe, l'ordinaire est amélioré.
Je rencontre l'ami Perrin à l'hôpital. Julien m'annonce
qu'il a reçu la médaille militaire ; le 26 à mon tour
évacuation pour la France, je suis un des plus anciens de la
salle, je suis heureux à la pensée de revoir bientôt ceux que
j'aime ! Avant mon départ je suis victime du vol de mon
porte-monnaie, Georges me prête vingt francs. Nous
embarquons le 29 sur le "Tchad", joli petit navire-hôpital,
départ le 30, 11 heures du matin ; derniers regards vers la
Macédoine et sa capitale qui ne me laissent que de cruels
souvenirs ! 31, nous filons au sud-est, le navire doit faire
des détours pour éviter des sous-marins ou les mines !
Janvier 1917
Cette nouvelle année nous trouve en pleine mer, où me
laissera-t-elle ? Il serait superflu de l'affirmer, triste nouvel
an ! Aucune sympathie, aucune étrennes. La mer est forte, je
suis malade, nous filons vers l'ouest ; 2 janvier, la mer est
passable, aucune côte, nous devons être en mer Ionienne.
Vers 15 heures nous approchons des côtes d'Italie (Calabre).
Presque tout le littoral est habité, et doit être agréable, une
voie ferrée la longe. Nous franchissons le détroit de Messine
à la nuit. Les villes de Reggio et Messine de chaque côté du
détroit, le Mont Etna est remarqué par la fumée. La mer est
calme, le 3 direction nord ouest. Le 4, mer bonne, à gauche
la Corse, à droite l'île d'Elbe et le rocher de Montecristo.
Arrivée à Toulon le 5 au matin, je vois peu de choses du
port militaire, je suis embarqué en train sanitaire qui me
dépose à Alès a 10 heures du soir, hôpital Ste-Barbe.
Ancienne école, nombreuses infirmières, tout confort désiré
qui contraste avec notre vie en Orient ; le 10 une permission
de visiter la ville, Alès, environ 30000 habitants, doit son
importance au bassin minier. Le temps est beau et froid, je
vais bien, il neige toute la journée. J'apprends la triste
arrivée de Montenoise à Toulon ; la neige continue toute la
semaine. Le 19 je suis à la méthode brésilienne par suite de
constipation ! le 27 ordre de départ pour Nîmes.
Février 1917
Je dois quitter Alès le
1er
à 6 heures du matin pour
Nîmes. Il fait très froid, je regrette un peu Ste-Barbe, pour
la forme je passe deux visites successives (un cadeau,
quinze jours de permission… d'interminables démarches, je
profite pour visiter la ville, admirables vestiges romains.
En compagnie de Ruffy de Fesches nous partons à 9
heures pour Tarascon, le rapide de Marseille nous emporte
vers Lyon à 1 heure du matin. Je dois passer par Dijon pour
arriver à Besançon le 3 à 18 heures, Julien et Madeleine
m'attendent, j'ouvre les yeux sur tout ce qui a été l'objet de
mes désirs pendant trente mois de campagne ! L'hiver est
rigoureux. Les jours passent rapidement, je vois presque
tous les amis, Édouard vient le 14, nous pouvons tous être
réunis quelques heures, il repart le 15, je l'accompagne en
venant demander une prolongation qui m'est refusée ; nous
voyons les amies à Besançon. Je rentre le 19 au matin, le 235ème me renvoie au 260, après d'interminables
renseignements à la 25ème Compagnie, rue Mégevaud, là je
me retrouve comme dix ans auparavant lorsque je débutais à
la caserne ; je m'habitue pourtant à cette vie de départ, n
peut sortir en ville aux dépens du porte-monnaie !...
Je revois les copains d'Orient au 35ème, au
60ème ; on
nous vaccine à nouveau. Je suis proposé pour un dentier. Je
déjeune le 25 chez la cousine Berthe.
Mars-Avril 1917
La vie continue au dépôt à la
25ème. Je vois les amies
du quai ; avec une fausse permission je vais à Verne. Je dîne
avec Georges et sa famille, j'espère une autre permission
pour le samedi suivant !
Le 6 je rends visite à Mme Besançon, le 8 la neige à
nouveau, je rends visite à Melle Poutignat qui m'offre à dîner,
le beau temps revient. Le 10 je dois partir en permission
agricole avec quinze jours et deux prolongations de dix jours
je suis de Verne jusqu'au 14 avril. Ces trente-cinq jours de
détente sont appréciables mais l'hiver persistant ne me
permet pas de fournir grand travail à la maison. Je rentre le
16 avril , la Compagnie est à la Citadelle. Je retrouve les
copains, Armand, Oudin, etc… l'hiver persiste, les combats
au nord de Reims font renaître l'espoir à l'arrière ! Je rends
visite à Mme Bey ; je prends la garde à Chamars, je passe à
la 28ème. Je vais à Verne le 29 ; nous devons partir le 30.
Mai 1917
1er
mai, c'est le fameux Camp du Valdahon qui
m'abrite. Je suis accepté comme mitrailleur. Je retrouve le
Commandant Macherey qui dirige le 28ème ; après bien des
difficultés j'obtiens une permission de rappel d'Orient !
Quinze jours à Verne par un temps superbe, l'arrivée
d'Édouard, une bonne journée à Besançon me rendent le
cafard, il me faut rentrer au Valdahon le 21. Je m'attends à
partir en renfort ; le 27, jour de Pentecôte, je rends visite à
Louis à Moutiers, une belle journée me rappelant des
souvenirs d'il y a quatorze ans.
Juin 1917
Je dois partir avec l'équipe des mitrailleurs, mais un
cas d'oreillons isole ma chambrée et m'exclut du groupe. Je
vais à Fablerans. Je suis invité chez Mme Besançon ! Le 10
Julien est venu couper le foin ; je suis contaminé et suis le
cours d bombardier et vais à Besançon, il fait très chaud ; le
19 je vais chez le dentiste et en profite pour aller à Verne.
Je suis affecté à la 27ème Compagnie comme subsistant. Je
passe quelques bonnes journées au plateau, je reçois mon
appareil dentaire. Le 24 je vais à Verne, j'en profite pour
aller au baptême à Fontenelle le 25 et suis porté manquant à
plusieurs appels ce qui me vaut huit jours de boite ! Mes
amies du quai me rendent deux visites !
Juillet 1917
Je me retrouve en tôle ; je m'habitue à mon dentier, je
me rattrape de ce que je n'ai pu sortir pendant huit jours !
On me garde à la 27ème Compagnie.
Le copain Oudin part en renfort au 363ème. Une
permission de vingt-quatre heures me permet d'aller à
Verne le 8 juillet, le séjour à Besançon se prolonge, mais le
10 je suis rappelé en renfort au 363ème encore un voyage à
Verne ; encore une voyage à Verne, puis retour au
Valdahon le 14. Nous sommes habillés pour le 235ème
d'infanterie. Je passe de deniers bons moments à Besançon ! Je fais
mes adieux. Nous partons le 17, direction Dijon. Melle B. et
Melle J m'accompagnent en gare, j'en suis
touché ! Le 18 arrivée à Chaumont puis St-Dizier. Le
Régiment est en ligne cote 304, je suis affecté à la 20ème
Compagnie. Je suis désigné au premier départ en
permission, le 24 j'arrive à Verne, après une halte à
Besançon. Sept jours à Verne, je participe à la moisson,
Édouard arrive aussi. Ainsi se termine ma troisième année
de guerre sans le moindre espoir de paix ! !
Août 1917
Je dois rejoindre le
D. Dre le 4 avec Édouard nous
passons une bonne journée à Besançon, nous dînons au
plateau. Le train nous emmène à Dijon-Troyes puis St-Dizier, le 6 je rejoins le Régiment à la 17ème Compagnie
d'infanterie, des autos nous emmènent du côté d'Avocourt,
la nuit sans abri on prend la relève ; un affreux boyau nous
conduit entre le bois d'Avocourt et la cote 304, du bois
aucune végétation ne subsiste suite aux bombardements sur
le secteur ; nous sommes en réserve entassés dans une sape.
C'est l'affreuse guerre qui dure depuis bientôt quatre ans
pour moi ! ! Après un violent bombardement, nous avons
quelques blessés ; les chasseurs nous relèvent le 14 au soir ;
ces huit jours me mettent dans un tel état que je me
demande si je pourrai résister à cette situation. Nous
restons à proximité des lignes, le bombardement devient
continu ; jusqu'au 18 nous devons être relevés.
L'attaque a lieu le 20, nous restons au camp de la
Source, nous pouvons un peu nous reposer, nous nettoyer,
le 26 départ en réserve.
Septembre 1917
Le
1ère
la Division est relevée. Nous devons quitter la
Meuse à 3 heures du matin pour prendre les autos à
Dombale puis Givry-en-Argonne, le 2 à Champigneulle,
c'est repos ! Les permissions sont rétablies pour les
privilégiés, nous attendons une nouvelle secousse ! Le 10,
je fais partie des signaleurs. Je retrouve Beuret, Jeannin
vient me voir, nous partons le 20, les baraques du camp de
Châlons nous abritent, relève le 22 ; au soir c'est la marche
harassante à travers l'immense plaine, nous occupons en
deuxième ligne une ancienne tranchée conquise. Il fait un
temps superbe durant neuf jours ; nous possédons un fusil
mitrailleur en position contre avion.
Octobre 1917
Le
1er
relève ; nous venons en réserve à 5 kilomètres
de Mourmelon, nous travaillons de nuit. Le 5, mauvais
temps. Reprise des tranchées au "Titon", douze jours de
petits postes, le service est pénible, le temps mauvais, le
Régiment est dissout, venons en réserve, je vois Édouard, je
fais une demande de permission et arrive ainsi à Besançon
le 24 à Verne pour repartir le 5 novembre. Je donne la main
aux semailles qui sont très en retard, je passe les jours de
Toussaint en famille où l'on s'habitue à l'état de chose
actuel !
Novembre 1917
Le 5, la perm se termine ! Je passe la journée à
Besançon où le meilleur accueil m'est réservé. Mais quel
cafard au retour. Je passe voir Henri Girard à Mourmelon.
Je retrouve ma Compagnie aux avant-postes. Pendant ma
permission mon Régiment passe au 334ème et ma Compagnie
devient 13ème. Nous sommes entre le Mont Sans Nom et
Auberive, ce sont de lugubres nuits de novembre aux P.P.,
secteur calme à part les torpillages de tranchées
quotidiennes, l'une entre dans l'escalier d'une sape, fait tout
sauter, quatre morts, cinq, six blessés ; 11 novembre, St-
Martin n'est guère encore honoré cette année ! Serait-ce
pour l'année prochaine ? Les Italiens battent en retraite, les
Russes nous sont à charge… Le 303 nous relève et venons à
Mourmelon, la détente est appréciée ; je vois Henri Girard,
nous visitons la tombe de Dormais à Suippes. Nous devons
relever le 335ème le 22. De Mourmelon au Mont Sans Nom
l'étape est très dure ; c'est encore les P.P. qui nous
attendent, le mauvais temps revient, le 26 fausse alerte par
Lassinger.
Décembre 1917
Le
1er
nous trouve aux AP ; le secteur est assez calme,
le froid est vif ; dix-huit jours ainsi, c'est un record! Le
camp Berthelot nous offre de légères et froides baraques.
Un avion ennemi est abattu près de nous. Je ne peux voir
Henri parti aux tranchées, huit jours de repos vite passés
nous renvoient aux AP, nous sommes en réserve, l'hiver bat
son plein avec de la neige !
L'armistice russe est signée ! Nous passons Noël d'une
façon supportable, mes amies Bisontines nous envoient à
Édouard et à moi quelques gâteries, Lanoise m'apporte un
petit colis. Nous sommes Compagnie de réserve au B. La
neige tombe, les nuits claires et un froid rigoureux. Des
bruits de relève circulent, le 30 une lettre de Somme.
Suippes m'apprend brutalement la mort d'Henri Girard.
Janvier 1918
C'est tout attristé par la mort d'Henri que ce quatrième
nouvel an me trouve. La Champagne est couverte de neige,
les opérations sont calmes, mais on sent dans l'air qu'il faut
que la nouvelle année trouve une solution dans l'horrible
conflit, serait-ce par la cruauté ou la conciliation. Le 3 je
quitte les AP pour me rendre à Mourmelon-le-Petit prendre
des nouvelles sur la mort d'Henri ; il fut tué derrière le
téton par un éclat d'obus le 20 décembre. Il repose à Billy,
sept kilomètres de Mourmelon ; l'hiver redouble, nous
sommes abrité par le tunnel du Mont Sans Nom. Des bruits
de déplacements imminents circulent ; nous venons au camp
de la Noblette après une étape de vingt kilomètres. Le 20
retour au camp national de Mourmelon, des bruits de
dislocation circulent ; nous allons aux travaux de défense à
l'arrière. J'obtiens un laissez-passer pour me rendre sur la
tombe d'Henri. Le tour de permission va recommencer le
27. Je vais à Sommes-Suippes où le meilleur accueil m'est
réservé chez des amis d'Henri.
Février 1918
L'ordre de quitter ces régions arrive ! Le
1er
nous
embarquons à St-Hilaire pour Ste-Menehould, nous devons
cantonner à Noirmont ; le 3, relève des AP 132ème Colonial,
rive droite de l'Aisne, nous venons en réserve, le 6ème
Bataillon nous relève, le camp des Hauts-Batis nous abrite à
côté de Vienne-la-Ville. Je dois partir en permission le 22 !
Travail de défense, les nuits sont très froides. Départ en
permission, étape à Neuville, Ste-Menehould, arrivé à
Besançon. Henri m'attend en gare de Baume à midi, arrivée
à Verne le 24.
Je savoure le bonheur d'une permission au sein d'une
famille heureuse.
Mars 1918
Le 3, je passe la journée avec Maman à Mounans dans
la famille de ce regretté et cher Henri. Le 5, Édouard
arrive, c'est la fête en famille avec Fredo. Je vais à
Gouhélans, à Baume, Maman et Édouard m'accompagnent à
Besançon ; nuit à l'hôtel, le 10 je suis à Ste-Menehould, on
nous embarque pour Somme-Bionne où se trouve le
Régiment sans affectation spéciale, travail de défense
habituel, nous sommes inquiets devant l'offensive
allemande préconisée, celle-ci se déclenche sur le front
anglais, départ le 24 ; venons à la cote de Neuville-au-Pont.
Le Régiment doit prendre les tranchées le 27 secteur de St-
Thomas. La Compagnie est en réserve, nous apprenons la
sanglante avancée sur Amiens, nous avons la faveur de
passer Pâques assez tranquille le 31 mars. Lanoise
m'apporte un colis.
Avril 1918
Toujours à St-Thomas, nous allons au travail tous les
soirs, la bataille continue dans la Somme, le mauvais temps
persiste, les Américains doivent venir nous renforcer et
nous faire disloquer. Je fais partie d'une patrouille sur les
rives de l'Aisne, le 13 au matin, ordre imprévu nous amène
dans le camp des Hauts-Batis, jusqu'au lendemain le camp
des Peupliers nous abrite, le Bataillon doit être dissous,
nous sommes aux environs de Hans sur la Bionne. J'ai
expédié chez nous mon carnet de pécule (96 francs).
La bataille fait rage sur le front anglais, les
évènements ont l'air décisifs ! Autour du 20 des gelées
blanches marquent un temps funeste, retour à Neuville-au-Pont. Je plante des pomme de terre à Colson ; le 24 on
embarque pour Valmy puis Bar-le-Duc ; le Bataillon doit
reformer la 29ème division d'infanterie qui arrive de la
Somme ; je suis au 165ème, 1ère Compagnie, nous devons
embarquer pour Verdun.
Mai 1918
Nous passons la ville détruite pour venir nous abriter
au tunnel de Tavannes, devons prendre secteur rive droite,
région fort de Vaux. Relevés le 2 au soir, allons en réserve.
Un bouleversement incroyable témoigne la lutte sauvage
qui s'y est déroulée il y a deux ans !
Le changement de Bataillon nous prive de lettres, avec
le beau temps activité de l'aviation de l'artillerie, nous
avons quatre hommes tués à la 6ème Compagnie. Une série
de jours brumeux rend le secteur calme, mais les corvées
sont pénibles tous les soirs. Nous relevons les P.P. le 12
près des batteries devant Damloup.
Le 19, Pentecôte triste et monotone en ces lieux. Le
beau temps revient. L'offensive se déclenche sur le Chemin
des Dames ; le 27, l'avance est inquiétante, pour notre part
nous avons des coups de main dans la région de Bezonvaux,
bombardement par obus toxiques !
Juin 1918
Reprise des P.P. en face Damloup.
Édouard m'apprend
son entrée au C.J.D, situation avantageuse pour l'heure
angoissante qu'il nous fait subir ! Rien de nouveau à part le
service de nuit assez pénible. Je rencontre Guinchard ;
après quatre jours et quatre nuits de P.P. nous revenons
dans les nouveaux emplacements de G.C., service jour et
nuit.
La bataille a repris entre
Montdidier et Noyon, légère
avancée ennemie. Beau temps sec ; le 20, pluie et froid.
Nous sommes relevés par le 3ème Dragon. Sous une pluie
fine nous venons coucher dans des sapes à côté des casernes
Marceaux (Verdun). Le 22 au soir nous devons déjà
remonter au fort de Douaumont. Je profite de ma journée
pour reconnaître au cimetière du Faubourg-Pavé la tombe
d'Octave ; j'ai peine à découvrir la petite croix noyée dans
l'herbe, j'ai presque honte de réclamer une tombe à
l'abandon ! Pas la moindre marque d'affection, je ne puis en
ce jour hélas y remédier ! ! Nous partons pour le fort
immortel, la guerre l'a ébréché mais non détruit ! Ses vastes
et solides souterrains offrent un asile confortable et sûr.
Nous y sommes en réserve, Douaumont nous abrite sept
jours, la détente est appréciable. Mais le 29 nous devons
prendre le secteur des Courrières. La Compagnie de réserve
est au ravin de l'Ermitage.
Juillet 1918
Le fameux bois est toujours aussi lugubre et
mouvementé, presque chaque jour il y a bombardement de
part et d'autre, chaque nuit des coups de main. Le 4 je fais
partie d'une reconnaissance dans un coin intenable, deux
évadés rentrent dans nos lignes en même temps que nous ;
le 7 nous sommes relevés pour venir dans les sapes de
Fleury juste le temps de se nettoyer pour rentrer au secteur
de Damloup. Encore un 14 juillet au P.P., l'événement est
limité dans le supplément à l'ordinaire. Dès le 15 au matin,
la canonnade en Champagne nous annonce la reprise de
l'offensive, succès médiocres pour l'ennemi. Il fait très
chaud, la 2ème Compagnie nous relève ; comme volant je
viens avec la 1ère section au ravin du tunnel, les avantages
sont appréciables ; eau, cuisine, nous allons au travail de
nuit, enfin deux jours de pluie bienfaisante ! Cette
quatrième année guerrière est marquée par une contre-
offensive qui chasse l'ennemi des rives de la Marne, mais
ne nous laisse rien augurer d'une fin prochaine.
Août 1918
Cinquième année de guerre ! continuation de
l'offensive en Champagne qui nous rend Soissons et répare
l'échec du 27 mai. La pluie met fin à la sécheresse ; nous
relevons la 3ème Compagnie aux avant-postes, P.P. latéral au
ravin de Tavannes, le 9ème Bataillon de Coloniaux nous
relève, nous revenons aux sapes de Fleury. L'offensive
reprend du côté d'Amiens par l'avance Franco-Britannique.
Je reçois un colis américain. Je signe l'arrêt de mon pécule,
195 francs à ce jour. Après cinq jours de repos, le 14 au
soir nous venons en réserve au ravin de Héli. Il fait très
chaud, nous sommes relevés par la 32ème. Nous couchons à
la citadelle de Verdun, départ en auto pour Marots (région
de Bar-le-Duc), le 25 embarquement à Mussy jusqu'à Paris.
On traverse des régions dévastées des bords de Marne par
les récents combats, puis les paysages riants des abords de
Paris, les monuments de la capitale étincelants au soleil
couchant ; nous passons par Pantin reprendre la ligne nord
et arrivons dans une riche ferme de l'Oise ; des camions
nous transportent exténués aux abords de Soissons le 28.
J'apprend la blessure d'Édouard juste pour aller le
remplacer aux combats. Mon tour est venu de prendre part
aux grandes batailles ! Qu'en adviendra-t-il ? 31 août,
toujours en situation d'attente pour l'attaque au sud est de
Soissons, nous devons opérer une action sur la droite, la
gauche reste menaçante par les canonnades furieuses ; les
opérations se développent sur Nyon, Péronne, etc.
Septembre 1918
L'attaque prévue n'a pas eu lieu, nous avons un peu de
répit ; le 1er
D.I. doit passer l'Aisne à l'ouest de Soissons.
Vingt-cinq à trente kilomètres à pied nous amènent au point
de rassemblement. Départ pour les lignes le soir même,
coucher dans les grottes de Chavigny au nord de Soissons ;
venons dans un ravin au pied de Leury ; les avions boches
nous repèrent ce qui vaut un terrible bombardement au gaz ;
deux tués, six, sept blessés. Ma santé fléchit, quelques
permissionnaires partent, nos succès continuent ; nous
relevons le 3ème R.I.. La pluie abondante remplit d'eau les
trous individuels dans les anciennes tranchées, nous
sommes des tas de boue ! Nous sommes en soutien des
Fusiliers-marins sur la grande route de Soissons-Lens près
de Moulin-Laffaux. Attaque ajournée à cause du mauvais
temps, le bombardement est chaque jour significatif ;
attaque le 14 au matin, soutien des Fusilliers-Marins,
avance de trois kilomètres, le caporal Hochet est tué,
Seroux blessé, ainsi que le Commandant et le Colonel, nous
restons sur nos positions ; succès de l'offensive américaine,
le 167ème attaque à notre droite, nous ne pouvons
progresser, la résistance s'affirme sur notre gauche, combat
à la grenade, nous venons en soutien au 42ème ; nous
apprenons le succès de l'offensive d'Orient. Le 22 au soir
nous les relevons les P.P. à droite de Soissons au ravin de
Montreuil. Après neuf jours de bombardement intense nous
sommes relevés, mais le 28 ordre de marcher en avant ; les
Boches se replient ; après un arrêt aux crêtes de Montreuil
et une journée harassante nous passons la nuit à la ferme de
Vauvaines ; le 29, nouvelle avance, nous dépassons le
Chemin des Dames, le fort de la Malmaison en direction de
la forêt de Penon, nous revenons passer la nuit à la ferme
où j'apprends mon départ en permission ! Les évènements
se précipitent, la capitulation bulgare ainsi qu'une offensive
en Belgique.
Octobre 1918
Le
1er
octobre, départ pour cette chère permission !
Arrivée à Verne le 3. Le bonheur est attristé par les
funèbres conséquences de la grippe espagnole. Néanmoins
l'espoir grandit avec le succès des alliés ; St-Quentin,
Cambrai tombent, Gouraud progresse en Champagne.
Quand, oh bonheur ! le 6 une demande officielle d'armistice
de la part des ennemis apparaît sur les journaux. Pour se
résigner à la capitulation ceux-ci font traîner les
pourparlers pendant lesquels les succès continuent ; Laon
est évacué ; Lille tombe le 18 ; à Verne je participe à
l'arrachage des pommes de terre ; un passage à Besançon, je
rejoins mon Régiment en repos à Blagny. Tout fait espérer
une fin prochaine de la guerre ; le 23 première étape,
Troësnes près de la Ferté-Milon, deuxième étape, sud de
Soissons où nos étions hébergé il y a deux mois. Le 25
départ de Muret pour Missy ; nous avons trois jours de
repos, les bruits d paix circulent ; on apprend la
capitulation de l'Autriche le 28, départ pour Montreuil,
Laffaux, Ainsy, Suzy (forêt de St-Gobain).
Novembre 1918
Jour de Toussaint, tranquille ; capitulation turque, et
autrichienne, par la défaite de Piave (rivière) et la
désagrégation de l'Empire, on annonce l'abdication du
Kaiser. Le 4 nous devons remonter en ligne par Crépy, nous
venons à Vieraise en réserve, nouvelle avancée en Argonne
et dans le nord, retraite générale du front ennemi, revenons
à Dercy, nouveau départ en direction de Marle avec un
temps et des chemins affreux. Passons la nuit à Erlon, à
côté de Vervins, la région est intacte. La joie des habitants
est grande, les récits interminables, on nous annonce
l'arrivée des parlementaires allemands ; défilé à Vervins
aux Minelles, l'ennemi fait des difficultés à capituler, la
poursuite continue.
St-Martin 1918
Enfin le 11 novembre au matin, annonce de la
signature de l'armistice !
Joie indescriptible ! Toujours aux Minelles accueil
bienveillant, suis de garde, nous devons partir le 12 le
Hocquet (environs de Montcornet), ensuite par les Aillettes.
Le froid est vif, les évacués, les prisonniers rentrent, nous
repartons pour Dagny ; travaux sur route, déplacement pour
Landouzy, Etreaupont, Lacapelle, ensuite Fourmies où nous
prenons le service au quartier de la gare, minée par les
Boches, nous cantonnons dans les écoles, assez bien
installés.
Décembre 1918
Le
1er
décembre nous trouve à Fourmies où rien ne fait
pressentir le départ. Le séjour se prolonge assez agréable !
concerts, cinéma, concours, je suis adjoint au vaguemestre.
Mon tour de permission s'annonce pour les environs de
Noël ; je prends le train le 27 à la Capelle pour n'arriver à
Verne que le 29 ; c'est la fin de l'année, et la fin de la
guerre ! !
Janvier 1919
Année de délivrance, début idéal, c'est la vie à Verne
avec sa monotonie et son agrément ; je viens à Besançon le
18 où je reçois le bon accueil habituel. La température est
assez douce, permission agréable. Je dois repartir le 23
avec l'heureuse perspective de la libération pour fin mars.
A Orry-la-Ville j'apprends la nouvelle affectation du
Régiment, on se dirige sur Bergues par Amiens, Boulogne,
Calais, Dunkerque ; puis le 26 pour Tirlemont (Belgique).
Régions dévastées d'Ypres, Courtrai, Audemarde et
Bruxelles. Le voyage très lent dans des conditions
difficiles. Le 27 par Louvain, Tirlemont et Liège. Il fait
nuit lorsque je visite la ville. Nous sommes expédiés sur
Aix-la-Chapelle, on arrive à 2 heures du matin le 28. Dès 6
heures en compagnie de Mayolle nous cherchons Édouard
dans la vieille capitale de Charlemagne ; au bout de trois
heures nous le trouvons sur le Kaiser Platz avec une
surprise compréhensible. Je suis restauré en compagnie des
flics et peut, avec Édouard visiter la grande ville, les
permissionnaires du 165ème arrivent, mais le Régiment n'est
pas arrivé, le 97ème nous prend en subsistance. Je profite
pour revenir à Aix où je passe la nuit ; retour le 31. J'ai
trouvé un mit, nous sommes à dix kilomètres de Düsseldorf,
la ville est importante par sa grande gare ; nous entassons
des munitions.
Février 1919
Ce début de mois me trouve en bonne situation, j'ai
rendez-vous avec Édouard à Cologne ; nous visitons la
grande ville. La cathédrale, les ponts, l'ensemble est
remarquable. Tout recèle la richesse et l'organisation,
aucune nouvelle du Régiment en attendant la libération
prochaine. Je vois Édouard le 6 à Aix. Nous quittons
Grevenbroich pour la région de Gladbach. Je trouve un lit
chez Muller. Je suis de garde, j'obtiens un laissez-passer
pour Aix où je trouve le Régiment ; je couche avec Édouard
pour retourner à Wickratch le 15 ; je rapporte les lettres des
permissionnaires du Bataillon. Le 17, visite à l'usine de
papier. La Compagnie doit venir prendre le service du Bad-Hôtel. Suis de garde au parc à munitions. J'obtiens une
permission pour Aix et passe une bonne journée avec
Édouard pour rentrer à Odenkirchen le soir.
Mars 1919
Mois libérateur ! J'espère le finir dans mes foyers.
Suis de garde. Le 2, Édouard vient me surprendre, nous
passons une journée ensemble grâce à la complicité de
Joséphine ! Rien de particulier parmi les agréments de
l'occupation ; temps pluvieux et doux ; garde le 10, je dois
partir le 22. Retour du mauvais temps, il neige. Le 19, prise
d'armes mémorable pour la présentation du drapeau aux
jeunes recrues. On m'accroche enfin la Croix, je vais à Aix
où je trouve Édouard au lit ; il est convenu que nous
rentrons ensemble. Le jour de gloire est arrivé !!
Je suis libérable le 22. Après avoir obtenu mes
papiers, je fais mes adieux pour prendre le train à Wicherat
à 18 heures ; arrivé à Aix à 20 heures, nuit avec Édouard
chez Cornely, dernière journée, trouve Clausse, Alfred et
Girardot. Départ pour Metz à minuit, il neige, triste région
du Palatinat par Trèves et Luxembourg, arrivé à Metz à 15
heures, visite de la ville. Nous couchons à l'hôtel, nous
regagnons la caserne à Montigny pour le rassemblement et
formation du train spécial des 20, 21, et 7ème régions.
Installés dans des wagons aménagés, départ le 25 par Toul,
Neufchâteau, Épinal, Gray, Besançon le 26 à midi.
Quelques rigides formalités nous rendent la liberté à 16
heures ; nuit à l'hôtel ; quelques visites aux amies de
Besançon ; l'express nous dépose à Baume à une heure et
demie, le 27 mars 1919 !
Fin.
Textes recopiés fidèlement d'après un carnet jauni et défraîchi retrouvé
après la mort de ma mère Léonie en 1989. Pauline Brasey (née Cœurdevey).
|

|