|
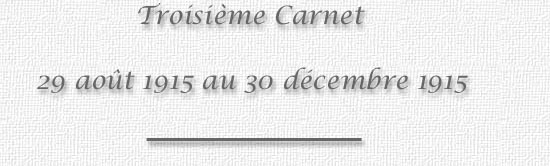
-
Aisne (Pierrefonds) -
Le
25 août 1915 - Nous
sommes arrivés hier à Pierrefonds. Le site aurait pu causer
quelque joie si les circonstances "die Gemüt, die
Stimmung" ("l'état d'esprit") avaient
été meilleures.
C'est
toute une pénible histoire. Depuis quelques mois, il y a du
tirage entre Töpfchen und ich. Il y a eu toute une série
d'à-coups qui, au lieu de ramener petit à petit l'équilibre,
tendent de plus en plus à le renverser complètement. C'est un
caractère ombrageux, orgueilleux et mielleux, souple devant les
puissants et la nécessité, méprisant et cassant envers les
inférieurs ou les égaux ; son orgueil se coiffe de jalousie en
face de chaque avantage dont il ne jouit pas, de chaque succès
ou de chaque supériorité qu'il ne domine pas. Et ce qui est
plus grave, c'est qu'il est extrêmement sensible à la
flatterie, que toute fierté ou quelque indépendance
l'offusque. Un exemple entre mille : à Duvy, une après-midi,
il avait dû travailler au bureau : les adjudants n'ayant rien
à faire avaient laissé couler les heures, et vers le soir ils
installèrent le jeu de croquet.
Il
vint à rentrer un peu las, et nous vit. Son cœur jaloux se
serra. Il fit une moue féroce et nous dit : "Vous êtes
deux cossards, vous n'avez pas mis les pieds au bureau cet
après-midi". Nous crûmes que l'expression était
familière et non injurieuse. Mais le soir il passa à côté de
nous pour aller se coucher et détourna la tête.
Un
autre fait. Nous aimons Ravenet et moi, faire du cheval. Nous
avions à Duvy, pendant nos longs loisirs projeté de faire
chaque jour ou le plus souvent possible, une promenade à
cheval. A cet effet nous nous étions entendus avec les
sous-officiers du train pour le choix des montures, et le
capitaine nous avait dit : "Vous pouvez monter quand vous
voudrez, je vous y autorise."
Nous
avons donc monté quelquefois, mais Herr Töpfchen nous faisait
la moue à chaque fois, offusqué de nous voir profiter d'une
heure où le plus souvent il était occupé. Aussi nous avons
suspendu un plaisir qui ne faisait pourtant aucun tort au
service.
 Avec
cela, j'ai eu la malchance de me heurter avec Jammer, cet esprit
étroit, infatué et besogneux, avec un filet de fiel coulant à
jet continu dans son âme étique. Avec
cela, j'ai eu la malchance de me heurter avec Jammer, cet esprit
étroit, infatué et besogneux, avec un filet de fiel coulant à
jet continu dans son âme étique.
Cette
psychologie de rhinocéros s'allie chez lui à une bassesse
baveuse. Il a quelque chose de la chatte et du crapaud.
Chatte,
il étend volontiers une couche de confiture sur les fesses de
ses supérieurs pour les mieux lécher ensuite, crapaud, il bave
haineusement sur ceux qu'il hait de son intelligence butée. Il
a donc fait tout un travail souterrain, souple et glissant; pour
me faire écarter du bureau.
Comme
Töpfchen est sensible aux flatteries, jaloux des indépendants,
ce fut facile de me faire mettre à l'écart, moi et tous ceux
qui ont l'échine raide, et de peupler le bureau des reptiles du
détachement. Hans der Grosse und (…illisible…) sont
devenus de réels personnages, quand ils ont parlé, c'est dit.
Qu'est-il
arrivé ? Mis à l'écart je suis trop fier pour m'insinuer à
rentrer. Au contraire, je m'y suis tenu. Tant qu'on fut à Duvy
au repos, où il n'y avait rien à faire, cela fut de peu
d'importance et l'on m'oubliait volontiers. Mais revint le
service actif. Les tâtonnements du début donnèrent un
surcroît de travail énorme à ces Messieurs les bureaucrates.
Je me tins sur la réserve, attendant des ordres qu'on ne
voulait pas me donner car on attendait que j'aille, pris de
compassion en présence de leurs fatigues, offrir mes services.
Cela dura ainsi huit jours, dix jours. Et l'électricité peu à
peu changeait de potentiel. Je remplissais avec le zèle tout
platonique et l'application tout objective qui poussent à
l'action le service des colis. A part cela, rien de plus. Et
comme j'avais pris l'habitude de ce dédain venu du bureau, je
ne notais pas l'animosité croissante comme un ruisseau d'orage
qui gonflait les cœurs fatigués. Töpfchen cherchait donc des
rognes, des occasions de me "saler".
D'abord
ce fut la brimade étroite de la demi-suppression de mon vélo ;
puis l'observation de ne pas m'arrêter en route, retour du
terrain de distribution.
Mes
haltes à MorelKreutz l'irritaient. Je n'en ai guère tenu
compte car je ne pouvais rien faire en arrivant plus vite.
Or
la veille de mon départ, Mme M., pour me remercier des leçons
données à Georges m'invita à souper. Je n'acceptai que sous
la condition d'être libre le soir. Dans l'après-midi, je
croisai Töpfchen. Il s'arrêta à demi pour une question
tranchée au galop ; quand il fut à dix pas plus loin,
l'invitation du soir me vint à l'esprit, je voulus lui demander
la permission de m'absenter. Mais j'hésitai une seconde, puis
il était trop loin. Cela passa ainsi. A 6 heures, vinrent des
ordres de la Sous-Intendance. J'allai au bureau. On ne me dit
rien. Par pudeur, je ne demandai aucune permission, je
m'éloignai, prévins le sergent Klein, au cas où je serais
appelé et partis.
A
peine étais-je en route que le Monsieur, averti ou défiant,
éprouva le besoin de me faire appeler. On lui dit où j'étais.
Moi,
j'ai passé une soirée tranquille dans la famille amie et quand
je rentrai, je m'endormis du sommeil le plus tranquille. A
quatre heures, Töpfchen me faisait appeler. Je le rencontrai en
route. Il ne répondit pas à mon salut. "Vous aurez à
choisir entre huit jours d'arrêts de rigueur ou votre passage
dans l'infanterie. Vous avez "découché" cette nuit.
Je suis allé moi-même dans votre chambre hier au soir à 8h ½
et vous n'étiez pas rentré."
-
Mais… j'avais…
-
Je ne veux pas d'explications.
Je
me suis donc tu. L'orage de haine et de rancune mesquine
éclatait. Mais ce n'était pas un simple orage. Dans sa caboche
de Breton têtu, les mauvais sentiments se burinent sur le
granit.
Je
n'attendais rien de bon de lui, mais une telle explosion de
férocité me confond.
Avec
une telle mauvaise foi, il faut prendre garde. Il n'a pas de
scrupules. Pas un. Ravenet disait que c'était une
"canaille" dangereuse. Je suis de son avis. Après
avoir jeté un regard par ce coin entrouvert du rideau souple et
souriant qui cache l'antre noir de son fond. Tiens-toi à
carreau. Cela m'amène à me rappeler le rôle écœurant qu'il
a joué pour faire tomber une jeune fille, rencontrée en
voyage. Les effrontés mensonges qu'il fit sont
caractéristiques et significatifs.
Il
allait voir sa femme et son fils nouveau-né. Sa compagne de
train est une fille, jeune fille "russe ?". Il se pose
en officier d'infanterie, il revient des tranchées.
Il
lui fait une déclaration. Elle lui montre l'alliance qu'il
porte. Oh ! Fit-il, c'est l'alliance de ma mère ! Vous savez
comme les vieilles mamans sont superstitieuses. Elle a voulu que
j'emporte son anneau à la guerre. Elle croit que c'est une
amulette toute efficace contre les balles. La jeune fille se
laisse embobiner. Elle promet une prochaine rencontre. Il en eut
de nombreuses et dut user d'une ruse déshonnête pour la
posséder. Il s'entend avec la patronne de l'hôtel afin qu'il
n'y ait plus qu'une chambre de libre au milieu de la nuit...
Mais
les plus malins trouvent de plus fins qu'eux. Il a eu à faire
à Rübelein.
Rübelein
en ce temps là était installé à N. le H. pour des
expéditions de stock. Un jour Töpfchen le prévient de trouver
une chambre pour le rendez-vous. Comme Rübelein avait besoin de
sa liberté d'action et n'aime pas à sentir une entrave, il
calcula que Töpfchen allait s'amener tous les samedis soirs et
lui gâter ainsi les soirées les plus propices. Il songea donc
à esquiver le coup, à se débarrasser de lui. Dans ce but, il
trouva donc une chambre au séducteur dans l'hôtel même où il
prenait pension et pria la patronne pour embêter un peu l'autre
d'être formaliste.
Quand
les deux amoureux arrivèrent du train, l'hôtelière exigea
leurs noms, prénoms et qualités, et laisser-passer.
De
sorte qu'on peut voir sur les registres de l'hôtel de la Croix
Rouge à N. le H. à la date du 4 juillet, je crois : M. le Lieutenant Töpfchen
und Frau…
à la date du 4 juillet, je crois : M. le Lieutenant Töpfchen
und Frau…
Le
malheureux ! Qu'il serait facile de le couler à pic.
Depuis,
il a supplanté Rattens et semble avoir eu des succès assidus
près de Mme H (…illisible…) à Trumilly. Dame, c'est
un légume important, elle a couché avec un ministre. Son aile
protectrice peut-être un sûr abri, et en attendant, elle a la
cuisse aussi puissante que bien faite. Elle est venue à tant de
reprises, si effrontément, en visite au cantonnement. Et lui
allait si fréquemment passer les soirées à la ferme, qu'il
est connu comme le loup blanc de tous les paysans de la plaine.
Depuis son éloignement, c'est plus difficile, mais il
transforme sans scrupules un cycliste en larbin pour ses
commissions amoureuses, sans même en paraître étonné.
Le
30 août - Mes huit jours d'arrêts
sont écoulés. Töpfchen doit être satisfait. Depuis nous
avons eu une explication assez vive. Il m'a reproché d'avoir
mis de la mauvaise volonté. Ce à quoi j'ai riposté que je
n'en avais pas mis de mauvaise, mais assurément pas de bonne.
Je lui ai fait avouer qu'il m'avait mis systématiquement à
l'écart du convoi et du bureau, et j'ai conclu que j'avais le
caractère ainsi fait pour ne pas m'insinuer auprès de qui
m'écoute, que je ne sais pas faire des sourires que je
n'éprouve pas, pour remettre la peau sur les gourdes, que j'ai
plus de l'âme d'un loup que celle d'un chien, et que si je ne
lui rendais pas de service ce n'était pas ma faute. Alors il a
appelé l'éponge…
Verba
"Les
femmes qui n'ont plus leurs maris sont déjà les hommes
d'aujourd'hui et nous allons préparer nos filles à être ceux
de demain." Mme Charrière…
Debout
les morts !…
"Qui
donc meurt, si l'Angleterre survit." R. Kipling.
"Le
travail au pays se fait comme par enchantement, tout le monde
travaille avec une énergie farouche et se résigne à passer
l'hiver seul. Le moral n'est pas très fort, chacun est las,
mais l'espoir de la victoire règne et domine le reste ; cela
viendra, c'est certain." D'une lettre de Julien, de Verne,
le 1er septembre.
En
cette même journée de 1914 c'était Bayonvillers (Somme) où
j'ai goûté avec appétit les betteraves. Id.
Adieu
Pégoud ! La France continue. (Le Journal)
! La France continue. (Le Journal)
Tableau
du soir, dans la vallée de l'Aisne, entrevu au passage le 3
septembre.
Le
soleil glisse ses derniers rayons sur le bois des collines.
Elles sont là comme deux remparts épais qui enserrent la
vallée. Sur l'une on remarque les traces sinueuses de la glaise
jetée à ses flancs par les récents travaux du génie. On
distingue très bien boyaux, tranchées et abris entrecoupant de
leur ocre la verdure de la pente. Sur l'autre les bouquets
d'arbres masquent les batteries françaises qui envoient leurs
salves du soir, et çà et là, les petits nuages blancs
marquent les ripostes allemandes.
 Entre
ces deux lignes l'Aisne déroule son ruban qui s'assombrit
déjà par endroits où l'ombre de la colline s'allonge, tandis
qu'à d'autres des taches dorées ruissellent paisiblement entre
les rangées de peupliers. Entre
ces deux lignes l'Aisne déroule son ruban qui s'assombrit
déjà par endroits où l'ombre de la colline s'allonge, tandis
qu'à d'autres des taches dorées ruissellent paisiblement entre
les rangées de peupliers.
Au
milieu, une barque. Trois soldats l'occupent. L'un rame
nonchalamment, un autre est étendu paresseusement et se laisse
bercer, le troisième, assis à l'autre bout, lit une lettre, et
sur cette paix roule inefficace, l'orage des détonations
voisines.
1er
septembre 1915
Les
Russes reculent, les Russes ont reculé. Heures lourdes où nous
nous attendions aux grandes catastrophes. L'armée russe
anéantie. Quelle redoutable éventualité en perspective. Si
elle se produisait, la lutte serait inégale, l'Allemagne
triomphait, nous n'avions plus qu'à faire la paix, quel sombre
avenir. Mais les Russes sont sauvés maintenant. La guerre à la
Koutouzov leur a réussi, l'ennemi est haletant. Il est désorienté,
déconcerté. Et à l'Orient un grand souffle de liberté passe
qui soulève d'un mouvement sacré et irrésistible l'âme et
les forces du grand peuple russe tout entier. Allemagne, tu es
perdue. Tu ne résisteras pas à la colère du colosse qui
s'émeut, sous l'avalanche de la mitraille, il n'y a que les
chaînes du peuple qui seront détruites. Le tsar libéral a
balayé les influences germaniques, c'est les slaves cette fois
qui de leur énergie lente mais irrésistible vont mener la
poussée.
leur a réussi, l'ennemi est haletant. Il est désorienté,
déconcerté. Et à l'Orient un grand souffle de liberté passe
qui soulève d'un mouvement sacré et irrésistible l'âme et
les forces du grand peuple russe tout entier. Allemagne, tu es
perdue. Tu ne résisteras pas à la colère du colosse qui
s'émeut, sous l'avalanche de la mitraille, il n'y a que les
chaînes du peuple qui seront détruites. Le tsar libéral a
balayé les influences germaniques, c'est les slaves cette fois
qui de leur énergie lente mais irrésistible vont mener la
poussée.
Le
9 septembre - Départ en
permission.
Une
grande colère ouvre cette grande joie. Töpfchen m'a fixé mon
départ deux heures à l'avance ! C'est encore une de ses
délicatesses.
En
route, je fais bavarder un sergent infirmier, écœuré des
ignobles pratiques de l'hôpital de Royallieu .
Le médecin-chef, une vieille brute galonnée fait de cet
hôpital un bagne, afin de faire désirer aux malheureux
blessés le départ au front. Il n'a que les mots de fainéant,
salopard, à la bouche. Diminuez les rations, qu'ils s'en
aillent vite, tel est le mot d'ordre. Et de fait il y a douze
fois du bœuf bouilli au menu en une seule semaine. On ne compte
plus les blessés morts faute de soins… .
Le médecin-chef, une vieille brute galonnée fait de cet
hôpital un bagne, afin de faire désirer aux malheureux
blessés le départ au front. Il n'a que les mots de fainéant,
salopard, à la bouche. Diminuez les rations, qu'ils s'en
aillent vite, tel est le mot d'ordre. Et de fait il y a douze
fois du bœuf bouilli au menu en une seule semaine. On ne compte
plus les blessés morts faute de soins…
Et
ces vieilles canailles auront des galons et des croix en
récompense au lieu du poteau qu'il méritent…
 Le
10 septembre - Dijon. Arrivée
vide. Le
10 septembre - Dijon. Arrivée
vide.
Dépression.
Lourdeur du cœur, du front, des yeux. L'appel. Les pas errants,
la prière vaine. La gare. Melle Dugois la bavarde.
Le télégramme. Les ailes. Je ne puis lire, ni tenir en place.
7
heures. L'arrivée ailée.
L'immense
joie qui soulève. Enfin une soirée douce, les caresses
aimées, lentes et douces. Enfin un long réveil heureux, une
journée heureuse, le lendemain de l'arrivée. Les errants dans
la rue noire : l'anxiété dans le bouge. Le cri : "Oh !
Non ! Pas ici !"
Le
réveil confiant malgré les punaises !
Le
12 septembre - Une journée
heureuse. Toute la paix du fleuve qui coule dans la plaine
féconde sous un ciel plein de joie. Nos cœurs s'épanouissent.
Une halte dans la vie, une des plus belles, une de celles dont
le souvenir illumine.
Le
13 septembre - Encore un jour
d'insouciance heureuse et d'affection douce comme des vagues
caressantes sur une plage ensoleillée.
Le
14 septembre - Arrivée au pays
natal par les deux vieilles villes.
Rien
n'est changé : la population travaille avec acharnement, avec
une résignation obstinée acceptant le sacrifice comme une
chose inéluctable plutôt que par patriotisme.
Tant
de femmes font pitié ! Celle de Jean-Louis, maladive et faible
se cramponne à la vie et à la tâche avec ses quatre enfants
pour qui elle s'obstine à semer. Je l'ai vue attelant seule ses
grands bœufs à la porte d'une écurie où le fumier n'avait pu
être porté plus loin faute de forces, faute de temps. Un autre
type, c'est le voisin Jules, permissionnaire.
Je
l'avais vu partir si déchiré à la mobilisation. Il a dix mois
de tranchées maintenant et se retrouve pour six jours au milieu
de ses champs, de sa maison.
Il
reprend la tâche interrompue comme s'il ne devait plus
repartir. Mais il repartira à l'heure fixée, sans une minute
de retard. Il a rapporté de la vie infernale une sorte de
fièvre. Sa voix est saccadée, il fait des gestes en parlant,
brusques comme des sursauts de moteur sous pression. Il
repartira. Il le faut. "Je ne veux pas que mes enfants
deviennent Prussiens", explique-t-il. Je ne sais pas si je
reviendrai, mais j'irai ! Si nous étions battus, ils seraient
malheureux, si je suis tué ils le seraient aussi, mais j'ai
l'espoir qu'ils n'auront pas à se battre. J'irai, tant pis.
C'est
le seul homme que j'aie entendu parler si noblement avec tant de
simplicité.
Les
autres paysans. Pas d'autre souci que la paix, bonne ou
mauvaise, mais la fin des horreurs qui détruisent leurs fils,
la fin de la guerre qui les accable d'un surcroît de fatigues,
la fin des angoisses et des ruines. Pas de vues d'avenir, ni
d'esprit de sacrifice méritoire.
Une
prudence ancestrale, une crainte instinctive des éventualités.
L'or ne sortira pas des cachettes.
J'ai
dû avoir à ce sujet une violente discussion avec maman. Sans
la gravité des circonstances, la brièveté des heures, le
conflit aurait pu devenir aigu.
Je
voulais qu'elle me rende l'or que je lui avais confié au
départ. Cela lui donna une secousse quand elle vit que je
parlais tout à fait sérieusement. Elle réplique qu'elle n'en
donnerait pas, que d'ailleurs elle n'était pas obligée d'avoir
conservé cet or, pourvu qu'elle me rende la somme remise, je
n'avais rien à réclamer, que j'aille donc avec mon papier que
je crois aussi bon que l'or, l'échanger à la Banque ou chez
Caillaux, que ceux qui en ont des marmites le portent au
Trésor, etc… Elle ne m'en donnerait pas une pièce et je
voyais qu'en insistant je lui arrachais quelque chose au cœur.
J'ai expliqué que je ne me faisais pas d'illusions sur la
valeur de mon dépôt pour sauver le pays, que mon don était
bien minime mais que le salut de tous était fait du sacrifice
de chacun, si petit soit-il, que je voulais faire un versement
si minime soit-il, pour le principe, comme pour
l'accomplissement d'un devoir, et qu'elle aussi me mettrait un
remord au cœur si elle me mettait dans l'impossibilité de
l'accomplir.
C'était
le soir. Chacun se sépara entêté dans sa manière de voir.
Le
lendemain, à la veille du départ, j'ai posé à nouveau
froidement la question : oui ? Ou non.
Et
quelques louis d'or sont tombés comme des fruits encore à
demi-mûrs d'un arbre qu'il faut ébranler jusqu'à ses racines
pour qu'il en abandonne quelques-uns.
A
Baume je n'ai pu qu'entrevoir la tante. Ce n'est pas une visite.
Le
18 septembre - A Besançon.
Soupé chez Mme Bez. Nous ne sommes plus à l'unisson. Elle est
usée. Elle n'a plus de belle flamme au cœur. Égoïsme,
lassitude et férocité d'une vieille qui ne veut pas vieillir.
Le
19 septembre - La journée a
été trépidante. Beaucoup d'émotion, trop vite éprouvée.
Louis Colin, Maria, la fenêtre du cher Grand. Ç'a été comme
l'entrevue avec la maman Colin à Baume. Dans le remue-ménage
des rencontres pressées, on effleure seulement les cœurs.
A
Montbéliard, j'ai baisé pieusement son épée, et j'ai admiré
les trophées avec un frisson d'orgueil déchirant. S'il était
là ! Mais il n'y a que son piètre frère Lucien qui me montre
ces choses poignantes comme le ferait un conservateur de musée
!
Dimanche.
C'est l'adieu à notre chez nous, c'est le dernier voyage, ce
sont les dernières minutes avidement arrachées aux heures
dernières jusque sur le quai.
Impression
générale.
Les
heures trop courtes ont fui trop vite. Ni le temps de jouir de
la liberté, ni celui de voir, d'observer, de réfléchir.
Quelque chose d'inachevé flotte dans l'âme tandis que le train
roule vers le front.
Je
tâche de sommeiller pour ne pas penser ne pas sentir.
Les
Civils : Ils sont las, mais espèrent. Ils on fait un gros
effort pour continuer la vie en notre absence, ils n'osent pas
envisager un redoublement du même effort. Ils craignent que les
forces les trahissent, ou le courage. Nous avons bien semé une
fois, et nous avons dû faire la récolte seuls, nous ne pouvons
pas recommencer. La victoire ! Ils l'attendent plus qu'ils ne
l'espèrent. Et ce qui trahit le mieux l'impression communiquée
par les civils pendant un court séjour à l'arrière c'est
encore cette gravure trouvée déjà en hiver dans un journal :
Deux
poilus, l'un est assis, l'autre monte la garde et appuyé d'un
air pensif sur son fusil, il murmure avec un branlement de tête
inquiet :
-Pourvu
qu'ils tiennent !…
-
Qui ? - Les civils…
Le
21 septembre - Retour à
Pierrefonds.
J'ai
quelques détails sur la mort de Ch. Musson, l'officier adjoint
au gestionnaire. C'est une bombe de Taube placée avec une
terrible précision qui l'a tué en gare de Compiègne, il y a
dix jours.
Nul
ne connaît le destin de la bataille. Quelle leçon pour ceux
qui songent esquiver leur destin en l'esquivant.
Le
24 septembre - Deux vilenies de
Töpfchen dans la même journée : une algarade sur la
ponctualité adressée à moi personnellement, alors que nous
étions en groupe.
Le
soir, le coup des laisser-passer. Ces choses-là ne me touchent
plus, elles me dépassent, et j'aime mieux les subir que les
commettre !
Le
25 septembre - Les mauvais jours
reviennent. L'horizon s'assombrit. Le coup redouté de la
Bulgarie va s'accomplir. Elle mobilise. C'est l'attaque
traîtresse contre les serbes, à revers, c'est notre rejet des
Dardanelles, c'est le triomphe momentané des Germains, c'est la
prolongation de la guerre, l'accumulation des ruines, le monde
traverse une crise de folie.
Pour
nous, la question angoissante est de savoir comment les Grecs et
les Roumains vont réagir… Les Bulgares se suicident-ils ou
bien vont-ils assurer le triomphe définitif de nos ennemis qui
sont merveilleusement habiles à détruire les forces des
Alliés à mesure qu'elles se groupent, se forment. C'est de la
vraie tactique napoléonienne. Ils sont vraiment les émules du
Corse énergique et toujours en avance.
Et
on ne sent toujours pas une main ferme à la barre de notre
vaisseau. Toujours les mêmes phraseurs, aux muscles mous, avec
de l'eau dans les veines et rien dans le ventre. Danton et
Gambetta, où êtes-vous ?
Le
26 septembre - Ravitaillement
sous bois à Trosly. L'air est vif, dans la forêt le soleil
pose sur les troncs gris des taches joyeuses et sur l'ocre des
premières feuilles tombées de larges plaques dorées, on se
sent mieux en sûreté sous ce voile de verdure.
On
chuchote : "Il paraît que c'est déclenché. Nous avons
enlevé les tranchées de première ligne sur un front de cinq
divisions. C'est la riposte à la mobilisation bulgare…!
L'attaque se fait sur plusieurs points… Ce simple "on
dit" fait courir le sang plus vite. Aurions-nous enfin
quelques communiqués triomphants ?…
État
d'esprit et de corps.
On
a de ces jours pourtant ! Adieu
devoir,
Effort,
dignité, tout. On trouve délectable
Le
sort du bœuf repu buvant à l'abreuvoir.
On
ne quitte le lit que pour se mettre à table.
On
a pris son parti d'être un lourd ruminant
Dont
le ventre se vautre au fumier de l'étable.
On
se dit qu'il est doux de jouir maintenant
Tandis
qu'autrui bataille et pâtit sans relâche.
Et,
cynique, on n'a point honte en comprenant
Qu'on
emplira sa bière avec le corps d'un lâche.
J. Richepin.
Tant
que j'aurai du lait à crédit, je ne veux point acheter de
vache.
Maréchal des
logis Challaud.
O
boucherie, ô soif de meurtre ! Acharnement.
Horrible
odeur des morts qui suffoque et navre !
Soyez
maudits devant ces cent mille cadavres
Et
la stupide horreur d'un tel égorgement.
Mais
sous l'ardent soleil ou sous la plaine noire
Se
heurtant de leur cœur la gueule du canon
Ils
sont morts, Liberté, ces braves en ton nom,
Béni
soit le sang pur qui fume vers ta gloire.
L. de Lisle . .
Souvenir
de permission.
Le
train filait à grande vitesse dans la vallée, voici une gare,
et l'effort plaintif des freins brise l'élan des voitures qui
défilent le long des quais puis s'arrêtent. Des voyageurs
descendent, je reste à la portière, voici venir du pont et de
l'aiguillage voisin un brave garde-voie : costume civil, un
képi, un brassard bleu avec les trois initiales blanches, le
long fusil Gras pendu à l'épaule. Il marche d'un pas
tranquille et joyeux, indifférent au mouvement de la gare, le
regard droit en avant. Il sourit. Une femme s'avance vers lui,
d'une main elle porte un panier, le dîner du garde-voie, de
l'autre elle conduit un bébé de deux ou trois ans qui se met
à courir en avant dès qu'il aperçoit le papa. Le père le
prend sur le bras, l'embrasse et la mère arrive, elle donne un
baiser câlin au père et à l'enfant, puis tous trois se
dirigent vers la pelouse en jasant familièrement.
Le
père avec l'enfant, la mère avec le père et dans ce tableau
idyllique la carabine pendue à l'épaule donne un charme infini
où flottent de la fierté et du devoir tranquille, du danger et
de la résolution baignés de paix et de bonheur intime.
La
guerre n'a pas changé la nature humaine. Au village, même
jalousies, même rancunes. Ceux sur qui le malheur pèse
attendent l'aide des privilégiés, aide qui ne vient pas.
Ceux-ci se sentent jalousés parce qu'ils souffrent moins. Si le
malheur a épargné une famille, les autres mâchonnent sans
cesse : "En ont-ils de la chance ceux-là !" Un tel
est-il blessé. Aussitôt les voisins de faire des réflexions :
"Il vaut encore mieux que ce soit celui-là que tel autre.
Ou bien, il a de la veine d'être blessé, il aurait pu être
tué, ou le mien a bien été tué…" et cela est dit avec
cette férocité des âmes basses qui aspirent à quelque
monstrueuse égalité dans les deuils, les ruines et les
souffrances.
4h
40 - Ravenet m'ennuie. Il me traite de vieux con.
Vivement
la classe, soupire t-il !
Le
26 septembre - A table, nous commentons les nouvelles. Les
bruits les plus fantaisistes courent sur l'attaque dont le
communiqué parle à peine. Les lignes ennemies seraient
crevées. Les dragons se sont rués, déjà, dans la
boutonnière, ont sabré les artilleurs des pièces lourdes.
Je
n'aime pas ces rêvasseries creuses. Puis on nous apporte une
note du Q. G. prescrivant les mesures à prendre au cas de
marche en avant du corps d'armée. Les compagnies de
territoriaux sont déjà désignées pour assurer la manutention
des matériels abandonnés.
Un
souffle d'espoir passe, éphémère.
4
heures du soir -
Un
passant s'arrête à la fenêtre du bureau et jette la nouvelle
de la victoire. Douze mille prisonniers en Champagne. Trois
kilomètres de tranchées de prises sur un front de vingt-cinq
kilomètres. Tout le labyrinthe est à nous.
Télégramme
officiel. Chantons la Marseillaise…
Ce
soir on boira le Champagne.
Le
27 septembre - Ce matin vient
enfin le communiqué attendu. Il est magnifique. Vingt mille
prisonniers et vingt-quatre canons. Rien ne pèse que la gêne,
la honte de n'être pas de la fête. Oh ! La belle minute que de
s'élancer victorieusement hors des tranchées.
J'étais
tout à la joie de vibrer à l'unisson de la France lorsqu'un
fourrier de l'ambulance du 1/85 est venu m'annoncer tout
brutalement la mort de mon ami Bedu, tué à Compiègne par la
bombe imbécile de ce Taube qui a broyé M. Musson notre
officier et blessé Grosjean, Bombois.
J'en
suis atterré. Je m'attendais un peu à cette catastrophe. Je me
sentais si attaché ou mieux attiré vers lui. J'entrevoyais
pour nous un si bel avenir d'amitié supérieure. J'ai dû crier
ma peine à Camille, je me sens déchiré comme il y a un an
lors de mon premier deuil. La Mort sait choisir les plus beaux
et les meilleurs hélas !
8
heures du soir - Nous sommes venus ravitailler le 170ème
à Rethondes. Ils vont à la rescousse dans la grande mêlée.
C'est une joie nouvelle de rompre la monotonie des
ravitaillements à heure fixe en plein jour. Cela rappelle les
nuits d'Alsace ou de la Marne.
10
heures du soir - Oh ! La férocité de la paresse ! elle est
impitoyable.
Tout
à l'heure, les wagons qui doivent prendre les troupes sont
arrivés sans aucun aménagement. Le Commandant du Bataillon est
venu me demander, à moi, "de l'intendance", au moins
de la paille pour adoucir les planchers. Je ne suis qu'un
instrument. L'Intendant n'a pas prévu la paille. Je n'ai point
de paille. Mais le Commandant me fait observer qu'il doit mener
ses hommes au feu en descendant du train, qu'ils doivent n'être
pas moulus et que ceux qui vont mourir ont bien droit à un peu
de paille. Il a trop raison. Coup de téléphone à Pierrefonds
au Sous-Intendant. Je rentre vite en auto pour repartir amener
de la paille, toute la nuit s'il le faut.
Je
vais rendre compte à Töpfchen de la demande du Commandant du
174ème.
De
ma démarche, je m'offre à repartir, pour ces hommes qui vont
mourir. Mais il est couché, il est à moitié endormi. Il
faudrait qu'il se lève, trouble sa quiétude et sa nuit : en
guise de réponse il me tend la main. "Dites, Cœurdevey,
allez donc vous reposer… c'est trop tard."
Le
28 septembre - Sous-bois. Trosly.
L'air
cingle déjà les doigts. Nous nous ébrouons pendant que les
voitures forment le parc. C'est le brouhaha coutumier, cris des
conducteurs, coups de fouet, cahots des roues, chevaux qui
renâclent, l'un tire à droite, l'autre se cabre, jurons, coups
de gueule de Larcher : "Mais avancez donc brigadiers de
merde ! Qu'est-ce que vous traînez à la queue de la colonne
!"
Doublez
! Doublez. Passez à droite ! Le pain à gauche, le vin là-bas
!
Pendant
ce temps, parmi ce bruit auquel on est habitué les
sectionnaires se rassemblent, les "clients" arrivent
successivement.
On
s'aborde, on se serre la main, quoi de nouveau ? Et les bruits
vont leur train. On a pris 300 mitrailleuses ailleurs. On se
retranche sur les positions ! C'est un tort. Il faut pousser
vivement de l'avant… etc. etc… Chacun y va de son petit
commentaire…
Chacun
aussi se groupe généralement par grade. Les simples soldats
sont là, révélant bien souvent sous l'uniforme les
distinctions sociales de la vie civile : les paysans avec l'air
placide, les mains dans les poches, les membres noueux. Les
"gones" de la Croix-Rousse affichent leur aplomb, le
képi de côté, l'attitude dédaigneuse sans grand souci de la
correction, le côté celui qui était le type le plus chic, qui
se rase plus soigneusement et soigne ses ongles, les
secrétaires au visage frais, à la mine appliquée,
consciencieuse, ex-bureaucrates paisibles ou fonctionnaires
consciencieux, ou employés intelligents… Et voici des
brancardiers ou ambulanciers au visage ras, le regard timide, le
geste craintif de gens qui n'ont pas encore su s'adapter à la
nouvelle vie. Cela accuse (?) l'ecclésiastique en
uniforme, comme les lunettes sur des yeux myopes révèlent
l'ancien universitaire.
Le
groupe des sous-officiers est plus uniforme. Ceux-ci ont eu plus
d'aptitudes à se façonner au nouveau pli, mais il y a tel
sergent du Génie qui avec ses guêtres en cuir fauve, son bras
coudé, sa tête inclinée en avant puis redressée, a encore
toutes les allures de l'élégant qui va aux courses, comme tel
autre a conservé l'air tranquille du laboureur mobilisé. Un
peu à l'écart se tient le groupe des officiers. Ils sont là
qui posent, plaisantent, pérorent oisifs et inutiles pendant
que les sous-officiers et soldats feront la perception des
vivres aux divers chantiers. Ils sont là, tapant sur leurs
guêtres avec la badine, courbant le râble sanglé dans la
belle tenue bleu clair. Ils racontent des riens, des histoires
de femmes ou de bombe crapuleuse, rient bruyamment, se donnent
des poignées de main et des sourires puis remontent à cheval
comme ils sont venus, frelons bourdonnants et dorés, parasites,
écornifleurs, nourris grassement pour laisser faire le travail
aux sous ordres, promenant leur inutile intelligence inemployée…
Le
29 septembre - Chargement en
gare. Matinée habituelle. Nous sommes sur des charbons ardents.
La victoire ne va pas du même élan que nos désirs. Le
communiqué d'aujourd'hui est terne. Et il pleut inlassablement
sur les routes et sur les enthousiasmes. On espère et on craint
que nous ne nous brisions encore les ailes comme en juin !
10
heures du soir - Avant d'aller à la soupe on nous apprend un
nouveau succès. La victoire a fait un deuxième pas en avant.
La 2ème ligne allemande brisée. Hardi les
Français. Et voilà que la pluie ne mouille plus les cœurs.
Le
30 septembre - Trosly, toujours.
La route faite à pied est un plaisir toujours nouveau. Ce sont
ces étapes faites si souvent qui nous ont rapproché Rübelein
et moi. Nous partons dès l'aube ou avant, soit en devançant le
convoi, soit de préférence en empruntant des sentiers
inconnus. C'est une joie toute spéciale d'en découvrir à
travers la grande forêt.
Tantôt
ce sont des raccourcis, tantôt des chemins d'écoliers. Ce
matin elle était particulièrement belle notre grande forêt
familière. Après des jours pluvieux le soleil est revenu, à
l'aube il posait sur les feuilles fauves des hêtres de longs
frissons dorés. On aurait dit que le tapis du sous-bois allait
s'agiter, frémir comme s'il eut été secoué d'un frisson
d'enthousiasme, pareil à celui qui nous parcourait à la
méditation des dernières bonnes nouvelles, et que la clameur
des pièces lourdes tonnant à quelques kilomètres stimulait
d'heure en heure. Mettons nos mains sur nos cœurs.
Ce
sont des minutes rares, si patiemment attendues celles que nous
avons la joie de savourer. Pour ma part j'ai tant cru que les
lignes allemandes étaient imbrisables, comme les nôtres, et
que le front actuel resterait à peu près sans changement
jusqu'à la fin des hostilités ; qu'on s'épuiserait
réciproquement sur le front d'airain.
Mais
les dernières nouvelles confondent mon scepticisme. Nos
arsenaux ont suffisamment travaillé, nous sommes, semble-t-il,
armé aussi bien que la bête de proie qui nous ronge les
entrailles. Je suis le premier à m'en réjouir car mon
scepticisme était douloureux et n'était que l'angoisse de voir
la Patrie étranglée…
Le 1er
octobre 1915
Nous
attendons la confirmation officielle de la percée des lignes
allemandes, nous espérons savoir que les trois divisions de
blindés ont élargi la brèche… Et la fameuse 14ème
en serait. Le communiqué indique à mots couverts qu'elles ont
dû se replier sous les feux d'enfilade. Nous soupçonnons
l'inutile hécatombe et moi je tremble pour nos Franc-Comtois
dont la témérité excitait ma fierté.
Cet
à-coup rappelle les imaginations enfiévrées et trop
complaisantes aux dures réalités de la lutte monstrueuse.
L'après-dîner,
pour fleurir d'une pensée pieuse ma journée attristée
d'inquiétude et de déception je vais visiter la très vieille
église de Pierrefonds. Le sergent Petit m'accompagne, je
voudrais bien être seul car son ignorance gâte le plaisir
d'être dans ce vieux monument de plusieurs âges. Les portiques
sont du plus parfait gothique, tandis qu'un clocher original
avec des ornements surabondants porte la date de 1557. A
l'intérieur les remaniements sont plus frappants. On dirait
deux anciens édifices voisins réunis en un seul. Les voûtes
autrefois ogivales ont dû être plafonnées.
Il
ne reste plus que quelques fragments des vieux vitraux, les
fenêtres ont été restaurées récemment par un généreux
donateur. Elles ont été garnies de ces vitraux modernes aux
tons adoucis, aux couleurs suaves mais où les scènes manquent
d'originalité. Des saintes familles très fades, une Ste
Geneviève au regard terne ou niais près de ses moutons, etc.
Petit me déconcerte avec une réflexion sur un tableau
ultra-moderne de P. Lagarde représentant la fuite en Égypte.
Une belle toile d'ailleurs. Sur le cadre il y a un numéro
d'ordre (1280) et Petit me fit : il est bien vieux, voyez la
date, 1280 !… J'étais vraiment bien malheureux de ne pouvoir
lui rire au nez.
Cependant
des peintures anciennes existent là. Il y a dans un coin une
Madone avec l'Enfant Jésus qui est du plus naïf et inhabile
des Primitifs.
Le
soir. Le bruit court que les sectionnaires vont être versés
dans l'infanterie, comme les tringlots le sont dans
l'Artillerie. Mais ici les cadres restent. Peut-être que chez
nous il en sera de même.
Le
2 octobre - Le matin, il est entendu
que les adjudants resteront au CVAD. Ravenet va passer officier.
Töpfchen l'a proposé, l'a noté chaudement ! C'est à cette
occasion qu'il a assuré qu'aussi longtemps qu'il serait
gestionnaire il ne me proposerait pas.
L'affaire
de Ravenet ne va pas toute seule. Il a des compétiteurs bien
recommandés. Le sous-intendant le fait appeler et lui dit de
faire jouer énergiquement les recommandations politiques, s'il
en a, et il doit en avoir lui qui est secrétaire d'un Préfet.
Et Ravenet lance des appels de tous les côtés non sans me dire
en route vers Trosly : "Les allemands n'avaient pas tout à
fait tort de dire que la France était pourrie. Si la nation ne
l'était pas le monde politique est bien écœurant. Dire qu'à
la guerre, en campagne, après quatorze mois au front, il faut
un coup de piston pour avoir des galons ! Je ne m'attendais tout
de même pas à celle-là !". Le soir. Le lieutenant nous
apprend que les adjudants partiront aussi dans l'infanterie.
Pose et blague à part, cela m'a donné une émotion et j'ai du
faire effort pour réprimer des nerfs trop sensibles.
Maintenant
cela va, aussi calme qu'un autre soir. Je ne suis pas d'une
gaieté débordante assurément, c'est la pensée des soucis qui
vont ronger à nouveau ma mère et Camille qui revient le plus
souvent à l'esprit et me pèse. Puis je sens le prix du
confortable qui nous a si rarement fait défaut, je songe aux
nuits d'hiver, nuits froides, nuits d'insomnie, nuits où mes
nerfs seront mis à rude épreuve. Ma volonté accepte cette
participation plus dangereuse à la lutte. On me poserait le
marché en main en me disant : "choisis entre ton repos et
la défaite ou la victoire et ton départ aux tranchées"
que je dirais, sans enthousiasme parce que je sais quelles
épreuves attendent, mais résolument et volontairement. Les
tranchées et la victoire. Que va dire mon frère Louis ?
Le
3 octobre - Dimanche.
Chargement
en gare enlevé rapidement. Je m'esquive pour aller en un coin
où l'on puisse se recueillir. Ma chambre ? Non, c'est dimanche
et la cloche appelle. Je vais à l'église.
Un
prêtre barbu, à la voix chaude et vibrante parle éloquemment
du Calvaire de la France. Mais il mêle à son sermon les
mesquins souvenirs de la lutte politico-religieuse d'avant la
guerre et explique par cette étroite raison la dure et longue
colère de Dieu et insinue que le sang des Justes doit couler et
coule et coulera pour expier le rapt des fondations et
l'indifférence religieuse de ses ouailles. C'est le vol
essoufflé d'un manchot alors que je venais chercher l'aile
d'une mouette blanche.
Notre
départ est confirmé. C'est une chose acceptée et le calme des
jours sereins revient en moi. J'aurai l'âpre joie de la lutte.
Heureusement que le sergent Petit ne sera pas appelé. Quelle
angoisse que celle d'un père de famille tel que lui, et
cependant, je sens qu'il accepterait sans murmure.
Le
4 octobre - Les nouvelles du front
sont ternes. On a l'impression que le vigoureux soubresaut
donné en Artois et en Champagne n'a été qu'un effort énorme,
redoutable, mais impuissant encore à briser le cercle de fer
qui nous étreint.
Et
les Bulgares vont frapper. La complication farouche du grand
drame, entrevue dès février ne va plus tarder à s'accomplir.
Quelle ruée. O boucherie, soif de meurtre, acharnement horrible
de la monstrueuse humanité.
La
reconnaissance des peuples vaut celle des individus. Reçu une
carte de mon Henri. Il part à Épinal demain. Hélas. Qu'est-ce
que l'avenir lui réserve ?
Une
bonne lettre de Besançon calme toutes mes inquiétudes.
Le
5 octobre - Matinée grise
d'automne. Le train de ravitaillement est bondé de
marchandises. Gros travail. Peu de voitures, fausses manœuvres.
Le
service s'accomplit comme si nous devions l'assurer
indéfiniment. Il ne vient presque plus à la pensée qu'il faut
être parti dans quelques jours vers quelque point dangereux à
la dure vie.
A
cette même heure, à Verne, Henri part, on pleure tout en
continuant le labeur obstiné. Je les vois d'ici. Ils ne
prennent pas le temps de fêter les joies ni davantage celui de
pleurer. Existences enchaînées.
J'ai
appris aujourd'hui une nomination au grade d'officier à
laquelle malgré tout le cynisme que je connais, j'étais loin
de m'attendre.
Notre
sous-intendant avait pour conducteur de son auto un gommeux au
profil sémitique fort accusé, le beau Monsieur le visage
toujours impeccablement rasé, des verres montés sur or, des
gants de peau, des vareuses en drap de bonne qualité et bien
ajustées avait éprouvé devant la menace de la guerre un
accès de servilité remarquable. Propriétaire d'une auto, il
l'avait offerte à M. le sous-intendant et s'était mué en
larbin très chic.
D'ailleurs,
rien ne lui manquait. Il pouvait s'offrir chaque jour des repas
soignés au meilleur hôtel et restait gros et gras, le poil
lisse.
Je
ne sais rien de ses capacités. Je ne connais que sa morgue.
Mais voici venir la menace de verser tous les simples soldats de
services dans l'infanterie et vite l'on bombarde ce pleutre
pistonné au grade d'officier d'administration. Quand une
administration se permet de ces cyniques audaces, elle est bien
piètre. Et quand ces fantaisies éhontées se pratiquent en
temps de guerre cela devient un crime de lèse-patrie qui
mérite le bagne, car il faut songer au coup de hache dans les
dévouements et les enthousiasmes qu'un tel favoritisme porte
inévitablement.
Voilà
les vrais crimes contre l'union sacrée. Que des cancres
puissent esquiver la loi commune du sacrifice, prendre la place
des hommes compétents et devenir d'encombrants parasites,
réservés pour la régénération sociale d'après la guerre,
hélas, c'est triste infiniment, autant que décourageant.
Il
nous est arrivé ce matin en renfort un de ces officiers
d'occasion. Il avait à assurer un ravitaillement dès son
arrivée. Il a levé les bras au ciel, attestant son
incapacité, son ignorance. Et c'est nous, les adjudants
dédaignés et ignorés, qui avons assuré son service !
Aux
heures les plus hautes un intense désir de sacrifice me
soulève et je me sentais prêt l'autre jour à remplacer aux
tranchées un père de famille plus utile que moi à l'arrière
moins utile que moi à l'avant, le brave Fourgeot, ou le sergent
Petit. Quand je vois des iniquités, des trahisons, le
baromètre moral tombe, tombe.
Soirée
lourde. Maman m'a envoyé la douloureuse lettre de Madeleine .
Je suis amèrement puni de ma négligence. Je ne sais quelle
indéfinissable tristesse me baigne. Je l'ignorais comme l'air
qu'on respire. Et son geste qui arrache les dernières
illusions, les derniers lambeaux du rêve, du beau rêve de
jeunesse semble emporter le souffle qui faisait vivre un
penchant. Ma pensée et mon cœur se refusent à contresigner sa
décision. Je ne veux pas briser tout. Je veux attendre les
résultats de la guerre sur ma vie matérielle et morale, sur
mon avenir. .
Je suis amèrement puni de ma négligence. Je ne sais quelle
indéfinissable tristesse me baigne. Je l'ignorais comme l'air
qu'on respire. Et son geste qui arrache les dernières
illusions, les derniers lambeaux du rêve, du beau rêve de
jeunesse semble emporter le souffle qui faisait vivre un
penchant. Ma pensée et mon cœur se refusent à contresigner sa
décision. Je ne veux pas briser tout. Je veux attendre les
résultats de la guerre sur ma vie matérielle et morale, sur
mon avenir.
Enfin
une carte de Louis. L'inquiétude grandissait. Henri doit être
arrivé dans la froide Épinal. Louis Colin rejoint le front
aussi. Pauvre maman Colin.
Le
6 octobre - Journée grise.
Nos
rêves fous de départ en avant se dissolvent comme un
arc-en-ciel d'avril. Les ordres donnés pour que la marche en
avant s'exécute vivement s'oublient comme un on-dit. La guerre
de tranchées reprend son étroite âpreté avec son étouffant
horizon.
Aux
Balkans quelque chose de terrible se prépare. Trois nouvelles
graves aujourd'hui. Les troupes françaises ont débarqué à
Salonique. Le roi Constantin a débarqué son ministre
Venizelos. La Russie a lancé un ultimatum à la Bulgarie.
C'est
notre doigt mis dans un engrenage. La roue bulgare tourne
déjà, la roue turque va accourir, la roue grecque emboîtera
le pas et nos troupes jetées là vont être prises entre les
dents meurtrières de ces nations traîtresses et ingrates et
l'étau allemand. Encore une redoutable aventure. Clemenceau
seul a élevé la voix contre cette faute suprême.
Le
7 octobre - Toute la matinée dans
la gare où il y a tant de pittoresque animation. Voitures
franc-comtoises entremêlées aux charrettes normandes et aux
voitures maraîchères bretonnes ; autos essoufflées,
fiévreuses auprès des lourds camions haletants,
permissionnaires inquiets de leur direction, la musette à
l'épaule, le petit paquet ficelé par la femme aimée qui se
balance au bout du bras, artilleurs qui débarquent de chevaux
effarés, il passe un train de matériel aux allures
menaçantes, un train de troupes bruyantes ; puis voici le
sanitaire luisant, discret, précautionneux. Dans la cour
cavaliers, piétons, débardeurs, officiers, intendants se
croisent comme des fourmis. C'est ainsi qu'il doivent
apparaître à l'aviateur qui évolue au-dessus de nos têtes.
Moi,
je contrôle mon wagon de colis avec mon brave Clapisson. Il a
la large gaieté du marchand de vin lyonnais. Il me lit la
consigne, ordre de transport d'un colis de comestibles d'où
découle une sueur significative. Elle porte en toutes lettres :
"matériel non convoyé".
Ça,
fait-il, je crois qu'il y a erreur, il doit y avoir tout un tas
d'asticots convoyeurs.
Notre
départ aux tranchées ne prend pas d'allures pressées. Est-ce
chose arrêtée ou oubliée ? Mais on n'en parle plus, et rien
ne révèle les mesures qu'on doit prendre pour notre
remplacement. Je dis : C'est un grand coup de bâton dans l'eau
pour la galerie, une manœuvre à la Millerand…
Et
Ravenet réplique ou corrige : "Les circulaires c'est comme
les belles filles, elles sont faites pour être violées."
Malgré
notre impatience, on travaille dur et ferme en Champagne. La
prise de Tahure et de la formidable butte 199 console un peu de la catastrophe
que nous nous préparons en envoyant en Serbie des troupes
vouées aux coups de poignard dans le dos des énigmatiques
Roumains, Bulgares et Grecs. Tous les chacals aiguisent leurs
crocs pour dépecer le vaincu, et il ne faudrait pas une grosse
victoire allemande en Serbie pour que les Grecs nous coupent la
voie Salonique emprisonnant nos troupes là-bas. C'est une
aventure d'Espagne. J'ai peur qu'elle ne nous réserve un Baylen
et de la formidable butte 199 console un peu de la catastrophe
que nous nous préparons en envoyant en Serbie des troupes
vouées aux coups de poignard dans le dos des énigmatiques
Roumains, Bulgares et Grecs. Tous les chacals aiguisent leurs
crocs pour dépecer le vaincu, et il ne faudrait pas une grosse
victoire allemande en Serbie pour que les Grecs nous coupent la
voie Salonique emprisonnant nos troupes là-bas. C'est une
aventure d'Espagne. J'ai peur qu'elle ne nous réserve un Baylen .
Ce nigaud d'Hervé .
Ce nigaud d'Hervé et ce jobard poseur de Barrès établissent des plans de
campagne à l'usage des concierges, c'est-à-dire de la plupart
des Français, car à la façon dont le peuple souverain a été
renseigné sur les données de la lutte pour laquelle il donne
sans compter on peut juger l'estime qu'ont pour lui ceux qui
sont ses chefs élus…, ses despotiques ministres qui n'ont pas
même l'excuse d'être de sang aristocrate ou simplement
courageux, sinistres parvenus, effrontés bavards, cyniques
bourreurs de crâne du peuple jobard dont ils vivent, ils
traitent la France comme le souteneur une fille…, sous
prétexte de la défendre ils l'exploitent.
et ce jobard poseur de Barrès établissent des plans de
campagne à l'usage des concierges, c'est-à-dire de la plupart
des Français, car à la façon dont le peuple souverain a été
renseigné sur les données de la lutte pour laquelle il donne
sans compter on peut juger l'estime qu'ont pour lui ceux qui
sont ses chefs élus…, ses despotiques ministres qui n'ont pas
même l'excuse d'être de sang aristocrate ou simplement
courageux, sinistres parvenus, effrontés bavards, cyniques
bourreurs de crâne du peuple jobard dont ils vivent, ils
traitent la France comme le souteneur une fille…, sous
prétexte de la défendre ils l'exploitent.
Quand
on songe que le Ministère de la Guerre graisse la patte et le
ventre à des intermédiaires, et quels intermédiaires, des
étrangers, des rastaquouères, des surveillées de la police
des mœurs ! Pour passer des commandes de munitions à l'usine
nationale, à la manufacture d'État de Ruelle ! Et de même pour le Creusot ! Canailles ! Va. La Guillotine,
la belle septième arme, s'écriait Humbert
! Et de même pour le Creusot ! Canailles ! Va. La Guillotine,
la belle septième arme, s'écriait Humbert l'autre jour !
l'autre jour !
Le
9 octobre - La question d'Orient,
que si peu de personnes apprécient à sa valeur, prend une
importance aussi tragique qu'au XVIème siècle.
L'avenir de l'Europe est en jeu. Si les allemands réussissent
dans cette audacieuse tentative ils ne seront pas vaincus, que
dis-je, ils dicteront la paix aux alliés dispersés, exsangues,
épuisés.
J'éprouve
à nouveau cette angoisse physique des semaines où nous
luttions à Roye, Lassigny, Arras, Ypres. Une brèche dans la
digue que nous opposions à cette époque et le flot revenait à
nouveau, irrésistible. C'était fini de la France. Et je me
souviens encore de ce trouble des entrailles à la moindre
nouvelle alarmante, ou lorsque nous épiions l'intensité de la
canonnade pour juger du mouvement des lignes.
Aujourd'hui,
la partie qui se joue va être encore plus serrée. C'est la
belle, diraient les joueurs. Il y a eu maldonne. Cette fois ci,
celui qui échouera ne s'en relèvera pas.
Or
quand j'y songe, j'ai des transes. Les allemands ont les plus
beaux atouts. La meilleure situation stratégique, la
préparation achevée, l'unité de décision, la netteté des
vues et l'énergie foudroyante pour les réaliser, avec des
moyens supérieurs.
Contre
cela, les pauvres serbes, peuple héroïque, d'une ténacité
d'airain, mais sous le lourd marteau et sur l'enclume, le
meilleur acier doit céder. Les voit-on assaillis sur deux
fronts contre deux adversaires dont un seul serait déjà plus
que redoutable. Grecs et Roumains se tiendront prudemment à
l'écart. J'ai une maigre confiance dans les contingents
effilés et épars que nous allons égrener sur la ligne
Salonique-Uskub exposés aux coups de flanc et dans le dos, qui sait ? alors
qu'il faudrait une massue qui brise tout, soit ici sur le front
boche, soit là-bas sur le crâne bulgare et l'échine turque.
Il faudrait de l'unité, de la décision et de la virile
exécution. Nous n'avons rien de tout cela. Le salut est dans la
Russie. J'y avais déjà réfléchi plusieurs fois, et
aujourd'hui enfin un journaliste indique le remède : donner à
la Roumanie toutes ses terres "irredente". Bessarabie
comprise, et qu'elle tombe sur les derrières des
Austro-allemands et des Bulgares, et qu'elle ouvre toutes ses
écluses au flot russe. Il n'y a que cela qui puisse éteindre
le très grave incendie adroitement allumé là-bas par les
allemands. "Sie sind Kerle !" ("Ce sont des
fripouilles !"). S'ils n'ont pas la victoire ce ne sera
pas leur faute. Et si nous l'avons nous n'y aurons guère
tâché, nous, du moins ceux qui nous dirigent…
exposés aux coups de flanc et dans le dos, qui sait ? alors
qu'il faudrait une massue qui brise tout, soit ici sur le front
boche, soit là-bas sur le crâne bulgare et l'échine turque.
Il faudrait de l'unité, de la décision et de la virile
exécution. Nous n'avons rien de tout cela. Le salut est dans la
Russie. J'y avais déjà réfléchi plusieurs fois, et
aujourd'hui enfin un journaliste indique le remède : donner à
la Roumanie toutes ses terres "irredente". Bessarabie
comprise, et qu'elle tombe sur les derrières des
Austro-allemands et des Bulgares, et qu'elle ouvre toutes ses
écluses au flot russe. Il n'y a que cela qui puisse éteindre
le très grave incendie adroitement allumé là-bas par les
allemands. "Sie sind Kerle !" ("Ce sont des
fripouilles !"). S'ils n'ont pas la victoire ce ne sera
pas leur faute. Et si nous l'avons nous n'y aurons guère
tâché, nous, du moins ceux qui nous dirigent…
Autre
chose qui me touche plus immédiatement. L'affaire de notre
départ dans l'infanterie est réglée pour quelques temps au
moins. Voici.
La
première circulaire en application de la loi Dalbiez est venue comme une trombe qui balaie tout. Personne ne devait
rester. Impitoyable, aveugle, elle ne respectait ni cadres, ni
aptitudes, ni même la confirmation de services qui ne souffrent
pas d'interruption. Mais elle a dû être rédigée à l'usage
de la galerie et en vue d'une interpellation comme argument
irréfutable.
est venue comme une trombe qui balaie tout. Personne ne devait
rester. Impitoyable, aveugle, elle ne respectait ni cadres, ni
aptitudes, ni même la confirmation de services qui ne souffrent
pas d'interruption. Mais elle a dû être rédigée à l'usage
de la galerie et en vue d'une interpellation comme argument
irréfutable.
Draconienne,
elle a soulevé une vague de puissantes protestations qui
n'étaient pas toutes dépourvues de bonnes raisons et de bon
sens pratique. D'où lettre explicative de la féroce
circulaire. Elle prévoyait un relèvement progressif et
partiel, non plus brutal et intégral, selon les ressources en
R.A.T. Puis aujourd'hui est venue une note explicative de la
lettre, laquelle note est rédigée en vue de la résistance
hypocrite à la loi Dalbiez, dans le but de neutraliser ou à
peu près la loi imposée au souple ministre.
Elle
spécifie, cette note, que seuls seront relevés "ceux des
C.O.A. qui ne sont pas spécialisés : bouchers, boulangers,
etc"… Cet etc est délicieux. Il permet aux chefs de
détachement d'appeler spécialisés ceux qui sont des chefs de
distribution, "ceux qui me rendent des services" a
expliqué Töpfchen.
C'est
à dire, a expliqué Laurent, ceux dont la tête vous revient,
et partiront ceux dont la tête ne vous revient pas… et
cyniquement Töpfchen a dit : "mais oui". Et donc ont
été baptisés spécialistes l'aide cuisinier, l'eunuque
Saillard et ont été désignés pour l'infanterie les pères de
famille Coulon, Marchand.
Ce
soir il faisait gaiement cette sinistre besogne. J'admets
parfaitement que la plupart de ceux qui sont désignés n'ont ni
grande valeur, ni droit à une pitié qui serait déplacée.
Plusieurs sont des voyous, d'autres des cancres ou des gourdes.
Mais l'injustice ou plutôt le choix arbitraire est trop
flagrant pour que ma conscience ne se cabre pas en travers de
cette porte ouverte à toutes les injustices d'un vulgaire
Monsieur capricieux, à toutes les bassesses des lèches-culs,
des flagorneurs et des pistonnés.
Le
10 octobre - Belgrade est
réoccupée! A midi à table, vive discussion sur la question
balkanique. Je soutiens que notre situation est dangereuse
autant que grave, qu'il faut y parer à tout prix et qu'on ne le
peut guère.
Chevaleret
me traite de pessimiste, de semeur de mauvaises nouvelles. A
quoi je réplique que mon pessimisme part d'une vue peut-être
un peu plus nette de la situation que celle de ceux qui ne
cessent de bourrer le crâne au public en l'assurant que tout va
bien. Voilà un an que tout va bien, et, reprenant le mot de
Clemenceau : "les Allemands sont toujours à Noyon"…
J'atteste encore que mon pessimisme part peut-être d'un souci
d'une anxiété qui pourrait provenir d'un patriotisme tout
aussi ardent que celui de ceux qui s'en vont la bouche en cœur
répétant depuis des mois que les Boches "manquent de
tout", et qui se contentent d'attendre que les alouettes
tombent toutes rôties du ciel.
Ce
n'est pas des niaiseries comme l'histoire secrète de Bertha
Krupp qui chasseront les allemands de notre sol. On ferait mieux de
renseigner le public sur les difficultés énormes que nous
avons à surmonter, sur les moyens dont disposent encore les
Allemands et partant, sur ceux que nous devons trouver, que de
lui donner en pâture - de quel mépris de sa valeur cela
témoigne - des racontars malpropres de femme de chambre.
"Le peuple souverain". Quelle farce ! Et quel mépris
cette expression renferme. Cela donne l'envie d'un roi à ceux
qui aiment le peuple, qui l'aiment avec droiture.
qui chasseront les allemands de notre sol. On ferait mieux de
renseigner le public sur les difficultés énormes que nous
avons à surmonter, sur les moyens dont disposent encore les
Allemands et partant, sur ceux que nous devons trouver, que de
lui donner en pâture - de quel mépris de sa valeur cela
témoigne - des racontars malpropres de femme de chambre.
"Le peuple souverain". Quelle farce ! Et quel mépris
cette expression renferme. Cela donne l'envie d'un roi à ceux
qui aiment le peuple, qui l'aiment avec droiture.
Le
11 octobre - Une accablante
nouvelle. Mon frère Louis est en route pour Salonique ! Pauvre
Louis, quel crève-cœur. Il lui était déjà si dur de se
battre en France ! Aller crever dans un champ macédonien sous
une balle turque ou bulgare ! Quelle angoisse et quel
découragement doivent l'étreindre. Et d'autant plus qu'il doit
avoir des camarades qui lui montent le cou. Il est dur de s'en
aller à l'aventure, s'il savait dans quel guêpier on risque de
les fourrer ! Pauvre Franc-comtois. Éreintés à la Marne de
toute la pesée de von Kluck ,
décimés aux âneries commises sur le plateau de
Nouvron-Quennevières ,
décimés aux âneries commises sur le plateau de
Nouvron-Quennevières ,
hachés en Champagne, voilà qu'on envoie le reste se faire
mutiler par les féroces bulgares ! Pitié. Je me demande quelle
épouvantable anxiété doit tordre ma mère. Nous ne reverrons
sans doute jamais ce pauvre Louis. ,
hachés en Champagne, voilà qu'on envoie le reste se faire
mutiler par les féroces bulgares ! Pitié. Je me demande quelle
épouvantable anxiété doit tordre ma mère. Nous ne reverrons
sans doute jamais ce pauvre Louis.
Et
pour moi, la question de mon départ est remise sur le tapis. On
nous arrache comme les feuillaisons à l'automne.
Le
14 octobre - Louis est au camp de
la Valbonne… Il m'envoie une lettre à sa manière caustique.
Il reste calme.
Delcassé
a démissionné. Pourquoi ? On l'ignore encore. Il serait
opposé à l'aventure à Salonique.
Son
départ est-il un bien ? Est-il un mal ?
En
tout cas c'est encore un retard, et ceci peut être une
catastrophe. Les malheureux serbes sont frappés comme du fer
sur l'enclume. Et les Bulgares infâmes prennent leur revanche.
Les Grecs commettent l'infamie de renier le traité d'alliance.
Il y a de grandes trahisons qu'un petit peuple ne doit jamais
commettre. Les Grecs s'en relèveront-ils jamais ? En tous cas
les Belges sauveurs et les Serbes martyrs sont devenus grands
parmi les plus grands. Et toutes les ruines, toutes les
défaites, toutes les horreurs accumulées sur leurs sols
désormais sacrés, ne serviront qu'à leur élever un Golgotha
rayonnant. Des toutes les souffrances héroïques supportées
par cette génération broyée il y a de quoi nourrir les âmes
des descendants plusieurs siècles.
J.H.
Fabre vient de s'éteindre. Une des plus grandes figures de
l'humanité s'en va, inaperçue comme un bon vieux serviteur
qu'on oublie dans l'incendie de la maison.
vient de s'éteindre. Une des plus grandes figures de
l'humanité s'en va, inaperçue comme un bon vieux serviteur
qu'on oublie dans l'incendie de la maison.
Le
15 octobre - Départ pour
l'Infanterie du premier groupe de nos hommes. Ciel gris et cœurs
suintant la tristesse.
L'horizon
ne s'éclaircit pas. C'est l'automne. Les espoirs tombent comme
les feuilles.
C.
ne m'envoie plus rien, ni lettre, ni carte. J'attends. C'est un
besoin (?).
Le
20 octobre 1915 - Jours mornes
d'attente trouble. Russes, Italiens se dérobent. Les Français
seuls iront se faire tuer héroïquement pour la gloire. Les
nouvelles de partout sont des nouvelles grises. L'obscurité du
brouillard glacial. Louis m'envoie son adieu de Marseille.
Madeleine m'a renvoyé ma lettre. C. n'écrit plus…
(…trois
lignes gommées…)
La
résolution de ressaisissement est énergique et ferme.
Le
canon tonne avec furie sur le plateau. Les vitres ici en
tremblent. Cela change les idées idiotes ou le
demi-abrutissement dans lequel je suis après avoir subi une
séance de pornographie telle que le deviennent nos heures de
table.
Le
24 octobre - Jours anxieux. On ne
songe pas sans frisson à la grande horreur du supplice de cette
héroïque Serbie qui ne veut pas mourir. Et pourtant c'est la
ruée des fauves sur la proie sans défense. C'est plus tragique
encore que l'invasion de la Belgique. Tant de grandeur dans le
sacrifice n'a jamais été sans récompense dans l'histoire. Un
tel peuple ne peut pas périr. Il dépasse de cent coudées
l'humanité.
Et
la Grèce refuse Chypre ! Et nos troupes arrivent lentement
là-bas, trop peu et trop tard, mieux vaudrait pas du tout. Que
feront les Roumains ? C'est le secret de demain tout proche.
Les
Serbes tiennent tête ! Jamais on n'avait vu plus odieuse
agression. Jamais on ne vit lutte plus angoissante et aucun
peuple au monde n'est encore monté si haut. C'est la lutte
éperdue d'une nation héroïque qui ne veut pas mourir.
Femmes,
enfants et vieillards, tous se sont armés et se battent
jusqu'à ce qu'ils soient hachés. Les enfants et les vieillards
dans les tranchées lancent des grenades pendant que les hommes
tiennent les fusils et les femmes prennent les plus rudes
besognes.
Les
Grecs ne se sentent-ils pas monter le rouge au front ? Oui, il y
a des morts qui sont plus belles et plus riches et plus
fécondes pour le patrimoine de la postérité que les vies les
plus pleines…
Le
25 octobre - Encore rien de C. ???
Töpfchen
me prépare encore un affront. Comme Chevaleret va partir en
permission, au lieu de me confier son poste pour lequel je suis
tout désigné et tout préparé, il songe à faire appel à un
brigadier du train, récemment arrivé, un caissier des Dépôts
et Consignations… Assurément cet ex-caissier est plus expert
que moi dans l'art des chiffres mais la comptabilité est-elle
si complexe sur un terrain de distribution pour qu'on m'écarte
à priori.
Il
y a aussi le prétexte que je suis indispensable et
irremplaçable à l'habillement (avec les éléments dont le
convoi dispose). Mais au fond il y a toujours cette hostilité
sourde et féroce de cet orgueilleux et entêté breton.
Il
est dénué de tout sentiment d'équité et de commisération.
Deux hommes du détachement gardaient des ballots en gare. Ils
en ont retiré pour leur usage personnel un chandail et une
paire de brodequins… Ce n'est pas délicat la chose est sûre
et indiscutable, et les deux hommes ne sont pas les perles du
convoi. Dénoncés par une lettre anonyme, "Il" a fait
rendre immédiatement une enquête, rendu compte au
sous-intendant, et voici mes deux malheureux en prévention de
conseil de guerre. Pourtant ! Que celui qui a les mains propres
leur jette la première pierre… lui-même a bu du Champagne,
fumé des cigares, porté de beaux gants qui ne lui
coûtaient pas plus cher que les brodequins de Mignot et Cremel…
L'hiver dernier il était vêtu d'un tricot "barboté"
dans un convoi. Non seulement lui, mais vous, moi, chacun de
ceux qui ont fait les manipulations de ces effets.
Et
puis, ne se félicite-t-il pas chaque jour de ce que son homme
de confiance "roule" si bien nos clients. Et hier
encore il félicitait son Mathis de ce qu'il avait su
"refaire" quelques paquets de cigarettes dans une
distribution, afin de couvrir le déficit. La différence de
morale ?
Le
28 octobre - J'ai rencontré ce
matin Ulysse Roussy. C'était tout à l'improviste au débouché
de la forêt.
Ce
fut une prestigieuse évocation des plus belles années
d'enfance, simples souvenirs puérils et magnifiques.
Il
ne me reconnaissait pas. Au premier regard je l'avais retrouvé.
Je m'adressais à lui : C'est toi Ulysse ? Il s'arrête, me
fixe, cherche, puis tout à coup : C'est toi, Daro ?
Oh
! Toute la musique qu'il y a dans ce Daro. Mon enfance
retrouvée pour quelques minutes. Les parties de billes, de
barre, de chasse aux nids, de maraude, de berger.
Tout
cela voilé du deuil de nos heures présentes. Il va en
permission à l'occasion de la mort de son jeune frère, tué en
Champagne. Je lui ai parlé de Julien : lequel ? Fit-il. Le
petit gosse ! Mais oui, c'est déjà un soldat.
Brave
Ulysse. Pas une égratignure encore. Et depuis le début il est
là.
Le
30 octobre - On nous balance
Viviani, Millerand et Cie. Ce n'est pas dommage d'avoir
débarrassé le terrain de ces phraseurs aux sentiments de
mollusques. Mais par qui les remplacera-t-on ? Des jeunes, des
énergiques, voilà ce qu'il nous faudrait, et j'ai bien peur
qu'on n'ait recours encore une fois aux vieux, aux fatigués,
aux gagas. Pourtant les Boches sont toujours à Noyon, et les
Serbes sont bientôt comme les Belges, étranglés !
 Conserver
l'article de Clemenceau du 28 - Hindenburg à l'Acropole. Celui
du 29 - Deux symboles (la mort de Miss
Conserver
l'article de Clemenceau du 28 - Hindenburg à l'Acropole. Celui
du 29 - Deux symboles (la mort de Miss  Cavell).
Cavell).
En
avant . .
Le
31 octobre 1915 - En gare. Dimanche
avec un lever de soleil prodigieusement beau sur le château.
Les plus beaux décors m'ont échappé, préoccupé que j'étais
par la réception de douze wagons de vêtements. Soixante mille
chandails, autant de cache-nez. Du bon travail, un peu trop
abondant pour un dimanche veille de fête.
Mais
mon travail est suspendu pour une très grave affaire :
Un
maréchal des logis de dragons était cantonné dans un village
quelconque. Il oublie son manteau. Remise du manteau par l'hôte
au maire. Du maire au maréchal des logis de gendarmerie qui
fait un rapport à son commandant, lequel prévient le Général
D.E.S., qui informe la S.R. et qui transmet le rapport au
Général d'Intendance de la 6ème Armée, rapport
transmis à l'Intendant du Q.G. au 35ème Corps, qui
transmet au Sous-intendant des P. et C. qui questionne
l'officier du CVAD lequel renvoie pour information au petit
adjudant que je suis afin de savoir si ledit paquet est arrivé
à son destinataire. Il faut rendre compte à tous ces pitres
mis en mouvement. Voilà à quoi servent pour un manteau de
vingt francs nos généraux et voilà pourquoi les Boches sont
à Noyon.
Le 1er
novembre 1915
Toussaint
mouillée, Toussaint boueuse, Toussaint morne, oppressante. Pas
même une échappée vers les choses éternelles et vers nos
morts. Après avoir été trempé par la pluie à Trosly, je
suis enfermé cet après-midi au bureau où l'on étouffe
d'hostilité et de fumée de tabac. Je me suis enfui un quart
d'heure à l'église. Je n'ai pas eu le temps de me dégager de
la glu ambiante, et de me recueillir pour penser, prier,
pleurer. Pauvre Cher Grand, qui dort là-bas, tout seul, sans
que je puisse lui porter une fleur et une prière.
Le
2 novembre - Même asservissement
matériel et moral à la tâche. Une visite furtive au hasard
d'une course jusqu'au cimetière.
Oh
! Toute la jeunesse couchée dans la terre. J'évoque la
procession des âmes de tous ceux qui sont tombés. Et l'on voit
la foule compacte et pressée de ceux qui se vont se coucher
encore pour se joindre au chœur immense.
Le
4 novembre - Déclaration
ministérielle. Nous avons changé un bavard contre un avocat.
Je cherche le cri sincère jailli du cœur, je ne découvre que
de la rhétorique. J'attends des déclarations qui soient déjà
des actes. Je ne trouve que des phrases évasives et creuses
autant que bien tournées.
Derrière
"le chœur des vieillards", tous les politiciens
auront beau jeu à continuer leur cuisine malpropre au
détriment de la France agonisante, au profit de leurs petits
clients. Pendant ce temps on étouffe les Serbes et les
Bulgares.
Les
Grecs aussi ont changé de ministère. Venizelos ,
d'un hardi coup d'épaule a renversé Gounaris ,
d'un hardi coup d'épaule a renversé Gounaris pour laisser à la Grèce la route droite et triomphale
déblayée des immondices où elle patauge. Diogène, dans les
rues d'Athènes irait chez celui-là, et poserait sa lanterne.
C'est un homme. Nous cherchons le nôtre. Voilà quinze mois
qu'on ne l'a pas encore.
pour laisser à la Grèce la route droite et triomphale
déblayée des immondices où elle patauge. Diogène, dans les
rues d'Athènes irait chez celui-là, et poserait sa lanterne.
C'est un homme. Nous cherchons le nôtre. Voilà quinze mois
qu'on ne l'a pas encore.
Le
20 novembre - Le travail suspend
ma vie morale, ma vie intérieure. Je n'ai plus le temps ni de
lire, ni d'écrire, ni de penser. C'est avec une sorte
d'étonnement que je me vois à la fin de novembre presque sans
le savoir. Mes derniers souvenirs sont du mois de septembre,
quelques échappées en octobre, quelques coups d'œil à la
nature splendide. Mais depuis, rien, rien. C'est le brouillard
épais de novembre dans lequel les jours glissent inaperçus.
Depuis quelque quinze jours, c'est moi qui assure toute la
distribution au Carrefour du Putois. Je continue en outre à
avoir la surveillance des colis. Il y a à ce service de quoi
remplir copieusement ses heures. Je ne suis pas débordé par le
travail, mais il est constamment impérieux. Je n'ai plus le
loisir de suivre avec angoisse la lente agonie des Serbes, je
lis les journaux pendant les repos. C'est déjà trop pour qui
veut avoir une âme d'autruche et fermer les yeux au danger grec
et roumain.
Le
30 novembre - Les jours passent
avec une vélocité surprenante. Ni le temps décrire ni de
penser. Vie âpre et pourtant enviable. Le nouveau ministre de
la guerre va nous appeler sans doute aux tâches plus
dangereuses et plus rudes. L'abrutissement de la tranchée et la
mort nous guettent. Circulaires sur circulaires arrivent, de
plus en plus précises et impérieuses. Ce n'est plus de la
littérature comme au temps de l'ineffable et cynique Millerand.
De
rares nouvelles des miens. Déjà deux lettres de Serbie.
Faut-il dire déjà ou seulement ? Là-bas, l'horizon
s'assombrit de jour en jour. L'agonie lente de la Serbie se
prolonge comme une merveilleuse fleur d'un couchant sublime avec
des lueurs rouges d'incendie et de sang. Quels historiens feront
frissonner les fils de l'avenir avec le récit de ces sacrifices
de peuples héroïques. Tout à côté pourtant les pires
bassesses. Les Roumains se tiennent à l'écart, mystérieux et
cyniques. Les Grecs, fils d'Ulysse entre l'enclume et le marteau
crient qu'ils ne veulent pas se battre. Beaux discours, visites
éminentes, menaces, intérêts, rien n'y fait. Le gouvernement
grec est en train de nous jouer je crois, un tour de cochon
comme disent les gens du peuple. Ils doivent nous rouler de main
de maître.
Le
roi gouverne, il est convaincu de la supériorité germanique,
il croit à la victoire finale de l'Allemagne, il aime
l'Allemagne, il lui est dévoué corps et âme et sans doute
lié par traité à elle, par traité secret. Mais Venizelos
qu'il a en haine a appelé les anciens libérateurs de la
Grèce, il leur a permis de s'installer en Macédoine. Les
alliés sont là, flairant et redoutant un coup de Jarnac sur
leurs arrières-lignes. Ils exigent des garanties. Leur donner
toutes serait se livrer à eux, prendre parti contre
l'Allemagne. Il n'y a plus qu'un moyen de sortir de cette
situation fausse : atermoyer jusqu'à ce que les allemands
soient massés à la frontière grecque prêts à broyer nos
pauvres troupes, irrémédiablement, et dicter à la Grèce un
acte de protestation pour la forme, la violer en apparence, puis
quand les alliés seront anéantis là-bas, il lui serait facile
de se laisser guillotiner par persuasion, et de répondre aux
mécontents : pouvais-je faire autrement ? Corneille et
Thémistocle auraient trouvé une autre réponse, mais n'est pas
un héros qui veut.
Descendons
plus bas, plus bas encore… très bas même, à une table
d'officiers où j'étais invité dimanche dernier :
Misère
morale, misère intellectuelle.
L'un,
un invité au pied levé amène la conversation sur les horreurs
germaniques et tout brutalement vient avancer : "Tenez, par
exemple, que n'a-t-on pas reproché aux Boches, des
bombardements de la cathédrale de Reims ! Eh bien, ils ont eu
raison. Nous en aurions autant fait à leur place. Il est
établi que nous avions installé dans les tours des
mitrailleuses. Je le tiens d'un commissaire du
gouvernement."
Tout
le monde se récrie. Je fis observer que la ville de Reims
était une ville de 100.000 habitants, que la cathédrale était
au centre de l'agglomération, qu'une mitrailleuse ne portait
qu'à cent mètres et que par conséquent, en aucune façon, les
mitrailleuses de la cathédrale, si tant est qu'elles y fussent
ne pouvaient menacer les lignes boches.
Mais
le capitaine, président de table, réplique crûment qu'il
était indigne d'alléguer de tels faits en faveur des Boches,
et que d'ailleurs cela ne tenait pas debout, que n'importe quel
expert appelé dirait : "celui qui a osé dire cela est un
idiot". Largeau pâlit, mais ne broncha pas. Quelle douche.
Un silence. Mais Weil cria : Voilà Messieurs un canard aux
navets qui me semble cuit à point.
La
conversation revint à la politique. La cause de notre insuccès
du début, c'était la politique, les partis d'extrême gauche
qui avaient prêché le désarmement.
-
Pardon, objecte M. Chazel, la faute n'est pas à ceux-là, mais
à la majorité. Ils n'ont jamais eu la majorité ceux que vous
incriminez, n'ont jamais été la majorité.
-
oui mais une majorité singulièrement paralysée par ces gens
là, par tous ces Jaurès, ces Hervé.
-
Ah ! mon Capitaine, fit Töpfchen, je vous demanderai de ne pas
dire de mal de Jaurès. J'étais un de ses plus fervents
adeptes. Il ne faut pas confondre Jaurès avec Hervé.
Mais
le Capitaine ne fait aucune distinction.
-
J'ai été élevé dans les principes républicains, dit-il, je
n'admets pas qu'on tolère des gens qui parlent de planter le
drapeau dans le fumier. Les Jaurès, les Hervé, c'est toute la
même bande. Nous sommes en guerre, c'est vrai, mais en temps de
paix, si un Monsieur dans une popote d'officier avait osé
soutenir de pareils hommes, on l'aurait sorti à coup de pieds
au cul !
Le
petit rageur céda sous le coup de botte, comme un cheval
attaché sous un coup de cravache. Il essaya de riposter, tout
pâle ; sa voix s'étrangla, il se tut. A grade égal, c'était
une gifle. Weil reprit le chahut… et l'orage s'en alla sans
éclater. Mais que j'aurais voulu être ailleurs.
La
bêtise, l'étroitesse d'esprit, la violence des caractères, la
brutalité des intelligences et des manières ne sont pas le
seul lot des humbles.
J'étais
gêné, ce n'était pas par sympathie pour personne. Je sais à
quoi m'en tenir sur la cordialité des ces invitations
périodiques faites dix minutes avant le repas. Je sais à quoi
m'en tenir sur la valeur morale du "botté". Encore
aujourd'hui un exemple typique.
Ce
matin après une nuit glaciale, il s'est mis à pleuvoir. Un
verglas magnifique recouvrait les routes. Il faut avoir vu ces
pauvres chevaux et ces conducteurs en lutte avec la route
traîtresse. La pluie ne cessait pourtant pas de tomber, froide
sur la terre gelée ; elle se figeait au fur et à mesure, et au
lieu de supprimer le verglas, l'accroissait.
Les
hommes et les bêtes étaient rentrés passé midi, harassés et
trempés. Et la pluie tombait toujours plus abondante et froide.
Les conducteurs chargés de fûts ont la consigne d'en déposer
quelques-uns uns spécialement marqués dans la cour de notre
cantonnement en rentrant à Pierrefonds. L'un d'eux estima sans
doute qu'il était plus urgent d'aller sécher ses chevaux et
ses vêtements. Or à quatre heures du soir, Töpfchen
s'aperçut qu'il manquait un des fûts spéciaux dans la cour.
Explication.
Recherche avec les distributeurs. Il fut établi à tort ou à
raison qu'un des conducteurs, lequel, on ne savait, avait mangé
la consigne. Alors, sans se soucier ni des fatigues ni des
difficultés du matin, ni de l'heure tardive, ni de la pluie qui
tombait à seaux, il donna l'ordre à toutes les voitures
chargées de fûts vides de venir à la cour de notre
cantonnement.
Et
les malheureux conducteurs et chevaux, à demi séchés, durent
venir se promener et s'en aller sans comprendre la manœuvre
aussi féroce qu'idiote. Mais des trente voitures chargées on
avait retiré un fût, le fût manquant. Le Dur pouvait dormir
en paix, son orgueil était satisfait.
Le 3
décembre 1915
Pas
de nouvelles de Louis. L'inquiétude renaît. Sa brigade a été
engagée avec les Bulgares. C. me le confirme sans le vouloir.
La désorientation balkanique est toujours aussi grande.
Le
5 décembre - Une lettre de Louis
du 12 novembre. Trois semaines de voyage à une lettre !
Le
10 décembre - Deux sujets de
nouvelles savoureuses avec un peu d'art dans le récit.
La
première, âpre. Derbaud est un vieux territorial, RAT. Sa
famille est restée dans le pays envahi, vers Lille. Il était
malade à la mobilisation. Il a fui comme il a pu. Il s'est
présenté aux autorités militaires, incorporé à un dépôt
quelconque de l'ouest où il est mal vu à cause de son
caractère énergique, loyal, nerveux. Il a l'échine raide, la
réplique prompte, la susceptibilité avivée par sa maladie.
Il
se déplaît dans cette caserne. C'est un soulagement d'aller au
front. Hardi et prudent, il recherche les missions périlleuses,
froidement guide les jeunes, les discipline, mais un sergent le
déteste à cause des qualités de l'homme. Un jour, Derbaud est
malade, ne peut se traîner. Le sergent l'a remarqué. Il
s'empresse de le désigner pour une corvée, par brimade, le
vieux se plaint : - Marche donc, vieux con, grince l'autre.
Il
marche…
Quinze
jours plus tard, nouvelle patrouille de nuit accueillie par une
fusillade et des rafales d'obus. Le sergent se blottit dans un
trou, oubliant ses hommes et sa mission. Derbaud le cherche. Il
le découvre au fond d'un fossé, blotti, tremblant.
-
Qu'est-ce que tu fous là ! Tu as peur, lâche. Vois-tu le vieux
con est là. A nous deux. Veux-tu bien sortir lâche. Il faut
que ce soit ton vieux c. qui te montre l'exemple. Allons ouste.
Vas-te plaindre.
Et
Derbaud lui envoie un coup crosse en plein visage et s'éloigne.
Il continua la patrouille, puis rentré à la tranchée :
-
Mon lieutenant, j'ai tué le sergent.
-
Tu as tué le sergent ? Pourquoi ?
-
Je lui ai cassé la figure d'un coup de crosse parce qu'il nous
avait abandonnés et s'était caché.
-
Tu as bien fait, fit l'autre.
L'autre
est plus humaine et plus gauloise.
Nous
étions cantonnés à Haramont le bourg, dans la clairière de
la forêt. Beau cadre. Dans la maison forestière, la jeune et
accorte, faunesse vicieuse du Moulinet.
Le
sergent Petit. Les privations d'amour. Le soir, il est excité
en écrivant à sa femme. Le flux de sang du mâle. Il se
relève, quitte son camarade de lit, part à pas de loup dans la
laie, arrive au Moulinet, la jeune femelle se relève,
l'accueille en chemise, les amours fausses. Mais là dans le
lit, où la mère indigne accepte le visiteur, dorment deux
enfants. Le brave père de famille qu'est Petit sent le rouge
lui monter au front. Il a honte, lâche la femelle et s'enfuit.
Le
19 décembre - Notre nouveau
gouvernement ne peut pas plus se dépêtrer des difficultés
balkaniques que l'ancien. Même entêtement aveugle à attirer
les Boches à Salonique, même affolement, inquiétude,
irrésolution sur les moyens de s'y opposer.
Les
Bulgares donnent le premier gros choc à nos frères. A quelle
boucherie à t-on envoyé ces pauvres Franc-comtois ? Le manque
de cohésion, de décision, de direction dans notre camp
multiplie les chances des allemands, leur promet de conserver
les fruits de leurs premiers succès, et de faire durer la
guerre au-delà des forces des peuples.
Le
12 décembre - Dimanche.
"Es
ist nicht immer Sonntag im Leben", (ce n'est pas
toujours dimanche dans la vie). Cette phrase d'un livre lu
à Krems (Für Dich) me revient en mémoire aujourd'hui où je
sens chanter un peu de joie inattendue et pour moi, une fois.
"Est
ist heute Sonntag in meinem Herzen", (Aujourd'hui, c'est
dimanche dans mon cœur). Pourtant je ne saurais pas bien
dire d'où vient ce flux qui monte ne chantant.
Ce
matin la tempête de neige faisait rage. Elle s'est apaisée
vers huit heures. A dix heures j'étais libre par
extraordinaire. Je suis donc allé au château. Je n'avais pu y
remonter en pèlerinage depuis le 1er janvier, où j'étais
allé découvrir Julien encore épouvanté de la sanglante
attaque de Guennevières.
J'ai
passé une heure sur la terrasse, dans la cour, revivant le
premier jour de l'année terrible. En redescendant, après une
courte visite à la vieille église, j'ai eu la joie de trouver
une longue lettre de Louis, une de maman, annonçant la
libération de Julien, une de C. apportant une caresse. C'est la
joie complète. Laissons les ailes se déployer pendant cette
fugitive heure de paix.
Le
15 décembre - Une carte de Louis
datée du 1er décembre. Il n'a pas encore été
engagé. Poste à la garde d'un défilé à mille mètres
d'altitude dans la neige, et affamé.
Le
16 décembre - La retraite
française sur Salonique semble avoir été ou être très dure.
Notre anxiété fraternelle et patriotique grandit d'heure en
heure. Je prévoyais, je redoutais un désastre.
Le
21 décembre - Dure journée,
relativement. Sure pour nous qui vivons en sybarites dans notre
nid de Pierrefonds. Nous l'avons quitté ce matin.
Ravitaillement
à la Faisanderie. Course en vélo par la pluie, la neige et la
boue par Charny au Bac, Compiègne, la Croix-St-Ouen, Saintines où nous avons un accueil cordial qui détone sur ceux de la
région. Les hommes sont au moulin, cela rappelle Duvy. Je leur
ai procuré de la paille, une couche sèche et chaude. Cela
remettra des mauvaises humeurs.
où nous avons un accueil cordial qui détone sur ceux de la
région. Les hommes sont au moulin, cela rappelle Duvy. Je leur
ai procuré de la paille, une couche sèche et chaude. Cela
remettra des mauvaises humeurs.
 Töpfchen
est au château, moi chez une bonne vieille veuve dont le fils
unique est au front. Elle est résignée. Pourvu qu'il revienne. Töpfchen
est au château, moi chez une bonne vieille veuve dont le fils
unique est au front. Elle est résignée. Pourvu qu'il revienne.
Demain,
nouveau départ. Cela rappelle le début de la guerre. Je crois
que nous passons convoi de division et nous allons quitter le
front de l'Aisne.
Le
22 décembre - De Saintines à
l'accueil ouvrier, chaud et spontané au grincheux accueil des
paysans picards de Fouilleuse. Journée boueuse, pluvieuse,
pleureuse. Longues étapes pour moi en vélo par une boue
grelante dans la vallée de l'Oise sur des routes plus sèches
dès que les silex apparaissent.
A
Verberie, j'ai cherché et trouvé Redersdorf. Je lui ai serré
la main hâtivement. Il envie "mon filon". En causant
avec lui, j'ai aperçu par le plus grand hasard Marcel Sauvageot
qui ne me reconnaissait pas. Il m'a parlé - d'un air grave -
comme un homme détaché de tout. Il m'a cité un mort du pays,
et ajouta : "il y en a encore plusieurs autres, mais je ne
sais plus lesquels. Oh ! Ici on ne publie tout, on ne sait plus
comme on vit". Harancourt parlait hier du renoncement en quelque sorte religieux et
monacal de ces deux millions d'hommes engloutis dan le cloître
des tranchées… Pauvreté, chasteté, obéissance. Les trois vœux,
et bien remplis hélas, mais quelle soif et quel espoir de
délivrance et de revanche éclaire cette servitude et cette
privation.
parlait hier du renoncement en quelque sorte religieux et
monacal de ces deux millions d'hommes engloutis dan le cloître
des tranchées… Pauvreté, chasteté, obéissance. Les trois vœux,
et bien remplis hélas, mais quelle soif et quel espoir de
délivrance et de revanche éclaire cette servitude et cette
privation.
Il
serait délicieux de flâner à travers ce vieux pays de France,
dans la vallée de l'Oise où les villages pittoresques et
évocateurs d'une vieille histoire. La Croix-St-Ouen, Saintines,
l'Ermitage, Pont-Ste-Maxence, Estrées, St-Denis .
Et partout de vieilles bâtisses délabrées mais autrefois
opulentes et solides. Le vieux grès équarri abrita bien des
splendeurs monacales ou seigneuriales où maintenant il n'y a
plus que des paysans qui ne peuvent donc bâtir qu'à la
baraque. .
Et partout de vieilles bâtisses délabrées mais autrefois
opulentes et solides. Le vieux grès équarri abrita bien des
splendeurs monacales ou seigneuriales où maintenant il n'y a
plus que des paysans qui ne peuvent donc bâtir qu'à la
baraque.
A
Fouilleuse il n'y a qu'un vieux jardinier qui nous fait un
accueil cordial.
Le
23 décembre - Journée en gare
de St-Just-en-Chaussée. Cantonnement du soir chez le vieux
curé de Lieuvillers. Il m'offre une "goutte". C'est
un vieux simple et finaud à la fois. Il croit aux balivernes du
Matin, sur la volte-face de la Grèce, il ignore l'usage des
lampes de poche et s'émerveille devant ma lampe électrique
mais il me dit "qu'il tient ses paroissiens avec la
médecine qu'il pratique. Dès qu'ils ont une colique, ils
courent chez moi, m'appeler. Je suis tout de suite là et dès
lors j'ai un pied dans l'étrier."
Après
avoir trinqué au verre de fine, je le laisse préparer son
sermon de Noël. Le vent hurle, la pluie tombe. Ce sera encore
gai demain notre longue étape en perspective.
Le
24 décembre - Nous chargeons en
gare et revenons à Lieuvillers pour deux jours. Je retrouve ma
chambre chez mon vieux curé.
Le
convoi s'est scindé en deux. Rübelein me quitte. Gott gehe mit
ihm ! Ich habe gegen ihm einene sicken Verdrufs. Unter dem
gewöhnliche Vertraulichkeit, liegt ein wacher Hafz (Que Dieu
soit avec lui ! J'éprouve toujours à son égard un
mécontentement tenace. Sous les dehors de la familiarité
ordinaire, il y a une vive aversion).
Noël.
Popote calme, les imbéciles de 1ère classe nous ont
quitté. Quelques chants, une bonne bouteille, nous allons
chacun dans notre chambre. J'écris à M. Mathiez, aux miens, à
C. Il est 11 heures et demie. J'ai bien sommeil mais je vais
quand même à matines. L'église est humble et belle, mais les
chants éraillés, ma tête lourde, l'émotion religieuse n'est
pas venue.
Le
25 décembre - J'ai passé ma
fête de Noël dans un wagon à trier des colis.
Demain
nous quitterons Lieuvillers pour Blicourt-en-Beauvaisis.
Le
26 décembre - Départ de
Lieuvillers. Chargement en gare de St-Just. Par une gaffe de
Töpfchen je reste jusqu'au soir, attends un train.
Descente
à Crèvecœur .
Le chef de gare m'offre un wagon de 1ère classe où je passe la
nuit avec Froment. .
Le chef de gare m'offre un wagon de 1ère classe où je passe la
nuit avec Froment.
Le
27 décembre - Je viens dans
l'après-midi au nouveau cantonnement : à Pisseleu ,
(14 km N. de Beauvais). C'est le village des plateaux crayeux.
Riche campagne et aspect minable des habitations en torchis. Les
maisons en brique ne sont pas les plus nombreuses. Village plat,
rues sales. L'eau des mares n'excite pas à la propreté. ,
(14 km N. de Beauvais). C'est le village des plateaux crayeux.
Riche campagne et aspect minable des habitations en torchis. Les
maisons en brique ne sont pas les plus nombreuses. Village plat,
rues sales. L'eau des mares n'excite pas à la propreté.
Jammer
m'a préparé en apparence une chambre. Je loge chez Mme
Maillard. Le mari est au front, seule avec sa fillette.
Le
28 décembre - Je suis à nouveau
écarté de la comptabilité. Je suis systématiquement
relégué au service des colis. Toutes mes offres d'aide sont
accueillies par un merci cinglant. J'irai tous les jours en gare
assurer le chargement des effets d'habillement.
On
m'ignore. Des ordres viennent dans la nuit modifiant les heures
de départ, on ne me les communique même pas.
Le
31 décembre - Canaille. Le 29
décembre - L'inquiétude au sujet de Louis commence à peser.
Rien ne vient donner la garantie qu'il n'a pas disparu dans la
redoutable retraite. Pourtant les affaires françaises à
Salonique sont en meilleure posture. Pour une fois les
prévisions pessimistes sont démenties. Je croyais (et
craignais) que les germano-bulgares allaient poursuivre leur
succès et nous jeter à la mer. La frontière grecque les a
arrêtés. Il se sont arrêtés contre toute attente. Nous avons
eu le temps de nous ressaisir, d'organiser le terrain, d'envoyer
des forces et du matériel et des munitions. Un camp retranché
s'organise, s'affermit de jour en jour et qu'il semble de plus
en plus difficile d'enlever.
Pour
peu que nos adversaires tergiversent encore, la partie est
perdue pour eux. Leur expédition balkanique se terminera en
queue de poisson, à moitié chemin comme leurs précédentes
entreprises sur Paris-Calais, Moscou. Des forces françaises et
anglaises à Salonique assez considérables semble-t-il, c'est
une menace que le major Moralut qualifie à juste titre
"d'intolérable". Mais les tranchées établies et
armées, comment nous expulser d'une place forte libre du côté
de la mer. Il leur faudra tolérer la menace, l'épine au
côté. Vraiment, c'est Clemenceau et Kitchener qui avaient tort, Briand qui avait raison. Qui pouvait prévoir
cette impardonnable faute militaire d'un arrêt en pleine
poursuite victorieuse. Qui eut cru que des poteaux frontières
grecs seraient respectés quand ceux du Luxembourg et de la
Belgique pour des raisons moins impérieusement nécessaires ont
eu si peu de solidité. C'est que le problème balkanique est un
gluant écheveau. Nous nous y sommes pris, et les Boches s'y
sont lancés à plein vol, pas étonnant qu'ils battent déjà
de l'aile. Poursuivre les Français jusqu'à Salonique c'était
facile et urgent, mais il y avait deux coureurs vers le même
but, pour la même récompense. Salonique nettoyée, c'est beau,
mais quiconque y parvient ne veut pas s'en aller, sauf les
Anglais, et encore je ne voudrais pas le jurer. Si les Bulgares
y mettaient les pieds, jamais ils n'abandonneraient cette proie.
Les Grecs le savent. Ils sont lâches et infidèles à
l'Allemagne, mais les fusils partiraient tout seuls et alors…
c'est un ennemi de plus. Les Austro-allemands ont un appétit au
moins aussi aiguisé et aussi avisé que celui des Bulgares.
Salonique ferait bien leur affaire. Mais Salonique est grecque
et puis surtout, ils ne peuvent forcer la place sans le concours
des Bulgares. Donc avant de se lancer à l'assaut, ces bons
larrons se concertent pour savoir à qui on laissera Salonique.
qui avaient tort, Briand qui avait raison. Qui pouvait prévoir
cette impardonnable faute militaire d'un arrêt en pleine
poursuite victorieuse. Qui eut cru que des poteaux frontières
grecs seraient respectés quand ceux du Luxembourg et de la
Belgique pour des raisons moins impérieusement nécessaires ont
eu si peu de solidité. C'est que le problème balkanique est un
gluant écheveau. Nous nous y sommes pris, et les Boches s'y
sont lancés à plein vol, pas étonnant qu'ils battent déjà
de l'aile. Poursuivre les Français jusqu'à Salonique c'était
facile et urgent, mais il y avait deux coureurs vers le même
but, pour la même récompense. Salonique nettoyée, c'est beau,
mais quiconque y parvient ne veut pas s'en aller, sauf les
Anglais, et encore je ne voudrais pas le jurer. Si les Bulgares
y mettaient les pieds, jamais ils n'abandonneraient cette proie.
Les Grecs le savent. Ils sont lâches et infidèles à
l'Allemagne, mais les fusils partiraient tout seuls et alors…
c'est un ennemi de plus. Les Austro-allemands ont un appétit au
moins aussi aiguisé et aussi avisé que celui des Bulgares.
Salonique ferait bien leur affaire. Mais Salonique est grecque
et puis surtout, ils ne peuvent forcer la place sans le concours
des Bulgares. Donc avant de se lancer à l'assaut, ces bons
larrons se concertent pour savoir à qui on laissera Salonique.
Les
Bulgares n'iront pas s'y faire décimer pour la rendre. Les
Allemands ne peuvent décemment la prendre aux Grecs. Les Grecs
ne savent que faire. Délibérations. Nous sommes l'heureux
troisième larron. Chaque jour qui passe nous assure mieux
contre un désastre.
La
situation angoissante devient bonne, satisfaisante. Et voilà
les coalisés paralysés, ne pouvant se lancer nulle part
ailleurs avec notre arrière sur le flanc.
Le
30 décembre 1915 - Aujourd'hui
c'est fête. Une grande lettre de Louis. Il est sauvé.
 
|