|
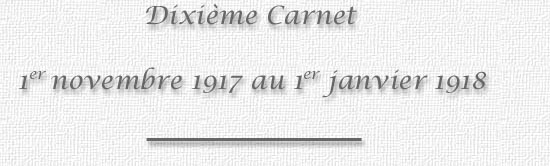
-Verdun-Lorraine-
Spera
in Deo.
Sustine.
Per crucem ad
lucem.
(Espère en
Dieu.
Supporte.
Par la croix
vers la lumière)
Le 1er
Novembre 1917
Toussaint
1917
Dans
l'épreuve, au fil des jours…
La
Toussaint à Verdun et en rentrant de permission.
Une
permission dont je suis mécontent. Je reviens non pas avec des
provisions, mais du vide au cœur, du vide où flotte de
l'effroi. J'ai tissé peu à peu de l'impossible et je sens que
les derniers fils se nouent pour m'attacher irrémédiablement.
J'ai
bien esquivé Belfort mais je ne suis allé ni à Montbéliard,
ni à Sancey…
Je
pressens avoir fait très mal à Marthe. J'ai trouvé ici un mot
de son amie F. qui me laisse voir où la pauvre glisse. Je n'ai
pas répondu à la Croix Morel. J'ai vu Camille plus morte que
vive. Je n'ai rien fait transmettre à la Croix-Rouge. Je
souffre encore de l'ancienne et définitive pitié. Tout cela
est plus confus que le brouillard. Mme Bey a commis
l'irréparable bassesse. Mon cœur n'a d'égal en confusion que
la situation politique et militaire. Jours noirs. Dies irae,
dies illa. (Jour de colère, ce jour-là). Mes pauvres
morts. Je monte en ligne cet après-midi.
Jour
des Morts.
A
la cote 344.
De
profundis clamavi at te Domine (Des profondeurs je crie vers
toi Seigneur).
Me
voici plongé dans l'abîme de misères indescriptibles. Il n'y
a que ceux qui ont trempé dans les tranchées inondées et
qu'il faut tenir quand même, qui en sachent l'horreur sans nom.
Pauvres malheureux. Pauvres hommes.
De
quel égoïsme est donc cuirassé le cœur humain pour que les
êtres qui nous aiment pourtant, vivent confortablement et
tolèrent ces innombrables supplices sans venir à notre
secours, et quel mystérieux ressort tend donc les corps et les
âmes suppliciés pour qu'ils résistent à ces abominables
souffrances monotones ? Et pour les accepter ?
Mais
passons. C'est le Jour des Morts. Il pleut. Le brouillard
dégouttant pèse sur le visage torturé de cette terre maudite.
Accroupi
dans un abri devenu citerne je songe à mes morts… Je songe à
mes proches que la terre a déjà dévorés. Je songe aux
immenses cimetières qui parsèment la terre de France de
Dunkerque à Belfort. Effroyable couronne d'épines enfoncée en
pleine chair saignante.
Et
voilà que le désastre italien appelle les Français à couvrir de leur courage la terre
d'Italie (?) qui a déjà vu tant de fois tomber les
corps français sur elle.
appelle les Français à couvrir de leur courage la terre
d'Italie (?) qui a déjà vu tant de fois tomber les
corps français sur elle.
Les
esprits pessimistes disent : est-ce que les Italiens sont venus
à notre secours à Verdun ?
Les
Italiens nous trahissent comme les Russes… Ils ont dû lever
les bras.
Les
simples disent. Je ne comprends pas que les Italiens se soient
fait prendre six cents canons, cent mille hommes. Il n'y a que
nous Français pour mater les Boches. Et c'est notre tour
hélas. D'autres disent : c'est bien fait. Ils n'avaient qu'à
rester neutres. Il y a si peu d'hommes qui comprennent que la
Belgique, la Serbie, la Roumanie, l'Italie ne se sont pas mises
dans cette affreuse guerre de gaîté de cœur, si peu qui
comprennent la fatalité de ces désastres successifs, de ces
égorgements de nations.
J'écoutais
cette nuit les hommes causer de la guerre dans leur abri !
Quels
grands enfants ou naïfs ou cyniques. Rien que des arguments
ineptes.
Couper
la tête à Guillaume, pendre Poincaré.
Espérer
que chacun lèvera les bras.
Demander
une mutation, la famine, etc… pourvu que la guerre finisse. Et
pour ceux qui ne sentent que l'odieuse brutalité de la lutte
n'est-ce pas en somme bien logique ?
Comment
leur en faire grief ? Et les souffrances s'accroissent, les
rangées de tombes s'allongent dans les plaines :
Resquiescant
in pace (Qu'ils reposent en paix).
Et
c'est une autre désolation que celle de mon cœur tiraillé en
tous sens, corrompu et odieux à un juge équitable.
Je
me suis mis à pleurer, à rougir en disant tout à l'heure la
"Prière pour celle qui m'aime" de Murner. De
profundis clamavi. La mort serait sans doute la solution la plus
loyale, la plus belle, la plus douce.
Le
3 novembre - Verdun . .
La
relève s'est faite au nez des Boches par la piste, la tranchée
et les boyaux étant inabordables. L'ennemi indulgent n'a pas
tiré. C'était déjà bien assez de misères de s'arracher des
fondrières de boue.
Jamais
marche ne m'a été plus pénible que cette descente à travers
la steppe boueuse de la cote du Talou à Bras. J'étais harassé
à pleurer. Mes pauvres petites cuisses étaient lasses de tirer
en haut mes pieds englués. Pour comble de guigne le guide nous
avait égarés.
Tout
cela est loin, car dans la cave ce soir les pauvres êtres
boueux chantent déjà :
"Bonsoir
les copains
On
se reverra
Demain
matin
Pour
le combat…"
-
On a déjà oublié toutes ses petites misères, fait Bouchart,
philosophe.
Il
est vrai qu'il y a eu un quart de vin supplémentaire.
Par
contre pas de bougie et je note ceci : titre de détail
scandaleux :
Mon
tampon frappant à toutes les coopératives ne trouvant pas de
bougie s'adresse à un "type" soldat du génie,
croisé en rue :
-
Tu sais pas où y a des bougies à vendre ?
-
L'autre réfléchissant : si, viens avec moi.
Et
ce roublard vendit à mon débrouillard des bougies touchées
pour l'éclairage des sapes du génie.
 On
nous a descendus de Bras On
nous a descendus de Bras à Verdun en péniche : c'est une des rares innovations
intelligentes que j'ai vues pour soulager le fantassin sortant
des lignes.
à Verdun en péniche : c'est une des rares innovations
intelligentes que j'ai vues pour soulager le fantassin sortant
des lignes.
Le
voyage fut une douce surprise dans ce paysage meusien voilé
dans le brouillard au roulis insensible du bateau.
Je
songeais aux descentes en bateau sur le Rhin, l'Aller, l'Elbe,
le Danube des temps heureux.
Parmi
les nombreuses péniches coulées dans le canal par les obus,
j'ai eu la surprise de lire quelques noms évocateurs et
symboliques des temps passés, des temps présents : Lorelei,
Margaretha !
A
l'arrivée à Verdun dans la ville sacrée la fatigue nous
pressait trop les tempes pour que nous puissions, nous qui
franchissions la première fois ces portes de Vauban, goûter,
éprouver l'angoisse solennelle qui les ferme.
Pauvre
ville dévastée. Mais on en a tant vu de ces ruines, que celles
de Verdun, elles-mêmes ne nous étreignent plus d'horreur
religieuse.
Pour
mémoire, la scène tragi-comique de l'incendie de la cagna. Le
caporal Chalmeton - un type. Son juchoir au-dessus de la sape
inondée. Le quart d'alcool à brûler renversé. Les flammes
partout, sur le corps, à la porte. Le moyen héroïque - sauter
dans l'eau. Le casque récipient.
Notre
fou-rire, après le danger.
Le
4 novembre - J'ai le corps engourdi
de fatigue, les membres me font mal après cette nuit de repos
dans une cave sur un édredon provenant des logements dévastés
par les obus et le pillage.
Le
5 novembre - Les profiteurs de la
guerre.
Un
territorial - de Toulouse - s'est débrouillé pour avoir
malgré la guerre et malgré son séjour au front, la vie
agréable et rémunératrice.
Il
s'est pourvu d'une clarinette et s'en va le soir à la recherche
des copains qui on l'accent. Il les aborde avec une verve de
charlatan, puis leur offre quelques airs d'abord gratuits.
Pour
de pauvres diables descendant de la boue, un tel compatriote est
une bénédiction du ciel du Midi.
Mais
cette "fille de pute" en soufflant dans la clarinette
attrape soif. Il demande à boire et manifeste sans gêne ses
préférences pour le vin en bouteilles. Il y a d'abord la
supériorité de la qualité qui fait le souffle plus ferme,
puis cet autre avantage inattendu et cyniquement étalé : il
demande les bouteilles vides pour sa peine : il les revend à un
marchand de l'arrière à sept sous pièce, grâce au concours
d'artilleurs qui assurent le transport des bouteilles avec
empressement par partage des bénéfices.
Le
6 novembre - Vraiment on abuse du
poilu ! Après une journée de repos pendant laquelle la boue
visqueuse des vêtements et des armes n'a pu être enlevée
qu'en partie, on ordonne des travaux de nuit.
Embarquement
dans les péniches, remontée de la formidable cote du Poivre,
et nous voici de nouveau en seconde ligne à approfondir la
tranchée.
Au
retour après un semblant de mauvais travail, un blessé par
balle de mitrailleuse, marche dans la nuit jusqu'à Verdun.
Les
hommes sont harassés, déprimés. A ce régime, on prépare une
sédition car l'après-midi qui suit, revue du Colonel,
nettoyage, théories prescrites.
Le
7 novembre 1917 - Hier soir, à la
citadelle, concert et cinéma donné à la troupe.
Vu
à la séance quelques officiers de la mission étrangère :
serbes, italiens, anglais, japonais.
Les
nouvelles d'Italie dépassent toutes les craintes.
Deux
cent cinquante mille prisonniers. Mille huit cent canons.
La
catastrophe est due à la défection de divisions travaillées
par les délégués du soviet. L'Entente se suicide avec la
révolution russe.
Seule
l'armée allemande, le gouvernement allemand ont une mentalité
de combattants, un patriotisme inébranlable et obstiné.
Les
autres gouvernements sont lâches et faibles. Ils tremblent
devant les trembleurs qui se parent du nom sournois de
pacifistes.
Et
ceux-ci s'enhardissent, travaillent à démoraliser les armées
de l'Entente. Qu'il arrive un coup de tangage et l'armature
s'effondrera, laissant les Boches seuls, debouts et triomphants.
Le
9 novembre 1917 - Durant ces mois
d'hiver où l'hostilité de la nature et des hommes s'acharnent
sur le pauvre fantassin connaissez-vous le tourment le plus
cruel ? Ce n'est pas celui de la sentinelle dont les pieds
trempent dans l'eau tandis que le vent aigre lui mord les chairs
et fait pleurer les yeux fouillant les ténèbres. Je crois que
le pire est une corvée de nuit.
Vous
représentez-vous ce que c'est que de s'en aller en longue file
morne, un rouleau de barbelé sur l'épaule par la nuit noire,
sous la pluie, à travers un terrain bouleversé par les obus
comme ne le fit jamais aucune charrue, d'aller avec un fardeau,
glissant d'un pied, enfonçant l'autre dans la boue visqueuse,
faire effort pour les ramener tous deux, aller puis heurter une
pierre, un rail et tomber dans un trou d'obus plein d'eau, se
déchirer les mains, les vêtements aux fils de fer barbelé,
tituber comme un homme ivre, s'effondrer sur les genoux, heurter
un voisin, qui jure et vous injurie, tout à coup être ébloui
et assourdi par le fracas des explosions, ne plus savoir si dans
quelques secondes il restera de vous et vos compagnons un seul
vivant, puis reprendre dans le silence et l'obscurité retombés
comme un manteau de fer, le douloureux cheminement c'est,
croyez-le, un véritable calvaire.
Et
ce martyre obscur et monotone est infligé chaque nuit à des
milliers et des milliers d'innocents et de braves gens.
On
est effaré quand on songe que nos autorités ne cherchent ni un
adoucissement ni une compensation à ces martyrs héroïques,
quand on s'aperçoit que leur bienveillance, leur sollicitude
est réservée à la canaille.
Les
repris de justice, eux, sont groupés dans de bons
cantonnements, hors de la portée des obus. Ils cassent tout
doucement quelques cailloux pendant quelques heures par jour,
ont les nuits paisibles, le repos dominical, deux quarts de vin,
des casse-croûtes, des boissons chaudes, des vêtements
fourrés et le droit de réclamer des améliorations de régime
aux députés et aux ministres…
Je
n'exagère pas. Le fantassin après sa corvée, a le devoir de
se taire, de regagner sa tranchée, souvent sans un seul abri,
sans aliment chaud, sans vêtement sec, il va reprendre la
faction au créneau, continuer son supplice en variant la
souffrance…
Pitié
pour les soldats de France, pour les infortunés fantassins.
Partie
hier soir par les péniches la Compagnie est montée par
l'affreuse piste avec l'agrément inattendu d'un tir de barrage.
Nous sommes restés là-haut jusqu'à 1 heure. Et pourquoi
faire, Grand Dieu ! Une douzaine de paysans en trois heures
auraient remué davantage de terre que ces cent soldats dans
leur nuit, sans direction, sans commandement, sans
encouragement, ce n'est pas étonnant que ces hommes ne fassent
rien. C'est même plus grave que le temps perdu et la fatigue
inutile : on les démoralise, ils ont l'impression qu'on gâche
leur temps, leurs forces, leur repos pour un travail sans
valeur, mal réparti, mal compris.
Nous
rentrons transis, mouillés, harassés à 5 heures du matin avec
trente kilomètres de trajet pour creuser quarante mètres de
boyau à vingt centimètres !
Le
10 novembre - La révolution russe
se développe selon sa redoutable logique :
Les
maximalistes ont mis en fuite Kerenski. Le mot d'ordre, le
programme passionnant de ces utopistes est : "La paix et la
terre". Avec cette double promesse ils sont sûrs d'être
soutenus par les cent millions d'ignorants et d'aveugles de ce
grand peuple enfant. Gare à la réaction inévitable. Si elle
proportionnée aux folies de ces rêveurs elle sera effrayante.
En
attendant nous en serons les premières victimes. La masse
allemande libérée du front de l'Est va revenir sur nous plus
arrogante et plus outillée que jamais.
Ensuite,
c'est la consolidation du pouvoir prussien sur la MittelEuropa.
C'est l'avortement des germes de révolution qui pouvaient se
trouver dans les cœurs las et clairvoyants d'Allemagne. Le
peuple allemand a un patriotisme trop éclairé, trop bien manœuvré
pour commettre la folie d'imiter ces fous qui tuent leur patrie
par lâcheté et idéologie. Il y a une autre conséquence plus
grave et plus inquiétante encore que je découvre dans les
réflexions de mes poilus à l'annonce du coup de force des
maximalistes : - Y a bon ! Voilà encore un coup qui fera
marcher les choses. La paix n'est pas loin, va ! Les Russes en
ont "marre". Ils ont raison. Si nous n'étions pas des
c… nous en ferions autant… c'est le seul moyen d'en finir.
-
Et je rapproche ces propos de cette expression de fatigue
entendue l'autre jour :
-
Je n'en puis plus. Il y a trop longtemps que je fais le c… Et
pour qui ? Pourquoi ? J'aime mieux être Boche vivant que
Français tué.
-
Et d'un caporal chuchotant ceci dans la nuit à un autre :
-
Je "leur" donnerais tout ce qu'ils voudront, la
Belgique, l'Alsace, pourvu qu'ils nous foutent la paix ! Il y a
trop longtemps que cette vie-là dure. Je me fous d'être Boche
plutôt que de vivre comme un chien.
Ces
inepties se répètent, sans grande volonté d'action. Ceux qui
les disent sont des soldats éprouvés, mais naïfs, ignorants
qui ne comprennent plus. Mais à se répéter ainsi à propos de
rien elles minent les volontés, la discipline.
Et
j'ai grand peur qu'un jour de tangage, l'armature craque et ne
fasse comme l'italienne.
Visite
à M. Maugras, rencontré avec le sergent Galliot de Dôle, un
révolté, un violent atterré de la mort lente de la France.
"Pays
pourri ! Pays foutu qui ne trouve pas une tête pour s'indigner
de cette anarchie ! Je veux me faire Papou ! Après la guerre
!"
Il
attribue toute notre lente défaite qui se prolonge à la
bêtise du Commandement :
Ils
sont cons, cons, cons, recons ! Hurlait-il à Maugras.
Ils
n'ont su ni prévoir, ni profiter des circonstances.
Le
11 novembre - Verdun.
C'est
aujourd'hui la St-Martin. La fête à Verne !…
J'ai
fait pour cette fête une lessive morale. Confession au père
Cannel, communion à l'église trouée par les obus à
St-Victor.
Misere
mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam… (Aie pitié
de moi, mon Dieu, dans ta grande miséricorde)...
Le
12 novembre - La nuit dernière,
travail à la cote du Talou.
Montée
en péniche. Nuit claire. Quelques obus. Thé à Bras. Retour
par le "Tacot".
Sommeil
de plomb toute la matinée.
Cet
après-midi, je suis allé au cimetière situé à l'extrémité
S.E. du faubourg Pavé à la recherche de la tombe d'Octave.
Sous-lieutenant Girard, 60ème de ligne - sur une
pauvre petite croix faite de deux lattes et plantée sur un
tertre étroit entre beaucoup d'autres. Et c'est tout ce qui en
reste.
Pauvre
Octave ! Quelle vie courageuse et propre et fière tu avais eue,
sans autre satisfaction que celle de ce fatal galon d'or !
Je
te demande pardon du mal que j'ai eu la tentation un jour de te
faire. Je te remercie du soutien que tu avais donné à mes
débuts. Repose en paix en m'attendant.
Ce
soir, j'ai écrit à Berthe… et lui ai envoyé une pensée
cueillie sur la tombe.
Le
13 novembre - Prise d'armes pour
remise de décorations.
Le
Colonel se montre sans distinction ni physique ni morale. Un
âme de toutou près du Général Segonne .
Une vulgarité de tambour dans les gestes et les discours. .
Une vulgarité de tambour dans les gestes et les discours.
Le
Général a demandé à mon petit Brunel :
-
Es-tu fatigué ?
-
Non, mon Général.
-
Bien vrai ?
-
Non, mon Général.
Et
après l'éloignement du Général tous les voisins qui
fulminent :
Con
! con, con ! Si ç'avait été moi, va… je lui aurais répondu
au général.
Et
le pauvre petit affolé de ces traits qui se concentraient sur
lui regardait de tous côtés cherchant un regard approbateur et
bégayait :
"A
ma place, tu aurais dit comme moi". Et moi intervenant je
le délivrai par un : "Silence ! Assez dit".
Lettre
de Louis rentré aux P.P.
Bruits
d'attaque prochaine. Le gros point d'interrogation du sort se
dresse. Et sans que je puisse les empêcher de se dresser en
travers de ma pensée, se lèvent dans mon esprit des sortes de
reproches sur mon attitude :
Ma
lâcheté me murmure :
"Hein,
si tu y restes, tu l'auras bien cherché !"
Que
deviendront tes frères et tes sœurs quand tu seras tué ? Ton
frère Henri, ta sœur Augusta ? Ils ont besoin de toi. Tu as
charge d'âmes. Tu n'as pas le droit de les abandonner. Ton
devoir n'est pas de rester dans l'infanterie meurtrière…
Puisque tu as le droit d'être à l'abri, profites-en".
Et
du monde extérieur viennent des encouragements à ces
insidieuses suggestions. C'est le sergent Galliot qui me cite
l'exemple du Seguin de Dôle.
Il
était dans l'infanterie territoriale. Il est passé aux C.O.A.
Je ne sais pas comment cela se fait, dit-il avec un sourire
malicieux. Car il le sait aussi bien que moi. Il sait que les
Seguin ne sont pas affiliés aux loges pour ne pas s'en servir.
Ils ont l'échine souple et la pudeur sous les genoux.
-
C'est l'adjudant Dornier qui a fait une demande de sursis -
demande refusée.
Mais
ajoute-t-il, je veux en avoir le cœur net, j'écris au Chef de
Cabinet du Ministre de l'Instruction Publique.
-
Alors vous voulez déserter le Bataillon, lui demandé-je.
-
Oh ! Oui alors, si je peux. Je m'en fous qu'on m'appelle
embusqué…
Je
n'ai trouvé que Maugras qui soit de ceux qui estiment devoir
rester, et rester surtout à présent que les cœurs faibles
s'effraient des menaces de la situation.
Rappelle-toi
ta promesse à toi-même. Tu dois rester pour te réhabiliter
envers toi-même - pour expier tes lâchetés envers ton idéal.
Sursum Corda.
Verdun.
Soirée
exquise. Dans un appartement abandonné un feu pacifique
flamboie dans la cheminée. Bourdiaux et Goueytes (?) font
de la musique, Lagneau dessine, je lis "l'Âme des Choses ",
Bretzner nous fait du thé - chacun de temps en temps interrompt
son plaisir favori pour goûter la mollesse des fauteuils, la
douceur de l'atmosphère, écouter la cordialité, la paix et la
joie qui chante dans l'air, en cette ville dévastée… ",
Bretzner nous fait du thé - chacun de temps en temps interrompt
son plaisir favori pour goûter la mollesse des fauteuils, la
douceur de l'atmosphère, écouter la cordialité, la paix et la
joie qui chante dans l'air, en cette ville dévastée…
Le
14 novembre - Le "Pays"
publie une émouvante lettre de Caillaux à Barrès :
J'en
suis bouleversé. La clarté, la sincérité, l'éloquence qui
ruissellent de cette protestation contre une âpre lutte menée
par un autre écrivain non moins éloquent et que je crois
également sincère et plus patriote me jettent dans un grand
trouble.
Depuis
la tension de 1911 où j'avais lu si souvent dans les journaux
allemands l'éloge dithyrambique de Caillaux et la haineuse
appréciation de "Barrès und sa clique", mon cœur
avait choisi. Instinctivement j'avais Caillaux en défiance,
Barrès en confiance.
Et
quand ces temps derniers l'Écho de Paris, par la grande voix de
Barrès, et l'Homme Enchaîné par l'âpre virulence de
Clémenceau dénoncèrent des menées antipatriotiques de Herr
Caillaux, mon opinion était établie déjà.
A
la lecture de cette lettre où frémit un patriotisme
indéniable, où retentit un véritable cri d'angoisse devant
l'abîme où "des aveugles conduisent des fous" et où
va sombrer la Patrie en danger, je ne sais plus…
Mon
Dieu, est-ce possible que des hommes d'une si haute intelligence
puissent perdre la France par esprit de parti. Car ici, c'est ou
Barrès ou Caillaux qui perd la France. Et ce qu'il y a de
tragique c'est qu'on ne sait pas lequel, et que c'est peut-être
celui qui revendiquait pour son compte le patriotisme le plus
ardent et plus pur qui est le plus sectaire et le plus aveugle.
On
aveugle la nation par des calomnies.
Que
veut-on donc en faire ? Où veut-on nous précipiter ?
Le
ministère Painlevé est en bas .
On devine deux meutes hargneuses se précipitant sur la proie à
s'entr'arracher. .
On devine deux meutes hargneuses se précipitant sur la proie à
s'entr'arracher.
Le
15 novembre - Verdun.
A
mon frère Henri.
Donc
tu m'as écrit une lettre pleine des confidences que tu n'as pas
su ou pu me faire quand j'étais tout près de toi… Je suis
heureux de ta confiance que je croyais effarouchée. Tu es si
longtemps resté silencieux que j'avais peur…
Je
suis ennuyé aussi de ne pouvoir te répondre directement.
Donc
tu continues à ruminer un projet de désertion. Car c'est
déserter que de quitter la terre, le village, la maison, nos sœurs.
Tu ne parviens pas à découvrir les avantages de cette vie
rurale. Tu n'en vois que les inconvénients et les laideurs.
Tu
cherches vers la ville un coin tranquille, où tes infirmité ne
seraient pas heurtées.
Je
comprends bien ta situation, va, tout ce qu'elle a de pénible,
d'inquiétant. Mais je crois que tu fais fausse route. Avec ton
instruction, tu ne peux pas obtenir une place privilégiée ; il
ne te serait accordé qu'une situation de manœuvre où il faut
gagner sa vie avec ses muscles et des sens en bon état : or
c'est ce que tu ne peux espérer, hélas. Et puis tu es mal
armé pour te défendre dans une administration, une grande
maison où chaque employé est l'adversaire des autres et la
victime rebelle de maîtres souvent anonymes.
Pour
ton corps, pour ton cœur, pour ton esprit, il faut un entourage
bienveillant fraternel - et tu ne l'auras pas en ville - ou une
situation indépendante et tu ne peux pas la trouver en ville,
tu es trop pauvre aussi et trop désarmé pour la créer
toi-même.
Si
je reste vivant, après la guerre, oui auprès de moi tu
pourrais avec mon soutien et ma présence trouver et garder un
coin paisible, mais si tu vas seul, tu feras ton malheur.
Je
ne vois qu'un moyen de te tirer d'affaire : c'est de te créer
une situation indépendante au village. La culture est trop
compliquée pour toi, je suis de ton avis, mais ne vois-tu pas
que les artisans vont manquer au village et que ceux qui
resteront sont, seront des hommes précieux. Tu es assez adroit
et assez jeune encore je crois pour apprendre le charronnage ou
le métier de maréchal-ferrant ou de bourrelier.
Dès
que la guerre sera finie, fais les frais d'un apprentissage -
c'est là me semble-t-il qu'est pour toi la façon de gagner ta
vie avec les moyens dont tu disposes, et d'avoir la vie libre,
indépendante que ton caractère espère, attend, et sans
laquelle tu souffrirais beaucoup et longtemps.
Réfléchis
bien… C'est après avoir tout pesé et écouté mon affection
pour toi que j'adopte pour te le conseiller ce projet d'avenir…
De
Louis :
"Tes
révoltantes contradictions se font sentir comme un besoin
lorsqu'elles ne sont plus qu'un souvenir".
Le
16 novembre - Verdun.
Nous
montons en ligne ce soir. Je serai à l'ancien petit poste
humide et boueux.
Courage.
Le printemps se prépare avec les tourmentes de l'hiver, la
résurrection avec les angoisses du Calvaire.
Le
18 novembre - Tranchée de Tacul.
Les
artilleurs échangent des politesses par-dessus nos têtes.
Comme les explosions ne sont pas tout à fait proches cela me
laisse assez indifférent pour pouvoir penser à beaucoup de
sujets qui passent dans mon esprit au hasard comme passent les
nuages devant la lune.
Voici
le cortège de mes affections. Je vais de Verne à Krems, de
Besançon à Montferrand. Puis les inquiétudes vêtues de
sombre, qui viennent de Russie, font halte en Italie, et
refluent dans Paris où elles tourbillonnent confusément.
Clémenceau
président du Conseil au grand effroi de beaucoup de gens. Pour
faire pièce à Caillaux et aux socialistes germanophiles
Poincaré a dû se résigner à caresser le Tigre qui lui a
servi déjà tant de coups de griffes…
Plus
haut que les rivalités de personnes, c'est deux politiques,
deux philosophies qui se heurtent.
Avec
l'ex-communard Clemenceau devenu avec l'âge un autoritaire et un patriote entêté, c'est
la politique de sentiment spontané de la race qui resserre la
barre. L'hostilité instinctive de l'idéaliste race française
contre la brutalité pratique et avisée de l'Allemand. La folie
héroïque de la jeunesse contre le calcul prudent des
arrivistes et des fatigués. Clémenceau est
"jusqu'au-boutiste" à un plus haut degré peut-être
que Poincaré et Barrès. Les victoire allemandes aidant, c'est
la continuation acharnée et obstinée de la guerre, jusqu'à
l'effondrement de la France s'il le faut ! Pourvu que l'âme de
la race soit sauvée et triomphante. Il veut la victoire
française.
devenu avec l'âge un autoritaire et un patriote entêté, c'est
la politique de sentiment spontané de la race qui resserre la
barre. L'hostilité instinctive de l'idéaliste race française
contre la brutalité pratique et avisée de l'Allemand. La folie
héroïque de la jeunesse contre le calcul prudent des
arrivistes et des fatigués. Clémenceau est
"jusqu'au-boutiste" à un plus haut degré peut-être
que Poincaré et Barrès. Les victoire allemandes aidant, c'est
la continuation acharnée et obstinée de la guerre, jusqu'à
l'effondrement de la France s'il le faut ! Pourvu que l'âme de
la race soit sauvée et triomphante. Il veut la victoire
française.
Avec
Caillaux et les socialistes on poursuit "la victoire du
droit". C'est plus vague et cela prête mieux à
l'accommodement.
Car
c'est une politique d'accommodement avec l'Allemagne que veulent
ceux qui prétendent monopoliser l'esprit démocratique.
Ils
soutiennent qu'un rapprochement avec l'Allemagne aurait été
moins désastreux pour la France que la lutte ouverte, la lutte
à mort qui est engagée.
Quand
on songe à nos désastres, à nos deuils, à nos ruines, à nos
sacrifices, et à ceux que l'avenir promet et impose,
sincèrement on est ébranlé… Ceux-ci sont des sages. Mais
c'est une question toujours controversée de savoir si la folie
des idéalistes, le mépris des avantages matériels ne vaut pas
mieux que la sagesse des profits immédiats.
Problème
de la vertu héroïque et maltraitée en opposition avec celui
du bon sens pratique. Don Quichotte et Sancho Pança.
La
douleur sanctifiante, et la prospérité déprimante.
Pour
l'instant, la France continue avec Clémenceau à prendre du
fiel, régime de l'huile de foie de morue… Combien de temps le
parti des avides, des sacrifiés et des fatigués le
tolérera-t-il ? Fera-t-il renier à la France douloureuse son
idéal séculaire ?
Et
c'est une étrange chose que mon esprit pèse et soupèse, ces
questions de principe quand mon corps est au supplice.
J'oublie
que j'ai l'air d'un monstre fabuleux avec ma peau de mouton
souillée de boue ; je ne sens pas que mes pieds baignent dans
l'eau et que l'humidité a imprégné mes chaussures, mes
chaussettes, mes chairs. Je ne tiens pas compte que je viens sur
un caillebotis dans un coin de fossé dissimulé aux vues de
l'ennemi de courir pendant une demi-heure comme un fou
emprisonné pour rappeler un peu de sang dans mes orteils
figés.
Je
ne songe pas que ceux qui écrivent, qui pensent ne sont pas
accroupis comme des rats au fond d'un trou.
Et
je ne fais pas attention à la mort qui passe et qui fauche tout
autour de moi et va peut-être venir me faire signe de quitter
toutes ces vaines pensées.
Scènes
fugitives.
La
Compagnie était rassemblée en ligne sur un trottoir d'une rue
de Verdun, prête à partir au coup de sifflet du Capitaine. La
1ère section fait à droite et se met en marche. Le
sergent-major qui a l'avantage de rester passe auprès des
camarades et leur donne une cordiale poignée de main avec un
"bonne chance, au revoir". En réplique la 1ère
section qui s'éloigne fait avec l'accent haineux et grossier du
faubourg parisien un "au revoir, embusqué".
C'est
la mauvaise tête de la section, le soldat Conerardy dont les
pages du livret matricule sont si remplies, qui jette en partant
son crachat de syphilitique et de voyou.
Le
"Chef" dédaigne, l'injurie. Et il ne la mérite
vraiment pas, car c'est bien le plus consciencieux garçon que
j'ai rencontré parmi les sergents-majors que j'ai connu.
Au
quai d'embarquement Conerardy se fait encore remarquer. Il n'est
pas monté dans la même péniche que sa section. Le Capitaine
lui en fait la remarque :
-
Moi, je n'ai pas pu suivre. Je fais ce que je peux, je ne fais
pas ce que je veux.
-
Tais-toi, marche.
-
Je marche quand je peux.
Au
débarcadère on mange la soupe.
Après
la soupe quand le Capitaine demande si chacun est prêt, le Chef
de la 1ère section dit :
-
Mon Capitaine, Conerardy voudrait vous parler :
-
Je ne veux pas l'entendre aujourd'hui.
-
Mon Capitaine, je vous préviens que je ne peux pas suivre. J'ai
des étouffements, je ne peux pas porter mon sac.
-
Tu feras comme les camarades, tu suivras.
-
Je ne peux pas, j'ai des étouffements.
-
Quand tu veux. En tout cas tu suivras, sinon tu sais à quoi tu
t'exposes - si tu ne
rejoins pas c'est comme tu voudras, je sais ce que j'ai à
faire.
Et
Conerardy a suivi sans étouffement.
Hier
au soir la montée en ligne a été extrêmement dure. Comme il
n'a pas plu depuis quelques jours, la boue est devenue
visqueuse. Par endroits c'était un effort énorme que de s'en
arracher le long de la piste, par la nuit sombre.
A
la fin, Boulay me dit :
-
Mon adjudant, je n'en puis plus ! Et le pauvre restait collé au
sol. A la lumière d'une fusée je vis son visage hâve qui
perlait la sueur et le découragement…
-
Courage va, mon pauvre, on arrive.
A
peine arrivés une vague de gaz nous a enveloppés. Et il fallut
faire l'installation des postes le masque sur le visage, les
pieds dans la boue jusqu'au genou. Mon Dieu ! Quel long tourment
! Et cette endurance des malheureux plongés là est un
patriotisme sans phrases, mais éperdument héroïque.
Au
matin, visite du Capitaine. En face, des Boches montrent la
tête.
-
"Mais il faut tirer dessus, si ce sont des Boches. Est-ce
bien eux, ce n'est pas possible, c'est les nôtres !"
On
examine le dispositif des lignes, le Capitaine s'avance vers le
petit poste de droite, il est arrêté par la boue ; reconnaît
que les silhouettes sont bel et bien ennemies, mais reconnaît
aussi que le boyau est impraticable et que pour gagner le petit
poste il faut monter sur la piste, s'exposer au tir de l'ennemi
ou s'enliser ou s'en remettre à la bienveillance, à la
tolérance tacite des occupants de ces bourbiers. Il comprend
alors le peu d'empressement des hommes à tirer. Et lui-même,
s'il veut à présent qu'il fait jour, rentrer à son P.C. il
faut qu'il choisisse une des trois solutions.
Il
s'en va donc à travers la pampa, à la merci des balles
ennemies qui, heureusement ne partent pas… Je le voyais la
canne à la main, regardant à gauche vers les bustes allemands
émergeant de leur tranchée et qui l'accompagnaient de leurs
regards indulgents.
Ce
que la misère fait accomplir, dit en hochant la tête le
caporal Dejean.
Et
le Capitaine n'insistait plus pour qu'on tire sur les Boches…
14
heures. Je ne sais pas comment nous sommes encore vivants, pris
que nous sommes entre le bombardement conjugué des premières
lignes par les deux artilleries adverses. Les éclats arrivent
ici de tous côtés, le sol se couvre de ferraille et on ne sait
plus distinguer si elle est française ou allemande.
Cependant
les hommes sont insouciants : les uns écrivent, d'autres
croquent du chocolat, d'autres sommeillent assis dans leur
niche, d'autres chantonnent. Le caporal Bernier s'approche :
-
Regardez mon adjudant, je n'ai pas de chance, et se baissant, il
fait passer un éclat encore chaud sur sa chaussure et me montre
la déchirure que le morceau vient de faire au cuir, sans
toucher la chair.
-
Cinq centimètres plus près, j'avais la fine blessure, dit-il
en riant.
-
Ce sera pour un autre jour, lui répliquai-je en guise de
consolation badine.
Et
nous avons les pieds glacés, le ventre vide, les gaz ayant hier
au soir empêché le ravitaillement en vivres.
Le
lieutenant Etienne a été évacué, intoxiqué.
La
canonnade reprend plus furieuse, sans rime ni raison.
Tenons.
Et
tenir c'est rester là, insouciant et gai, quand même.
Le
19 novembre - Il paraît qu'hier
c'était dimanche. La journée s'est achevée comme tous les
dimanches de guerre, c'est-à-dire mal.
En
faisant l'échange des hommes du petit poste à la nuit, il y a
eu de la "pagaïe". Les Boches après cette journée
de bombardement étaient sûrement l'oreille tendue. Ils ont dû
percevoir le bruit que font nos incorrigibles grognards :
Allons,
avance donc.
Oh
! La barbe, qu'est-ce qu'ils foutent qu'ils ne dégagent pas…
Fais
donc attention, nom de D… tu me pousses dans la gadoue.
etc.…
puis les flic-floc des pieds dans l'eau et la boue, puis les
heurts des fourreaux, des bidons.
Bref,
au moment où les deux groupes se trouvaient dans le carrefour,
l'ennemi tout proche s'avança, craignant sans doute un coup de
main et lança quelques pilons dans le tas, suivis de fusées.
Personne
ne fut touché, que par le trac. Il paraît - je n'y étais pas
à cette minute - que chacun lâchait tout, fuyait.
L'aspirant
Fourquez ne songeait pas à éclairer l'obscurité avec ses
fusées.
Le
lieutenant se tenait à distance respectueuse et ne faisait
rien.
Il
paraît qu'il n'y a que Bouchart qui conservant son sang-froid
riposta à la grenade et fit rentrer les Boches dans leur
tranchée - si toutefois ils en étaient sortis - car j'ai
entendu séparément les récits du lieutenant, de l'aspirant,
du sergent, chacun a le beau rôle et crosse les autres.
J'en
conclurais volontiers que tous trois avaient perdu la tête et
que si les Boches avaient été audacieux, ils faisaient une
jolie rafle.
Le
reste de la nuit a été un supplice. Mes hommes ayant changé
d'emplacement et de dispositif étaient épars dans une
tranchée plus boueuse et plus dépourvue d'abris que la
première. La corvée de soupe étant arrivée pendant cette
relève morcelée, ils ne se retrouvaient plus pour le partage
des vivres. Les premiers servis oublient les retardataires.
Ceux-ci n'ont ni pain, ni vin. Il reste un morceau de bœuf
bouilli et du rata froids pour moi et les dernières sentinelles
ramenées sans guide, au hasard, ici.
Les
doigts gourds laissent tomber la viande dans la boue.
Les
chaussures spongieuses ont réussi à me causer des douleurs aux
pieds à chaque pas.
Je
cherche sans le trouver un coin où m'asseoir. Il faut laper ce
rata froid qui me donne des coliques tandis que je grelotte à
taper du pied sur un caillebotis.
Je
voudrais m'orienter, savoir où sont mes emplacements de combat,
avoir sous la main des grenades, des fusées pour être prêt en
cas de surprise. Je ne trouve rien, et le sergent transi qui a
pris les consignes à ma place ne sait rien. Et les pieds me
font mal, mal. Et je grelotte.
-
Tenez, prenez donc une niôle pour vous refaire un peu, me dit
Bouchart.
J'en
ai besoin aussi. En effet, il s'est mis en devoir d'épuiser
l'eau qui à envahi une sape. Il pompe. Il pompe courageusement,
obstinément :
"Quand
elle sera vide, nous aurons un coin où nous mettre
m'explique-t-il, on pourra se mettre là nous deux avec au moins
quatre bonhommes… "on sera haut le pett".
Il
conserve sa bonne humeur malgré la misère de cette nuit où il
barbotte à tâtons dans la vase, transi, dégouttant et
dégoûtant.
Puis
il me répète son indignation contre la frousse de ses
grenadiers pendant la relève :
Ah
! Si j'avais eu Gras et Beaubert et Bouscatel, ça ne se serait
pas passé comme cela. Ce n'est pas eux qui m'auraient
abandonné, lâché. Cette escouade-ci, elle ne vaut pas un pet
de lapin. Ce sont des cochons ! M'avoir laissé seul dans le
petit poste en face des Boches ! Je n'oublierai pas cela. Ah !
Non ! Ah ! Non !
Et
il se remet à pomper.
La
tranchée occupée est prise d'enfilade par l'ennemi. Elle est
exposée aux vues de tous côtés. Interdiction de se monter
durant le jour.
Donc
depuis le petit jour ce matin je suis contre la paroi de la
tranchée, assis sur une caisse vide et abrité par une toile de
tente. Mais dès le jour les 150 ont commencé à pleuvoir.
Tantôt sur un rythme lent tantôt par rafales courroucées.
Un
avion est venu déjà deux fois régler le tir qui n'a pas
cessé, et la nuit vient.
Je
suis étonné que nul ne soit touché encore. C'est
extraordinaire que nous ayons tous échappé aux éclats. Mais,
hélas, il ne faut pas encore se réjouir. La pluie de ferraille
continue… Nous attendons.
Fiat
voluntas tua. Per crucem ad lucem (Par la croix vers la
lumière).
Le
20 novembre - Le bombardement
s'est poursuivi avec une inlassable férocité jusqu'à ce que
la nuit enveloppe de brume les collines torturées.
Ma
section n'a pas de pertes. Celle qui m'a remplacé au petit
poste hier à un tué et quatre blessés par un des
"pigeons". Les soldats nomment ainsi une grenade à
ailettes projetée par un appareil silencieux. Elle arrive
sournoisement en faisant un ff, ff, ff analogue à celui du vol
des ramiers.
Elle
éclate en touchant le sol et les éclats en sont fort
dangereux. Ainsi hier, une douzaine de "pigeons" nous
ont fait plus de mal que le coûteux et énorme bombardement
avec des gros obus.
Coup
de chance sans doute, mais c'est fréquemment le cas.
Le
lieutenant Loisillon, chef de la section du régiment qui est en
liaison à ma droite, me donne des nouvelles et l'adresse de
Gaussot.
A
la tempête d'hier succède un calme non moins extraordinaire.
Presque pas un seul coup de canon. Il est vrai que le vent
d'ouest a tissé une brume épaisse devant (?) les yeux
des observateurs d'artillerie.
Ce
n'est pas sans un soupir de soulagement mêlé de surprise que
nous le savourons ce calme bienvenu et éphémère après la
séance d'hier, après les misères de la nuit froide et sombre
il n'est pas à dédaigner.
Quelques
hommes comme Nozière, claquent des dents, ont la tremblote et
peut-être des coliques chaque fois que le hurlement sinistre
d'un gros obus approche. Et hier ce fut plusieurs centaines de
fois.
Lui
et ses semblables sont évidemment sur les dents, émaciés,
hâves…
Même
les plus indifférents à la menace de l'obus éprouvent à la
fin une sorte de lourde fatigue comme si tout ce bruit et cette
ferraille écrabouillée s'entassait sur leurs muscles. Et les
nerfs prennent peu à peu une tension qui lasse.
J'ai
surpris dans une de mes rondes de nuit Cazenale, le F.M. et son
pourvoyeur tous deux endormis dans leur guitoune ayant
abandonné leur arme sur le parapet.
J'avais
déjà quelques indications peu avantageuses sur leur moralité.
Je suis fixé à présent.
Je
devrais les punir impitoyablement. Mais, pour une première fois
l'indulgence me maîtrise. Lâchement je les charge d'une menace
au lieu d'une punition pour abandon de poste.
Il
serait peut-être inique, en tout cas inhumain d'être aussi
sévère que le code. Ils ne perdent rien pour attendre.
J'entendrai désormais, d'une autre oreille les propos obscènes
de Cazenale qui semble avoir, à vingt-deux ans, un passé de
souteneur - déjà, hélas. J'entendrai d'une autre oreille
encore les propos défaitistes, antipatriotes qu'il sème à
l'occasion dans l'esprit de ses camarades.
Qu'un
brave rouspète et maudisse la guerre, appelle la paix même à
tout prix dans des accès de mauvaise humeur ou de dépression,
cela passe, cela s'accepte, car il fait par ses actes et son
attitude une autre propagande plus efficace et qui neutralise et
au-delà, le propos en l'air.
Mais
un homme capable de flancher, il était de la
"pagaïe" du petit poste avant-hier, capable de
quitter son poste de guet avec une indifférence pareille, non,
il ne lui est pas permis de décourager par ses bavardages les
camarades plus fermes et plus sains.
Il
est reconnu que ce sont toujours ceux-là cependant qui, à
l'arrière détiennent le crachoir.
Rarement
un "fort en gueule" a le cœur aussi ferme que la
langue assurée.
Les
silencieux ne sont pas tous des poules mouillées ou des
imbéciles.
Dubourdieu
a agrandi et consolidé mon alvéole de sorte qu'elle est
devenue une petite cagna où je peux recevoir le sergent
Bouchart, y être abrité du vent, allumer un réchaud, une
bougie.
Nous
jouissons comme des enfants heureux de ce nouveau
"palais" à la Jeannot Lapin.
Le
21 novembre - Abri du Talou, où
nos sommes descendus la nuit dernière. Abri profond - sûr -
confortable où il aurait fait bon si le Commandement avec ses
ordres et contre-ordres ne gâtait jusqu'aux moindres parcelles
de notre rare bonheur - car c'en est un d'être ici quand on
descend de "là-haut".
Oui,
après avoir affecté à la Compagnie trois abris, quand les
hommes y sont bien installés on a la malencontreuse et tardive
décision d'en attribuer un à une Compagnie de mitrailleuses.
Il faut nous resserrer, nous entasser dans deux.
Tous
les hommes avaient une couchette la nuit dernière et y
comptaient. Cette nuit une partie doit céder sa couchette à un
"embusqué" (car pour le fantassin des Compagnies le
mitrailleur des C.M. est un "embusqué") et coucher
sur le sol - ou dans un escalier - et bousculer toute la
Compagnie. Aussi, cris, jurons, malédictions, menaces vont bon
train - "ceux qui commandent sont des salauds".
Je
leur dis que si on les avait laissés quatre jours de plus à
Weimar, comme c'est le cas d'autres Compagnies, personne ne les
aurait dérangés, mais en seraient-ils mieux ? Cela les apaise.
Lettre
de Louis, d'un Louis tendre et doux !
Nouveau
lieutenant à la Compagnie, M. Ducombeau, ex-officier de
renseignements du 417ème.
Il
doit être un fameux guerrier inspirant confiance aux poilus :
l'aspirant qui lui a passé les consignes me rapporte que ce bel
officier élégant ne sait pas se servir du pistolet
lance-fusées !…
Le
22 novembre - La déclaration de
Clemenceau est un acte de foi en la France immortelle. Déclaration
ministérielle pas banale.
est un acte de foi en la France immortelle. Déclaration
ministérielle pas banale.
Un
acte de foi, un acte d'amour, un acte d'espérance… et quelque
chose de viril, d'indomptable énergie.
Est-ce
que les socialistes infatués et encombrants vont mettre des
bâtons dans les roues et faire verser le char de guerre au
premier tournant ? Ils ont tout l'air de se proposer le
sacrifice de la France dans l'intérêt de leur parti - du parti
des embusqués. Il ne faut pas se le dissimuler, renverser
Clémenceau à bref délai c'est imposer la démission de
Poincaré, donner tout le pouvoir gouvernemental aux
socialistes, flotter, débrider les instincts à courte vue des
foules lasses, faire croire aux simples à une paix prochaine et
commode, désagréger les volontés, détendre les énergies et
par suite assurer le triomphe germanique.
Ils
(les socialistes) ont beau donner l'assurance qu'ils veulent
rabattre le militarisme prussien, on sent que c'est chez eux une
préoccupation secondaire. L'intérêt de classe passe au
premier plan - la France ensuite.
C'est
dommage, ils ont de l'étoffe, de l'énergie, de la jeunesse
dans leur parti d'avenir. Des sophismes et des illusions aussi
hélas.
Le
22 novembre - Abri du Talou.
Journée
claire. C'est une catastrophe pour de pauvres batteries voisines
qui se sont fait repérer et qui reçoivent une formidable
avalanche d'obus de gros calibre.
Une
institutrice, Mlle Brion ,
vient d'être arrêtée pour propagande défaitiste. Il ne
manquait plus que cette gaffe dont on frappera maître aliboron… ,
vient d'être arrêtée pour propagande défaitiste. Il ne
manquait plus que cette gaffe dont on frappera maître aliboron…
Le
23 novembre - Préparatifs de
départ pour Verdun.
Éclaircie.
Succès
surprenant et inattendu des Anglais qui arrivent d'un bond
devant Cambrai.
Sur
un autre front, ils vont entrer à Jérusalem. Étrange retour
de l'histoire. Et les Italiens reprennent du poil de la bête.
"Chassez
le cafard plus dangereux que le Prussien", conseille dans
une note le Général de la D.I. à ses troupes. C'est un
original essai de réconfort intellectuel pour les soldats
considérés comme citoyens intelligents.
Le
Général traite de la répercussion des affaires de Russie et
du désastre italien sur le moral des Français - portés par
leur défaut national à voir tout en noir.
-
Tiens, il ne dit pas trop de conneries le Général, ce fut la
réflexion élogieuse des barbus.
Acrostiche.
Pour Mlle
Poutignat qui voudrait savoir où je suis.
A la mémoire
de notre ami Maurice.
Songez-vous
quelquefois, durant ces jours sans nom,
A ses yeux
fulgurants où flambaient des turquoises ?
Mesurez-vous
encore l'ampleur de son beau front
Offert
hardiment en cible à la mort sournoise ?
Gardez-vous le
reflet de son ardente foi ?
Ni la peur, ni
le doute ne l'avaient troublée.
Et quand il
s'endormit pour la dernière fois
Un grand
espoir serein emplissait sa pensée.
Heureux ceux
qui sont morts les yeux illuminés !
Samogneux.
A la même.
A la mémoire
de ceux qui sont morts pendant une retraite.
Voulez-vous
avec moi, songer à ceux qui tombent
En voyant le
ciel noir et s'en vont écrasés
emplis de
l'anxiété d'un peuple qui succombe,
Doutant de
leur devoir, de leurs efforts brisés.
Un cafard a
rongé leur rêve de naguère.
Ne sont-ils
pas deux fois les vaincus de la guerre ?
Plaignons ceux
qui sont morts les yeux désespérés.
Verdun. Cote du
Talou. Abri 67. le 23/11/17.
Le
24 novembre - Verdun.
Nous
sommes redescendus cette nuit par un beau clair de lune qui a
facilité la marche, mais n'a pas raccourci la route.
Visite
à M. Maugras. Rien de saillant.
Dimanche.
Nous sommes alertés pour l'éventuelle contre-attaque
(enlèvement du Chapeau de Gendarme). C'est aujourd'hui que
l'attaque doit se déclancher. Il a plu à verse toute la nuit.
Le vent souffle avec une rage qui n'est dépassée que par celle
de la canonnade.
Et
que dirai-je encore Seigneur ? Que votre volonté s'accomplisse,
ai-je lu dans mon Imitation ce matin à l'église St-Victor.
Rencontré
Dorléac qui rentre démoralisé de permission.
Il
a subi l'influence défaitiste qui me semble se répandre dans
les milieux catholiques avec une force égale à celle qui agit
dans les milieux révolutionnaires.
"Il
serait criminel de continuer la guerre pour des buts
économiques".
C'est
"l'inutile carnage" du pape . .
Phénomène
analogue qui s'est produit dans les milieux catholiques italiens
- et concourant avec la démoralisation venue de Russie - a sa
part dans le désastre de l'Isonza.
C'est
un cruel dilemme.
Continuer
la guerre après la défection russe et s'exposer à un
désastre sans fin ou faire la paix ratifiant toutes les
brutalités des vainqueurs germaniques.
Où
est le devoir ? Où est la sagesse ?
Le
quartier où nous sommes cantonnés a été bombardé cet
après-midi à obus de gros calibre - 380 ou 305 - des morts,
des blessés.
Premières
nouvelles sur l'attaque qui serait réussie sans casse grave.
Nombreux prisonniers.
Le
26 novembre - Verdun.
Visite
à la cathédrale mutilée mais non anéantie.
La
voûte est crevée, mais l'édifice subsiste dans son ensemble.
L'autel
avec un baldaquin doré sur quatre colonnes de marbre est
intact, peut-être à cause de son mauvais goût.
L'évêché
se démolit, se dévalise lentement, comme toute la ville
d'ailleurs.
Les
soldats achèvent la destruction de la malheureuse ville.
 Pour
se chauffer ils brûlent meubles, boiseries, portes qui sont à
leur portée sans doute, d'abord ceux que les obus ont brisés,
mais à défaut, le soldat pillard, saccageur et paresseux prend
ce qu'il a sous la main. Pour
se chauffer ils brûlent meubles, boiseries, portes qui sont à
leur portée sans doute, d'abord ceux que les obus ont brisés,
mais à défaut, le soldat pillard, saccageur et paresseux prend
ce qu'il a sous la main.
Sans
doute, c'est une destruction anticipée car chaque jour les obus
abattent quelques-unes des maisons encore intactes. Et dans ce
cas, que les meubles soient en bon état ou déjà brisés,
brûlés par la troupe, la destruction est complète.
C'est
cependant un attristant spectacle que celui de ces mobiliers
abandonnés au saccage - de ces objets, quelques-uns précieux
ou de prix qui sont laissés par l'incurie du Commandement
exposés à toutes les déprédations.
Près
de la cathédrale, dans un ex-collège ou séminaire, il y a des
collections archéologiques, des statues en marbre, des tableaux
de prix, des bibliothèques à l'abandon sur lesquels s'acharne
la main des passants, l'action de la pluie, les coups des obus…
Dieu,
que cette destruction du travail sacré des générations est
triste.
Écrit
une lettre à M. Guiraud sur Clémenceau.
Le
27 novembre - Embarquement pour le
Talou.
21
heures. Abri du Talou.
L'attente
à la Galvaude. Les péniches en retard. Il fait froid.
On
casse la croûte à Bras dans l'abri des vieux territoriaux
hospitaliers.
L'aspirant
perd la liaison. Arrivée sans incident ni accident.
Le
28 novembre - Abri du Talou.
Sommeil.
Leçons d'anglais.
La
visite aux sapeurs armés de la perforeuse à air comprimé.
L'air soufflant et les tapis roulants pour les matériaux.
Ingénieuse utilisation de ceux-ci pour la construction des
"métros".
A
17 heures, arrivée des journaux. Rien de sensationnel que cette
effrontée publication des documents secrets par les léninistes
qui résolument veulent déshonorer la Russie avant de la livrer
à l'Allemagne.
Ordre
de monter en ligne dans la nuit. Mes hommes sont d'une gaîté
débordante. Ils forment des petits groupes et chantent des chœurs
à plusieurs voix comme pour se préparer à une grande fête.
Habituellement,
leur gaîté me gagne ou m'est douce parfois jusqu'à
l'attendrissement. Aujourd'hui, je ne sais pourquoi, elle
m'enveloppe comme une anxiété.
Nous
ne montons que pour quelques jours pour achever de gagner le
repos. Ma section est complète encore. Depuis le 20 octobre que
nous sommes dans cet affreux secteur, elle n'a pas eu
d'accidents, ni un mort, ni un blessé.
Et
ce soir, je ne sais pourquoi, j'ai peur devant leur belle
insouciance heureuse, de ne pas les ramener tous…
Soyez-nous
propice, ô mon Dieu.
Le
29 novembre - Samogneux . .
 Des
heures d'attente. Nous sommes arrivés par un beau clair de lune
en suivant un profond boyau creusé dans les alluvions dont les
dernières pentes portent les ruines du village. Un village
anéanti, comme il en est des centaines et des centaines. On ne
s'arrête plus, ému, devant cette destruction des choses qui
renfermaient l'héritage, le patrimoine matériel et moral de
milliers de familles. Où sont les bibelots des étagères, les
fleurs des fenêtres, les photographies pendues aux murs des
chambres, les vieux meubles de famille ? On ne songe plus à
tout cela. Les Familles sont dispersées, les choses anéanties,
notre sensibilité émoussée. Des
heures d'attente. Nous sommes arrivés par un beau clair de lune
en suivant un profond boyau creusé dans les alluvions dont les
dernières pentes portent les ruines du village. Un village
anéanti, comme il en est des centaines et des centaines. On ne
s'arrête plus, ému, devant cette destruction des choses qui
renfermaient l'héritage, le patrimoine matériel et moral de
milliers de familles. Où sont les bibelots des étagères, les
fleurs des fenêtres, les photographies pendues aux murs des
chambres, les vieux meubles de famille ? On ne songe plus à
tout cela. Les Familles sont dispersées, les choses anéanties,
notre sensibilité émoussée.
J'imagine
cependant le serrement de cœur des vieilles paysannes quand
elles viendront errer parmi ces ruines, à la recherche de leur
foyer.
Les
Boches sont à présent sur la colline en face. Ils ne sont plus
à épier à contre-pente, d'où l'attaque de dimanche les a
chassés. Ils ne paraissent pas vouloir réagir.
La
nuit a été calme. J'ai parcouru tout le secteur que je dois
occuper la nuit prochaine.
Cependant
cette mauvaise impression du départ persiste.
Elle
est renforcée par le lamentable tableau des trois cadavres
boueux déposés dans une niche sur le bord de la route par les
rafales d'artillerie qui ont blessés deux des hommes de la
Compagnie - mais pas à ma section.
J'ai
dû me fâcher pour obtenir que les langues de mes bavards se
reposent un peu, et que les voix se baissent. J'ai une équipe
incorrigible.
Nous
relèverons en première ligne après la soupe.
A
18 heures, au moment des préparatifs de départ, le Capitaine
me fait appeler :
Nous
nageons, me dit-il. La Compagnie est relevée de la première
ligne. Elle passe en soutien. Voyez le topo. Au lieu d'aller en
première ligne, vous devez occuper la tranchée que voici.
Faites reconnaître, je crois qu'il y a quelques abris.
Reconnaissance
- Déménagement.
Après
l'installation, corvée de fil de fer à fournir aux antennes
avancées.
Occasions
de visiter les fameux abris-casernes enlevés dimanche dernier.
Je
croyais que les Français avaient le privilège de la
malpropreté des abris et du gaspillage de matériel.
J'en
fais mon mea culpa. L'abri boche est un capharnaüm infect.
Équipements, effets, armes, vivres, déchets de cuisine,
papiers, tout y est, et tout a été fouillé, bouleversé par
les conquérants.
Je
rapporte un petit livre sur le fameux as aviateur von Richtofen que je lis aujourd'hui 30 dans ma sape.
que je lis aujourd'hui 30 dans ma sape.
En
attendant la relève par le 2ème mixte.
Le
30 novembre - Marthe m'a écrit
une assez vive riposte à l'article de M. Guiraud :
l'"Armature" que je lui avais envoyé.
Comme
réplique, si j'avais le temps, je pourrais puiser des idées et
des arguments dans cette pensée de Pascal :
"Toutes
nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si
différentes, selon qu'il y aura des biens éternels à espérer
ou non, qu'il est impossible de faire une démarche avec sens et
jugement, qu'en la réglant par ce point de vue, qui doit être
notre dernier objet ". ".
Le 1er
décembre 1917
Jardin-Fontaine . .
Nous
voici au complet dans une des casernes de l'ancien Verdun, du Verdun d'avant-guerre. Mes pressentiments sinistres étaient
pure imagination. Pourtant la relève a été laborieuse et
périlleuse.
Verdun d'avant-guerre. Mes pressentiments sinistres étaient
pure imagination. Pourtant la relève a été laborieuse et
périlleuse.
Au
moment où nous sortions de la tranchée pour céder la place
aux "biquots", l'ennemi à déclanché un brusque et
violent tir de barrage en profondeur sur la route de la relève.
Il mêlait savamment aux percutants et fusants, des obus à gaz
qui passaient en essaims bruissants par-dessus nos têtes, et la
vallée de la Meuse, les ravins s'emplissaient d'odeurs
délétères.
Quand
le tir se fut arrêté, nous sommes partis, les masques en
alerte. La troupe pressée aurait voulu avoir des ailes pour
quitter et franchir instantanément la zone mortelle. Mes hommes
demandèrent à l'unanimité que l'on emprunte la route exposée
aux obus et fort dangereuse mais plus directe et où l'allure
est plus rapide de préférence au boyau protecteur mais
tortueux et où la marche est forcément lente.
Ils
se pressaient comme un troupeau de moutons apeurés, tous
voulant être en tête et marcher plus vite. J'ai dû intervenir
à plusieurs reprises et énergiquement pour reformer la file,
déformer cet ordre serré et vulnérable.
On
se représente difficilement l'impatience d'une troupe relevée
à quitter le secteur. Tant qu'elle est au poste de combat, si
dangereux soit-il, elle reste ferme, l'idée de fuir ne hante
que les plus lâches et c'est une pensée inavouée ; mais dès
que les remplaçants sont là, nul ne songe à passer les
consignes, à renseigner les camarades, à bien faire la
soudure, chacun est pris d'une fièvre intense de vitesse vers
l'arrière auquel il a désormais droit. Toute seconde de retard
lui semble des minutes et si le chef de section s'attarde à
passer les consignes, l'impatience se manifeste par des murmures
:
-
Est-ce qu'on veut y pourrir ici ?
-
Eh ! Bin, est-ce qu'on part ?
-
Qu'est-ce qu'on attend ici.
-
Allons, foutons le camp.
-
On va attendre l'arrivée des marmites pour s'en aller.
-
Est-ce que vous débourrez en tête… etc.
Il
faut que les sergents usent d'énergie pour empêcher la mise en
marche sans ordre du chef.
Et
dès que celui-ci passé en tête, a dit en avant, chaque soldat
trouve le sac léger et l'allure trop lente, surtout les soirs
agités comme hier où un tir de barrage préalable annonce
d'autres "repérages" de la relève.
Nous
avons gagné Bras sans casse, ni malaises. Le vent assez vif
avait déjà dilué les gaz. Quelques passages seulement
exigèrent le masque.
Sur
la roue, des cadavres de chevaux baignant dans la boue
ensanglantée. Quelques minutes plus tard le barrage aurait fait
des victimes plus nombreuses.
Un
jour gris et froid s'insinue dans la grande salle où sont
couchés mes quarante hommes. Par les vitres cassées, par les
jointures des portes, par celles des fenêtres on sent se
glisser comme des couleuvres pressées de longues traînées de
vent glacial qui court sur les capotes et s'insinue jusqu'aux
chairs frissonnantes des dormeurs.
Brr
! On gèle ici, murmure une voix. La porte s'ouvre, le cri
traditionnel "Au jus, là-dedans" réveille tout le
monde. Et c'est une explosion de cris. Des mots spontanés
jaillissent des gorges, comme pour les réchauffer, les
réveiller. Les apostrophes habituelles sillonnent la chambrée
en tout sens, comme des balles malpropres de tennis que les
hommes se renvoient avec une animation passionnée. C'est le
chahut habituel de tous les réveils en sécurité, avec ses
cris, ses jurons, ses amicales injures, ses grossièretés
coutumières que Rabelais ou Zola auraient cueillies pour leur
collection d'expressions sales et de tableaux réalistes.
C'est
banal et monotone autant que grossier.
Chaque
matin les mêmes cris en guise de salutation.
La
conversation s'engage généralement ainsi entre copains.
Davidou
interpelle :
-
Hé ! Jacquart !
-
Quoi ? - Merde.
-
Ta gueule, con.
Ou
bien :
-
Hé, l'enfoiré, là, réveille-toi !
-
La ferme ! enculé.
-
Et ta sœur.
-
Elle est au boxon.
Ou
:
-
Eh ! Pujol ?
-
Quoi !
-
Mon cul.
-
Va donc, saligot. C'te fausse couche s'éveille pour emmerder
les autres, nom de Dieu…
Ou
:
-
Aux chiottes, Laboute !
-
Viens-y mettre, sale croupion.
-
C'est pas toi qui m'arrêterait, petit morpion.
-
Tu crois, espèce de châtré…
Puis
l'un pette, l'autre riposte, un autre tousse ou crache ou rote.
Et
quand une vingtaine de dialogues s'engagent dans cette
atmosphère sur ce ton et en ces termes choisis on peut imaginer
la suavité des réveils au milieu de ces hommes qui pourtant ne
sont pas tous des rustres.
Il
me revient à la mémoire ce cri de Pascal : "Que le cœur
de l'homme est plein d'ordure !"
!"
Il
semble, à ces minutes du réveil, que durant la nuit, les
volontés endormies, pareilles à des mains défaillantes qui
devaient maintenir élevés les cœurs, les ont laissés
s'enfoncer lentement dans une vase infecte.
Et
les premiers mouvements du réveil font dégazer ces odeurs,
produisant ces gargouillements malpropres.
Ce
n'est que peu à peu, après que le répertoire courant est
épuisé, que le besoin de rejeter bruyamment ces ordures semble
s'apaiser. Peu à peu, les conversations s'élèvent comme des
enfants malhabiles montant des escaliers difficiles. Les faits
de la veille s'évoquent, les occupations de la journée qui
commence apparaissent, semblent comme ces servantes le matin
s'interpellant d'étage en étage et penchées sur le palier
attendant et appellant les ouvriers du jour.
Ce
n'est que peu à peu que les choses sérieuses prennent la place
des jurons, des injures. Mais enfin, patiemment, j'attends
qu'elles s'installent. Les bavards se groupent par affinité
d'esprit, chacun trouve son sujet de conversation qui
n'intéresse plus que le voisin. Le ton baisse. Le silence vient
s'asseoir dans quelques coins, puis un peu partout il se
promène par toute la chambre comme un inspecteur qui fait taire
les bruits sur son passage.
Habituellement,
après le brouhaha brusque comme une fusillade qui s'étend, un
moment de silence complet vient se placer dans la salle, et s'en
va avec l'homme de jus ayant fini sa distribution. Et c'est
alors, seulement alors, que de proche en proche la contagion des
chansons reprend.
Les
hommes réchauffés, réveillés par le quart de jus, leurs
grossièretés expectorées, les voix purifiées s'essaient au
chant. Par groupes encore les chanteurs s'associent. Et dans la
salle il y a quatre ou cinq chansons différentes en même temps
parmi lesquelles se mêlent des airs sifflés, et cela forme une
harmonie délicieuse de gaîté, de jeunesse qui dissipe la
nausée du premier réveil, chasse la troupe malpropre des
jurons et des expressions goujates.
Je
savoure cette vague d'idéal qui chante et les remonte,
paresseusement étendu sur mon lit, les yeux mi-clos, tandis que
ma pensée s'en va vagabonder dans les sentiers familiers…
Et
malgré tout, ou à cause de tout cela, je m'attache à cette
vie fruste, grossière en surface, saine et belle au fond.
Hier
au soir, le long de la route, je songeais avec mépris à mes
tentations d'embuscade, je sentais comme un besoin profond de
rester ici, de remonter au danger, quelque désir comme celui de
l'eau et du linge propre lorsqu'on se sent couvert de vermine et
de crasse.
Je
ne me sentais pas la lâcheté de faire la démarche qui me
mettrait à l'abri et ferait de moi ce que les allemands nomment
un "Etappenschwein" (cochon d'embusqué).
Je
sentais que si je vaux parfois quelque chose, si je suis et veux
être un peu propre et utile, c'est ici qu'il faut rester, dans
cette dure vie dangereuse et souffrir du froid, de la fatigue,
à risquer cette carcasse, à mettre ce corps et cette âme à
la disposition de Dieu…
Le
2 décembre - Jardin-Fontaine.
Près
Verdun.
Dans
la grande caserne que l'incurie militaire laisse sans poêle ni
combustible pour abriter les malheureux qui descendent des
tranchées, nous avons passé une nuit froide. Chambres vastes,
vitres brisées, vent humide et glacé, pas de paille, quelques
matelas pour les privilégiés et les débrouillards, pour les
autres, la toile métallique… et des dents à claquer…
Le
réveil s'est fait avec des cris de basse-cour et de ménagerie.
Pujol
imite admirablement les aboiements du chien, Chollet miaule
bien. Debent pousse des cris de coq authentique, les autres se
sont mis à simuler tous les cris des animaux de la création,
à leur fantaisie. On se serait cru chez Hagenbeck ,
le marchand de fauves… Un beau chahut. Puis les chansons
tantôt grivoises, tantôt patriotiques. ,
le marchand de fauves… Un beau chahut. Puis les chansons
tantôt grivoises, tantôt patriotiques.
Dans
les journaux d'hier le premier discours du chancelier Hertling.
Discours débordant de confiance dans la valeur des généraux,
la force des troupes, l'énergie et la discipline patriotique
des populations. Discours tout retentissant des victoires
anciennes ou récentes.
Discours
menaçant pour les obstinés ennemis qui osent espérer contre
toute attente, la défaite de l'Allemagne. Discours enfin où
éclate la joie immense de la paix prochaine que la trahison
russe offre à l'Allemagne.
Je
sais nos efforts, nos impuissants efforts, je sais nos
espérances, nos soutiens, mais tout cela pèse peu à cette
heure en balance avec la triomphante masse germanique. Je ne
vois pas surtout, je n'entrevois pas la force irrésistible qui
peut renverser le fléau de la lourde balance. Et il faudrait
presque un miracle pour compenser la défection russe. Peut-on
sans folie attendre ce miracle ? Voilà que le doute revient,
que notre espérance se voile de deuil. Et la phrase de
Shakespeare revient comme un leitmotiv qui pleure en sourdine
dans les appels à la lutte quand même :
"Des
aveugles conduits par des fous".
Car
c'est folie de lutter encore si c'est pour conclure finalement
ce qu'on appelle par cruelle ironie sans doute - une paix
blanche ! Paix blanche, oui, mais de la blancheur des visages
que la mort à baisés. Paix blanche, cachant sous des voiles de
deuil d'immenses taches de sang inutile…
Pour
arriver à une "paix blanche", il aurait fallu le
martyre de ces pauvres petites nations torturées par leur
héroïsme et leur élan vers l'idéal ! Pauvre Belgique,
malheureuse Serbie, Italie meurtrie, Roumanie ulcérée, France
saignée à blanc. Toutes ces hécatombes, tous ces cadavres
d'hommes jeunes pourrissants à travers champs comme des rats
crevés ! Oh ! Non ! On en arriverait à maudire ceux qui ont
vaincu sur la Marne ! Car c'est leur succès qui aurait
prolongé et accru les sacrifices. Mieux eût valu dans ce cas,
le triomphe immédiat et complet de l'Allemagne, que ce triomphe
final sur les ruines du monde.
Pauvre
France ! Ma pauvre patrie, dans quel sanglant bourbier es-tu
enlisée ?
Voilà
où d'inconscients éteigneurs d'étoiles t'ont jetée…
Ce
soir embarquement vers Bar-le-Duc pour un repos de quelques
jours.
Le
3 décembre - Fains . .
Nous
sommes arrivés en gare de Balaycourt deux heures avant l'arrivée du train. Deux heures d'attente en
pleine voie à subir la glaciale étreinte de la bise, les pieds
battant le ballast.
deux heures avant l'arrivée du train. Deux heures d'attente en
pleine voie à subir la glaciale étreinte de la bise, les pieds
battant le ballast.
Ma
section, pour prendre la faute du commandement par le bon
côté, s'est mise à chanter, deux heures durant. Tout son
répertoire y a passé.
Le
train arrive. Wagons à bestiaux, non aménagés, ni bancs, ni
paille. Nous nous entassons ; la fumée des pipes combat mal la
froidure.
Toute
la nuit, les pieds frappent le parquet. On donne de la paille
aux bœufs qu'on expédie à la Villette…
Mais
chacun s'en fiche. Pas un homme de cœur pour veiller à
alléger la misère, à adoucir les souffrances des combattants
lorsque c'est possible.
Tous
ces indifférents, chargés de services qu'ils dirigent avec le
moindre effort, les voilà les vrais criminels contre la patrie,
les fauteurs de désordre, de sédition.
Je
l'ai dit au Capitaine, en signalant la terrible nuit endurée
par mes hommes. Deux jours sans feu, une nuit en chemin de fer
sans paille, en décembre ! Il faut qu'ils soient de bonne
composition les poilus, pour tant supporter toutes ces fautes
sans révolte, on veut les pousser à renifler, dirait-on.
-
Oui, m'a-t-il dit, il y a des fautes, de lourdes fautes de
commises.
Arrivée
à Fains. C'est un autre scandale.
Pour
cantonnement un grenier ouvert à tous vents, sans paille, sans
lits, sans table, sans brasero.
Il
y a de quoi pleurer de colère et de misère.
Mais
les soldats sont d'âme trop jeune pour pleurer. La jeunesse
surmonte tout : hier soir sur le ballast de Balaycourt ma
section s'est mise à chanter. Et les chœurs se sont succédé
dans la nuit claire durant deux heures d'attente glaciale.
Descendant
figés des wagons en gare de Bar-le-Duc, les loustics crient :
"les permissionnaires en bas. Tout le monde descend. Une
heure d'arrêt. Buffet".
Puis
nous filons à travers la ville silencieuse et déserte. Les
trottoirs sous la lune ont des reflets dorés qui n'atténuent
guère l'affreux tableau des maisons éventrées par les bombes
des avions ennemis.
Je
m'en allais songeant à André Theuriet, à ses descriptions du
Barrois, je retrouvais dans ma mémoire son petit poème des
confitures : "A la St-Jean d'Eté, les groseilles sont
mûres". La troupe me suivait en silence. Tout à coup,
l'exclamation de Bouchart : "M…! En voilà une !"
Et
du doigt, il désignait une forme noire (sur le trottoir d'en
face) qui d'avançait à notre rencontre :
"Mais
oui, une femme ! Tu parles, une gonzesse, il y a deux mois qu'on
n'en avait pas vu !"
Et
une vague de curiosité émoustillée déferla le long de la
colonne, sur le passage de cette femme, jeune ou vieille, on ne
sait, enveloppée dans un châle et qui glissait à cette heure
matinale le long de cette rue de la ville endormie.
La
troupe ne songeait plus à la froidure. Le rêve, l'espoir de
beaucoup fut traduit par un soldat qui donna cette assurance :
"Il
paraît qu'au patelin, il y a des "âmes-sœurs" en
foule".
Le
6 décembre - Fains.
J'ai
heurté une difficulté hier, et éprouvé une déception dans
mon commandement.
Pour
quelques raisons de détail que je n'avais pas à fournir, j'ai
cru devoir donner l'ordre après le rassemblement de une heure,
de faire éplucher les "patates" par toute la
Compagnie au lieu d'observer l'alternance des pelotons.
Ceux
qui, hier, avaient déjà épluché les pommes de terre
protestèrent avec une violence contagieuse. Il se forma un
groupe de récalcitrants déclarés, et l'un d'eux affirma
(Roussel) :
-
il y a trois ans et demi que j'en épluche des patates. Ce n'est
pas ceux qui arrivent, qui ont toujours été embusqués qui
nous feront marcher !…
C'était
un coup direct à mon adresse. Et j'ai dû me résigner à faire
punir Roussel.
Où
sont mes torts ?… Car ce mouvement d'insubordination de mes
meilleurs soldats ne peut être mis entièrement à leur charge.
D'abord,
ils ont été piqués par cette mesure faisant peser sur une
même section une corvée hors tour, corvée insignifiante, mais
de mauvaise réputation. Ensuite comme j'ai à cœur de ne pas
vouloir favoriser ma section au détriment des autres, et qu'il
est arrivé à quelques reprises que je la chargeais de petites
corvées supplémentaires, ils se sont imaginés que "je
voulais les avoir".
Enfin
j'ai eu surtout la maladroite et imprudente manière de ne pas
observer un tour régulier de corvées entre les hommes de la
section, mais de faire payer par une corvée supplémentaire au
lieu d'infliger une punition, les petites défaillances du
service.
Méthode
tatillonne qui pique, qui vexe, qui aigrit, qui exaspère et
surtout fait monter les têtes croyant à la persécution.
Méthode
à proscrire.
Etre
dur et juste vaut mieux qu'être indulgent et sembler partial.
Le
tort reste.
Le
6 décembre - Fains.
Départ
du Capitaine en permission. Son témoignage de satisfaction au
sergent-major.
Lettre
de félicitation au Commandant de Göys à l'occasion de
l'heureuse évasion de son frère, l'aviateur.
Lettre
à M. Baillot au sujet des projets d'enseignement post-scolaire.
Reçu
une bouleversant lettre de Marthe - une autre de Guite. Deux
lettres qui m'inclinent de plus en plus vers Marthe. Oh ! Que ne
puis-je disposer de toutes les forces de mon cœur pour hâter
l'inclination ! Patience. Espoir.
Le
7 décembre - Fains.
 La
Compagnie est de "Grand jour". J'ai le souci de
corvées à fournir à droite, à gauche, de faire relever la
garde et nettoyer les rues, d'approvisionner le Bataillon en
bois et de préparer la salle des fêtes. Le lieutenant D…
tout entiché de son Commandement de la Compagnie s'écoute
discourir et se fait écouter. Il passe une visite des
cantonnements de la Compagnie. La
Compagnie est de "Grand jour". J'ai le souci de
corvées à fournir à droite, à gauche, de faire relever la
garde et nettoyer les rues, d'approvisionner le Bataillon en
bois et de préparer la salle des fêtes. Le lieutenant D…
tout entiché de son Commandement de la Compagnie s'écoute
discourir et se fait écouter. Il passe une visite des
cantonnements de la Compagnie.
Bouchart
se faufile à la popote pour savourer en Rabelaisien une
douzaine d'huîtres arrosées de vin blanc.
L'adjudant
est appelé à hue, à dia. Pas deux minutes consécutives sans
être appelé.
Le
9 décembre - On nous a distribué
des cartes postales avec une Alsacienne à l'air bébête.
Au-dessous cette légende : "Soutenez tous l'emprunt afin
qu'elle ait moins longtemps à attendre !"
L'emprunt
a une mauvaise presse, une très mauvaise réputation, un triste
accueil parmi la troupe.
Avec
notre caractère fanfaron et frondeur, le dénigrement de
l'emprunt est systématique même chez quelques-uns qui dans
leur for intérieur sentent toutes les bonnes raisons de
souscrire et qui en fait, souscriront.
J'ai
entendu des sous-officiers dire :
"Souscrire
à l'emprunt ! Ben, nom de Dieu. Ils ont du culot ! Y a pas de
risque que je "leur" donne quelque chose. Quand ils
n'auront plus de galette, il faudra bien qu'ils s'arrêtent de
faire la guerre. Leur donner de l'argent pour qu'ils continuent
! Ah ! Non. C'est une guerre de capitalistes qui nous
trahissent. Depuis Percin jusqu'à Bolo, Malvy, tous ceux qui
nous ont menés sont des traîtres. Tous les jours c'est un
nouveau qu'on soupçonne.
Tiens,
jusqu'à cet Humbert. Ces temps derniers, les années passées,
il n'y avait de la gueule que pour lui dans les journaux. Des
canons, des munitions.
C'était
pour s'enrichir, et en plus il était payé par l'Allemagne.
Bande
de salauds ! Leur donner de l'argent c'est faire durer la guerre
! Ben, j'en ai assez, j'en ai marre de leur guerre dont nous
sommes les poires".
Les
simples soldats n'ont pas d'autres arguments, ni d'autres
expressions.
Les
paysans, je le sais par les miens, ont été mis en défiance
par toutes ces affaire de trahison qui sont des détails pour
les politiciens et d'une importance capitale dans l'esprit du
peuple ignorant et probe.
Seuls,
les rentiers et capitalistes, alléchés par l'appât d'un gros
intérêt souscriront au nouvel emprunt.
Les
souscripteurs par patriotisme seront bien rares. On leur a trop
menti précédemment. Ils on eu trop de déceptions pour avoir
conservé la foi…
Quant
à ceux qui voient par-dessus la mêlée et par-delà le
bourbier politique la grande France éternelle, on doit les
compter facilement. Leur troupe déjà petite en tous temps a
été saccagée par la bataille. Et en général ils ne sont pas
riches, ces petits propriétaires, ces bourgeois maigres, ces
humbles fonctionnaires cultivés et patriotes…
La
multitude marche comme un troupeau de mouton, tête à cul sans
voir la route ni l'horizon. "Où allons-nous ? A qui la
faute ? Elle est en haut lieu. Elle n'est pas dans le peuple.
Mais je ne veux pas, je ne peux pas désespérer de la France.
Elle
a été plus aveuglée et plus embourbée. Elle en est sortie.
La foi dans notre génie national que von Bülow nous enviait
n'est pas de celles qui disparaissent.
21
heures. Je viens de participer à la retraite aux flambeaux
comme un adolescent heureux.
Je
me baigne dans la joie exubérante, la jeunesse invincible, la
fierté ardente que ces manifestations font couler à flots sur
leur passage.
Il
fait bon retrouver ces moments là.
Le
11 décembre - Fains.
Charles
Humbert accablé sous une grave accusation de complicité et de
commerce avec l'ennemi vient de donner sa démission de
directeur du Journal.
Quelle
obsession pèse sur cette pauvre France meurtrie, martyrisée.
Sur ses plaies se répand au lieu de baume, de la pourriture !
Sur les blessures de la France paysanne, du peuple, du vrai
peuple de France, sur ses deuils, sur ses espoirs blessés,
brisés, sur ses anxiétés, il n'y coule comme baume que le pus
de ses politiciens. Qu'adviendra-t-il de cette purulence versée
sur un peuple à bout de patience et de sacrifices ?
A
bout de confiance surtout, car à qui se fier, grands dieux, à
présent ?
Humbert,
l'Humbert dénonçant le 13 juillet "le délabrement de nos
forteresses, le dénuement de nos artilleurs - et qui sait si
cette colère n'était pas une trahison ?
L'Humbert,
sénateur de la Meuse, sénateur de Verdun, clamant à tous les
coins du pays et jusqu'aux plus lointaines âmes sympathiques à
notre cause, son fameux appel : "Des canons, des munitions
!", cet Humbert là serait aussi un traître et cette
campagne aux apparences patriotiques n'était qu'une habileté
pour nous mieux livrer !…
Humbert,
vice-président de la Commission sénatoriale de l'Armée,
documenté sur toutes nos ressources, averti de tous nos
secrets, ouvrait son secrétaire à un agent de l'Allemagne, à
Bolo ! Et moyennant des millions, pour duper la galerie,
écarter les soupçons, pendant que Bolo penché sur les
dossiers prenait des notes, l'autre, par la porte entrouverte
criait à la France haletante et fervente et candide : "Des
canons, des munitions !"
Les
anciens supplices surannés repoussés par une fausse
sentimentalité devraient être remis en action devant de tels
crimes !
Je
me souviens de cette peine que m'avait causée il y a déjà de
nombreux mois, un article de Téry, insinuant que M. Ch. Humbert
n'avait peut-être pas assez perdu l'habitude du pourboire, lui,
ancien garçon de café…
Je
ne voyais là qu'une coupable jalousie sacrifiant l'intérêt
général aux basses rancunes personnelles. J'avais tort. Téry
était averti…
D'un
autre côté, il y a d'autres ébranleurs de notre résistance :
auprès de la méthode hypocrite, il y a la méthode directe des
oiseaux de malheur, ceux qui voient ou qui peignent tout en
noir, systématiquement pour lasser, décourager.
L'article
de fond hier, "du Pays" alors même qu'il dit des
choses vraies que chacun sait et sent, m'apparaît comme
criminel : il montre, en plein emprunt, l'abîme dont nous
côtoyons le bord de plus en plus près. Il sent le pêcheur
d'eau trouble, "Le Pays". Et pousser un peuple au
découragement, à la révolution n'est pas toujours une besogne
désintéressée et patriote.
(…une
ligne illisible, grattée…)
Mme
Bey m'accable d'une lettre où elle m'assure "de son
amitié dont vous n'avez que faire".
Elle
espère et attend une amnistie.
Elle
a été peinée, dit-elle. "vous ne pouvez pas comprendre
parce que vous ne savez rien de rien".
Croit-elle
savoir tout, avoir toutes les données de la catastrophe pour
comprendre, elle ?
Moi-même,
je ne comprends pas tout et je serai toute ma vie interloqué
par cet effondrement subit du chemin où je marchais…
Quelle
chute, ô mon dieu, à l'heure même où je croyais mettre le
pied sur la dernière marche de l'escalier qui me conduisait à
la vie normale, assurée, digne, et peut-être en compagnie de
la grande âme qui m'attendait, quand j'allais atteindre à la
vie (…illisible…).
Dieu
aura-t-il pitié de moi ! Et toutes ces souffrances que j'endure
et que j'offre pour l'atténuation de ma faute, pour mon
expiation, seront-elles acceptées, seront-elles salutaires et
régénératrices ?
Madame
Bey ne sait, elle non plus, rien de rien.
Et
la pauvre petite incriminée, elle non plus, ne sait pas grand
chose.
Et
la pauvre sacrifiée sait encore moins. Nul ne sait, que Dieu et
moi. Et je suis parfois épouvanté d'être tombé à ce
démenti de toute ma jeunesse s'efforçant de rester pure, de
tout mes principes les plus chers, les plus sacrés, de tout mes
espoirs.
J'avais
une première faiblesse avec Mme F. Je m'étais arraché de la
boue où j'avais hasardé mes pieds.
Et
à l'heure où je m'élançais, joyeux et fervent vers un
renouveau de ma vertu sur une route propre, j'ai pris sans m'en
apercevoir ce sentier qui m'a égaré et mené à l'impasse où
je suis.
Mme
Bey se demande si ses "taquineries ne m'ont pas été un
bien".
Oui,
celles portant sur quelques petits défauts, sur mon
pédantisme, ma vanité, ma myopie de jeune homme.
Mais
elle a donc oublié qu'elle fut un temps, la Tentatrice ?…
Elle
a oublié qu'elle m'a répété et répète :
-
"Vous devriez faire un peu la noce".
-Vous
avez besoin de vous amuser un peu, de connaître la vie avant de
vous marier.
Elle
ne sait pas que ces coups de marteau répétés avaient ruiné
ma résistance et que le jour où s'est produit la grande
désillusion, ma résistance morale s'est effondrée.
Je
suis triste d'avoir connu cette évolution inattendue. Je suis
accablé des décombres qui se sont entassés sur moi, dans ce
passage ; mais je ne puis accuser personne. La pauvre petite, si
sincère et malgré tout si pure, ne m'inspire que de
l'affection et de la pitié. Ne l'accablez pas.
Le
Lieutenant D. commande la Compagnie pendant la permission
du Capitaine Guize.
D.
est avocat à Toulouse, il a passé par les étapes de soldat de
deuxième classe, d'aspirant et de sous-lieutenant à grande
allure durant la guerre grâce à quelques bonnes
recommandations et à sa langue bien pendue.
Un
type. Un échantillon de cette nuée de phraseurs qui saoulent
de l'opium de leur phraséologie la France en guerre.
Un
homme qui se pare de mots et qui paie de mots creux les
exigences de son métier. Un homme content de lui, content de
ses phrases, content des autres qui l'écoutent ou font semblant
de l'écouter.
Au
fond convaincu que son bavardage continu révèle un grand homme
et fait œuvre utile.
Il
dicte des notes - pour la galerie. Il prescrit des exercices -
à des effectifs fictifs. Il répète des ordres déjà donnés.
Il
fait au rapport de petits speechs qu'il écoute mieux que
personne. Grands mots sur l'effort des paysans qui ont
"donné leur sang, leur or".
Sur
le Devoir de souscrire.
Sur
la discipline.
Etc.
etc. etc. Car cet homme parle sur tout sans croire à rien.
Son
âme de rhéteur desséché sue à travers la gaze de ses
phrases sans foi, sans sincérité.
Clémenceau
provoque des poursuites contre Caillaux ! C'est l'événement
sensationnel. Bravo Clémenceau. Vous êtes un Tigre ! Avoir
osé poser la greffe de la justice sur cet adversaire, aussi
fort à lui tout seul que tous les chefs des partis opposés
c'est d'un beau courage, et cela en dit long sur la lâcheté de
Painlevé, sur la puissance de ce chef de parti, sur sa force de
lutte. Dire que sa lettre, l'autre jour m'avait ébranlé !…
Le
13 décembre - Fains.
Le
sergent Cugnot vient de voir arriver sa femme à l'improviste.
Sa
joie provoque par ricochet un véritable déchirement en moi.
Ma
misérable sécheresse de célibataire abandonné, tiraillé me
fait mal.
Et
mes lèvres, quand je souffre ainsi tout au fond de moi-même se
mettent à murmurer plaintivement : Madeleine ! Madeleine !
Seigneur,
n'aurez-vous pas pitié de moi ?
Le
14 décembre - Fains.
Une
véritable fièvre d'avenir agite chaque nuit mon sommeil. Je
voudrais savoir, je voudrais espérer, je voudrais entrevoir. Et
je ne sens rien où poser ma tête pour rêver et attendre. Mon
cœur dispersé ne peut pas se ressaisir. Des fantômes pleins
de reproches m'environnent. Heureux les pur, ou les cyniques…
Le
15 décembre - Fains.
C'est
la vie des temps de paix en caserne qui reprend.
Je
fais l'adjudant de Compagnie, chien de quartier en quête de
détritus à faire enlever, de soldats de mauvaise tenue,
d'armes rouillées à faire astiquer, de corvées à prescrire,
etc. Les soldats eux, ont leur cantonnement passablement
aménagé. Ils ont touché des isolateurs, des paillasses, des
sacs à puces, des oreillers pour leur couchage. Du carton
bitumé pour s'abriter des vents coulis des greniers, des
tables, des bancs, des poêles sans charbon. Le matin, je les
rassemble pour l'exercice à 7 heures 30. j'envoie les
grenadiers s'exercer au lancement de la grenade, les
fusiliers-mitrailleurs au maniement de leurs armes, je fais
nettoyer la rue par le service de jour.
A
10 heures, rapport - soupe - patates.
A
midi et demi nouveau départ pour l'exercice. La troupe est
tenue en haleine avec plus d'activité presque que dans les
garnisons de l'Est avant la guerre.
La
différence et l'avantage c'est que la discipline est plus
indulgente, que le soldat loge chez les civils.
Nous
sommes en "popote" chez un ouvrier nommé Morel.
Les
douze sous-officiers nourrissent cette famille d'écornifleurs.
Le
père, la mère, un grand garçon, une jeune fille, une cousine,
une voisine, tout vient mordre au pain du soldat, partager nos
beeftecks, boire notre vin, s'engraisser à nos dépens
moyennant quoi nous avons le droit de nous servir de la
cuisinière, de nous asseoir à une table et d'avoir un coin
abrité.
La
famille a un fils au front, ce qui n'empêche pas le père - un
bavard de premier ordre - de se répandre en propos défaitistes
et de fulminer contre l'emprunt.
Souscrire
à l'emprunt c'est payer pour qu'on nous tue ! Pour faire durer
la guerre.
Les
Boches sont les plus forts et il n'y a qu'à le reconnaître.
Chez eux il y a des braves gens aussi, et moins de traîtres que
chez nous, etc, etc. Je me contiens, mais un de ces jours
j'éclaterai.
Le
16 décembre - Fains.
Notre
séjour à Fains, notre repos se prolongent. Est-ce que cela a
quelque rapport avec la grave menace qui pèse sur nous.
L'Allemagne
est en pourparlers de paix séparée avec une nation en pleine
anarchie, que la paix soit signée ou non, l'austro-Allemagne
est rassurée à l'est. Elle peut sans crainte prendre troupes,
mitrailleuses, canons et tout matériel sur le front russe, elle
est à l'abri d'une douloureuse surprise. Elle à l'esprit trop
pratique pour se priver des ressources mises ainsi, de façon
presque inattendue, à sa disposition.
Aussi
chacun a l'impression en France qu'il se prépare une attaque formidable à laquelle il faudra parer. J'ai idée que c'est la
suprême ruée des nations de proie qui ont projeté notre
anéantissement. Mais chacun ici a confiance sur la vanité de
l'effort, on sait que ce sera dur, mais qu'en fin de compte,
"il n'y a rien à faire". "On ne passe pas".
formidable à laquelle il faudra parer. J'ai idée que c'est la
suprême ruée des nations de proie qui ont projeté notre
anéantissement. Mais chacun ici a confiance sur la vanité de
l'effort, on sait que ce sera dur, mais qu'en fin de compte,
"il n'y a rien à faire". "On ne passe pas".
Le
17 décembre - J'ai refusé -
pour motif d'incompétence - d'être envoyé au C.I.D. comme
instructeur des élèves caporaux. Le phraseur Ducombeau ne
pouvait pas comprendre.
Le
18 décembre - Fains.
Instruction
sur la mitrailleuse allemande faite aux gradés du Bataillon par
les cadres de la C.M.
Après
la démonstration pratique, l'adjudant Motte de la 7ème
emmène au pas de gymnastique pour les réchauffer les
sous-officiers de sa Compagnie.
Il
a fait environ vingt mètres que le sous-lieutenant de la
mitraille dit avec morgue :
Vous
avez tiré, vous avez des étuis à ramasser. Il ne faudrait pas
me prendre pour votre domestique, hein, ni pour une poire. Vous
n'avez jamais vu de poires habillées comme moi.
C'est
faux, car il a des aides sous la main pour ramasser un méchant
seau d'étuis - son armurier, les conducteurs ne sont pas trop
grands seigneurs pour ce travail, mais les mitrailleurs se
croient d'un grade au-dessus des fantassins et un officier
mitrailleur, même s'il était garçon de café dans le civil
doit manifester quelque mépris envers des sergents et des
adjudants d'infanterie… Plus ils sont partis de bas, plus ils
sont de morgue et d'insolence. Celui-ci osa crier au groupe des
sous-officiers déjà parti : "Hé, la 7ème !
Avant de partir, venez ramasser vos étuis. Vous partirez
après".
Le
20 décembre - Fains.
Repas
pantagruélique ce soir.
Le
cuistot braconnier est allé faire une pêche miraculeuse… à
la grenade.
La
mère Morel nous a offert à chacun une aune de boudin.
Cris
de Bouchart : on la crève ! Je me déboutonne. Qu'est-ce qu'on
se met !
Le
21 décembre - Fains.
Préparatifs
de départ. Les canards vont leur train.
On
remonte à Verdun. On va en Haute-Alsace, l'E.M. de la D.I. est
à Baccarat. On serait envoyé en réserve des Anglais en
Flandre.
Lettre
d'Emma. Elle lui a dit : "C'est une fatalité".
Le
22 décembre - Fains.
Nous
allons quitter la 2ème Armée.
Cela
signifie pour moi une renonciation à contrecarrer le destin. Je
ne suis pas mécontent d'être délivré d'une tentation
mauvaise.
En
effet, le Capitaine interprète de l'E.M. de la 2ème
Armée est le professeur d'allemand du Lycée de Besançon, M.
Dreyfus… et un familier de Mme B. ; un juif en bonnes
relations avec le grand rabbin qui m'avait témoigné une si
encourageante sympathie - sur l'Aisne, grâce à mon copain
Collot…
Aussi,
sous l'influence de la frousse instinctive fouettée par les
menaces qui accourent de tous les points de l'horizon en ce
quatrième hiver de guerre, et qui n'est pas le dernier, par le
tiraillement de jalousie qui provient de mon versement
irrégulier dans l'infanterie, par les supplications d'Henri et
de Camille de me mettre à l'abri, par le désarroi moral qui
trouble toutes les âmes à cette heure sur la question de la
paix ou de la lutte, par tout cela, j'ai été amené à
projeter ma désertion du poste dangereux où "die dunklen
Mächte" les sombres puissances du destin m'ont amené.
Or
voilà trois mois que je me propose d'écrire au Capitaine
Dreyfus et de faire ma demande de candidat interprète : je ne
puis m'y résigner. Trois mois que je remets de jour en jour, de
semaine en semaine et toujours je recule devant la démarche.
J'ai honte de ce geste. S'en aller, s'embusquer ! Libre à
quelques-uns de dédaigner l'épithète "embusqué",
je ne puis l'accepter, la faire peser sur ma vie ; j'ai peur de
devoir rougir un jour devant mes enfants. Mes enfants ! De
quelle longue et profonde attente je dis ces deux mots qui
gouvernent ma vie et mon sort : "Mes enfants !"
En
aurai-je ? Je l'ignore, ayant brisé mon avenir, m'étant tissé
d'invisibles et redoutables liens qui paralysent mes efforts
vers la fondation d'une famille. Et puis, par mysticisme, je
crois à la vertu de la souffrance beaucoup plus qu'à la vague
idole aux pieds d'argile que les partisans de la fameuse et
fumeuse Société des Nations essaient de mettre debout ; une
idole pour laquelle quelques bons rêveurs très rares se
lèveraient. Iraient-ils jusqu'au sacrifice de leur vie ! J'en
doute. Les épreuves actuelles écrasent cet idéal trop creux
et trop vague. J'espère que leur rêve se réalisera. Il est
une étape prochaine vers la marche de l'humanité. Mais fous
sont ceux qui croient que la route sera douce désormais aux
pauvres êtres humains. "Plus près de toi, mon Dieu".
Oui, mais par la souffrance acceptée. Et puisque notre
génération a cette affreuse tâche de fonder un peu de paix
pour quelque temps, je ne veux pas me dérober, et rougir, plus
tard, si j'ai le droit de vivre encore.
Je
reste. Advienne que pourra.
Le
23 décembre - Fains.
3
heures du matin.
Tout
le monde est debout et s'équipe en chantant pour aller
s'embarquer.
Destination
inconnue. Les mieux renseignés affirment que c'est la Lorraine.
Nous verrons bien.
Je
quitte ce gros village que je n'ai pas vu. Nous y sommes restés
trois semaines. Rien ne m'y a intéressé, attaché. L'église -
gothique - mais sans âme, les aumôniers ont ânonné chaque
fois que j'y suis allé.
L'école
- sans livres - L'instituteur s'est dérobé poliment.
Les
femmes - sans pudeur - ne m'ont pas fait perdre un pas, ni une
parole.
Le
plus saillant, est l'arrière-pensée de l'hôte découverte
hier soir dans l'émotion du vin :
J'ai
honte d'être Français avec ce honteux gouvernement. Vive la
Royauté.
 Le
24 décembre - Ste-Barbe Le
24 décembre - Ste-Barbe . .
Treize
heures de voyage dans des wagons à bestiaux, presque sans
paille par un froid de loup à travers la Lorraine et nous
débarquons à Moyen. Nous devons cantonner à Ste-Barbe. Comme
personne n'a de carte, le lieutenant Ducombeau pour fixer nos
idées, nos cœurs et nos jambes nous dit que l'étape à
fournir avant de trouver un coin où on pourra se coucher est de
vingt kilomètres "au moins" ! Et nous avons fait les
vingt kilomètres, de 7 heures du soir à minuit par un beau
clair de lune, sur les bonnes routes qui enlacent les
ondulations de cette plaine lorraine.
Mais
quelle a été dure cette marche à nos pieds frigorifiés
durant toute la journée. Après chaque pause, la mise en marche
de la colonne ressemblait à une procession des habitués de la
Cour des Miracles ; les uns sautillaient, d'autres traînaient
les deux pieds, d'autres boitaient, tous avaient l'air de petits
vieux écrasés sous les sacs, affaissés, aux jambes flasques
et douloureuses. Quelques-uns sont tombés, épuisés, le ventre
creux et glacé - les repas froids des "vivres de chemin de
fer" ne réconfortent guère les pieds aux engelures
sanglantes, l'air froid, tout paralysait. Mais l'horreur de
rester étendu dans le fossé par cette bise assassine, loin de
tout abri était un puissant stimulant et chacun a fait
l'impossible pour arriver sans que nous les gradés ayons à
intervenir. La discipline des choses est la plus forte.
Il
y a eu quelques plaintes - pas trop. Marche silencieuse. Les
chants n'ont pas duré, ni stimulé l'enthousiasme figé.
Un
cri de colère de Biaggi :
"Bon
Dieu ! si seulement mon père s'était…"
"Si
jamais j'ai un fils, je l'étrangle pour qu'il n'endure pas
cette misère".
Tu
feras comme les autres, tu seras bien heureux de le bécoter,
lui réplique un voisin.
Ce
fut dur. Très dur. Moi-même je marchais sur des aiguilles
après chaque pause jusqu'à ce que la douleur soit
"échauffée".
Et
le plus triste fut la longue attente à minuit, à l'entrée du
village. Le campement n'avait pas fini la reconnaissance du
cantonnement. Naturellement, on procède toujours de la même
façon qui a quelque chose d'odieux et de cynique : les
fourriers doivent rechercher d'abord les chambres d'officiers,
les popotes, et ensuite voir les greniers de la troupe… qui
attend, l'arme au pied, en silence.
Je
me suis niché dans un tas de regain pour ma nuit. Une bonne
chaleur douce m'a endormi, tandis que des tuiles du toit tombait
comme un rideau d'air froid sur le visage. Je me suis réveillé
au matin avec le corps moite et le nez en museau de chien. Des
glaçons à la barbe, toute fatigue effacée.
J'écoutais
les poilus rappeler la souffrance de la veille.
-
Ça ne fait rien, puisque c'est pour la France, dit l'un,
ironiquement.
-
Oui, elle est propre, la France, réplique un autre. Tu peux te
crever pour Caillaux, Bolo, Malvy, Turmel, pour tous ceux qui
font faire la guerre.
-
Caillaux, Bolo, Malvy, Turmel, il n'y a pas qu'eux, va, ils sont
tous de la même bande, Briand, Barthou et les autres qui nous
trahissent et qui nous font marcher.
-
Oh y font bien de profiter de nous puisqu'on est si
"cons". Si nous ne l'étions pas tant…
-
On gueule bien, mais on marche quand même.
-
Mais à force de tirer sur la corde, elle casse, et ça pourrait
bien casser, un de ces jours. Déjà au mois de mai dernier, ça
n'allait pas si bien, il s'en est fallu de peu que ça casse
partout.
-
Oh ! Penses-tu. Il n'y a pas de risques ! Ils savent bien
comment on nous prend. Même ceux qui râlent le plus, c'est
facile de les faire marcher : avec une paquet de tabac, une
permission et un quart de pinard "Ils" les feront
tenir tant qu'ils voudront.
-
Au besoin, on ajoutera une médaille, compléta le voisin.
Et
tous les autres, en chœur, même ceux qui prédisaient que
"ça casserait" dirent :
-
C'est vrai.
Bêtise
diront les uns ; philosophie diront les autres.
Au
fond c'est l'instinct de la race qui maintient la cohésion
malgré les impatiences et les coups de gueule et les
velléités de révolte.
La
population vosgienne nous accueille à bras ouvert, comme savent
seuls le faire "les gens de l'Est".
Tous
mes hommes coucheront au grenier, puisqu'il n'y a pas de lit
pour chacun (les boches en ont brûlé la moitié) mais toutes
les chambres chauffées des habitants leur ont été ouvertes et
les tables, les couverts mis à leur disposition, comme à des
enfants de la maison.
Chaque
maison a son escouade qui s'installe. Déjà cet après-midi,
autour des tables et des fourneaux les soldats formaient cercle,
tandis que les ménagères vaquent aux travaux de la cuisine.
J'ai
vu dans une maison des soldats écrivant leurs lettres assis à
la table d'un "poêle" tandis que près de la fenêtre
trois ou quatre jeunes filles brodaient de la lingerie, et que
près du fourneau deux autres soldats, tout en se chauffant,
aidaient la mère à éplucher ses pommes de terre.
Noël
1917 - A Ste-Barbe.
Mon
camarade Faure et moi avons couché au grenier dans un de ces
lits vosgiens si douillets, matelas de feuilles mortes et un
seul drap, un plumon. Faure qui n'en avait jamais vu était tout
interloqué.
Ah
! Tu ne connais pas le lit vosgien ! Tu verras s'il est bien.
Il
était moelleux et moite. C'était doux, mais voilà que vers le
milieu de la nuit, de toutes les fentes du toit la bise à fait
pleuvoir une poudrée de neige impalpable, mais glacée. Il en
tombait sur nos nez qui durent se glisser sous la couverture, il
en tomba sur la couverture qui devint blanche, et en tomba sur
nos vêtements, dans nos chaussures.
Et
quand au réveil nous vîmes le changement du décor dans le
grenier, Faure me dit : Ah ! Je ne connaissais pas les lits
vosgiens ! Tu me la copieras celle-là. Il est épatant ton lit
vosgien. On s'y couche noir, on se lève blanc… Non, je ne
connaissais pas cela !…
Et
nous nous mîmes à rire comme des fous… amusés et
grelottants au sortir du lit.
Noël
! Messe de Noël dans un hangar aménagé en chapelle. Les
Boches ont en 1914 brûlé l'église et la moitié du village.
Le
père Cannel a fait un sermon sur le chant des anges le jour de
la Nativité : "Gloria in excelsis Deo et in terra pax
hominibus bonae voluntatis" (Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime).
Il
est terriblement inégal, cet aumônier à l'allure bizarre et
rustaude.
Il
emploie parfois de grands mots, ou des mots savants qu'il n'a
pas l'air de comprendre très bien, il a des expressions d'une
vulgarité choquante ; ainsi il a cité textuellement le cliché
des journalistes "la paix que nous voulons, c'est la paix
de la justice, la paix du Droit, et non la paix du Boche".
Par
contre, et par ailleurs, il m'a touché au coin douloureux quand
il a défini la paix selon Dieu.
"La
paix, c'est l'ordre". La paix intérieure, c'est l'ordre
dans les âmes, dans les cœurs.
Quand
donc pourrai-je faire régner cette paix, cet ordre en moi ? Ce
jour là, ce sera mon Noël, un beau Noël ! Lorsque j'aurai
fermé toutes les fissures et que j'aurai un foyer avec une
épouse, des enfants et l'affection simple et droite où règne
la paix.
Après-midi,
promenade à Baccarat en compagnie de Faure et de Toussaint. En
route, nous apprenons que Ravenet est cantonné à Baccarat.
Nous le rencontrons vite.
Il
m'a retenu à dîner. J'ai pu faire connaissance avec les
officiers de sa Compagnie.
Noté
l'intéressante personnalité du sous-lieutenant Dormoy, un type
d'officier français, de Français intelligent avec finesse et
souplesse, sans avoir l'air d'y toucher ou de le savoir, modeste
avec tact en portant sur la poitrine une croix de guerre à dix
étoiles - type à cran extraordinaire sous les apparences d'un
parisien de boulevard.
Le
26 décembre - Journée de calme.
Attente des ordres de relève. J'écris des lettres de nouvel
an.
Reçu la
lettre de M. Droz. Il a transmis la mienne au ministre, celle
où lui faisait part des négligences dont nous avions été
victimes en descendant de Verdun.
 Le
26 décembre - Glonville Le
26 décembre - Glonville . .
Départ
de Ste-Barbe à eu lieu à midi.
Traversée
de Baccarat où le Général de D.I. nous a regardés défiler…
La
Meurthe gelée en partie. La tempête de neige. Le froid vif.
Roussel ivre, tombe tous les cent pas.
 Dans
Baccarat un cycliste a cru à des gamins. Dans
Baccarat un cycliste a cru à des gamins.
-
Hé, là-bas ! Serrez-vous les gosses !
Et
eux, sur un ton hautain :
On
est pas des gosses ! On est des hommes !
Le
28 décembre - Miniéville . .
Une
douzaine de kilomètres vers le nord, et nous voici arrivés au
front, paraît-il.
Au
front ! Mais dans un secteur où, selon l'expression du
Commandant, "on ne fait pas la guerre".
Et
le premier coup d'œil nous en persuade facilement :
Le
Bataillon est en réserve. Au lieu des grottes du Chemin des
Dames, des abris du Talou, nous voici installés dans un village
intact à trois kilomètres des lignes, un village où
l'installation est plus parfaite que dans beaucoup de
cantonnements de repos, chaque soldat a sa couchette, dans des
chambres bien closes.
Les
officiers ont des lits avec des draps, les sous-officiers
"une popote", car il reste des "civils".
Après
la marche dans la neige dans la nuit froide je ne suis pas peu
ébaubi en entrant dans la maison qu'on m'indique comme étant
la "popote", et d'y trouver une famille avec
grand-père, grand-mère, jeune femme, jeune fille, enfants !
Et
pour me refaire les pieds, la jeune femme me fait asseoir dans
une chambrette bien meublée, bien tiède et pose devant moi une
chaufferette !
De
toute la campagne, je n'avais eu une telle délicatesse !
Le
29 décembre - Miniéville.
Journée
d'installation ; journée de repos éparpillé.
Le
30 décembre - Dimanche. Repos,
mais on nous annonce pour demain du travail à exécuter sous la
direction du génie.
Après
ce tourment d'inquiétude que j'ai subi durant le repos de
Fains, je me sens l'âme épuisée, à sec. Plus rien ne
tressaille au tréfonds de mon cœur comme si l'eau riche et fraîche
où l'on puise en soi quand on a soif avait entièrement
disparu.
Je
me suis trouvé comme cela en cette terrible période de 1913
où je n'ai pas su choisir et décider ; où j'ai attendu, trop
longtemps, le réveil…
Le
30 décembre - Miniéville.
Pendant
que la Compagnie était aux travaux de défense je suis resté
au cantonnement et ai passé une paisible journée à faire un
peu d'anglais, à lire mon livre de Vandal, et surtout à
écrire une douzaine de lettres de nouvel an.
Je
me figure mal que voici encore une St-Sylvestre, une année qui
tombe dans le passé, et qu'une autre année de guerre va
commencer, va continuer.
Il
me semble que c'est hier que j'ai quitté Besançon, mes
études, mes amitiés. Et pourtant j'ai vieilli de quatre ans.
La
nouvelle année commence et ne m'effraie pas. Est-ce faute
d'imagination, confiance aveugle, obscur pressentiment ? Je ne
sais, mais il m'apparaît presque normal d'être ici dans ce
village lorrain, de monter demain par les boyaux, dans la
tranchée glaciale et meurtrière, de passer après-demain
par-dessus le parapet, de courir le revolver au poing sur des
hommes et de leur brûler la cervelle.
Qu'il
m'arrive à ce jeu dangereux un accident irréparable, non, cela
ne se représente pas à mon esprit de façon nette et
inquiétante. Je rêve de projets d'avenir.
Je
ne crois pas que la guerre finisse en 1918. je n'aperçois la
paix qu'à l'épuisement du monde vers fin 1919, et je me
suppose déjà rendu à la vie libre et utile, encore maintenu
à la vie, à la jeunesse, et prêt à entreprendre une nouvelle
tâche comme si j'avais vingt ans.
Retournerai-je
à mes bambins ; prendre en main une bonne école rurale, la
façonner à ma façon comme un artiste, entreprendre comme un
architecte de reconstruire une jeunesse dans un coin de France,
après le relâchement de la guerre, attirer les jeunes gens,
organiser une œuvre modèle d'éducation des adolescents, avec
des idées à moi que je mûris ici dans mes longues heures
d'inaction : c'est une tâche bien tentante, conforme à mon
tempérament de pédagogue, d'étudiant, à mes goûts d'effort
intellectuel et d'effort moral.
Ou
bien je ferme les yeux et je vois cette merveilleuse vallée
d'Alsace en fleurs sous le soleil d'avril, redevenue française
; j'aperçois un de ces attirants villages blotti au pied des
coteaux, entouré de vignes et de pêchers, dominé par la
forêt et les croupes neigeuses ; je me passionne à l'espoir
d'y être installé et grâce à ma connaissance de l'allemand
d'y travailler à la soudure de la jeunesse locale à la vie
française.
Ou
encore, sous l'influence de mes goûts pour la géographie, sous
celle du cafard aventureux et audacieux qui m'a toujours
tourmenté, j'évoque la vie affranchie des nouvelles cités
marocaines où j'entrevois un développement formidable de
richesses. M'en aller là-bas comme professeur d'abord
instituteur et polyglotte, puis jetant mon petit avoir dans le
commerce, appeler à l'aide mon frère Henri, préparer une
fortune, une vie indépendante et large et prospère…
Ou
laissant paresser ma fantaisie et chanter mes souvenirs
d'enfance, revenir à la maison cultiver la ferme avec Louis…
Et
sur tous ces rêves le grand point d'interrogation : quelle sera
ma compagne de vie ?…
Je
fais aussi retour en arrière. L'année s'est faite en deux
étapes. La plus dure moralement n'a pas été la dernière.
Je
ne suis pas devenu un saint, je n'ai pas su me libérer, mais le
bilan de l'année ne s'établit pas avec les sombres dettes des
années précédentes. J'ai pu mieux prier, mieux communier,
mieux tenir.
Oh
! Si 1918 pouvait me donner l'ordre intérieur, la sérénité,
la discipline du cœur, qu'importeraient les souffrances de la
guerre…
Le 1er
janvier 1918
Miniéville.
Après
l'explosion de gaîté, de bruyante et joyeuse humeur dont
Cugnot, le brave aux cinq étoiles a accompagné ses vœux au réveil,
le silence s'est rétabli dans la "piole" encore
sombre. Je suis resté paresseusement couché sur mon
"isolateur" et j'ai fait dans mon cœur les prières
rituelles.
Un
"De profundis" pour l'année morte, un appel à la
clémence divine : "si iniquitates observaveris, Domine,
Domine quis sustinebit ?" (Si tu gardais le souvenir des
iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourrait subsister ?).
Puis
voici le Pater pour l'avenir :
"Seigneur
que votre règne arrive" et ce sera pour les malheureux que
sont les hommes en guerre, la paix attendue, la paix espérée,
suppliée.
Une
pensée à mes affections, puis debout, un brin de toilette et
nous allons, tous les sous-officiers, souhaiter la bonne année
à notre Capitaine.
Accueil
cordial, accueil loyal avec lui.
Pour
lui, chacun de nous fera plus que son devoir. Quelles épreuves
vont nous lier plus profondément à lui dans cette année qui
commence ?
Nous
les attendons le cœur ferme.

 

(…insert
joint…)
(Feuillets
isolés à réinsérer dans le texte suivant chronologie ou à
transférer dans l'annexe).
Questions
pédagogiques et scolaires.
"Le
problème pédagogique de demain n'est pas tant d'étendre ou de
changer le savoir, d'allonger ou de modifier des programmes que
d'orienter le savoir vers la vie, de tout enseignement non en
fonction du passé, mais en fonction du présent et de l'avenir.
Jusqu'ici nous étudiions pour savoir, au lieu d'étudier pour
mieux vivre". E. et V. 1. Crouzet . .
Rechercher
modifications des programmes primaires pour se conformer à ces
vues.
"Nous
voulons un enseignement démocratique fondé sur la sélection
par le mérite".
Rechercher
accession par concours de tous les élèves intelligents à
l'enseignement qu'il sont susceptibles d'acquérir
fructueusement et élimination des grandes écoles des cancres
dorés.
Voir
dans "le Pays" du 8/12 article de Flay (?) sur
enseignement post-scolaire :
Deux
nécessités primordiales : intéresser le public à la
réforme. Préparer un personnel compétent.
C'est
par l'enseignement du travail local qu'il faudrait commencer
toute éducation nationale.
A. Thierry.
Prof. A l'E.N. de Versailles. Tué à Noulette. Carnet de
guerre. (Ollendorf).
Elie Faure .
La Sainte Face. (Crès éditeur). .
La Sainte Face. (Crès éditeur).
Ch. Wagner .
La Vie simple. Fischbacher éd. 33, rue de Seine. .
La Vie simple. Fischbacher éd. 33, rue de Seine.
Driault .
La question d'Orient. 1917 (7ème) Alcan. 108 Bd
St-Cyr. .
La question d'Orient. 1917 (7ème) Alcan. 108 Bd
St-Cyr.
Société
Bibliographique. Par G. de Grandmaison. 5 rue St-Simon.
Œuvre des
bibliothèques populaires. 73 bis rue N.D. des Champs.
Dir. M.
Bastide du Lude.
Ligue
patriotique des Françaises. 368, rue St-Honoré.
Suite de
noms et régiments.

 

 
|