|
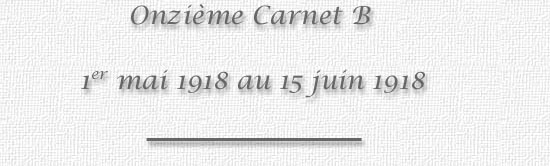
-
Vers la contre-offensive -
E.
Cœurdevey
167ème
RI. 5ème Compagnie
S.P. 191
A faire
parvenir en cas de mort à M. Fourgeot, à Montferrand. Doubs.
Mes compagnons
de lutte.
Quelques
silhouettes.
Le Commandant
de Compagnie,
Lieutenant
Droz-Bartholez.
Il
nous arrive pour la campagne active de 1918. Il vient du C.I.D
après un long séjour dans ce centre où quelques piliers
regardent défiler d'anciens combattants. Avec l'inquiétude
permanente de les suivre. La menace de départ est l'agent le
plus actif de la discipline. Ceux qui détiennent le pouvoir de
menacer y contactent des habitudes de morgue insolente et
récoltent plus de mépris que de confiance. Je crains que Droz
ne soit resté un peu longtemps au C.I.D…
Mais
patience, nous le verrons à l'œuvre. C'est un Franc-comtois un
peu massif, d'aspect lourdet et sombre : un donjon. Les hommes
l'ont déjà baptisé : le "Gros Noir" pour sa façon
écrasante et oblique d'aborder le monde - comme un
"210".
Pas
d'âge écrit sur son visage terne, des yeux profonds sans
reflet clair, l'expression du regard comme embusquée dans
d'épais sourcils en broussaille, les traits inertes, pas de
sourire, pas un mot aimable, ne manifestant aucun intérêt
marqué pour connaître ses gradés ni ses hommes, répondant
mal ou pas du tout au salut, faisant des observations sèches,
sans prendre de formes, il n'apparaît pas comme un entraîneur
d'hommes…
Attendons.
Le
26 avril - Premier exercice
commandé, dirigé par le lieutenant Droz. Bonne impression :
ordres clairs, précis, fermes, intelligents.
Le
2 mai - L'impression devient favorable.
La Compagnie reprise en main par la volonté calme et
silencieuse du chef.
Commandement
ferme. Pas de mots, des actes. Auprès du Commandant attitude
digne. Tact. A la manœuvre, calme et netteté de vues.
Les
défaillances des hommes ou des gradés relevées sans
indulgence, mais sans intempérance d'humeur ou de langage.
Le
4 mai - De la mémoire. Sait repérer
les têtes qui se sont fait remarquer en marche. Du coup d'œil.
Découvre aisément les "types" bons ou mauvais, les
"à coups" les défaillances de la fermeté. Ses
instructions aux chefs de Bataillon, ses sanctions contre les
tireurs au flanc (Valentin - Castay).
De
l'expérience du commandement en prescrivant (la)
conduite judicieuse à tenir envers les hommes.
A
été tué le 18 juillet 1918 au début de la grande attaque, en
lisière du terrible petit bois devant Corcy, au-delà de la
Savière. Trois balles de mitrailleuse dans le corps.
Le Lieutenant
Carlier.
Était
cycliste au début de la guerre. A conquis tous ses grades
successifs au 167ème, vient d'obtenir son deuxième
galon.
Il
a reçu … blessures et obtenu … citations. Il a du avoir,
avec beaucoup de chance, montré quelques capacités et une
bravoure remarquées.
Je
ne l'ai pas vu au feu. Ceux qui furent ses camarades de combat
ont des avis un peu divergents, mais il est reconnu comme étant
un de ceux qui par leur courage, leur énergie, ont brisé le
dernier et suprême effort des Allemands devant Verdun en
juillet 1916. Ce n'est pas un mince mérite.
Je
le connais mal. Il est de caractère assez difficile à
préciser, à cause de son humeur variable. Mais qui peut savoir
d'où vient le nuage fugitif qui assombrit le visage d'un
voisin, d'un chef, d'un camarade, d'un ami ?…
Le
lieutenant Carlier est originaire de Roubaix où il était
employé de commerce. Sa famille, parents, sœurs, sont restés
là-bas. Il m'a confié un jour n'avoir aucune affection
réconfortante, aucune branche où se reposer. "Je vais en
permission sans joie, parce qu'il faut y aller et se sortir un
peu d'ici", me dit-il sur le quai de la gare d'Azerailles…
Voilà de quoi produire bien des sautes d'humeur.
Cependant
sa physionomie est assez peu franche. Des yeux bleu-gris, très
froids ont des reflets mal assurés, avec des ombres de
raillerie cauteleuse. Menton énergique, beau front, corps
souple bien musclé, au total joli garçon - soigneux et
soigné.
Il
est passablement partial. Use de son autorité, de son
ancienneté pour favoriser sa section : choix des nouveaux venus
- cantonnement le meilleur - tour de service le plus facile.
Il
ne cache pas son antipathie à l'aspirant. A mon égard, presque
régulièrement aimable.
Que
fera-t-il à la prochaine bataille ? Comment se comportera-t-il
? L'ancienne attitude de ce brave est-elle un gage pour l'avenir
ou bien la dépense étant faite, il ne resterait plus que la
surface dorée de sa manche ?
Je
l'ai vu à 344. il est resté accroupi toute la journée et
toute la nuit au fond de la sape, s'est très peu préoccupé de
ses hommes. Et Quand les Boches avaient attaqué le P.P. il n'a
pas bondi avec beaucoup de hardiesse à la rescousse.
Autre
détail défavorable.
Lorsque
que le lieutenant Droz se fut défilé à l'avant-veille du coup
de main appuyé par attaque aux gaz, le lieutenant Carlier fut
chargé de la conduite de l'opération en vue. On attendait le
vent du sud. Dès que le baromètre fléchit annonçant
l'attaque prochaine, Carlier se sentit brusquement indisposé,
et … fut envoyé à l'infirmerie régimentaire. Il y resta le
temps de laisser passer l'occasion de se distinguer… Bizarre
coïncidence. Attendons…
Un
obus toxique est tombé sous la table où déjeunaient le
Commandant, le Caporal Portères et Carlier. Carlier, blessé à
l'œil, évacué. Mort de la grippe - 1918.
Après
un séjour paisible de quatre mois dans ce paisible secteur de
Lorraine, le Commandant nous accorde un repos de quelques jours
en dehors de la zone de l'extrême avant.
Les
exigences de l'heure, la valeur de notre division, le
regroupement en arrière de la ligne bombardée, le long d'une
voie ferrée, les exercices d'instruction prescrits pour la
période de repos, toutes ces indications et d'autres détails
significatifs font comprendre que notre marche de demain vers un
prochain village paisible est un acheminement vers la bataille…
Involontairement
je suis ému. A la pensée d'entrer dans la fournaise il se
produit en moi un remous que je ne maîtrise pas à volonté.
C'est plus violent que l'impression causée la première fois
par la perspective de monter au Chemin des Dames. D'où vient
donc cette angoisse physique ? Car je n'ai pas peur, puisque je
suis ici parce que je l'ai bien voulu. Peut-être est-ce que le
manque d'habitude au danger est un effroi de l'imagination ?
Le
23 avril - Nous quittons à l'aube la
bourg d'Azerailles. Brume fine que le vent dissipe. Nous
repassons à Glonville où nous avions cantonné une nuit de
décembre quand nous montions à ce secteur lorrain que nous
quittons. Le village grouille d'Américains. Ils font à 7
heures un copieux déjeuner. Ils font queue devant des
cuisiniers qui servent chacun des hommes. Distribution
individuelle différente de la nôtre qui est collective. On
distingue du riz fumant, du sucre en poudre, des confitures dans
les assiettes en aluminium, mets abondants que ces colosses
mangent avec un bel appétit, installés au hasard sur des
marche-pieds de camions, sur des timons de chariots. Toujours
l'impression puissante de ces troupes jeunes, magnifiquement
équipées.
Traversée
du gros bourg de Fontenoy où les soldats de la D.I. relevante
nous examinent : qu'ils sont propres ! Il n'y a pas de boue dans
vos tranchées, nous disent-ils…
La
route étroite. Marche en colonne par deux. Beau soleil
éclairant un fin paysage lorrain souriant de printemps. Des
collines où la silice rouge des grès forme nappe piquée des
jeunes pousses d'avoine. Boqueteaux de pins sur les sommets,
prairies et oseraies dans les vallons - Ménarmont.
Arrivée
à Xaffévillers vers 10 heures. Ma section est bien logée dans
deux fermes. Greniers propres mais sans aménagement. Dans les
rues : des Indous, des officiers anglais, des Américains.
Mauvais voisins pour nous. Pas de lait, pas d'œufs, pas de
chambres. Nous ne soutenons pas la concurrence.
Je
cherche en vain un lit. Je me résigne joyeusement à un coin de
grenier près de mes hommes. Je l'aménage cet après-midi. Une
petite cabine avec ma toile de tente, des sacs trouvés dans le
grenier. Une caisse vide me sert d'armoire, de bibliothèque, de
bureau, de table de toilette. C'est un petit home pittoresque.
Soir.
Le lieutenant visite les cantonnements. Il a pour toutes les
sections des paroles désagréables, malheureuses, maladroites,
qui font l'objet de commentaires tumultueux à la popote.
S'il
persiste dans cette attitude, il se fera rappeler qu'en ligne,
il témoignait moins d'intérêt à l'installation des hommes.
-
"Vivement qu'on aille dans la Somme ! On verra s'il fera
tant le malin", (Bouchart).
L'hôtesse
s'amuse de ma cabine qu'elle appelle un
"confessionnal".
Elle
m'offre un coin de table chez elle pour écrire.
Après
la soupe du soir, visite à un "bistro". Plus de
bière ! Tournée dans les rues. L'église a été détruite par
les Allemands en 1914 ainsi que tout le quartier avoisinant.
Nous errons dans ces ruines sacrées. Quelques-uns font des
plaisanteries d'un goût douteux. Fourquez me dit :
Vous
ne trouvez pas que cette façon de passer ici dedans a quelque
chose de choquant, de gênant ?
Nous
quittons le groupe. La cloche sonne. Je me rends à une chapelle
provisoire où des jeunes filles font en commun la prière du
soir.
J'apprécie
le contraste avec les promenades des ouvrières effrontées
d'Azerailles. Voici un coin de la vraie France éternelle, de
celle qui prépare à tous les sacrifices.
Le
24 avril - L'air humide me réveille
dans mon sac de couchage. Il pleut au petit jour. Je me blottis
pour me rendormir quand l'homme de corvée vient crier le
traditionnel : "Au jus, là d'dans !"
Les
hommes se lèvent les uns après les autres. Je les imite.
Payères m'a préparé mon eau pour ma toilette. Il pleut
toujours. Étant débarbouillé, je vais quand même faire un
tour, et rencontre l'aspirant. Nous allons déjeuner un couple
d'œufs au lard.
Désignation
d'un téléphoniste - pour le cours. C'est laborieux. Les plus
anciens refusent. Les jeunes… sont trop jeunes.
Des
vieux brisquards comme le père Than ne veulent pas être
"embusqués pour si peu".
-
"C'est la paix que je voudrais".
Pourtant
il n'ay aucune nouvelle, ni de paix, ni de départ.
10
heures. Je prends auprès de mes hommes quelques renseignements
pour compléter mon contrôle. Il y a de bonnes surprises :
Crolet, mon grand caporal F.M. a fait toute la guerre à la
Compagnie sans une blessure ni un jour de maladie.
"Le
père Than", lui, le vieux de la classe 1909, celui qui a
toujours le sourire et jamais la parole a d'étonnants états de
services. Une douzaine de combats, trois blessures.
-
Voyez, dis-je au bleuet Potier, quel est celui qui en a le plus
fait. C'est Than ! Quel est celui qui "la" ramène le
moins ?
-
C'est Than.
Quel
est celui qui se plaint le moins ? C'est lui.
Après-midi.
On nous laisse encore repos.
Je
rédige chez mes hôtes quelques notes. Je tiens à mettre mes
fiches à jour avant que nous embarquions. (Chez le Maire, M.
Demange).
Le
rassemblement de la D.I. s'opère lentement. Encore ni ordres,
ni indications des gens bien renseignés. Nous nous habituons à
la pensée d'aller "en mettre un coup". Mes hommes, me
semble-t-il ne seront pas très émus si on nous embarque pour
un des "coins durs" de la grande bataille. Ou bien
est-ce que je les juge d'après mon propre état d'âme ?
Un
symbole. La "chapelle" de la maison. Les
enfants de mes hôtes ont sur un petit meuble "leur
chapelle". C'est un petit dispositif en gradins, recouverts
d'une broderie - et où sont disposés des emblèmes religieux :
un crucifix, des statuettes de vierge, un drapeau du Sacré Cœur,
du buis béni, quelques fleurs, et pour l'illumination de petits
bouts de bougie que le gamin va récolter dans les greniers
après le départ des soldats.
Et
dire que dans ce village-ci, il n'y a plus de curé depuis la
guerre. La foi était trop vivante pour dépérir. Criminels et
fous ceux qui s'évertuent à éteindre cette flamme
moralisatrice et purifiante dans les familles françaises…
Soir.
Mes hommes ont décoré leur cantonnement avec des branches de
sapin. Cet air de fête donné au grenier a le don d'irriter
Renard qui traite durement la bonne volonté de ses camarades
avec les expressions de romanichel qu'il est. Je me contiens
pour ne pas intervenir.
Pendant
la soupe du soir, discussion sur la vertu de résistance des
peuples français et boche, sur la valeur comparée des soldats
allemands et français. Au fond, la conviction de notre
supériorité morale. Judicieuses réflexions de Perrin. A la
nuit tombante promenade hors du village. Pénibles haltes le
long de la route auprès des "Silencieux" couchés ça
et là, au hasard des balles qui les ont frappés…
Le
25 avril - La matinée a été
consacrée à la préparation et à l'attente de la visite du
Chef de Bataillon.
Quelques
hommes ont eu l'idée de décorer leur grenier de quelques
branches de sapin. Ce zèle déjà mal interprété par Lesage (?),
ne l'est guère mieux par Lacoigne, et ne semble pas compris du
Commandant de Compagnie. Il est passé sans mot dire. Le Chef de
Bataillon est plus généreux. Il trouve bonne mine et
élégance à mes poilus. Il leur promet qu'avec des Bataillons
tels que le nôtre, les Boches seront bientôt rejetés chez
eux. Dieu l'entende !
Soir,
repos. Bière et mirabelle avec les camarades préférés.
Lettres écrites, lettres reçues, heures douces.
Le
26 avril - Le Commandant de Compagnie a dirigé l'exercice.
Il laisse une impression rassurante d'homme compétent. Ordres
précis, intelligents.
Une
séance de gymnastique Hébert : c'est comme une douche de jeunesse, d'énergie, d'entrain ; le
sang court plus vite, le cœur bat mieux, le cerveau comprend
mieux la valeur de l'énergie assouplie. Mais grosse difficulté
: il est plus facile de commander à des hommes de se faire tuer
qu'à les décider à chanter.
: c'est comme une douche de jeunesse, d'énergie, d'entrain ; le
sang court plus vite, le cœur bat mieux, le cerveau comprend
mieux la valeur de l'énergie assouplie. Mais grosse difficulté
: il est plus facile de commander à des hommes de se faire tuer
qu'à les décider à chanter.
Le
26 avril - L'après-midi, je suis chargé d'apprendre aux
caporaux à se diriger à la boussole. Incroyable ignorance des
points cardinaux, mais marche intéressante à travers les
vallons semés des débris de la lutte en août 1914, coupés
des tranchées provisoires de l'époque et hélas ! peuplés de
tombes.
Visite
au château de Villers incendié.
Les
nouvelles : nouveaux assauts des Allemands devant Amiens. Ils
semblent avoir plus de peine à briser la ligne hâtivement
établie que les anciennes positions barbelées.
Deux
épisodes sensationnels : la mort du Capitaine aviateur
Richtofen, l'as des as.
Le
raid anglais contre Ostende-Zeebruge . .
Non,
la lutte n'est pas finie. L'Angleterre se raidit et prend la
température ardente de la dernière passe. Tenez-vous bien,
Messieurs les pangermanistes ; voici la réaction.
Notre
promenade du soir à un autre coin de la plaine. Encore des
tombes éparses dans les champs… Un ossuaire de quatre-vingt
onze soldats du 16ème. La couronne de la veuve au
sergent X… L'innombrable sacrifice : "Que nous sommes
petits !", me murmure Fourquez…
J'évoque
mon Maurice, Octave, Henri, mes morts. Et je songe ce soir à la
pensée : "Les morts sont des invisibles, non des absents ". ".
Le
27 avril - Xaffévillers.
Il
nous est arrivé, à nous sous-officiers de la Compagnie un
malheur en puissance ; la menace est assurément à un haut
potentiel. C'est l'envoi parmi nous d'un adjudant-chef,
"rempilé" d'active, qui a traîné sans avancement
durant quatre années de guerre ces galons de fainéant et de
cancre (du moins avec leur signification dans l'ancienne armée
active). Un camarade qui le connaît bien, et auquel
j'annonçais l'arrivée d'Auglagnoux à la Compagnie me dit :
"Mon pauvre ! C'est toi qui as ce ballot là !…"
Je
tâche d'être prudent, d'éviter les heurts, les gaffes, les
"piques" d'amour-propre, mais il n'en rate point, il
les attrape au vol. il fait l'empressé, la mouche dorée et
bourdonnante du coche, quand il n'y a rien à faire, et se
défile dès qu'il faut prendre la responsabilité de commander
une corvée…
Ce
soir, il n'a pas voulu mettre d'accord les sergents en
défaillance de camaraderie.
La
prière du soir dans la chapelle en fête a effacé toutes ces
petitesses.
Le
27 avril - Dimanche à Xaffévillers.
Joie
des bons levers tardifs sur la fatigue qu'on abandonne comme du
linge sale.
Joie
des petits déjeuners à deux copains. Un œuf acheté par ruse,
ou une boite de conserves choisie et réservée dans la cantine,
préparée à la "popote" - arrosage au vin blanc.
Douceur
divine d'une messe dans une chapelle débordante de ferveur.
Douceur
des après-midi paisibles à écrire une dizaine de lettres à
tous les oubliés, les négligés.
J'offre
à mes poilus une boite de cigare : "Oh ! fait l'un, nous
avons un adjudant comme il n'y en a pas beaucoup !"
22
heures. Douceur des soirées d'étude cueillies comme des fleurs
difficiles à trouver, dans cette vie de camp pareille à une
lande dévastée, foulée au pied.
Le
29 avril - Voir. Deux articles de M.
Guiraud dans la Croix de cette dernière dizaine d'avril.
La
bataille reprend avec rage. Double réaction dans mon âme.
Tantôt,
en considérant quels sont ces hommes qu'on sacrifie au profit
de l'égoïsme forcené ou de la dépravation honorée,
encouragée de l'arrière, c'est le sentiment de doute amer qui
me ballotte. Nous sommes de pauvres ilotes qu'on exploite, aussi
égarés, aussi niais, aussi sottement sacrifiés et exploités
que les gladiateurs à Rome disant avant l'entrée des fauves
dans l'arène "Ave César, te morituri salutant" ou
que les serviteurs et femmes des rois nègres qu'on persuade à
se brûler ou à s'enterrer à la mort d'une brute, leur maître
et idole.
Tantôt,
si je ne sens plus l'instinct en émoi, si je m'abandonne aux
plus captivantes séductions de ma pensée en prière, je ne
vois plus la mort hideuse mais libératrice, l'âme victorieuse,
triomphante dans les épreuves, le sacrifice méritoire pour la
cause des foyers propres, qui sont encore cependant le noyau de
la France pour le triomphe de la justice humaine qui ne peut
être que la volonté de mon Dieu, pour la purification de ma
vie, pour la domination victorieuse dans mon pauvre petit
domaine moral, de l'âme sur la bête…
Et
puis, comment ne pas se griser à la pensée de rester à
l'encontre de tant de déserteurs, un ouvrier de la dernière
heure ? A la perspective de se préparer une vie riche de
fierté, de mérites, de courage ?…
Le
30 avril - Manœuvre de cadres par la
pluie, sur un terrain détrempé.
La
liaison fonctionne mal.
Le 1er
mai 1918
Manœuvre
de Bataillon.
Il
fait un brouillard dense. En ce jour qu'on imagine lumineux et
fleuri, on ne voit pas à cent mètres, et tout est sombre.
Année de guerre. Mois morne.
Avant
la manœuvre, rassemblement des Commandants de Compagnie et
Chefs de Bataillon auprès du Capitaine Michel, Commandant le
Bataillon. Autour de lui les Commandants de Compagnie sont
animés de sentiments discordants.
Le
nôtre est celui qui a le plus de tact et d'adresse. Il n'a pas
d'opinion sur les vues du Commandant.
Le
Capitaine Portères se tait avec un petit sourire énigmatique.
Approuve-t-il ? Désapprouve-t-il ? On ne sait. On devine qu'il
sait qu'il devrait avoir le commandement du Bataillon et qu'il
se lave les mains, avec le sourire…
Le
lieutenant Picouret chasse les grenouilles, abat les noix. Il ne
comprend pas, parce qu'il ne peut pas comprendre, et néanmoins
tâche de comprendre.
Le
Capitaine Cléret, que je prenais pour un homme bien élevé,
plein de tact doit céder au ressentiment, à la jalousie pour
faire l'imbécile à ce point. Il feint de ne pas comprendre ;
il ne veut pas comprendre (on le devine et M. Muhel lui dit)
parce qu'il fait exprès de ne pas comprendre, pour embêter et
discréditer le Chef de Bataillon. Celui-ci se comporte en homme
calme et poli. Il fait sentir à Cléret la mauvaise volonté
qui anime ce dernier. C'est grave cette rivalité sourde,
inavouée des Commandants de Compagnie contre leur Chef de
Bataillon.
C'est
grave et c'est triste.
Soir.
Encore une visite aux Morts - que de choses ils racontent ces
guetteurs silencieux, perdus dans les cultures…
Le
2 mai - Le Commandant est venu me voir manœuvrer ma
section.
"Vous
êtes dans la bonne voie, mais habituez vos sergents et vos
caporaux à prendre plus d'initiatives. Votre troupe n'est pas
assez souple".
A
la réunion d'onze heures, il reprend ce thème et forme cette
indication qui en dit long et contredit les racontars des
communiqués et des journalistes :
"Dans
le Nord, les Allemands ont fait tomber des positions très
fortes avec très peu de monde, en combinant le feu et le
mouvement. Les Anglais ont été pris et surpris par une
poussière de Boches".
Soir.
Marche sous bois.
A
la pause j'ébaubis Bouchart en plaçant une balle de revolver
dans une "tune" à douze pas. Toute la Compagnie
passionnée au pari que je gagne deux fois de suite.
Théorie
aux caporaux qui ne connaissent pas les points cardinaux !…
Le
récit du Maire, M. Demange. Souvenirs de la Bataille d'août
1914 (au sujet de deux cadavres de soldats retrouvés hier dans
la plaine !!!…)
La
première patrouille. L'officier allemand appelle le Maire, lui
dicte une proclamation aux habitants (espoir de bon accueil,
sinon incendie et fusillade). Le Maire emmené en sabots, en
bras de chemise, huit sous en poche, les yeux bandés. La halte
sous les obus. La détention au poste de police allemand de
Ménaucourt durant dix-sept jours (faim - froid - peur).
La
retraite allemande, l'abandon des otages. Le retour au pays.
Hébétude.
Les
cadavres pourrissant dans la plaine, ordres d'enfouissement
(gendarmerie, préfet). Enfouissement sommaire, un trou près de
chaque cadavre roulé dedans, sans identification, sans honneurs…)
Le
3 mai - Xaffévillers.
Ce
matin, contre-ordre pour l'exercice. Ordre de départ très
prochain. Montage de sacs, distribution de vivres de réserve,
des munitions. Je fais ma cantine au milieu des poilus
rouspétant - par habitude. Dernier verre de vin blanc au café
voisin. La petite femme brune du débit essuie une larme quand
nous lui disons : "ne craignez rien, si le 16/7 s'en va,
c'est qu'il n'y aura rien. Gardez de nous un bon souvenir".
Le
4 mai - Giriviller.
Itinéraire
de la première étape. St-Pierremont - Magnières - Mattexey -
Giriviller au pied de la butte d'Essey. St-Pierremont et
Magnières portent les traces cruelles de la bataille avec leurs
maisons incendiées, les portes des granges, les murs criblés
de balles, les toits troués par des obus, les tombes aux abords
des routes, des haies.
Passage
de la Montagne, simple riviérette apaisée dans les prés
fleuris.
L'étape
a été laborieuse pour les gradés, pénible pour les hommes à
qui des ordres malheureux avaient coupé la bonne volonté qu'on
pouvait obtenir d'eux.
D'abord,
le matin trois ordres successifs, faute de prévision
intelligente du Bataillon obligent à faire, défaire, refaire,
redéfaire et remonter les sacs. Murmures.
Au
rassemblement quelques vestes sur la patelette du sac
déplaisent au lieutenant, ordre de cacher les vestes, de mettre
les cravates : remurmures, gestes de dépit, d'insubordination.
Castay ne bronche pas - sans cravate. Ne la met que sur
l'intervention réitérée du chef de demi-section. Aussi, dès
le "Pas" de route, il commence un discours :
-
"Ah ! Ma mère, si tu voyais ton fils. Les Boches l'ont
épargné, mais c'est les Français qui le pendront…"
A
quoi le froussard Leconte réplique :
-
"Vivement la Somme ! On les verra là-bas".
Je
dois intervenir pour faire cesser ces imbécillités.
Cent
mètres plus loin, Castay perd deux trousses de cartouches, n'en
ramasse qu'une. Il faut mon ordre formel pour qu'il aille les
ramasser toutes les deux. En montrant la côte de Mattexey, il
se met dans le fossé. Il est imité par Leconte, Dudilieu,
Thomas. C'est la rançon de l'obéissance passive obtenue dans
la mise des cravates au cou, des vestes sous la patelette.
Le
chef de Bataillon sans expérience d'une colonne en marche
irrite la nervosité générale où la mauvaise volonté charge
déjà les épaules, chauffe les têtes, tandis qu'en arrière
des sections marchent en chantant la Madelon.
Au
village accueillant, trois heures après, le pinard a reposé et
égayé tout le monde.
Le
4 mai - Giriviller.
Nous
pensions embarquer aujourd'hui. On nous laisse encore une
dernière journée de séjour en Lorraine.
C'est
une fête des yeux que le spectacle de cette nature en travail
de jeunesse et d'exubérance dans ce vallon verdoyant sous un
soleil radieux. Paysage aux contours adoucis des croupes
marneuses auxquelles les luzernes donnent un aspect d'abondance
et de fertilité. Près du village aux toits rouges des vergers
disent une ancienne et persistante richesse transmise de
génération en génération. A l'horizon le piton solitaire
d'Essey, vieux témoin du bon temps et des autres temps, semble
un protecteur de la paix locale.
Et
cette paix diffuse dans les choses d'ici, nous imprègne au
point de nous faire croire au printemps, à l'avenir, à la vie
féconde, aux récoltes heureuses de la paix d'autrefois…
Et
pourtant, nous sommes des soldats qui vont s'embarquer pour
"la fournaise". Aucun d'entre nous ne s'en rend
compte. Heureusement.
Rare
douceur du soir. Le paysage se fait câlin au soleil couchant.
De ma promenade à flanc de coteau, après la soupe, j'ai sous
les yeux un paysage de paix reposante. Le village blotti sous
les arbres des vergers bourdonne des bruits joyeux du Bataillon
en instance de départ. Les cloches de plusieurs villages
sonnent à la fois l'angélus du samedi. La verdure semble
joyeuse d'avoir tant poussé par cette journée radieuse et il
monte des champs fertiles une sorte de prière fervente. Il fait
bon vivre, il ferait bon s'endormir en ce lieu.
J'entre
à l'église bien entretenue. Je visite le cimetière où les
tombes disent quelles générations tranquilles se sont
succédées là.
Le
5 mai - En gare de Einvaux.
Nous
quittons Giriviller à trois heures du matin. Nous arrivons en
gare quand la pluie commence à tomber. Embarquement gris. Pas
d'entrain. Les poilus se taisent résignés sous l'averse. Le
wagon à bestiaux devient par suite un abri attrayant.
Nancy
- 11 heures.
Je
somnolais sur mon banc, j'ouvre les yeux : par la porte
entrouverte j'aperçois deux tours encadrant une statue de Saint
: St-Nicolas du Port, dis-je, et les souvenirs me réveillent.
Nous voici à Nancy dans la gare mutilée. Vitres brisées,
halls incendiés, mais des visages de femmes aux fenêtres
éblouissent tous les yeux qui ne voient plus l'horreur,
fleurissent les lèvres de sourires, de bons mots ineptes et
joyeux.
Neufchâteau
- 14 heures 30.
Le
voyage morne obscurcissant mon moral. Mais quel grand souffle
d'air héroïque quand un soldat cria : Voilà Domrémy !
Grande
émotion - prière.
A
travers la vallée meusienne, les beaux villages heureux. C'est
dimanche. Les jeunes filles en toilette claire aux fenêtres,
sur les routes nous envoient des baisers, nous saluent de la
main avec de beaux sourires joyeux. Elles sont trop.
Les
villages égrenés le long de la ligne nous font un accueil
inlassable ; toujours des visages ensorceleurs. C'est dimanche.
Les cultures prometteuses de richesse, et les femmes, de bonheur
; avec la couleur du crépuscule tout défile sous nos yeux
comme un paradis dont on nous arrache. C'est trop. Et à la
gaieté dans l'âme succède une émotion presque douloureuse.
Rimaucourt
- halte repas. Un des cyclistes du Bataillon est du pays. Sa
jeune femme et son bambin sur le quai… Il y a de quoi pleurer.
Nous
gagnons la vallée de l'Aube par le vallon de Clairvaux.
Toujours le pays ensorceleur qui a l'aspect des vallées
comtoises.
Après
Bar - s'étendre sur la paille. Dormir. Bon sommeil. Je
m'éveille. Il fait jour, le train est arrêté en Brie.
Vite
un peu de toilette au robinet de la locomotive et l'âme pourra
se trouver à l'unisson du matin de mai qui chante dans le
paysage.
La
vallée de la Bièvre et ses villas dans la verdure. Tout le
charme fin de l'Île de France où l'homme et la nature semblent
s'être policés et entraidés mutuellement tant l'harmonie est
complète.
Versailles
- morne gare, vieille, malpropre.
Le
Château - l'Orangerie entrevus dans une découpure du vallon et
du parc.
Marly
- avec une apparition de l'aqueduc. C'est ici de la grande
histoire, des temps de victoire.
Argenteuil
- c'est la Seine presque majestueuse. La ville en amphithéâtre
barre la vallée. C'est grand comme dans les pays de
l'antiquité. Je songe à quelque vue d'Athènes ou de Rome et
je m'écrie "herrlich" (magnifique) - et
j'aperçois Linz - Krems - Stein - le beau Danube auquel ce
paysage est comparable.
Midi.
Voici Pontoise. Je la quitte après une halte de quelques
minutes… j'ai eu la chance de découvrir un livre longtemps
cherché.
Nous
gagnons la Normandie, le pays de Bray. Les herbages enclos de
haies, les fermes pauvres en torchis couvertes en chaume, les
maisons prospères en briques - ardoises. Mais partout les
prairies grasses et le bétail nombreux. Gournay,
Forges-les-Eaux, pays connus de mon imagination dont les images
étaient justes.
Sergueux
- nœud ferré. Halte. Un train d'Anglais attend près du
nôtre. Cordialité des troupes. C'est réconfortant et
significatif. Les Anglais saluent, nous ne sommes pas en retard,
ni chiches, de signes de sympathie. Les Britanniques jettent des
cigarettes. Nous tendons des illustrés. Un poilu échange son
bonnet de police contre une casquette khaki. Un audacieux
loustic retrousse la jupe d'un highlander écossais. Mais c'est
le wagon des "women", de laides filles futées, plates
et décidées en uniforme qui s'amusent follement à nos
taquineries : échange de baisers avec les doigts, de billets
taquins comme des papillons.
Débarquement
à Fouilloy. 20 heures. Le canon tonne.
La
nuit est sombre, mais le moral joyeux. La pluie gâte tout.
Arrivée à la
ferme Canada. Le bon grenier chargé de foin nous sèche et nous
repose.
Le
5 mai - Riencourt.
Dix
jours en pays picard. Dix jours en cantonnement d'alerte, en
attente de départ précipité vers la ligne de feu.
Les
jours d'attente s'ajoutent aux jours d'attente, et peu à peu
nous prenons l'habitude d'être sans souci de départ : nous
nous installons. La tension d'esprit qui existait du fait d'une
prévision d'entrée presque immédiate dans la fournaise
faiblit. Le pourcentage des permissions est élevé. C'est les
doux espoirs qui succèdent dans beaucoup de cœurs aux sombres
perspectives. L'atmosphère change pour la troisième fois.
D'abord ce furent les journées d'étapes depuis la gare de
débarquement ici.
Aumale
- Boulainvillers - Molliens-Vidame - Riencourt. Villages à
peine entrevus. On arrive à midi, on repart le lendemain matin.
L'hôte est soit bienveillant, soit grognon, peu importe. Il
suffit d'un coin où l'on s'étend sur la paille ou sur la terre
nue. "On part demain" est la fiche de consolation.
Les
"fouinards" trouvent cependant les maisons où l'on
boit, celles où l'on s'amuse, celles où il y a des œufs,
celles où il y a des lits.
Je
n'aime pas me mettre en chasse pour ces satisfactions de
détail. Je retiens un coin auprès de mes hommes et je m'en
contente.
Mon
"tampon" est un garçon bien dévoué, mais il est
plus dévoué que débrouillard. Beaucoup de petites choses
m'échappent ainsi par notre résignation à toutes les
privations de la vie en campagne.
A
Canada - Foin, mais œufs et beurre.
A
Boulainvillers - Terre nue, mais Cointrot.
A
Molliens-Vidame. Un bon lit, et puis surtout l'invitation chez
l'oncle de Fourquez (M. Pouch Morel) à Bougainville.
Cela
rend un avant-goût des bons accueils de la vie civile.
Riencourt.
Village accroché au talus abrupt de la petite vallée picarde.
Paysage habituel, classique. Les champs de blé sur le limon du
plateau, les flancs en gradins taillés dans la craie, la
vallée rectiligne, plate, humide, plantée de grands peupliers
entre lesquels arpente la rivière.
Les
moulins à vent sur le plateau, les moulins à eau sur le
ruisseau. Les maisons en "biscuit".
Nous
nous occupons à dresser la troupe à la nouvelle tactique. La
fable des attaques ennemies en masse démentie par nos nouvelles
instructions. La tactique d'infiltration. Le mouvement
articulé. On nous poisse avec cela : manœuvre de cadres,
manœuvre de Bataillon de D.I. chaque jour par les beaux matins
de mai, on part sur le plateau et on manœuvre. Les soldats sont
un peu surmenés, mais cela vaut mieux que le désœuvrement.
Les
esprits sont déjà suffisamment chauffés, détraqués par la
perspective de la prochaine attaque. La plupart, hommes et
gradés, sont plus chatouilleux, plus difficiles à l'accord,
plus lunatiques.
Entre
officiers, l'accord est laborieux au Bataillon. Le Capitaine
Michel, Commandant, est le plus brave homme que je connaisse :
délicat, prudent, réfléchi, mais fatigué : "J'ai
horreur des critiques" dit-il en songeant à celles non
qu'il sait subir, mais faire aux autres.
Il
n'ose pas commander, ayant peu d'expérience de la troupe et de
la guerre réelle. Il a trop vécu dans l'atmosphère d'un E.M.
Il demande des avis avant de prendre une décision laborieuse.
Aussi
son autorité est flottante sur les Commandants de Compagnie où
il a affaire à forte partie.
Le
Capitaine Portères, ayant déjà commandé et avec habileté le
Bataillon se défile, il semble vouloir être spectateur
ironique des gaffes et tâtonnements de son concurrent.
Le
Capitaine Cléret, très personnel, tête de Breton, discute les
ordres reçus.
Le
lieutenant Picouret, bavard, bouché, servile, entasse gaffe sur
gaffe - se rend insupportable à chacun.
Le
lieutenant Droz est en somme le plus habile, étant le plus
discret. Mais c'est un Franc-comtois. Il ne louvoie pas et ne se
laisse pas marcher sur les pieds.
Avant
hier, à propos de je ne sais quelle bagatelle, il y a eu sur le
terrain de manœuvre en présence du Bataillon, prise de bec
contre Droz et Picouret. Ce dernier faisait de grands gestes
désordonnés, irritants, moulin à paroles. Droz plus calme,
mais non moins irrité, répliquait à voix contenue. On voyait
aux geste, une "pique" violente. Entendu Droz dire à
son adversaire sur un ton cinglant : "Apprenez, mon ami…"
C'était
pénible, déplorable, démoralisant pour la troupe qui prévoit
très bien que le manque d'entente ici, en réserve, pourrait
très bien entraîner de graves conséquences au combat. Si
souvent le salut repose sur le voisin, sur la liaison entre
unités, sur une camaraderie dévouée.
J'ai
entendu les hommes commenter durement après le conflit entre
les officiers.
Entre
sous-officiers, dans la Compagnie, ce n'est pas l'accord profond
et j'ai dû lutter énergiquement ces jours-ci pour m'opposer à
la formation d'îlots, de clans des entêtés, de butés, des
chatouilleux. La popote est le moyen d'action le plus énergique
pour maintenir l'unité d'esprit entre sous-officiers dans une
Compagnie. Plusieurs voulurent la quitter, manger à part. les
uns se plaignent de ceci, d'autres de cela, avec une
susceptibilité qui n'existe pas en temps ordinaire.
"Il
est temps qu'on monte "là-haut" me dit Fourquez ; il
n'y a que cela pour remettre la camaraderie d'aplomb. Avant
l'attaque du 8 septembre (1917) c'était déjà les mêmes
difficultés d'accord. Les têtes fermentent, ça les
calmera".
En
effet les têtes fermentent. J'en ai eu la grave indication à
la ferme Canada, où un groupe a pris délibérément l'audace
de ne pas se présenter à la revue que j'avais prescrite, un
groupe comprenant les meilleurs de nos soldats, les plus soumis,
les plus disciplinés, mais entraînés par les deux têtes
chaudes, et déraillés par la vague qui sévit sur ces gradés
d'intelligence obtuse : le Caporal Crolet et le Sergent
Bracquart.
J'ai
temporisé, laissé apaiser la fermentation, j'ai
"poissé" les insubordonnés, et tout s'est remis
d'aplomb. Mais le Sergent Bracquart est intolérable. Il agit
sur ma section comme la gelée sur un bloc d'argile : il me la
désagrège. Les hommes flairent ses inconséquences, ses
étourderies, ses défaillances, et surtout son esprit de
révolte.
Il
est le plus brouillon, le plus "gosse" des gradés et
n'admet aucune observation. Chaque fois que je lui en ai fait
une le plus amicalement possible il s'est cru irréprochablement
offensé. Il boude, se retire à part, converse avec les mauvais
soldats quand il ne chahute pas avec eux, ou, je n'en n'ai pas
de preuves, quand il ne va pas jusqu'à me crosser, me
calomnier. Je sens mon ascendant, mon emprise morale sur ma
section, se dissoudre peu à peu, sur ces hommes qui étaient
dévoués et dociles.
Homo
me rapporte avoir surpris un coup d'œil d'encouragement, lancé
derrière mon dos par Bracquart à un homme à qui je faisais
une observation.
Une
dernière scène à la suite d'une observation pour une
négligence effrontée me décide soit à sévir, soit à
guérir radicalement le mal.
J'expose
la situation au Commandant de Compagnie et lui demande le
changement de section pour incompatibilité de caractères, et
dans l'intérêt du service, du Sergent Bracquart. Accordé.
Maintenant,
au bout de cinq jours je sens plus dociles les leviers d'action.
Crolet a été sermonné par Lacaque. La section sera à nouveau
en main, espérons le, pour monter en ligne.
Le
17 mai - Monter en ligne ?
C'est
bizarre, on n'en parle plus.
Calme
des lignes. Les infanteries allemande, française attendent. Les
gens informés signalent en préparation la plus formidable
attaque de la guerre. Nous sommes sans doute réservés pour y
parer. Beau sort.
Riencourt.
Pentecôte.
J'ai
fait aujourd'hui mes préparatifs de départ.
Mise
en ordre de l'âme, des choses préférées, des armes -
j'écris à maman : "omnia parata…" (tout ira
bien…).
Et
voilà ce soir l'ordre de se tenir prêt à partir.
Légère
émotion. Mais les cœurs sont raffermis.
Rogy.
Trinité.
Les
camions automobiles nous ont déplacé vers le Sud, mais ne nous
ont guère rapprochés du front.
Nous
cantonnons à Rogy. Est-ce pour un jour ? une semaine ? un mois
?
Nul
ne le sait. Une semaine cependant est écoulée dans ce village
du plateau, la semaine durant laquelle d'après tous les faux
prophètes la grande ruée devait avoir lieu. Nous n'en savons
pas plus que le premier jour où nous pensions être dirigés
sur la zone tumultueuse.
Emploi
du temps habituel.
Matin,
exercice à la cote 150. Thème répété, réduction d'un îlot
de résistance. Une pause de foot-ball - un dispositif de
Bataillon - on rentre - il est 10 heures 30 - on mange - une
petite sieste - une revue - c'est la soupe du soir - musique sur
la place - "Mois de Marie" à l'église - une causerie
avec l'aspirant - c'est déjà la nuit - une journée est
écoulée. Une journée d'attente. Au loin, depuis deux jours,
cependant la canonnade est frénétique. Le sol tremble ici à
vingt kilomètres des lignes. On a l'impression que cette lutte
d'artillerie est un appel. Pourtant, nous passons une bonne
journée de dimanche, comme un jour de fête.
Il
y eu concours sportif sur le plateau.
Les
équipes de foot-ball, de coureurs, de lutteurs ont rivalisé
d'entrain avec l'appui de la musique, et l'encouragement moral
de tout l'E.M. du Régiment, notre nouveau Colonel en tête.
Car
nous avons perdu notre bon Colonel Galbrunner, promu à un poste
supérieur. Après son baiser au drapeau, ses adieux au
Bataillon, son départ, nous avons eu la cérémonie de
l'investiture du Lieutenant-Colonel Regard au Commandement du
Régiment, puis la présentation individuelle des Chefs de
Section.
Il
a trouvé que j'avais peu de service effectif pour être déjà
nommé sous-lieutenant.
Nous
le jugerons à l'œuvre, mais il n'a pas l'abord loyal de
Galbrunner.
Le
28 mai - Ordre de se tenir prêt à
partir, soit en camion, soit en chemin de fer.
Où
?
Les
Boches ont attaqué violemment en Champagne. Les commentaires
exagérés vont leur train. Ne vous frappez pas, dis-je à la
popote. On les arrêtera.
Irions-nous
là-bas à la rescousse ?
Peut-être.
Qu'importe. Je suis prêt autant que notre pauvre chair humaine
peut être prête, et je suis ferme autant que notre esprit
ballotté et aveugle peut se maintenir en équilibre.
Avec
l'aide de Dieu, ça ira.
Parfois,
quand je suis inattentif et que l'image brutale de la fournaise
se dresse à l'improviste, je ne puis pas encore rester froid,
indifférent, il y a dans mon ventre un bouillonnement de
lâcheté, d'angoisse. Il faut que je me répète pour me
ressaisir :
"Plus
près de toi, mon Dieu - afin que ton règne arrive".
Le
28 mai - Rogy. Je viens de faire une sorte de veillée des
armes… j'ai écrit mes recommandations suprêmes à mon frère
Henri, mes dernières pensées à mes Parents, quelques
instructions à mon ordonnance en permission. J'ai rangé ma
cantine. Je veux être prêt à n'importe quel voyage, sans
distractions au départ. Maintenant, En avant.
Mérard
(près de Mouy).
Je
songe au recueillement grave et aux minutieux préparatifs en
vue d'une mort possible et prochaine, à la Stimmung solennelle
de l'autre soir. C'est tout simplement grotesque aujourd'hui.
Don Quichotte et pompier. Tartarin !
L'entraînant
: "En avant" s'est traduit par un bel: "En
arrière", puisque me voici installé au C.I.D. (12ème
Compagnie) à cinquante kilomètres de la bataille !
Le
30 au matin, à 9 heures, taquinerie de M. Ehrendorf sur mon
envoi au C.I.D. M. Foudraine me met au courant de la note
prescrivant la constitution d'une réserve de cadres. État
néant.
-
"C'aurait été vous jouer un vilain tour que de vous
envoyer au C.I.D. juste au moment où on va gagner des galons
qui vous sont promis.
Et
puis ce n'est pas pour un grand coup qu'on se passe d'un bon
serviteur…"
Une
demi-heure plus tard, note impérative prescrivant mon départ
immédiat au C.I.D.
J'ai
éprouvé comme un frisson d'inquiétude en apprenant cette
décision qui est - à pareille heure - une chance enviée par
tous, une bénédiction dont je ne me sens pas digne.
Il
ne m'aurait pas été désagréable d'avoir enfin le baptême du
feu dans une vraie bataille… Je suis, je reste en somme un
"embusqué". Je n'ai pas encore souffert jusqu'au sang
pour la patrie.
Les
nouvelles sont de plus en plus mauvaises.
Nous
avons embarqué avec toute la D.I. Par toutes les routes, les
camions nous ont amené au front de Compiègne.
Les
Bataillons actifs franchissent l'Oise, on les engage dans la
grande forêt où je regarde dans le feuillage se balancer mes
souvenirs.
J'ai
l'espoir tout proche de revoir Chelles - Vic - La Forte Haie -
Pierrefonds - La Croix Morel. Voilà Royallieu - Compiègne sous
mes yeux.
Les
camions transportant le C.I.D. font demi-tour, reviennent à
Clermont que n'atteignent pas les bruits de la bataille.
Pourtant ça va mal.
Le
premier jour, les Boches ont atteint l'Aisne. Le deuxième la
Vesle. Le troisième Fère-en-Tardenois. On a l'impression
qu'une grande porte a été enfoncée, que l'ennemi s'y
engouffre irrésistiblement. Je ne puis croire à pareil
désastre, ni comprendre l'absence de résistance qu'on
pressent. Et malgré tout, je n'ai pas cette détresse ressentie
quand les communiqués annonçaient la prise de Noyon, et les
racontars celle de Compiègne. "On les arrêtera". Ne
vous frappez pas, répété-je à mes camarades.
"On
les arrêtera !".
Je
me demande si on s'efforce de le faire. Et où. On avoue que
l'ennemi a atteint la Marne, tente de la franchir, enveloppe
Château-Thierry !
Comment
répéter : "On les arrêtera !"
Mais
nous nous disons : Où donc est l'armée française ? que se
passe-t-il ? Surprise d'attaque ? comment est-ce possible ? Et
l'invasion reprend comme aux mauvais jours d'août 1914 !
Ah
! enfin on signale un blocage. La Division des Loups aurait
repris Faverolles, interdit l'entrée de la forêt de
Villers-Cotterêts. (Premier racontar, quatre-vingts pour cent
de perte !)
Les
journaux portent en titre : "Vers la stabilisation".
Il est temps !
Oh
! Ce paradis de la vallée de la Marne. Je me révolte à la
pensée du saccage qui recommence là, jusqu'au cœur de la
France.
Et
dire que je suis ici comme un bœuf à l'engrais. C'est une
humiliante sécurité.
Un
dimanche après-midi à Mouy, vieille petite ville de la vieille
Île de France.
Le
Mail. La Place, les vieilles maisons, les vieux moulins sur le
Thérain. Et surtout, entre tout, l'émouvante église gothique
du XIIIème siècle.
Mouy
moderne. La gare encombrée de wagons. La jeune fille dévêtue
plutôt qu'habillée du "café".
Le
cinéma. "Modern Cinéma"!
L'incident
attristant : Bravos du "poulot" à l'apparition sur
l'écran du buste de Jaurès. Coups de sifflets des mêmes quand
se présente Clémenceau.
"Qui
est-ce que ces saligauds-là", me demande Toussaint.
C'est la
France qui se déchire, s'ignore et renie et se prépare à la
défaite…
J'ai
rencontré un beau caractère, le sergent Cézar, le Hollandais.
Boursonne
(Oise).
Dans
une clairière de la forêt.
Un
îlot de limon cultivé parmi les sables boisés. Village qui
devait être délicieux avant la fuite éperdue des habitants.
Les champs et la forêt l'enrichissaient. Aujourd'hui c'est la
ruine totale, des maisons, des cultures, de la forêt.
Les
troupes qui se sont trouvées ici lors du départ des habitants
se sont ruées au pillage des maisons, de la cave au grenier.
Des artilleurs, dit-on.
En
effet, dans tous les coins des cours et des jardins on ne voit
que peaux de lapins, plumes de volailles, têtes et pattes de
canards, de poules.
Les
bouteilles vides, ou cassées gisent partout, sur et sous les
tables, dans la paille des greniers. On a fait une telle
ripaille qu'un de mes sergents en préparant la place pour se
reposer, découvre une bouteille de vieux Bourgogne blanc,
oubliée par le pillard repu.
Le
spectacle le plus navrant est dans les appartements où c'est un
désordre indescriptible. Le contenu des armoires, des buffets,
des garde-robes, des secrétaires, des bureaux, linge,
dentelles, robes, chapeaux, papiers, livres, cartes postales,
portraits d'albums, objets de toilette, tout a été jeté
pêle-mêle sur les planchers, fouillé, piétiné, refouillé,
souillé, anéanti par goujaterie, fainéantise, instinct de
destruction, curiosité vulgaire : la bête humaine s'était
déchaîne, toujours ardente et pareille, depuis Caïn.
Et
les officiers négligents ou débridés eux aussi, laissent
faire. Pas de sanctions.
Les
champs ont de belles récoltes en promesse. Des blés
magnifiques, dans lesquels on se cache pour les besoins
spéciaux, par paresse de creuser une feuillée, ou de s'y
rendre. Pistes tracées en tous sens dans ces beaux épis. Les
fourrages sèchent sur pied - par un beau soleil de fenaison. On
en organisera sûrement la récolte, mais quand les pluies
seront revenues et quand la valeur des herbes sera nulle. Les
pommes de terre sont étouffées par les plantes parasites. Sur
mille hommes personne pour les piocher, les buter, mais une
centaine de cuisiniers qui déjà, en cachette, par maraude vont
arracher les tiges afin de rapporter quelques tubercules gros
comme des noix : pommes de terre nouvelles, oui. Mais manger le
blé en herbe est un luxe inquiétant quand le monde entier est
guetté par la famine. Mais qu'importe, nous ne seront pas là
en août. Et pas une autorité pour imposer cette prévoyance.
Quant à la forêt, on y fait des coupes sombres pour préparer
les piquets nécessaires aux réseaux que nous établissons avec
la hâte peu fébrile de la main d'œuvre militaire.
Le 15
juin 1918
Boursonne.
Promenade dans la forêt. Campement abandonné d'une batterie de
105. Ils ont abandonné là, parmi les douilles, les matelas,
les fagots de poudre, les bouteilles vides, les fourneaux, les
tonneaux, les chaises apportées du village pillé…
Nous
rentrons d'un exercice de cadres, une douzaine de sous-officiers
guidés par les capitaines Derez et Larseneur. D'une maison du
village sortent deux automobilistes chargés chacun d'un
matelas. Les officiers laissent faire, (pas d'histoires !), et
finalement piqués par la rumeur d'indignation qui bruisse
derrière eux, sentant nos regards interrogateurs leur demander
: "est-ce que vous ne vous opposerez pas à ce scandale
?" ils se décident à faire semblant de vouloir rejoindre
les deux pillards. Ces derniers ont disparu dans une cour.
Larseneur y entre, ne voit ni matelas, ni automobile et sort,
confus d'une part, satisfait d'autre part de n'avoir pas à
faire acte d'énergie.
Le
Commandant du C.I.D. a fait connaître la menace de conseil de
guerre visant quiconque emporte un objet quelconque d'une
maison.
Une
demi-heure après son arrivée il buvait sous un arbre du parc
un beau vin blanc dont la bouteille poussiéreuse disait assez
la provenance.
Le
lendemain, son cycliste vient dans la maison où nous avons
installé notre popote et cherche à "barboter" une
lampe à pétrole. Nos cuisiniers s'y opposent, l'autre riposte
:
"C'est
pour le Commandant. Il m'a dit : il me faut absolument une
lampe. Débrouille toi".
Les
cuisiniers des popotes d'officiers sont les premiers à arracher
les pommes de terre à demi-formées. On comprend ce que
pourront se permettre les gredins. Cette conduite des officiers
explique la dévastation des beaux villages, sans qu'il y ait
recherche des responsabilités, ni sanctions assurées. Quelques
maladroits mal vus paieront pour la forme. Défaillance des
caractères ! Niveau inférieur de nos officiers.
Boursonne.
Premiers
renseignements véridiques sur l'offensive.
Mon
ami Fourquez est le seul gradé blessé de la Compagnie. Tous
les sergents sont indemnes.
Les
blessés légers en forte proportion. Tués : huit, dont quatre
à ma section. Deux petits de la classe 18. Thévenard, le
malmené s'est conduit admirablement. Il était bon tireur. Il a
fait de véritables cartons sur les Boches. Bouvignet, le
parisien qui avait si bon cœur. Riet, le clerc de notaire
caillautiste, mais fiancé depuis cinq ans… Une malheureuse de
plus.
Enfin,
mon père Thau, le brave et silencieux père de famille, tué
par son imprudence. Puis à la 2ème Section Lafougat
- Laville.
Trois
sections ont subi l'attaque allemande. Il a été possible de
faire subir des pertes cruelles à l'ennemi, sans efforts
surhumains. Ehrendorf cité à l'Armée.
Les
héros de la journée furent le Capitaine Michel qui par son
courage mobilisa pour une contre-attaque fougueuse et réussie,
des sections de tanks qui firent merveilles.
Le
légendaire Capitaine Hennegrave qui a sauvé un Bataillon du
168ème et repris Faverolles. A chargé sabre au
clair en tête de sa Compagnie. Est arrivé sur deux
mitrailleuses qui se sont enrayées miraculeusement. Il est fait
Chevalier de la Légion d'Honneur sur le Champ de Bataille avec
une citation sans pareille.
Grâce
à la Division des Loups l'accès de la forêt a été interdit
à l'ennemi.
Notre
commandement, je crois, n'attendait pas un heureux résultat à
si bref délai, si on considère la zone évacuée par ordre -
Betz - Crépy sont déserts - en fuite éperdue sur ordre de
l'autorité militaire qui donne quelques minutes aux populations
pour se préparer à partir.
Les
travaux de défense sont poussés activement dans la forêt. Les
réseaux surgissent du sol, le dessin des tranchées et des
boyaux court déjà sur le sol. Nous avons reconnu les
emplacements d'alerte. L'ennemi a été arrêté. Il passerait
cette fois difficilement en avant.
Chaque
matin, les travailleurs vont sous bois. Ils sont mis à la
tâche. Section de réseau au mètre cube de terrassement ; avec
des milliers d'hommes cela fait vite un travail formidable en
peu de temps. Notre rôle, à nous gradés est un rôle de
surveillant, et un peu de direction. Les bleus sont peu adroits.
Ils ne savent pas manier la pioche ni la pelle. Ils
s'embrouillent dans les fils d'un réseau.
J'abandonne
les travaux pour suivre le cours de F.M. dirigé par le
lieutenant Brien du 169.
A
présent, ce sont les Italiens qui sont à la peine. L'armée
autrichienne pèse sur eux de tout son poids renforcé. Ils ont
l'air de s'être ressaisis depuis leur défaillance de
Caporetto. Ils tiennent bon. Ils tiennent ferme. Peuple à
surprises que ces Latins, plus sensibles que nous encore à
toutes les influences.
La
grippe espagnole, maladie à la mode, m'a saisi et je suis
amoindri sur ma paillasse.
Mon
frère Louis m'envoie une lettre inquiétante. Son moral baisse,
baisse toujours : il ose écrire :
"Cela
ne va pas mieux, les macaronis tiennent le coup".
J'envoie
d'urgence un cri d'alarme à mes parents.
Le
25 juin - Cuvergnon.
Le
C.I.D. s'est déplacé vers le Sud. Nous voici installés à
Cuvergnon où j'avais déjà cantonné - où j'avais tant passé
avec mes troupeaux quand j'étais chargé de la boucherie.
Mais
le village est mort. Pas un civil. Le saccage a sévi. Les
débris malpropres que l'armée laisse sur son passage souillent
la mare, les rues, les cantonnements, les sentiers, les jardins,
les blés.
J'ai
voulu faire un tour de promenade dans un chemin creux. J'ai du
reculer devant les sentinelles innombrables, couvertes d'essaims
de mouches. L'homme est un animal sale.
Le
26 juin - J'ai enfin quelques lueurs
sur le mystère de nos premières défaites.
La
faute ? Oh ! Pas à la troupe trop ardente. Mais à un
état-major recruté par camaraderie et protection politique.
Tare fondamentale. Ensuite E.M. ayant élaboré une théorie
simpliste de la guerre à coups d'hommes, adopté "la
solution paresseuse" de la guerre des lavabos à la Ponce
Pilate…
Le
travail de mise au point de l'armée moderne avait effrayé
l'E.M. Il avait biaisé et trouvé plus simple d'ignorer la
puissance défensive des armes automatiques, la puissance
offensive de l'aviation et de l'artillerie lourde ou d'y parer
par l'offensive à la hanneton, la marche en avant à tout prix.
La défaite était fatale…
Cuvergnon.
Journées
de lassitude. Je me ressens peut-être encore des effets de la
grippe, mais jamais je n'ai été aussi effrayé de la longueur
de la guerre ? je vois avec découragement ma jeunesse perdue,
ma vie brisée.
Et
ici, on respire un air malsain. L'absence de danger, la crainte
de monter au secteur mal famé donne aux caractères une
attitude hargneuse, égoïste, vile.
L'ennui
ronge. Les pensées déprimantes mijotent dans le cerveau. Ah !
Plutôt la première ligne "qui rapproche de Dieu" me
disait le père Prunier.
Le
scandaleux départ du "marchand de bougies", le
flagorneur Hubert à l'État-major de la D.I., achève de me
dégoûter. Je plains mon pauvre pays de ne pas savoir trouver
que de si pitoyables hommes pour les postes de confiance.
Les
vices que Clémenceau pourchasse à l'intérieur semblent
refluer en troupe envahissante dans les compartiments de la
machine militaire.
Où
est le dictateur qui mettra au pas cette nouvelle féodalité,
cette nouvelle franc-maçonnerie que devient peu à peu l'armée
française. Ducombeau, Hubert. Des gens qui se paient de mots et
qui adorent les "solutions paresseuses".
Le 4
juillet 1918 -
Cuvergnon.
Au
milieu des inquiétudes et des tristesses de l'heure présente,
nous avons la réconfortante aide américaine qu'on sent
idéaliste, puissante, volontaire et intelligente.
La
France fête avec les États-Unis l'Independance Day. Pourvu que
les Américains conservent leur dévotion pour la France. Qu'ils
ne voient pas le cynisme de notre bourgeoisie gouvernante, et
qu'ils sachent découvrir le vrai peuple de la France
éternelle. Wilson nous annonce le chiffre du million atteint
ces jours-ci. C'est prodigieux.
Et
les Italiens ont changé en déroute l'offensive autrichienne.
"Italia fora va se". C'est également prodigieux.
Et
puis un autre fait non moins inattendu et étonnant. La
main-mise des volontaires Tchéquo-slovaques sur la Sibérie…

 

(…insert
joint…)
(Feuillets
isolés à réinsérer dans le texte suivant chronologie ou à
transférer dans l'annexe).
Sur
Lacaque.
Le
jour de pluie dans l'abri.
Les
récits du Lorrain. Amorcé par commentaire (?) sur
Paris. Son voyage à Paris. Je ne l'ai vu que deux heures.
Ah
! Vous êtes allé à Paris ?
Oui.
Je sortais de l'ambulance de Gap. Convalescence à Grenoble.
Rejoindre Toul. L'express de Lyon à Dijon, l'idée de passer
par Paris au lieu de changer de train.
Gare
de Lyon. Jamais j'avais tant vu de monde. Le renseignement sur
le moyen de gagner la gare de l'Esse. Métro, sans changement à
la Bastille. Trois sous. Le Métro. Des petits trains qui ne
laissent pas le temps de monter dedans.
La
gare de l'Esse. Les deux heures d'attente. Descente de la rue.
Le
vieux type qui m'arrête. Un cireur :
-
Un petit coup à vos chaussures, militaire ? J'avais des
souliers encore tout rouges et tout crottés.
-
Ah ! Un petit coup, si vous voulez !
Mais
le vieux avait de la peine à se baisser :
-
Donnez moi donc vot' brosse. Tenez.
Quand
ce fut fini, je lui offre de venir boire une chopine. Il me dit
qu'il aimerait mieux l'argent. Alors je lui donne deux sous.
Mais il m'a semblé qu'il n'était pas content. J'avais soif. Je
l'ai invité à venir boire une chopine quand même, il a
accepté.
Après
je m'en ai descendu une rue. Je savais pas laquelle prendre, il
y en avait qui allaient à droite, à gauche, de tous côtés.
L'entrée
au restaurant.
Ça
m'a bien coûté six francs. Un mauvais repas qui ne valait pas
quarante sous chez nous. La crainte d'être égaré. Le chemin
de la gare. La vieille avec un tite charrette vendant de tout,
des lacets, des petites montres. Elle m'a appelé. Elle a voulu
que je lui achète une montre de gosse. Pas besoin. Mais la
vieille pleure. Pas mangé depuis trois jours. J'aurais soufflé
dessus qu'elle serait tombée. J'ai bien vu qu'y avait encore
plus de malheureux que chez nous.
Je
lui ai acheté sa montre pour qu'elle pleure plus. Elle marche (?)
encore.
Les
cafés pleins de femmes. Elles entrent seules, fument, boivent
des bocks. Chez nous elles vont pas au café ou seulement avec
leur mari.
Ah
! C'est encore un pays où les femmes sont des vaches.
L'économie
obligatoire. Il me restait dix-sept sous. Et puis je les ai
donnés à des femmes en arrivant à Toul. Elles vendaient des
petits canons à mettre à la boutonnière.
Jeunesse.
Le
vieil aveugle avec son chien et sa flûte. Passages
périodiques. Ma mère lui mettait une tranche de lard dans son
sac. Je crois qu'il était guère aveugle. Un jour qu'y jouait,
je faisais des grimaces devant lui. Y s'arrête et m'envoie une
grande baffe en plein nez qui me fait rouler dans la rigole.
Le
poteau lait de la fille du maire pour la mère hydropique.
Donne
moi un coup à boire.
Il
y en a pas trop pour ma mère.
Le
crachat dedans.
La
raclée de la mère Lacaque à son grand propre à rien.
Le
soir rampant dans la vallée.
La
colline couronnée de soleil.
Monter
la colline accablé de remords.
Sentir
sur ses épaules tomber des pleurs de femmes.
Entendre
gémir derrière soi, comme des chiens abandonnés, les
malheureux.
La
nuit engloutit le soleil.
Aix-la-Chapelle,
le 6 août 1919.
Mon cher
Monsieur Cœurdevey !
Je
vais vous écrire maintenant en français, parce que je cause
maintenant en français couramment comme un petit ruisseau. Ne
riez pas !
Nous
étions très étonnés sur votre lettre du 1 août parce que
vous aviez promis de nous visiter pendant vos vacances.
J'espère que vous êtes un homme de mot et que vous faites ce
que vous avez promis. Nous avons vous invité, il est donc tout
naturel que tous les frais de votre voyage sont à ma charge. Je
veux toujours parler français avec vous pendant les vacances
pour me perfectionner en français. Vous avez aussi assez
d'occasion de votre part de profiter en allemande et c'est donc
pour nous deux très agréable d'être ensemble pendant les
vacances. Je vous prie donc encore une fois, de nous visiter
comme vous avez promis et de prendre le train le plus prochain
et le plus vite possible. Nous avons l'intention de visiter avec
vous le Rhin, et c'est sûr, que vous ne vous repentez pas de
nous avoir visité. Je vous conseille encore une fois de prendre
le train prochain et le plus vite pour nous donner votre
réponse convenante en personne en quelque jours à partir
d'aujourd'hui. J'espère donc que vous arrivez ici le plus tôt
possible.
Entretemps
je vous salue cordialement.
Signature.
Adresse du
destinataire :
A. Peyrefitte.
8ème Génie, T.S.F. Sect. post. 96.
Aachen, den
6. August 1919.
Werter Herr
Cœurdevey !
Sehr
gefreut haben wir uns über Ihren lieben Brief. Vorest unsere
herzlichsten Glückwünsche zu Ihrem grossen Erfolge. Wir haben
sie schon täglich erwartet und hätte mein Mann Sie so gerne
mit sich nach Boppard genommen um geläufig französisch zu
lernen. Sie brauchen sich wegen Nahrungssorgen keine Unruhe zu
machen. Wir haben Sie doch für einen Monat eingeladen und
erwarten wir Sie daher ganz bestimmt hier bei uns. Das Geschäft
geht wider alles Erwarten sehr gut und müssen sie bestimmt
kommen, damit mein Mann auch noch besser französisch lernt. Wir
hoffen also bestimmt auf Ihren Besuch. Zudem schreiben wir
diesen Brief zweimal, damit wenigstens einer davon Sie erreicht.
Alle Neuigkeiten heben wir auf bis Sie uns besuchen werden. Wir
waren mit Kaatzer einige Tage in Cöln, wo Herr Stern jetzt
ständig lebt. Also auf Wiedersehen, hoffentlich in baldiger
Zeit, denn mein Mann legt grossen Wert auf die französische
Sprache.
Auf
Wiedersehen bin ich mit freundlichen Grüssen.
Frau lieschen
Cornaly
N.B.
Am sonntag brachte ein Soldat Grüsse aus La chot Fonds.
Aix-la-chapelle,
le 6 août 1919.
Cher
Monsieur Cœurdevey
Nous
nous sommes fortement réjouis de votre aimable courrier. Tout
d'abord, nos compliments les plus cordiaux pour votre grande
réussite. Nous vous attendions déjà d'un jour à l'autre et
mon mari vous aurait volontiers emmené avec lui pour aller à
Boppard afin d'apprendre du français courant. Ne vous faites
pas de soucis quant à des problèmes de nourriture. C'est pour
un mois que nous avons invité et c'est pourquoi nous vous
attendons de pied ferme chez nous afin que mon mari puisse
encore mieux apprendre le français. Donc vous pouvez être sûr
que nous attendons votre visite. J'ajoute que nous écrivons
cette lettre deux fois pour être sûrs que vous en recevrez au
moins une. Nous gardons toutes les nouvelles à raconter
jusqu'à votre visite. Nous avons été quelques jours à
Cologne où réside en permanence maintenant Monsieur Stern. Au
revoir donc, nous l'espérons, bientôt, car mon mari attache
beaucoup d'importance à la langue française.
Au
revoir, et avec mes amicales salutations.
Madame
Lieschen Cornaly
N.B.
Ce dimanche un soldat nous a apporté des salutations de La
Chaux-de-Fonds.
Die
Cake (Lacaque)
Nidrige
Stern, aber aufrichtige Auge. Eignesinniges Kinn. Seine Famile -
elf Kinder - harte Erziehung - Schimpworten Ohrfeige - Stafz
"Gut zu nichts" - Keine Kultur - Versteht nicht alle
feinen Ausdrück - "Je ne comprends pas ce tu me dis
là".Ihre Lothringer Betonung - Fromache - Salât - mettre
des caillebotis sur la Pisse - Prendre le Petit Posse - (…illisible…)
Schule erinnerungen à grande cruche.Aber ihre eigene Art zu
erzählen die Geschichte von den Schuhen.Erste Kommunion des
Bruders - das Bitten - Der Vorschlag ab - Die Räche - Die
Strafe - Die unglückliche Ziegz Monette.
(Front
bas, mais des yeux honnêtes - menton têtu. Sa famille - onze
enfants - éducation stricte - grossièretés et gifles -
punition - "bon à rien" - aucune culture - ne
comprend pas les fines expressions - "Je ne comprends pas
ce tu me dis là". Son accent lorrain - Fromache - Salât -
mettre des caillebotis sur la Pisse - Prendre le Petit Posse - (…illisible…).
Souvenir d'école à grande cruche. Mais sa propre manière de
raconter l'histoire des chaussures. Première communion du
frère - la prière - la proposition - les vengeances - La
punition - la malheureuse chèvre Monette.)
Le
sentiment de Justice.
Impétuosité
- Potier - Trou des Aches.
Générosité
- le vin cher - Les piquets à porter en ligne.
Hauptmann
Bru. (Capitaine Bru)
Erste
Versammlung - Pinard - Femmes. Départ en mufle. Bild - Familie
- Politique. Prahlerein Erster Fehler im Linie. Heuchler mit
einem Unterordination (?) Grunz salat.
(Premier
rassemblement - Pinard - Femmes. Départ en en mufle. Image -
Famille- Politique. Vantardise. Première faute en ligne.
Obséquieux avec les sous-officiers (?) Salades.)

 

 
|