|
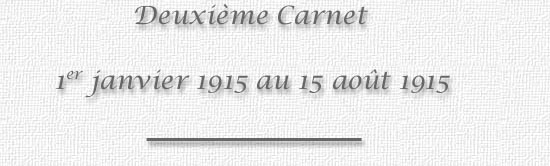
-
Aisne -
Le
1er janvier 1915
Oh
! Le beau début d'année.
Depuis
près d'un mois que j'avais perdu les traces de Julien, et
depuis une dizaine de jours que je vivais dans l'inquiétude,
Dieu a voulu, comme par un gage d'espoir, une promesse
d'heureuse année que je le rejoigne en ce jour et que nous
réussissions, malgré les épreuves à nouer le faisceau des
affections familiales pour cette fête.
 J'ai
fait la longue course avec des ailes. Dès midi j'étais au
fameux château de Pierrefonds J'ai
fait la longue course avec des ailes. Dès midi j'étais au
fameux château de Pierrefonds .
Quand il me vit dans la cour il resta stupéfait de joie, puis
se mit à courir à ma rencontre. L'heureuse minute ! Dans la
somptueuse et émouvante demeure nous avons passé une bien
heureuse après-midi. Dommage qu'elle fût gâtée par
l'insuccès de nos tentatives photographiques. J'ai comme
l'anxiété d'avoir manqué l'ultime occasion. Mais non c'est de
la déraison. Un bon souper avec Heitz nous ranime et j'ai comme
une sorte de joie à braver au retour la tempête qui m'oblige
à pousser mon vélo à la main. Dans ma mémoire et dans mon cœur
chantent les dernières paroles de ce pauvre : "Oh ! Je
suis bien heureux que tu sois venu !". .
Quand il me vit dans la cour il resta stupéfait de joie, puis
se mit à courir à ma rencontre. L'heureuse minute ! Dans la
somptueuse et émouvante demeure nous avons passé une bien
heureuse après-midi. Dommage qu'elle fût gâtée par
l'insuccès de nos tentatives photographiques. J'ai comme
l'anxiété d'avoir manqué l'ultime occasion. Mais non c'est de
la déraison. Un bon souper avec Heitz nous ranime et j'ai comme
une sorte de joie à braver au retour la tempête qui m'oblige
à pousser mon vélo à la main. Dans ma mémoire et dans mon cœur
chantent les dernières paroles de ce pauvre : "Oh ! Je
suis bien heureux que tu sois venu !".
Et
dans ces simples mots je sentais trembler tout l'effarement des
mêlées traversées et toute la crainte vague des horreurs
prochaines, et toute la joie fiévreuse d'une belle heure
fugitive qui survient dans l'épopée épouvantable qui dure
depuis des mois.
Je
suis rentré à minuit, trempé et joyeux. Le gui porte-bonheur
venu de la vieille ville était là qui m'attendait pour que
rien ne manque à cette belle journée.
Les
éléphants.
Les
bruits les plus fantaisistes circulent avec une extraordinaire
facilité en temps d'épreuve. Qu'on songe à la Grand'Peur de
juillet 1789. Aux fameuses histoires du Général Perrin que des hommes censés intelligents répétaient : le Général
avait abandonné Lille, il avait gardé dans sa poche
quarante-huit heures l'ordre d'aviser le 7ème C.A.
de venir à la rescousse dans le Nord. Par négligence ? Ou par
trahison ? Assurément par trahison : sa fille ayant épousé un
officier allemand !
que des hommes censés intelligents répétaient : le Général
avait abandonné Lille, il avait gardé dans sa poche
quarante-huit heures l'ordre d'aviser le 7ème C.A.
de venir à la rescousse dans le Nord. Par négligence ? Ou par
trahison ? Assurément par trahison : sa fille ayant épousé un
officier allemand !
Puis
le Général, dénoncé par son ordonnance s'était fait sauter
la cervelle... Pour d'autres, il était enfermé à la pension
du Cherche-Midi : moi-même j'y ai un peu cru.
Et
les terribles effets de la mystérieuse poudre Turpin ,
quels espoirs n'ont-ils pas fait naître en ces jours
angoissants où nous nous repliions à marches forcées sur
Paris, où nous attendions sous les forts de la capitale le choc
décisif qui allait sauver la Patrie. ,
quels espoirs n'ont-ils pas fait naître en ces jours
angoissants où nous nous repliions à marches forcées sur
Paris, où nous attendions sous les forts de la capitale le choc
décisif qui allait sauver la Patrie.
Puis
ce fut le débarquement de 100 000 Cosaques à Marseille pour
mettre la lance dans les reins des allemands en fuite après la
Victoire vers la Marne.
Les
tranchées et la guerre spéciale qu'elles imposent, n'ont pas
moins mis à découvert de riches lots d'âneries. D'abord ce
furent les "Carrières" qui offrirent les premiers
aliments aux imaginations. Les Boches y étaient formidablement
retranchés, murant les entrées, n'y laissant qu'un étroit
passage pour les gueules des canons.
Puis,
le bruit courant qu'un tunnel souterrain creusé par le génie
français allait les faire sauter.
Puis,
comme rien ne sautait, on se figura et on répétait partout que
les Allemands allaient d'eux même les évacuer, elles étaient
devenues intenables à cause de la pourriture des cadavres
accumulés à l'entrée. Mais la plus belle fleur du bouquet fut
l'arrivée des éléphants.
Notre
hôtesse, une solide gaillarde aux allures de maréchal des
logis de gendarmerie, mais crédule et naïve comme toutes les
femmes, vint un soir à notre popote et gravement nous fit part
de la nouvelle sensationnelle du jour.
Oui,
on avait trouvé enfin un procédé pour en finir avec les
Allemands abrités dans leurs tranchées derrière leurs
réseaux de fils de fer barbelés infranchissables. On allait
faire venir un troupeau de mille éléphants, qu'on tiendrait
captifs et affamés pendant une semaine, puis on les lâcherait
sur les réseaux qu'ils emporteraient comme des fils
d'araignées dans leur course affolée et irrésistible.
Derrière, l'infanterie française n'aurait qu'à s'engouffrer
dans la trouée.
Nos
rires sarcastiques déconcertèrent un peu la pauvre femme, et
ébranlèrent sa confiance dans la valeur du moyen. Mais tout de
même, elle y tenait "des personnes très autorisées me
l'ont affirmé, disait-elle. Vous me rabrouez toujours quand je
dis quelque chose". Elle faillit se fâcher, et l'affaire
en resta là.
Deux
jours après, l'ami Jacquet, adjudant au train, vint nous voir.
Nous lui racontons l'histoire des éléphants. Et nous rions de
la candeur du public, lorsqu'une idée diabolique traverse notre
esprit : "on va lui jouer un bon tour, à Mme
Pulliat". Là-dessus, Ravenet et Jacquet sortent dans la
cour. Du regard et du geste, ils en évaluent la superficie,
puis ils passent dans le verger, se montrent du doigt les murs,
les arbres, hochent la tête, discutent. Mme Pulliat, de sa
fenêtre, intriguée, les épiait. Ils entrent chez elle :
"Eh ! Bien, Madame fit Ravenet, je viens faire amende
honorable, c'est nous qui avions tort hier, à propos des
éléphants. Il en vient pour de bon.
-
Je vous disais bien. Mais vous vous me prenez toujours pour une
imbécile quand je dis quelque chose.
-
Oui, il vient d'en débarquer douze cents à la gare
d'Eméville. Mon camarade Jacquet que voici est chargé de
préparer un cantonnement - (En effet Jacquet était
spécialiste du cantonnement).
-
Il vient de regarder combien vous pouvez en abriter.
-
Mais je n'en veux pas.
-
Vous n'en voulez pas, Madame. Mais ces bêtes, il faut bien
qu'on les mette quelque part. On ne les loge pas (douze cents
éléphants) dans sa poche. Nous venons d'examiner votre cour
fermée, et votre verger clos de hauts murs conviennent bien, il
semble qu'on pourrait vous en mettre 500 environ.
-
Non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est toujours sur moi
qu'on tombe ! Qu'on les mette dans la cour du maire. - Y
choisissons toujours les femmes seules, attendez quand mon mari
reviendra.
-
Allons Madame, ne vous défendez pas si fort, il faut absolument
les loger. Tenez, pour vous arranger, au lieu de 200 on en
mettra seulement 200 !
-
Non, non, je ne veux pas qu'il en entre une seule de vos sales
bêtes. Elles me passeront plutôt sur le corps.
-
Sur le corps. Vous n'y songez pas, Madame. Un éléphant ça
pèse 4000 kilos fit Ravenet, railleur, de son air le plus
sérieux.
Et
la pauvre femme, crédule, s'énervant, se mit à pleurer.
-
Allons Madame, faites-vous pas tant de bile, on tâchera de
s'arranger, firent les deux compères, seulement il faut se
dépêcher d'arranger ça.
-
Et quand est-ce qu'ils viendront, fit-elle, résignée. Bientôt
?
-
Parbleu ! Mais ils sont en route. Ils vont être là dans une
heure ou deux.
Et
le gamin, qui était resté au milieu de la cuisine pendant la
discussion, partit dehors, dans la rue, appelant ses camarades :
"Les éléphants, y venions par la route de
Villers-Cotterêts !"
Et
le soir tout le village au courant de la mystification, se
réjouissait de la fantastique attente des éléphants :
"avez-vous vu les éléphants, se disaient les passants
!"
Un
soldat du Régiment a été encore signalé par la Gendarmerie
portant un cache-nez pendant le jour. Cet homme est puni de
quinze jours de prison dont huit de cellule.
Tous
les cache-nez portés dans cette condition seront immédiatement
retirés aux délinquants et brûlés en leur présence. Tout
gradé qui passera à côté d'un homme portant un cache-nez et
qui ne le fera pas détruire séance tenante et ne signalera pas
immédiatement le coupable sera cassé.
Le
Lieutenant-colonel est décidé à la première faute commise
dans ce sens à faire incinérer tous les cache-nez et
passe-montagnes.
Ordre du 42ème
Régiment d'Infanterie,
à
St-Pierre-Aigle
Signé Petit,
le 23 janvier 1915.
Cueilli lors de
la visite à Julien.
Note de service
Sous
prétexte de mériter peut-être le qualificatif de
"Poilus", par lequel on désigne actuellement les
militaires à la fois résistants, tenaces, braves, et hardis,
bon nombre de soldats laissent pousser outre mesure et leurs
cheveux et leur barbe.
Mais
pour être un vrai "poilu", il ne suffit pas d'être
sale et hirsute ; il faut avant tout le sentiment du devoir, le
cœur bien placé et être discipliné ; qualités
indépendantes du développement du système pileux.
MM.
les Généraux et les Chefs de Corps et de Service veilleront
donc tout spécialement à la tonte sérieuse des cheveux de
leurs hommes et à l'émondage de la barbe, surtout sur les
joues. C'est une question urgente d'hygiène de tenue et de
discipline.
De Villaret,
Le 15 février
1915.
Histoires du
Q.G. du 7ème C.P.
(récit de
Sarrazin)
Les petites
Schweinereien (vacheries).
Un
don de la colonie française de la Jamaïque contenait entre
cent petites choses diverses, de beaux cigares.
Ordre
d'en faire l'inventaire, et indication non moins ferme, de
réserver les beaux cigares... pour le Grand Manitou.
L'exemple
vient d'en haut.
Il
paraît même qu'au temps des paquets individuels anonymes, on
procédait à certain Q.G. à l'inventaire de ces paquets, avec
la précaution d'enlever tabac et cigarettes qui s'y trouvaient
(abstraction faite du beau linge pour officiers, trop beau pour
les poilus).
Une
autre fois, c'est l'arrivée de caisses de Cognac, de paniers de
champagne.
-
Jamais un vulgaire palais de simple soldat grelottant n'aurait
du déguster les marques les plus fines - Réservées - Et si en
haut on fait des réserves, l'exemple n'est pas perdu.
Intendant, sous-intendant, officiers gestionnaires et leurs
sous-ordres, chacun prélève son tribut - Certes il parvient au
front la majeure partie des dons, mais non pas la meilleure - et
c'est surtout pour le Principe que ces choses là sont
révoltantes.
Il
se répète également d'éhontées pratiques. Tel gros légume
a un quelconque invité un peu inattendu. Le Q.G. est mal
approvisionné, les ressources locales sont nulles. Vite on
dépêche un chauffeur et un sous-officier planton à la ville
voisine et Me. Du Navet peut offrir une côtelette fraîche qui
coûte dix francs d'essence.
Tel
autre petit Pacha a un ami à un Q.G. quelque peu éloigné ; la
correspondance est suivie. La voie ordinaire, bonne pour la
plèbe est lente et encombrée. Qu'à cela ne tienne. Il y a des
automobiles qui auront pour tout service dans la journée
d'aller porter une lettre personnelle. La course coûtera dix à
quinze francs d'essence, mais n'a t-on pas la franchise postale.
Et
ce capitaine du génie qui avait une auto et un chauffeur pour
aller tous les matins à la pêche à la ligne à une rivière
quelque peu éloignée, tandis que ses équipes se faisaient
sauter dans les tranchées.
-
Autre plaie -
Une
ambulance casse une roue de fourgon le 18 décembre : le 19,
demande écrite à la D.E.S. d'une roue de remplacement que doit
fournir le Parc d'Ambulance. La roue est arrivée en gare le 1er
février et le 6 février l'ambulance était à la recherche de
sa roue.
Les cyniques.
Rübelein
et son ami Jammer ont combiné une "partie carrée".
En
quête d'une maison accueillante et discrète, demande de
permission en règle, laisser-passer etc... et départ.
Le
soir, c'est l'ignoble et cru récit de l'orgie. Puis comme si ce
n'était pas suffisant, on corse l'aventure par l'envoi à la
femme, à la mère, d'un télégramme d'affection, bonne santé,
bons baisers.
Cela
s'appelle "bourrer le crâne" à sa femme.
Rübelein hat
einen Freund. Et ist ein Viveurfreund. Der ist Feldwebel am 42ème
Rég. Er wurde bei dem Gefecht um Soissons verwundet, eine
kleine Wunde am Kopf. Da wurde er einen Monat in einen
Feldlazarett gepflegt, gut gepflegt, sagt er, und besonders
durch die Schwestern, welche er, im Civilleben verbanden wollte.
Da hat er seine Frau mehere Wöchen bei ihm gehabt, und nun
scheint er Gott, Frau, Kind, Pflicht, alles Heilige zu
verspotten und doch, am Abend, bei Tisch, als das Gemüt zu
gewaltig wird, hat er einen schweren Angriff des Cafards, so
gewaltig er den Tränen nah ist. So sind viele Franzosen : sie
halten spottische Reden über die heiligsten Sachen, und im
Grund sind sie vielleicht gegen ihren Willen, gemütliche,
weiche, sanftmütige, ehrenvolle Leute.
Rübelein a
un ami, un bon vivant adjudant au 42ème
Reg. Il a été blessé lors de la bataille de Soissons, une
petite blessure à la tête. Soigné dans un hôpital de
campagne durant un mois, bien soigné, dit-il. En particulier
par les infirmières, avec lesquelles il aurait bien aimé se
lier dans la vie civile... Là, il eut sa femme près de lui
pendant plusieurs semaines, et maintenant il semble se ficher de
tout ce qu'il y a de sacré, Dieu, femme, enfants, devoir, et
pourtant le soir à table, quand les sentiments deviennent trop
prégnants, c'est un grand cafard qui l'étreint jusqu'à le
faire éclater en sanglots. Beaucoup de Français sont ainsi :
des discours les plus ironiques sur les choses les plus sacrées
de la vie mais d'un autre coté ce sont d'honnêtes gens d'une
grande douceur, sensibles et pleins d'amabilité.
Un cas
original :
Mon
ami Philippe a vécu la majeure partie de sa vie en Angleterre,
il a épousé une Anglaise... Pourtant à vingt ans il s'était
présenté au recrutement, avait servi trois années dans un
régiment de cuirassiers, puis était reparti pour reprendre sa
vie à Jersey. Vint la guerre. Il répond, dès le premier jour
à l'ordre de mobilisation. Ce n'est que son devoir, mais il ne
courait pas le risque de la contrainte...
Pourtant
il y a plus fort. Il a un frère, âgé de trente ans qui
jusqu'à la guerre n'avait jamais mis le pied en France, né en
Angleterre, élevé à Jersey, marié à Southampton, ayant un
commerce là-bas, tous ses souvenirs, toutes ses affections,
tous ses intérêts le rattachaient à l'Angleterre. A vingt
ans, il n'avait pas cru agréable ou utile, ou impérieux de
faire son service militaire... C'était un insoumis. Vint la
guerre. Immédiatement tout est bouleversé en lui sans doute.
D'un côté ses intérêts, sa sécurité. De l'autre la force
mystérieuse de sa nationalité, la crainte de vivre avec un
remords, et ceci balaie cela comme un fétu de paille, et sur
l'heure, dès le premier jour, il se présente en France, et le
voilà jeté dans la mêlée. Force mystérieuse des âmes ; le
devoir n'est pas un vain mot. L'intérêt ne prime pas
tout.
Le 12
mars 1915
M.
Moneil alité depuis quelques jours est évacué. Chacun est
consterné. L'on a comme la vague prescience qu'un malheur nous
frappe tous ou qu'il va nous arriver quelque chose de
malheureux.
Son
successeur n'inspire pas encore la même confiance. On se
demande avec quelque inquiétude si l'élévation de son rôle
ne modifiera pas son caractère. On craint que les quintes
d'amour-propre dont il a été atteint à quelques occasions -
rares il est vrai - ne vont pas devenir plus fréquentes et plus
âpres.
Pourtant
il est loyal, il est débrouillard, il est jeune et enjoué mais
je le sais ombrageux, au point de se forger de chimériques
craintes et d'imaginer des rivalités ou des familiarités
choquantes là où il n'y a que confiance dégourmée.
Le
15 mars - Herr Töpfchen est
parti pour trois jours. Il est allé voir son fils et la maman.
Veinard. Et il n'était pas content avant de partir... Or juste
pendant son absence, l'ordre de relève du convoi survient à
l'improviste. Je suis seul pour prendre toutes les décisions,
et toutes les mesures. Voici le dernier ravitaillement. Un ciel
gris, pénétrant, voile la plaine. (de Vivières à la ferme de
Duvy).
La
plaine monotone avec son horizon fade, où nous allons et venons
depuis tant de semaines. six mois exactement ! Oui, elle était
laide, elle était morne, elle était désespérante. Et voilà
qu'aujourd'hui où l'on me la laisse traverser pour la dernière
fois elle me paraît attirante et belle. Tout mon cœur
s'accroche à elle à mon insu. Une invincible tristesse
m'étreint et j'ai envie de pleurer en regardant ce repli de
terrain simple et monotone, avec ce hangar banal près desquels
nous sommes venus tant et tant de fois. En automne par les
matins dorés, en hiver par les tourments de neige comme par les
premiers sourires printaniers.
Et
toutes ces connaissances que l'on avait servies tant de fois
étaient devenues des familiers. Les uns si sympathiques que
l'on voudrait les connaître mieux pour mieux les aimer, en
faire des amis, de crainte que la mort ne nous en laisse point.
J'avais le cœur vraiment gros en disant adieu à M. Michel qui
a été l'intermédiaire et le témoin des joies les plus
grandes de ma vie, lorsque j'allais retrouver pour quelques
heures fugitives le frère devenu le frère bien-aimé.
Pauvre
Julien, j'aurai moins souvent la grande joie d'aller le
réconforter après chacune de ses épreuves dans la tranchée
ou sur le champ de bataille.
(...une
ligne illisible...)
...un
repos que nous n'avions pas sollicité. J'ai peur de cette mise
en réserve que nous y croupissions dans l'oisiveté, traînant
notre paresse et notre inutilité à cinquante kilomètres de
ceux qui se battent. Là-bas au moins quoiqu'on ne puisse
aspirer à la dignité de "poilu" on respire un peu de
cette odeur forte de l'âpre lutte, on participe de loin
peut-être, au grand sacrifice, on peut en percevoir les échos
et à l'occasion en récolter quelques miettes, et même risquer
aussi quelque peu. Et voilà qu'on nous ôte cette humble
satisfaction, qu'on nous retire ce modeste privilège. Passez
convoi d'armée ! C'est-à-dire convoi d'inutiles.
Si
encore j'avais des amis, des hommes, enfin pour aider à
supporter dignement ce sacrifice d'être inutile ! Mais je
prévois et je crains la marée montante des instincts pervertis
de Rübelein, des vagues de fond qui remuent la vase de
débauche qui s'étale en lui. Le gaspillage des bonnes choses
dont il ne sait pas le prix et qu'il vilipende ; les conflits et
sales histoires ou histoires sales qui naîtront inévitablement
des intrigues amoureuses qu'il va nouer, dénouer, combiner,
entrelacer à l'envi. Et Cœurdevey, sous peine d'abdication
morale devra se tenir à l'écart.
Départ
D'Haramont pour Duvy.
pour Duvy.
Abend, verlast
mich. Ich bin ganz allein. Das Gemüt ist gerührt. Ich bin
traurig und sehne nach Liebkosen. Ich erinnere mich die Liebe,
welche nach und nach ganz leise ins Hertz sich geschlichten hat.
Die B. hat so liebkosenden Augen. Ich widersetze. Doch ich muss
von ihr Abschied nehmen. Und gehe wie ein Raüber, durch Nacht
und Wald, noch einmal, ein letztes Mal zu MorelKreutz, dem
schönen Mädchen hin... Glücklicherweise der abschied ist
ehrlich geblieben. Sie ist doch so schön und so feurig. Bitte
um Verzeihung, Millchen, ich habe dich nicht getrogen. Nur eine
platonische Untreue. Liebe woh, freundlich.
Le soir,
qu'on me laisse. Je suis tout seul, l'âme émue. Triste et
nostalgique de caresses. Je me souviens de cet amour qui, peu à
peu, s'est doucement installé dans mon cœur.. B. a de si
tendres yeux. Je m'oppose à ces sentiments. Pourtant je dois
lui dire adieu. Je m'en vais comme un brigand à travers la nuit
et la forêt, une dernière fois à la Croix-Morel, vers cette
jeune fille... Heureusement l'adieu reste pur. Mais comme elle
est belle et passionnée! Je te demande pardon Milchen, je ne
t'ai pas trompé. Juste une infidélité platonique. Adieu...
Le
17 mars - J'étais arrivé un
jour en arrière pour initier nos successeurs aux travaux du
service. Ils paraissent pas mal embarrassés et le pire, peu
débrouillards. Je quitte le père et la mère Lefèvre à 8
heures du matin en vélo. Pourtant avant de partir ils m'ont
offert à déjeuner, le vieux pingre qui avait eu le front de me
faire payer quatre sous une bouteille vide lorsque je lui en
demandais une pour envoyer un peu de rhum à Julien. La
rapacité paysanne, quoi ! On ne laisse pas de son cœur à de
telles gens, quoiqu'on ait vécu tranquille deux mois sous leur
toit.
Le
17 mars - Arrivée à
Duvy . .
Un
asile de charme et de paix. Notre débrouillard Ravenet a
préparé un cantonnement de luxe. Nous sommes logés, officiers
et sous-officiers dans une villa. Ravenet a su manœuvrer pour
que la femme du jardinier, gardienne de la propriété en
l'absence de maître, nous fasse notre popote. C'est le rêve,
que cette villa de la Tour, et cela me réconcilie un peu avec
le repos détesté d'avance. Elle me rappelle un coin favori sur
les bords de l'Ognon, la villa de M. Vincent, l'industriel de
Loulans-les-Forges.
 C'est
au détour d'un vallon inséré discrètement dans la plaine du
Valois, si discret qu'on ne le soupçonne pas en sortant de
Crépy et qu'on suit la route toute droite à travers ces
immenses labours. Il n'est guère plus profond que les hauts
peupliers qui garnissent la dépression, guère plus large
qu'une écharpe ourlée du vert sombre des sapins et des
genièvres qui s'accrochent aux flancs abrupts. C'est
au détour d'un vallon inséré discrètement dans la plaine du
Valois, si discret qu'on ne le soupçonne pas en sortant de
Crépy et qu'on suit la route toute droite à travers ces
immenses labours. Il n'est guère plus profond que les hauts
peupliers qui garnissent la dépression, guère plus large
qu'une écharpe ourlée du vert sombre des sapins et des
genièvres qui s'accrochent aux flancs abrupts.
Un
ruisselet tranquille et abondant semble se promener dans ce coin
frais comme le compagnon bavard de la route blanche qui suit
toutes les sinuosités au bord de la colline - à l'un de ces
détours de petites digues redressent et ramassent les eaux et
les guident à travers un parc aux allées ombreuses avec des
recoins où les ifs, les sapins et les lierres mettent une
fraîcheur verte qui vous fait rêver de chaudes après-midi
d'été, toutes baignées de paresseuses siestes.
Au
bout des allées qui semblent s'appuyer à la colline la
maisonnette se mire dans l'écluse d'autrefois, car cette villa
remplace un vieux moulin, et l'écluse est devenue bassin et
cascade dans le jardin. L'eau chante jour et nuit en contournant
les corbeilles de fleurs, et de ma fenêtre j'écoute et je
découvre toute cette poésie champêtre. Cela me semble
étrange d'être dans ce calme, dans ce décor reposant, joyeux,
pacifique après n'avoir entendu pendant des mois que le
martèlement continuel du canon et durant les nuits sereines le
déchirement de la fusillade. Le contraste est violent et je
suis un peu honteux quand je regarde et savoure d'avance ces
bancs où je me propose de passer des heures calmes et
studieuses et quand je songe en même temps que là-bas, à
vingt-cinq kilomètres la même horreur des hommes s'entretuant
continue et règne en souveraine.
Le
comble du cynisme.
Der
Kerl Rübelein schrieb zu seiner Frau unserem neuen Lager so
früh als er ihn erfuhr, damit sie so rausch als möglich
könne.
(Rübelein
a écrit à sa femme depuis notre nouveau campement, dès qu'il
l'a su, afin qu'elle le rejoigne au plus tôt.)
La
pauvre se mit en route, télégraphia son arrivée prochaine à
la parente.
Dès
le second jour de notre installation ici nous eûmes quelque
liberté que Rübelein mit à profit pour aller faire une
excursion dans les parages... Il m'emmena avec lui, et ce fut
une agréable partie de cheval à travers une campagne paisible
- choses nouvelles pour nous. Arrivés à N. le H. nous rencontrâmes la tante qui nous annonça l'arrivée de la
nièce à six heures du soir. Il en était quatre. Chose
bizarre, R. eut un souci de la fonction et de la discipline
auquel il ne nous avait point accoutumés. Il ne voulut pas
attendre. Et nous rentrâmes, lui aussi calme que moi. C'était
un sujet d'étonnement qu'il montrât si peu d'enthousiasme pour
revoir une femme qu'il dit aimer et qu'il a quittée depuis huit
mois. Ils sont pas mal enviés, ceux qui ont ce furtif bonheur
de revoir leurs femmes pour couper d'une trêve, l'austérité
de la longue campagne.
nous rencontrâmes la tante qui nous annonça l'arrivée de la
nièce à six heures du soir. Il en était quatre. Chose
bizarre, R. eut un souci de la fonction et de la discipline
auquel il ne nous avait point accoutumés. Il ne voulut pas
attendre. Et nous rentrâmes, lui aussi calme que moi. C'était
un sujet d'étonnement qu'il montrât si peu d'enthousiasme pour
revoir une femme qu'il dit aimer et qu'il a quittée depuis huit
mois. Ils sont pas mal enviés, ceux qui ont ce furtif bonheur
de revoir leurs femmes pour couper d'une trêve, l'austérité
de la longue campagne.
Le
lendemain soir il se proposa d'aller enfin retrouver sa femme.
Mais à midi, à la popote, deux femmes vinrent "prendre de
nos nouvelles". C'était la jeune femme d'Haramont, la
fille de notre hôtesse, devenue la maîtresse de Jammer, avec
une cousine à elle, d'Haramont également et dont le mari aussi
est prisonnier. Je ne la connaissais pas et Rübelein l'avait
vue, quelquefois l'avait repérée mais sans réussir à pousser
plus loin l'aventure que les premières passes d'approche.
Or
l'une avait amené l'autre pour se tirer un peu de honte,
d'autant plus que la dernière avait avec elle son bébé.
Visite courte, elles prennent le café avec nous - reconduite à
quelques pas par Jammer et Rübelein. Celui-ci, aguiché depuis
Haramont pour cette audacieuse assez jolie femme, se prend au
jeu, que dis-je s'enfonce dans le jeu et nos deux compères
prennent rendez-vous pour le soir au village voisin avec les
deux commères...
Le
soir vint. Rübelein sait que sa légitime épouse est arrivée
de la veille et l'attend. Et, cyniquement s'en va avec Jammer
faire une "partie carrée" avec cette passante... Le
matin, à l'aube il rentre, la figure ravagée par une nuit
d'orgie. Mais comme il a promis et demandé au Chef sa journée
pour être avec sa femme, humide de la sueur infâme il s'en va
effrontément embrasser la mère de sa fillette, la jeune et
jolie épouse qui se morfond.
Le 1er
avril 1915
Une
tournée de réquisition.
C'est
une magnifique journée de printemps. Dans l'air vif flotte
déjà une odeur chaude. Ravenet et moi pédalons sur la route
qu'enserre la vallée où s'égrènent des hameaux. Nous
descendons à la mairie de Glaignes où la jeune institutrice
fait fonction de secrétaire. Une jolie brunette rougissante,
tout apeurée d'être en tête-à-tête avec deux gaillards
galonnés et peu timides. C'est elle qui nous donne quelques
renseignements sur les divers fermiers du hameau. Munis de ses
indications - très vagues - car elle n'est pas encore guère
pénétrée par les contingences rurales, nous avisons une
ferme, "Tenez, nous dit une vieille, voilà la patronne
dans le coteau". Et nous escaladons la pente pour joindre
la patronne qui est en train de rouler un blé.
"Voyez,
c'est les femmes qui sont obligées de conduire les chevaux
puisque nous n'avons plus d'hommes" dit-elle en arrêtant
son attelage.
C'est
une forte paysanne, charpentée à la serpe, mais de carrure
solide et avec un air d'intelligence plus massive encore.
Pourtant,
elle mène la tâche utile, mieux qu'une femme affinée et
délicate. Elle n'a pas l'air accablée de continuer l'âpre
lutte avec le sol que les paysans en partant ont léguée aux
femmes et aux enfants. C'est Ravenet qui mène l'interrogatoire
:
-
Nous cherchons de l'avoine, Madame, vous en avez quelque peu ?
-
J'en aurions si elle était battue, mais j'avions déjà
emprunté celle que j'ai semée.
-
S'il ne s'agit que de la battre, je m'en charge.
-
Vous ? Comment ? Fit-elle en souriant.
-
Oui Madame, j'ai une équipe d'ouvriers. Combien auriez-vous
d'avoine ?
-
Je ne sais pas. Je ne m'occupais pas de cela. Il faudrait un
homme pour le dire !
-
Oui, mais vous savez à peu près combien vous avez de gerbes ?
-
A peu près 1200. Peut-être plus, peut-être moins.
-
Bien, 1200 gerbes, cela fait environ 40 x.
Mais
la grand-mère qui s'est rapprochée et qui voit bien qu'on lui
enlève son avoine s'interpose :
-
Mais y nous la faut pour nos chevaux.
-
Combien avez-vous de chevaux ?
-
Trois.
-
Bien, à quatre kilos par jour et c'est la bonne mesure, vous ne
leur donnez pas plus de quinze litres par jour, n'est-ce pas,
cela fait donc 3 quintaux par mois. D'ici la première récolte
il vous faut 20 quintaux au plus. Donc il vous reste 20 quintaux
de disponibles. Vous nous les fournirez. Je vous les achète et
je vous aiderai à les battre. Si vous préférez, je vous
réquisitionnerai votre avoine.
Mais,
crie la pauvre femme, il nous en faut plus que cela, jamais nous
n'en vendrons 20 quintaux. Déjà que cette année les allemands
et les dragons ont pillé je ne sais combien dans la meule. Je
ne sais pas ce qu'il reste, mais il n'y en a pas de trop pour
nos chevaux et pour rendre celle que j'ai empruntée.
-
Madame, d'un côté comme de l'autre il me faut de l'avoine. Si
vous ne voulez pas la vendre je la réquisitionne. Ce n'est pas
votre avantage. En la vendant, je vous paie tout de suite.
-
Oh ! Oui, vous racontez toujours cela, et rien de ce qui a été
réquisitionné n'est encore payé.
-
Et puis c'est toujours sur elle qu'on tombe, fit la vieille. Il
y en a qui sont plus riches qu'elle et qui touchent des
allocations. Celles-là vivent de leurs rentes, pendant qu'elle
- sa fille - s'éreinte à travailler et ne peut rien toucher.
-
Vous déplacez la question, Madame, cela n'a rien à voir avec
l'avoine. Je vous en prends 20 quintaux. Là-dessus la jeune
femme se met à sangloter.
-
Eh ! Bien, prenez tout ce que vous voulez, vous viendrez
cultiver à notre place. Il faut tenir la terre et vous nous
prenez tout.
-
Oui vous prenez tout et vous donnez les allocations à celles
qui ne les méritent pas, fait la vieille en montant le ton.
-
Madame, croyez-vous que cela soit pour moi bien amusant. Ce
n'est pas mon métier, ni pour mon plaisir que je viens chercher
votre avoine. Il en faut à tout prix pour l'armée.
-
Oui, mais que ce ne soit pas toujours sur les mêmes qu'on
tombe.
-
Cela ne me regarde pas.
-
Si, cela vous regarde.
-
Permettez-moi de vous dire Madame, que vous vous mêlez de ce
qui n'est pas votre affaire. Ce serait les Prussiens qui vous la
demanderaient, votre avoine, vous tomberiez à genoux et leur
donneriez tout ce qu'ils voudraient.
-
Pardi, et les hommes quand ils sont pris par les allemands,
est-ce que vous n'en faites pas autant.
-
Madame, parlons d'avoine. Vous n'en voulez pas vendre, eh bien
je vous en réquisitionne 20 quintaux.
-
Prenez ce que vous voudrez, voleurs !
Et
Ravenet tourne les talons, descend la pente pour mettre fin à
cette pénible scène, où il y a de l'injustice et de
l'inintelligence de part et d'autre.
Ravenet
a d'abord fait un compte de charlatan en tablant sur 20 quintaux
disponibles. Tout au plus - on le sait après - peut-elle en
céder 10 quintaux et c'est une brèche énorme dans un petit
train de culture que rafler 10 quintaux de plus.
La
fermière par contre, ne sait pas voir l'exagération
systématique du bourreur de crânes. Elle s'émeut, se bute, ne
sait pas transiger, soupçonne l'injustice et pleure.
Pauvres
paysans, c'est de vos sueurs que la France se renouvelle, se
soutient. Les gouvernants vous arrachent encore le sang et les
larmes.
Notre
tournée s'est continuée avec moins de tragique. Ailleurs nous
avons trouvé des paysannes moins effarées, ou bien la saignée
que nous voulions faire était-elle par hasard moins
douloureuse. Par endroits nous avons même été bien
accueillis, et le maire de Morienval lui-même gros fermier nous
a offert deux chambres pour receler nos femmes.
Jours de
printemps.
Les
jours sereins sont revenus dans la nature. Les violettes et les
coucous s'épanouissent avec l'ardente espérance des années
pacifiques. Dans notre vallon de Duvy, tout semble plus
tranquille encore. Dans la plaine, on ne voit pas cette
activité remuante de nos campagnes morcelées où une foule
d'attelages et de familles s'occupent à éveiller le sol
fécond. Est-ce le résultat de la guerre, mais ici la campagne
est presque déserte par ces beaux jours de printemps. A peine
dans un coin de la plaine remarque-t-on le halètement discret
d'une charrue à vapeur et le va-et-vient puissant des socs
accouplés, ailleurs, un attelage de bœufs parachève le labour
de la machine et un semoir traîné par 4 chevaux dépose sans
poésie et sans bruit la semence prometteuse d'une incertaine
récolte.
Mars.
Les beaux
jours de printemps.
Les
terres fermes, les routes praticables : tout ce que l'on disait
nécessaire à la reprise des opérations est revenu. Et les
opérations restent suspendues.
Jamais
un calme aussi complet ne s'était fait remarquer depuis le
début de la guerre. On est tout surpris de remarquer
l'immobilité persistante des armées. Chaque matin on guette
l'arrivée du journal dans l'espoir d'une indication nouvelle,
d'un succès en cours, en préparation. Et toujours la même
petite déception : "Rien de nouveau à signaler sur le
front".
De
même on épie l'annonce d'un nouvel arrivant dans le conflit.
Bulgares, Grecs, Italiens, Roumains ? Et depuis des mois que la
presse attise les espoirs, assure la très prochaine
intervention de l'un, puis de l'autre, la même neutralité
équivoque règne parmi les chacals. Pas un ne bouge. Il ne voit
pas encore distinctement lequel des belligérants fournira la
charogne à dépecer. Et ils guettent l'heure propice et
l'indication définitive, irréfutable. En attendant, ils
aiguisent leurs dents et la France reste impassible, attend sans
fièvre que le signal lui soit fait de donner le coup de boutoir
énergique qui doit faire râler l'adversaire et devenir le
signal de la curée. Est-ce aux Dardanelles que le coup portera
?
Pâques
- C'est Pâques ! Un Pâques en pleurs. Il bruine dans un
paysage désolé pendant qu'on entend à l'horizon voisin
éclater les obus... En ce jour de fête c'est lugubre. Il
semble qu'il pleut des larmes, tant c'est triste cette pluie, ce
jour de Pâques dans l'angoisse de la guerre.
Semaine
de Pâques - un beau rêve qui retombe...
Dimanche
de Quasimodo - La Revanche joyeuse du triste Pâques. Il faut un beau soleil
avec une bise guillerette qui vous stimule. J'ai obtenu -non
sans peine et gros émoi et secousse comme pour un conflit- la
permission d'aller faire une randonnée jusqu'à Julien. Déjà
le dimanche des Rameaux, j'avais pu le rejoindre après une
très longue course par Pierrefonds où je gagnais encore (?)
le Vieux Château, par Courtieux où je fus accueilli à bras
ouverts par Maugras, puis Ressons où je ne fis qu'une halte et
où l'on me renvoya jusqu'à Laversines que j'atteignis vers le
soir - au retour une auto avec Sara...
- La Revanche joyeuse du triste Pâques. Il faut un beau soleil
avec une bise guillerette qui vous stimule. J'ai obtenu -non
sans peine et gros émoi et secousse comme pour un conflit- la
permission d'aller faire une randonnée jusqu'à Julien. Déjà
le dimanche des Rameaux, j'avais pu le rejoindre après une
très longue course par Pierrefonds où je gagnais encore (?)
le Vieux Château, par Courtieux où je fus accueilli à bras
ouverts par Maugras, puis Ressons où je ne fis qu'une halte et
où l'on me renvoya jusqu'à Laversines que j'atteignis vers le
soir - au retour une auto avec Sara...
C'est
ce jour-ci que je vais retrouver Julien à Laversines où il est
au peloton des élèves officiers. Voyage par
Villers-Cotterêts, où je prends en passant un énigmatique
colis de Pâques. Puis j'arrive à midi, Frossard m'invite à
dîner ; Julien est avec moi, nous nous promenons une bonne
partie de l'après-midi sur le flanc de la colline. Après,
c'est l'envoi des ordinaires cartes à nos chers.
Retour
en vélo toujours über Coeuvres wo ich Louis Girard und Sara
grüsse, dann über das beliebte Kreuze Morel, wo ich ams
Abendessen mithielt. Nach den Abschied der ganzen Familie, kommt
der Abschied des armen sehnsuchtigen Fraüleins. Einige heftige
Küsse, ein Versprechen, eine Beruhigung, dann weithin,
weithin... Ich springe beim Bahnhof Emeville ab, grüsse den
Bahnhofmeister, und finde mein Bett um Mitternacht wieder, die
Seele übervoll von Freude. Es war Sonntag in mir...
Retour
en vélo toujours par Coeuvres, où je salue Louis Girard et
Sara. Après cette familière Croix-Morel où je partageais le
dîner. Après des adieux nostalgiques à toute la famille, à
la pauvre demoiselle. Quelque ardent et passionné baiser (?),
une promesse, des mots rassurants, et enfin partir, partir... Je
saute jusqu'à la gare d'Emeville, salue la le chef de gare et
je retrouve mon lit vers minuit, l'âme débordant de joie. En
moi, c'était dimanche...
Avril
-
Avril,
le mois joli. La bise s'est faite douce, caressante et tout
semble frémir de l'ivresse du renouveau. Les premières fleurs
pointent à l'envi et jusqu'au fond du vallon étroit, humide,
presque boudeur, les noirs buissons se mettent en émoi. Il fait
un temps splendide. Mais il est difficile de s'abandonner à la
griserie du printemps. A toute minute, même à la distance où
nous sommes du front de bataille, on peut percevoir dans le
lointain comme un gémissement sourd et prolongé les énormes
explosions. Ce sont des symboles, ces bruits assourdis par la
distance, comme les plaintes étouffées des âmes dans
l'angoisse, tandis qu'en même temps, le printemps épanoui nous
invite à l'espoir. Oui la France souffre et les plaintes sont
étouffées ; la France espère, mais la crainte paralyse les
chants d'espoir. Chaque jour on attend du nouveau. On a cru tout
l'hiver que le printemps ramènerait les hostilités plus
violentes, et le front reste calme, mais avec quelque chose de
serein, de puissant, d'énigmatique.
Nous
ne tremblons plus à l'arrivée des nouvelles, anxieux de savoir
si elles n'annonceraient pas un désastre - comme c'était le
cas en octobre, novembre, décembre. Chacun est rassuré - la
certitude de la résistance solide renaissait peu à peu à
mesure que les mauvais jours étaient passés, en janvier,
février. Maintenant c'est la certitude de la victoire qui
s'infiltre peu à peu dans tous les cœurs, la conviction que
l'armée allemande est impuissante est établie, et c'est même
de l'impatience à faire la poussée générale que l'on croit
nécessaire et suffisante, impatience parmi les troupes, parmi
le public.
Puis
les jours passent, sans rien apporter que des affaires de
détail, alors l'on prend peu à peu conscience que l'heure
n'est pas arrivée et que Joffre veut encore attendre - Joffre !
- comme il décidera ce sera bien. Il juge qu'il faut attendre.
Attendons, et la France docile attendra. Et les femmes sont
aussi patientes que les hommes. Tant qu'il faudra... Qui eût
cru à une telle ténacité, à cette froide énergie de nos
femmes, de nos Français raffinés ?
Mais
quand même on attend : chaque soir on se dit : qu'est-ce que
demain apportera ? Et chaque matin un flux de curiosité
impatiente soulève et précipite vers le premier journal :
encore rien - un communiqué officiel de quelques lignes...
Mais
ce n'est plus nos communiqués qui ont la primeur des
curiosités : l'Italie. Depuis si longtemps qu'on nous berce
avec cet espoir que l'Italie viendra à la rescousse, qu'elle
attend la fonte des neiges sur les Alpes... La neige fond, mais
l'Italie n'ôte pas son voile.
Elle
reste énigmatique... et cela devient irritant. La sœur latine,
pour qui nous avons versé notre beau sang à Magenta sans tergiverser ni marchander, comme elle est dure à la
reconnaissance. Comme elle se couvre d'un épais manteau qui lui
donne des airs de vieille tireuse de cartes, qui vous
détrousserait à l'occasion. Un chacal qui flaire d'où vient
le vent et cherche vers la meilleure charogne. Les politiques
les plus effrontément égoïstes continuent à régler les
rapports des nations. Rien n'est changé et les peuples
éclairés sur leurs intérêts apparaissent encore plus fourbes
et plus âpres au gain que les despotes d'autrefois, à tous les
siècles de l'histoire. Il faut revoir le livre d'A. Sorel sur
la diplomatie au XVIIIème siècle
sans tergiverser ni marchander, comme elle est dure à la
reconnaissance. Comme elle se couvre d'un épais manteau qui lui
donne des airs de vieille tireuse de cartes, qui vous
détrousserait à l'occasion. Un chacal qui flaire d'où vient
le vent et cherche vers la meilleure charogne. Les politiques
les plus effrontément égoïstes continuent à régler les
rapports des nations. Rien n'est changé et les peuples
éclairés sur leurs intérêts apparaissent encore plus fourbes
et plus âpres au gain que les despotes d'autrefois, à tous les
siècles de l'histoire. Il faut revoir le livre d'A. Sorel sur
la diplomatie au XVIIIème siècle ou Machiavel, ou les propos de Frédéric II. De bas
marchandages perpétuels soit en serrant le poing, soit en
remuant le sabre, soit aujourd'hui en fondant des canons. Et les
Roumains qu'on nous annonçait entrer en campagne en fin
février sont plus énigmatiques que les Bulgares eux-mêmes...
Comme on sent bien le jeu intéressé : le plus de profits avec
le moins de risques.
ou Machiavel, ou les propos de Frédéric II. De bas
marchandages perpétuels soit en serrant le poing, soit en
remuant le sabre, soit aujourd'hui en fondant des canons. Et les
Roumains qu'on nous annonçait entrer en campagne en fin
février sont plus énigmatiques que les Bulgares eux-mêmes...
Comme on sent bien le jeu intéressé : le plus de profits avec
le moins de risques.
Où
est la politique sentimentale de St-Louis, de Louis XV et de
Napoléon III ?
Pour
écouler la longue attente dans l'oisiveté, ces jours-ci,
j'étudie à nouveau l'histoire de la formation des
nationalités au XIXème siècle.
Das
schamlose Rübelein mit seinem Freund Jammer haben sich als
verheiratete Männer einer alten Frau vorgestellt, und haben ihr
zwei Zimmer gemietet. Am folgenden Tag kamen die zwei Vögel an.
Die Freunde hatten vermutet das die Weiber erst für einige Tage
zu ihren Verfügungen kamen sich stellen ; aber die Eltern
hatten bei den ersten Ausflug die Wahreit vermutet. Sie
widersetzen sich energisch einem neuen Abschied der jungen
Frauen, und die jenigen brachen die letze Brücke, schimpften
sich mit ihren Eltern, nahmen das Kind mit, und hatten die
Absicht hier ewig bleiben, ewig wie die Liebe... Das flüsterte
ins Ohr zu Rübelein sein Schatz. Erste Wolken. Doch wurde das
Fest schön. Aber am folgenden Tag suchte er schon ein Mittel um
sie bald abzuschieben. Nichts weiter als eine Woche diese
Maitresse zu haben. Das Wandern ist des Müller Lust... Dieses
ist doch tüchtig, erzählt er. Und ich muss jeden Morgen das
compte rendu der vorgen Nacht hören. Kein Taktgefühl. Keine
Scham. Und die zwei Paare haben eine Tauschen vor... Aber der
Jammer ist nach zwei Nächten kraftlos, ohnmächtig, er weigert
sich gegen eine neues Fest. Er kann nicht. Und Rübelein hat die
Verwegenheit mich als Ersätzer zu bitten. Dank schön... Er
sicht nicht den écœurement welchen ich fühle... Also er
bleibt allein. Das ist nicht so schön, und er ist bald müde
des Weibes. Er erzählt ihr dass sie entdeckt wurden. Die Gefahr
ist gros... Sie soll abreisen... Sie versteht die Lage und ist
entschlossen sich zu entfernen. Dann sagt er ganz
romantischerweise : Ich habe dich zu lieb, bleibe. Um so
schlimmer. Und sie antwortet : Nein, diese Opfer nehme ich nicht
an. Samedi 24 avril - Abend. Rübelein geht aus meinem Zimmer.
Er hat mich vor dem Bettgehen besucht und geschleicht... Was hat
mich dann bedroht. Lügner, Lügner. Ich lese in seinen Spiel.
Er hat demütige, freundliche, Zuvorkommenheit. Gebe acht...!
L'effronté
Rübelein et son ami Jammer se sont présentés à une vielle
dame comme des hommes mariés et ils lui ont loué deux
chambres. Le jour suivant, les deux loustics arrivèrent. Les
amis avaient tout d'abord cru que les "bonnes femmes"
arrivaient pour quelques jours, à leur disposition, mais les
parents ont suspecté la vérité lors de leur première
excursion. Ils se sont énergiquement opposés à de nouveaux
adieux des jeunes femmes. Et celles-ci ont coupé les ponts, se
disputèrent avec leurs parents, emportèrent l'enfant et
prétendirent rester là éternellement, éternellement comme
l'amour. Son "trésor" chuchotait tout cela à
Rübelein. Premiers nuages. La fête fut belle quand même. Mais
le jour suivant, il cherchait déjà un moyen pour la renvoyer
bientôt... Pas plus d'une semaine par maîtresse! "Das
Wandern ist des Müllers Lust" .
Ceci est raconté scrupuleusement. Et je dois écouter tous les
matins le compte-rendu de la nuit. Pas question de tact ni de
honte et les deux couples ont prévu de s'inverser, mais notre
Jammer est sans forces après deux nuits, évanoui, il refuse
une nouvelle fiesta, il ne peut plus. Et Rübelein a
l'effronterie de me demander de le remplacer. Merci bien...! Il
ne voit pas l'écœurement que je ressens. Alors il reste seul.
Ce n'est pas si "drôle"que ça d'être fatigué des
femmes. Il lui raconte qu'on va bientôt les découvrir, que le
danger est grand, qu'elle doit partir. Elle comprend la
situation et est décidée à s'éloigner. Ensuite très
romantiquement il lui dit : "je t'aime trop, reste! Tant
pis". Elle répond : "non, je n'accepte pas ce
sacrifice". Samedi 24 avril - Le soir. Rübelein sort de ma
chambre. Il m'a rendu visite avent le coucher et s'est éclipsé
furtivement. Il m'a fait des reproches. Menteur, menteur... Je
lis dans son jeu. Il paraît aimable, humble, prévenant. Fais
attention...! .
Ceci est raconté scrupuleusement. Et je dois écouter tous les
matins le compte-rendu de la nuit. Pas question de tact ni de
honte et les deux couples ont prévu de s'inverser, mais notre
Jammer est sans forces après deux nuits, évanoui, il refuse
une nouvelle fiesta, il ne peut plus. Et Rübelein a
l'effronterie de me demander de le remplacer. Merci bien...! Il
ne voit pas l'écœurement que je ressens. Alors il reste seul.
Ce n'est pas si "drôle"que ça d'être fatigué des
femmes. Il lui raconte qu'on va bientôt les découvrir, que le
danger est grand, qu'elle doit partir. Elle comprend la
situation et est décidée à s'éloigner. Ensuite très
romantiquement il lui dit : "je t'aime trop, reste! Tant
pis". Elle répond : "non, je n'accepte pas ce
sacrifice". Samedi 24 avril - Le soir. Rübelein sort de ma
chambre. Il m'a rendu visite avent le coucher et s'est éclipsé
furtivement. Il m'a fait des reproches. Menteur, menteur... Je
lis dans son jeu. Il paraît aimable, humble, prévenant. Fais
attention...!
Dimanche
25 avril - Encore
une visite à Julien. La 16ème paraît-il. Et
celle-ci dans le cadre heureux d'un parc non dévasté, avec la
bonne nouvelle de promotion... A Ressons-Le-Long . .
Mercredi
28 avril - C'est
le soir. Presque une soirée d'été tant l'air est tiède et
caressant. Nous soupons dans le jardin, et la nuit est venue
avec toute sa puissance d'émotion. Le cadre est infiniment
heureux. D'un jardin d'air monte le parfum des premières fleurs
et le frisson des bourgeons qui gonflent à éclater, le
ruisseau chante sur l'écluse et dans le bosquet voisin les
oiseaux attardés se font de nocturnes confidences...
Mes
camarades causent, plaisantent, rient. L'un berce l'accordéon
qui rappelle les airs simples et frustes qui ravissaient mon cœur
à dix huit ans... La jeune mère joue avec son bambin. Je
n'entends rien mais je suis vaguement bercé par tous ces airs
et bruits familiers. Et mollement caressé par ces impressions
de paix heureuse je me grise du bonheur rêvé : avoir une femme
et des enfants dans un jardin à soi, et s'y refaire le cœur et
l'âme.
Tout
à coup sur le viaduc voisin qui barre le vallon un train arrive
en rafale comme un reproche cinglant à notre quiétude.
Il
s'enfonce violemment avec quelque chose de puissant et d'anxieux
dans la nuit après avoir jeté l'éclair de ses phares. Il est
chargé de troupes. Il va vers le Nord où la bataille fait
rage... Des hommes sont là, fiévreux, haletants, prêts aux
furieuses hécatombes, qui vont être jetés dans la
fournaise... et nous savourons la douceur d'un beau soir dans
les jardins d'une villa !
Mais
l'ébranlement s'apaise peu à peu. Le calme est revenu, avec
quelque chose de grave et de douloureux. Ce jardin est beau,
cette soirée est sereine ; mais ce n'est pas la douceur
rêvée. J'évoque le grand verger un peu fruste où il ferait
meilleur encore qu'ici. Et ce soir, sans doute, il est désert.
Le père sommeille dans son fauteuil, la mère songe anxieuse
sur le banc près de la porte, les sœurs vaquent en causant à
voix basse aux derniers travaux du jour, et le frère chéri
écrit peut-être une carte aux absents, aux dispersés : l'un
en Alsace dans quelque tranchée à demi enterré, l'autre sur
les rives de l'Aisne, en cantonnement d'alerte, et moi, ici,
paisible et tranquille, mais tout seul... Et des milliers de
femmes pleurent dans la nuit.
Le 3
mai 1915
Grande
randonnée sur le front.
Je
suis arrivé vers midi à Ressons, près de Julien. J'avais
apporté une collection de photos des groupes pris à la
précédente visite. Il faudrait voir quelle ruée vers moi, à
mon arrivée dans la cour du château pour avoir les résultats.
Quelle curiosité ardente. Et la joie des uns et la déception
de ceux qui s'écartent subitement en disant : "pas de
chance, je suis coupé..."
Puis
ce sont de nouvelles prières. Avez-vous votre appareil ?
Voudriez-vous
nous prendre nous trois ensemble ? Il ne me restait plus qu'une
pose quand trois bleus, au visage enfantin sont venus avec des
regards suppliants et ardents : "Je ne le suis pas encore
sur aucune". J'avais réservé cette pose pour Julien et
moi. Je le leur dis, mais je lis leur chagrin si grand que je
les rappelle. Nous ce sera pour une autre fois, nous avons
déjà été pris deux fois. Allons placez-vous...
C'est
une grande joie pour eux et un peu touchant pour moi. Vers
quatre heures, je pars pour St-Christophe. Le ciel est
magnifique, la nature prometteuse et malgré les détonations
toutes voisines des canons, le sillage aigu des obus par-dessus
les têtes, la vallée est en plein travail de semailles...
Partout des attelages de quatre grands bœufs blancs ou de trois
percherons. Et la voix des bouviers alterne avec les coups de
feu. Ceux-ci sont devenus une habitude, on ne les remarque plus
presque et l'on s'attache avec plus de curiosité mêlée de
surprise à tous ces bruits des champs. On dirait un jour de
fête tant il fait beau et la verdure aux jeunes teintes si
variées enveloppe les jardins et vergers blancs. Mais sur la
grande route de Soissons, avec sa double rangée de peupliers,
on ne rencontre pas de civils : des soldats de toutes armes, et
même spectacle original et rare, à l'abri le long de la haute
pile des blocs de grès de la gare de Vic, on relève la garde
avec la sonnerie du clairon ! St-Christophe ! Le malheureux
village me semble encore plus maltraité... La tombe est déjà
souillée par les orties. On l'a délaissée. Pourtant un ami
est venu, car il y a sur le mur une inscription nouvelle :
"prière d'entretenir la tombe, la famille viendra le
relever", et sur chaque tombe une bouteille avec
l'indication des noms et du corps.
Je
fais la toilette de la tombe, je plante quelques fleurs, je
dépose les violettes des amies lointaines. Pauvre Grand. Dans
un jardin voisin, je vais cueillir une gerbe de lilas... Je
voudrais de l'eau. Le village dévasté semble désert. J'entre
dans une cour où l'on devine à je ne sais quoi un reste de
vie. La porte de la maison est entrouverte, j'aperçois une
vieille de soixante douze ans. Elle est une des huit habitantes.
Elle ne veut pas s'en aller.
-
Où irais-je ? Chez ma fille ? Elle a déjà quatre enfants sur
les bras.
-
Mais vous risquez d'être tuée à toute minute.
-
Oh ! Fit-elle, s'ils me tuent, ils en ont bien tué de plus
jeunes que moi... Je l'ai déjà échappé bien des fois.
En
effet, il manque à sa chambre la moitié de la muraille.
J'étais assise près du lit, m'explique t-elle. Tout a été
renversé, mais je n'ai pas eu de mal. La brèche a été
masquée avec des couvertures.
Et
il y a trois jours, un éclat d'obus a traversé les
couvertures, pénétré dans la chambre et cabossé le tuyau de
poêle. Tout l'hiver elle a soigné les soldats.
Je
méritons bien une récompense pour être restée,
hasarde-t-elle. Sans nous qui est-ce qui aurait fait la soupe
aux soldats...
-
Est-ce qu'ils s'en iront bientôt ?
-
Je ne sais pas. Encore deux ou trois mois à attendre...!
-
Tant que ça... Je ne l'aurais pas supposé. Si seulement je
pouvais bêcher mon jardin, mais ils le remuent tout le temps...
et on n'est jamais tranquille un moment avec leurs obus...
Pauvre
vieille, quels liens les attachent donc ces vieux à ce coin de
sol dévasté ? Je causerais bien encore avec elle, mais il se
fait tard. En route, l'orage. Kreuz m'hébergea.
Les
5 et 6 mai - Soirs
lourds d'inquiétude. Les nouvelles sont dures !
On
ne parle qu'à demi mot de la bataille d'Ypres, de l'attaque des
Dardanelles engagée à fond : on souligne les difficultés, on
parle des troupes turques bien équipées, attaquant avec
fougue... Cela ne doit pas aller. Et les Russes... on ne nous en
souffle plus un mot, alors qu'on lit dans un coin de journal,
comme une chose insignifiante que Berlin et Vienne pavoisent car
le front russe serait brisé sur la Drina...
Et
l'Italie ? Espoir suprême qui se fait désirer comme une
coquette supra-rouée... On compte sur elle, d'heure en heure,
voici la cérémonie significative du Quarto. Le Roi y sera.
C'est un premier coup de canon ! Et ce soir un télégramme
énigmatique déclare que le Roi n'ira pas au Quarto .
L'Italie recule. Elle ne versera pas une goutte de sang ni pour
elle ni pour nous. On désespère. L'heure est lourde. Des
vagues de découragement déferlent sur les cœurs. Je dors mal
et pourtant j'espère. .
L'Italie recule. Elle ne versera pas une goutte de sang ni pour
elle ni pour nous. On désespère. L'heure est lourde. Des
vagues de découragement déferlent sur les cœurs. Je dors mal
et pourtant j'espère.
7
mai - Des vagues d'espoir déferlent sur les cœurs...
L'Italie a déclaré la guerre dit-on, - c'est une fausse
nouvelle d'hier au soir.
Mais
aujourd'hui les pseudo-victoires allemandes en Galicie sont
démenties. Les Russes tiennent bon et les nouvelles italiennes
s'accusent à des riens que l'heure est proche.
Ce
soir, nouveau bruit donné comme officiel : elle aurait envoyé
un ultimatum à l'Autriche...
8
heures du soir.
L'ultimatum
officiel a bien été envoyé mais c'est du Japon à la Chine...
La confusion est plaisante. Et c'est un officier qui l'a
rapportée (Larcher).
8
mai - Horreur ! Les bandits ! Ils ont coulé le
Lusitania. Je n'y ai ni parent ni ami et mes cheveux se dressent
d'horreur. Je suis agité comme par la fièvre et les larmes
m'ont giclé des yeux quand j'ai lu l'en-tête du journal. Mon
Dieu ! Il n'y a pas d'expression pour traduire l'indignation
d'effroi, la colère, la pitié, la haine, l'effarement qui tous
en même temps me secouent. Le Lusitania ! Le paquebot géant,
l'orgueil de la civilisation matérielle avec ses deux mille
habitants, une ville flottante anéantie et coulée froidement dans les eaux glauques : Oh ! Les corps
éperdus qui se débattent par centaines ! Des femmes, des
enfants, des neutres férocement châtiés d'avoir accepté les
services de la Compagnie rivale de l'orgueilleuse
Hamburg-Amerika. Je suis atterré comme le jour où j'ai appris
la destruction de la cathédrale de Reims. Le passé et
l'avenir. Ils veulent tout anéantir. Jusqu'ici je n'avais
qu'une haine indulgente, tenue en laisse. Maintenant je sens la
colère et la vengeance me secouer...
coulée froidement dans les eaux glauques : Oh ! Les corps
éperdus qui se débattent par centaines ! Des femmes, des
enfants, des neutres férocement châtiés d'avoir accepté les
services de la Compagnie rivale de l'orgueilleuse
Hamburg-Amerika. Je suis atterré comme le jour où j'ai appris
la destruction de la cathédrale de Reims. Le passé et
l'avenir. Ils veulent tout anéantir. Jusqu'ici je n'avais
qu'une haine indulgente, tenue en laisse. Maintenant je sens la
colère et la vengeance me secouer...
Les
14, 15 mai - Les heures fiévreuses
reviennent. C'est d'abord un bulletin de victoire : la première
depuis la bataille de la Marne... Nous avons pris des canons,
des mitrailleuses à foison, enlevé des positions importantes.
Enfin quelques gouttes de cordial... N.D. de Lorette priez pour
nous...
Et
jour et nuit près de nous défilent les trains bondés de
troupes qui vont à la grande fournaise...
Et
puis l'Italie frémissante nous donne aussi la fièvre. On sent
que les heures décisives approchent. Voici le discours
enflammé de d'Annunzio à la cérémonie du Quarto, puis son
appel aux armes à son arrivée à Rome...
L'Italie
marchera. C'est résolu et cette semaine on le pressent. Et ceux
qui espèrent en sont convaincus, ceux qui en sont désespérés
nous le prouvent par leurs aveux de découragement ou de rage.
Mais
ce matin, une nouvelle... une nouvelle qui vide les artères :
Salendra donne sa démission, Giolitti
donne sa démission, Giolitti -Bulow -Bulow lui barrant la route... Je m'y attendais un peu à ce coup de
théâtre mais ceci n'est que le début. Cela va précipiter les
évènements, les ajourner en une intervention de la dernière
heure, à la roumaine. En ce cas, c'est une lâcheté
avantageuse pour l'Italie mais du sang français, du beau sang
rouge encore, encore et davantage, jusqu'à l'hiver...
Attendons.
lui barrant la route... Je m'y attendais un peu à ce coup de
théâtre mais ceci n'est que le début. Cela va précipiter les
évènements, les ajourner en une intervention de la dernière
heure, à la roumaine. En ce cas, c'est une lâcheté
avantageuse pour l'Italie mais du sang français, du beau sang
rouge encore, encore et davantage, jusqu'à l'hiver...
Attendons.
Le
16 mai - La lutte politique et
diplomatique est passionnante à Rome. Elle devient épique. Au
redoutable traquenard que les neutralistes tendaient à
Salandra, voici une riposte magistrale. La foule s'est soulevée
frémissante et le roi, sûr de l'opinion irrésistible des plus
nobles forces nationales maintient Salandra. Cette fois le duel
est déplacé. Giolitti a en face de lui le Roi et tout ce qui a
du sang rouge en Italie. Il lui faut ou capituler ou hasarder
une révolution dynastique. Il est coulé à fond. C'est la
guerre. Je sens un souffle d'espoir qui ne craint plus. Ce sera
pour la fin de la semaine, la grande secousse qui amène les
canons en batterie.
Le
19 mai - On parle de la veillée des
armes en Italie. C'est demain que se réunit le Parlement
italien... Demain la journée décisive où la Grande Cause sera
portée devant le tribunal du peuple. Quelle scène digne de
l'ancienne Rome. Que décidera le peuple ?...
A
remarquer la réserve extraordinaire de la presse
austro-allemande, on a l'impression qu'ils espèrent encore. Que
vont-ils machiner ? Ces gens si chatouilleux il y a un an
avalent sans broncher les plus fortes couleuvres. Quelle force
d'âme et que cela doit leur coûter. Mais s'ils perdent la
partie, quelle rage sauvage va s'emparer d'eux. Toujours est-il
qu'ils restent impassibles, et malgré la certitude que l'on
sent de la résolution ferme de l'Italie on en est
impressionné. Justement aujourd'hui m'arrivent deux lettres de
mes pessimistes inguérissables : celle de Louis et de Cheval.
Louis, qui doute, qui est jaloux du traitement inégal des
Français : son dévouement ne coûtera rien à l'État, rien au
Trésor Public, alors dit-il que d'autres, qui n'ont pas plus de
mérite ni d'intelligence touchent des soldes scandaleuses, dont
ils font triste usage...
Cheval
n'a pas perdu sa philosophie amère et découragée de jeune
homme fatigué avant la vie. Il est allé au feu la mort et la
peur dans l'âme. Il est las au point d'avoir souhaité la balle
qui délivre... Cela fait pitié et cependant il reste toujours
avec sa pensée si noble et généreuse qu'on ne peut le
mésestimer. Il ne s'est jamais senti la force de lutter, ni
même d'espérer "sachant trop pour lutter comme tout est
fatal".
J'évoque
la nature débordante de Maurice... Quel contraste, et le
souvenir de ce pauvre réconforte et chasse un peu ce voile de
pessimisme que les pensées sombres de Cheval laissent dans
l'âme comme une buée sur une bouteille. Le soir je suis allé
en tournée. J'ai trouvé une jeune femme dont le mari et les
frères sont au feu. Je lui glisse insidieusement les pensées
de Cheval : quelle horreur, quelle longueur, quelle misère. Ne
serait-il pas préférable d'avoir cédé à l'Allemagne que
d'avoir subi cet effroyable fléau ? Et elle riposte,
véhémente : "Comment ? Etre Boche.
Ah
! Non, j'aime mieux que mon mari aille à la bataille plutôt
que de supporter cela". Voilà au moins une Française.
Le
24 mai - Jour de la Pentecôte.
L'esprit
ailé des espoirs immenses est descendu. Nous avons senti le
souffle divin. L'Italie mobilise. Cette fois c'est irrévocable,
c'est la guerre. Le grand miracle s'est accompli. La main de
Dieu s'appesantit sur les aigles noirs... L'Allemagne est
perdue. La victoire est à nous, la victoire prochaine. J'ai
senti aujourd'hui ce qu'était l'allégresse et l'enthousiasme.
Ô puissance magique du passé et l'idéal pour l'avenir. Tout
ce qu'il y a de sublime, de débordant dans cette idée il
Risorgimento m'est apparu comme un fleuve qui jaillit du sol à
bouillons irrésistibles. Il Risorgimento. La magnifique
continuation de l'œuvre extraordinaire de Cavour et de
Garibaldi... E viva Italia, la grande Italie a pris le parti de
la Belgique. La Justice sera vengée.
Qui
m'aurait vu ce matin m'aurait pris pour un fou. Je revenais de
la messe, longeant le talus du chemin de fer et les grands
peupliers. J'avais à la main le Journal où les phrases
fatiguées étaient répétées ; je ne pouvais pas lire. Ma
poitrine se soulevait avec des soubresauts prête à éclater ou
à bondir. Les larmes coulaient de mes yeux et quelque chose
d'irrésistible chantait en moi. J'aurais voulu avoir quelqu'un
pour communier avec moi dans cette minute d'émotion
extraordinaire et j'avais envie de m'adresser aux arbres aux
brins d'herbe et leur crier : Frémissez donc, il se passe
quelque chose de grand dans le monde : le jour de gloire est
arrivé. Et il me semblait entendre comme l'immense rumeur qui
court des Alpes à la Sicile et qui claironne : aux armes
citoyens. La Marseillaise qui jaillissait instinctivement de ma
poitrine ne m'avait jamais fait éprouver le frisson sacré qui
l'inspira. Aujourd'hui je la comprends. Je l'ai sentie. Et
l'Italie doit la chanter. Elle va à la guerre, résolue et
enthousiaste. Vive l'Italie !
Le
6 juin 1915 - Depuis quinze jours nous
passons la journée à la va comme je te pousse ; sans savoir ce
que nous faisons au juste, sans savoir ce que nous ferons
demain.
D'abord,
ça a été une extension des randonnées à travers la campagne
environnante à la recherche de stocks d'avoine, ce qui me
permit de, le 21 mai visiter Senlis la mutilée, la malheureuse
ville et les bandits : toute une rue qui devait être la plus belle n'est qu'une ruine. L'une après
l'autre chaque maison a reçu sa pastille incendiaire, les
Boches se sont écartés et les flammes ont achevé la
destruction. J'avais le cœur oppressé et des larmes
irréfoulables montaient à mes yeux.
devait être la plus belle n'est qu'une ruine. L'une après
l'autre chaque maison a reçu sa pastille incendiaire, les
Boches se sont écartés et les flammes ont achevé la
destruction. J'avais le cœur oppressé et des larmes
irréfoulables montaient à mes yeux.
Aujourd'hui
c'est pourtant moins triste que cela dut l'être aux premiers
jours après la catastrophe quand les feuillages roussis et les
ruines fumantes versaient l'horreur aux passants.
Maintenant
la nature semble s'être faite maternelle et vouloir cacher ces
horreurs. Des nappes de verdure et de fleurs recouvrent d'un
voile discret et plein de promesses d'avenir la plupart des
brèches calcinées car les villas entourées d'arbres étaient
nombreuses dans cette rue luxueuse.
Qu'une
ville soit bombardée, anéantie dans la furie du combat passe
encore, mais voir cette odieuse destruction sans un frisson de
colère et de dégoût, non, ce n'est pas possible.
Le
26 mai - C'est la visite à Compiègne.
Visite sommaire, pressée. Il ferait bon butiner dans la ville
à la recherche des souvenirs historiques. Je n'ai vu que le
merveilleux hôtel de ville et une éloquente statue de Jeanne
d'Arc.
On
ne soupçonne presque pas que l'invasion a passé là. Les
magasins sont aussi luxueux et les rues animées. Seules les
piles du grand pont se dressent comme des moignons douloureux et
accusateurs au milieu de la rivière.
Mais
par cette magnifique matinée de mai, la plus belle ville est
moins émouvante que la promenade matinale à travers la
magnifique forêt.
J'en
ai rarement fait de meilleure. Rien n'y manquait de ce qui rend
la nature pénétrante : l'heure matinale, la route unie,
roulante, la vitesse sans fatigue, l'air vif et parfumé, la
lumière chantante avec mille jeux dorés sur les fûts, les
muguets en abondance, les chevreuils dans les fossés, les amis
aux carrefours.
-
Halte rapide à la Forte-Haie - puis l'illusion de la
liberté... Ç'a été une bonne journée.
Dès
le lendemain voici les énervantes manœuvres,
contre-manœuvres, et fausses alertes.
La
2ème Section du C.V.A.D. est partie ; nous devons
assurer tous ses services à Crépy. Boucherie, expéditions de
paille, foin, avoine en gare. Me voilà installé à un bureau
à la gare improvisé chef de service à la Compagnie du Nord ;
réceptions, expéditions.
Le
28 mai - Nous nous installons à Crépy .
Il faut quitter la villa de la Tour pour un cantonnement infect,
sans cuisinier, sans ordonnance. .
Il faut quitter la villa de la Tour pour un cantonnement infect,
sans cuisinier, sans ordonnance.
Mais
enfin on s'organisera. Tout à coup deux ordres contradictoires,
suspension de tous services. Rechargement du convoi avec départ
immédiat. Une journée d'attente vaine. Deuxième ordre :
déchargement du convoi le 3 juin ; le départ aura lieu vers
l'avant. Bravo, la vie active va reprendre. Töpfchen manœuvre
der Frauen wegen um das Bleiben (à cause des femmes, pour
pouvoir rester). La moitié de la section restera, l'autre
partira. C'est la dislocation. La nouvelle en est apportée de
façon brutale, avec les choix qu'il a faits où se révèlent
ses sympathies et ses antipathies.
Le 3
juin 1915
Il
y a une minute la grosse émotion. Je serai de ceux qui restent
et cela n'a rien de séduisant, vivre avec un être sur le dos,
un chef qu'on déteste parce qu'on le mésestime, avec un autre,
un inférieur qui vous irrite par son ombrageuse étroitesse
d'esprit et qui vous brime...
On
m'ôte Crevoisier, on me fait coucher sur la paille, manger avec
les hommes, toutes choses qui ne me peinent pas en elles-mêmes,
mais par la façon dont elles sont imposées...
Qu'importe,
je serai plus au-dessus de ces mesquineries et je ne les veux
même pas remarquer...
Cela
m'a fait plus de peine de voir partir de vieux camarades. Même
Ravenet que je détestais si cordialement et qui me le rendait
bien, m'était devenu sympathique et par certaines attitudes de
loyauté et d'indépendance en face de Töpfchen avait noué les
premiers brins de l'amitié. Il est parti avec d'autres ; cela
m'a fait de la peine et j'en ai vu dans les deux groupes plus
d'un qu'on aurait cru dur et indifférent qui se cachait pour
pleurer.
Le
4 juin - Jour de la séparation, mais
heureusement adoucie, entièrement noyée dans une des
meilleures joies de la vie. L'avant veille, le départ de tous
avait été fixé. Julien devait être à Puisieux. J'allais
partit sans le revoir. J'ai eu une grande détresse. Malgré
notre répugnance à mendier une permission, j'ai fait le
sacrifice. Me voilà avec cinq heures de permission pour faire
mes cinquante kilomètres. Qu'importe. Je suis parti avec une
crainte, celle de trouver le nid vite. En effet, je n'ai pas eu
à aller jusqu'au bout, à Villers-Cotterêts, l'ami Arcay
m'arrête. Le 42ème est parti...
Une
poussée vers Tracy-le-Val est en préparation, et l'on a encore fait appel au 42ème.
Arcay était à ma connaissance un homme énergique. Et je le
vois las, las d'attendre. Il parle de la grande poussée. Elle
tarde tant. Peut-être parce qu'on n'ose s'y résigner, on n'ose
la tenter tant le prix en est effrayant... Et je sens qu'il a
raison. Je rentre accablé même après un réconfort auprès de
Morel.
est en préparation, et l'on a encore fait appel au 42ème.
Arcay était à ma connaissance un homme énergique. Et je le
vois las, las d'attendre. Il parle de la grande poussée. Elle
tarde tant. Peut-être parce qu'on n'ose s'y résigner, on n'ose
la tenter tant le prix en est effrayant... Et je sens qu'il a
raison. Je rentre accablé même après un réconfort auprès de
Morel.
Cette
lourdeur m'écrase deux jours durant jusqu'à ce que j'obtienne
une seconde permission. Je sais que le 42ème est en
cantonnement d'alerte à Trosly-Breuil. Le ciel est gris, mais
la route est bonne. Ma fidèle machine un peu retapée m'inspire
confiance ; la course est longue mais j'arrive très vite.
Le
beau sergent ne m'attendait pas et son étreinte est toute
frémissante de joie et de surprise. Pauvre cher Julien. Il se
sent débordant et rassuré de me revoir encore une fois avant
la grande épreuve. Nous nous promenons dans une échancrure de
la forêt. Nous allons la main dans la main comme deux petits
frères, comme deux fillettes. A table, il me pose sa main sur
l'épaule, sur les genoux comme à une fiancée. L'après-midi
nous allons voir quelques amis. Pas un coup de canon dans le
ciel, heureux. On ne soupçonnerait jamais que la lutte la plus
furieuse est là en puissance, prête à se déchaîner. Les
hommes en sont presque heureux. Ils voudraient en finir, et
chacun espère, compte qu'il ne sera que blessé. Julien a
"pleine confiance" m'a t'il écrit, et il me le
répète en ajoutant qu'il a trois chances sur quatre. Je peux
en sortir sans rien, ou être blessé ou prisonnier ou tué.
Etre blessé : c'est le rêve de tous. Une toute petite blessure
au bras, à la cuisse, quelle veine : Ça nous ferait trois mois
dans un hôpital, bien soigné, une convalescence, et après...
dans trois mois, dame, ce sera fini sans doute. Je soupe avec
eux. La nuit est venue. Je rentrerai tard. Mais je ne veux pas
m'en aller. Il fait si bon avec tous ces beaux jeunes gens. Il
m'accompagne sur mon chemin, nous allons lentement. Je voudrais
lui laisser tant de joie afin qu'elle lui porte bonheur. Malgré
moi j'ai je ne sais quelle angoisse ; il me semble que c'est la
dernière fois que je peux être ainsi avec lui. Je ne réussis
pas à être joyeux ; c'est lui beaucoup plus que moi qui est
confiant, souriant, joyeux. Mais nous sommes heureux tous les
deux.
Je
rentre à Duvy, et lui s'attend à monter à Tracy-le-Val dans
la nuit.
Dimanche,
je me réveille avec grande anxiété. Les canons tonnent avec
la fièvre des mitrailleuses. C'est la préparation de l'attaque
annoncée. Mon Dieu. Pauvre Julien, il est dans la fournaise. Je
voudrais être loin pour ne pas entendre. Ce martèlement précipité me fait mal. J'entre
à l'église pour prier. On
chante : "Pitié mon Dieu", et moi je tremble et
sanglote et prie avec ferveur. Je sors plus calme, le canon
s'est tu. Les baïonnettes sont en danse sans doute, mais c'est
moins terrible. On n'entend pas.
Ce martèlement précipité me fait mal. J'entre
à l'église pour prier. On
chante : "Pitié mon Dieu", et moi je tremble et
sanglote et prie avec ferveur. Je sors plus calme, le canon
s'est tu. Les baïonnettes sont en danse sans doute, mais c'est
moins terrible. On n'entend pas.
Le
10 juin - Un mot de Julien. Il est
indemne. En même temps le journal apporte le récit de leur
attaque : (Guennevières). Le récit assure que la nuit du 7 fut
calme, Julien est aux avant-postes ; mais le plus fort de
l'orage est passé.
Depuis
deux jours, je suis installé à la boucherie. Hier je suis
allé jusqu'à Mareuil-sur-Ourcq chercher un troupeau. En route - je suis né pour avoir du
malheur - une aventure tragi-comique : la noyade d'une vache
dans un (...une ligne illisible...).
chercher un troupeau. En route - je suis né pour avoir du
malheur - une aventure tragi-comique : la noyade d'une vache
dans un (...une ligne illisible...).
...
Les lettres de Mme Ramel (...?...) régulièrement.
Aujourd'hui elle me confie le raccourci de sa vie douloureuse.
La belle âme droite, limpide et généreuse. Pourquoi ne
l'ai-je pas trouvée sur mon chemin il y a dix ans ? ou une
telle. Une puissante sympathie m'incline vers cette femme que je
ne connais pas, que j'ai à peine entrevue une seule fois, et
dont ce que Maurice m'avait dit d'elle avait suffi à lui gagner
ma confiance. J'éprouve une telle sécurité que je sens en
elle un abri, un refuge de consolation que m'aurait légué le
grand ami en partant.
Pourquoi
est-elle si âgée. Je n'hésiterais pas à en faire mon
épouse. C'est une telle femme que j'ai toujours rêvée. Mère
puissante, âme douce, simple, et se montrant intelligente,
infiniment (...une ligne illisible...) âme maternelle.
Voici
un autre échantillon de femme. Bon appétit Messieurs. C'est la
copie textuelle, orthographe respectée d'une lettre adressée
à Herr Töpfchen par des connaissances qu'il avait faites sur
la route en allant tous les 4 jours à Morienval.
- Le 8-5-15
Cher ami,
Je
prends la liberté de vous écrire car nous avont l'idée de
faire une partie de plaisir dimanche à vaudram-pont alors ayait
donc la bonté de faire part de ma lettre à votre ami M.
Ravenet et à sont camarade Gindre (Jammer) qui la compagne dans
les ravitaillements nous conton sur vous dimanche sans faute qui
est le 9 nous seront toutes a vous attendre en forêt sur la
route de Compiègne nous y seront a 1h/2 en attendant le plaisir
de vous voir recevez cher ami mes amitiés sinser.
Melle Germaine
Brun Chez Mad. Caron. Morienval. Oise.
A
dimanche sans faute. Faite en part aussi à M. George le Major.
Voilà
de quoi refaire la France.
Ces
trois numéros-là étaient venues relancer leurs amis de
passage jusqu'à Duvy, certain samedi soir. C'était Ravenet et
M. Georges qui les avaient régalées, car M. Henri avait déjà
trouvé mieux...
Une
maîtresse de ministre, dame, c'est à cultiver. Et il s'y
applique. Il a déjà décroché la fonction de gestionnaire. Je
ne voudrais pas énumérer tous les moyens employés que je
suppose sans savoir, mais je suis de l'avis de Rübelein qui,
résumant une discussion sur l'absence de scrupules de ce triste
sire disait : "C'est une crapule".
Il
sait faire la bouche en cœur aux puissants, sait se faire
valoir sans paraître ramper, il sait exposer ses doléances
quand elles mettent un camarade dans les torts ou l'embarras et
que cela peut lui être utile. Et après coup, il s'en vante, le
cynique.
Je
n'oublierai pas le jour où il osait confesser qu'il regrettait
d'être marié parce qu'il trouve un plus brillant parti sur son
chemin.
Le
12 juin - Des renseignements me
viennent du Q.G, là où l'on est relativement heureux l'on
manque de ressort. Ces pleutres sont déprimés. Ils soupirent :
"C'est long ! C'est infiniment long", et ils ajoutent
pour achever la démoralisation cette réflexion corrosive :
"C'est impossible. A quoi bon tant de sacrifices". Et
une atmosphère lourde, accablante pèse sur les cerveaux, sur
les cœurs. Ils n'ont pas la foi ; pas même la virilité des
courages désespérés. Et quand la foi meurt en haut, parmi les
chefs, qu'attendre des petits, des simples qui sont sacrifiés
et se sacrifient souvent sans comprendre ?
Il
fait lourd dans notre ciel. C'est vrai. Aux Dardanelles notre
affaire se brise, et les Russes dont les derniers succès
faisaient monter de grands espoirs sont balayés par les usines
allemandes. Ils reculent, reculent ; perdant leurs lignes de
défenses successives, abandonnant Przemysl ,
et Lemberg ,
et Lemberg est menacée. On nous l'annonce comme si sa chute était
prochaine, inéluctable. Après les Russes "Ils"
pourront faire face aux Italiens, puis à nous. Ils tiendront
tête au monde, et leur énergie farouche et méthodique, si
elle est incapable de terrasser l'Europe pourrait très bien la
fatiguer. Et alors, nous n'aurions plus que nos deuils et nos
ruines pour lot... Je me rebelle devant cette perspective
lamentable.
est menacée. On nous l'annonce comme si sa chute était
prochaine, inéluctable. Après les Russes "Ils"
pourront faire face aux Italiens, puis à nous. Ils tiendront
tête au monde, et leur énergie farouche et méthodique, si
elle est incapable de terrasser l'Europe pourrait très bien la
fatiguer. Et alors, nous n'aurions plus que nos deuils et nos
ruines pour lot... Je me rebelle devant cette perspective
lamentable.
Les
Russes. Quel peuple extraordinaire. Écrasée, mutilée, en
déroute l'armée russe fait tête en retour offensif à l'heure
où on la croyait en fuite ou brisée. Et la voici qui brise les
crocs et les mâchoires qui croyaient déjà enserrer la
Galicie. La Russie, elle est puissante et fuyante comme la mer
et la fatalité. Sachons donc maîtriser nos nerfs. Pauvres
Français trop sensibles.
le
18 juin - "Un bataillon du 42ème
a été anéanti pendant la contre-attaque à
Guennevières". Voilà ce que je viens d'entendre dans la
conversation de mes hommes. Il ne m'ont pas vu pâlir. Je
questionne. Le renseignement vient en ligne droite du Q.G.
Billot, le juge en vient et l'a rapporté à celui qui parle.
Mon
Dieu ! J'ai envie de courir à Duvy voir Billot. Et puis j'ai
trop peur de savoir le numéro du bataillon et d'accroître mon
angoisse. Non, je n'irai pas, je préfère attendre. Je vais
écrire à Sara. D'ici sa réponse j'aurai peut-être des
nouvelles rassurantes. Deux chances sur trois...
Le
19 juin - Journée d'attente vaine.
J'ai un fardeau sur la poitrine. Pas de nouveaux détails.
L'espoir subsiste.
Le
20 juin - Julien est blessé. Une
carte arrive qui rassure et inquiète. Je pars à midi en vélo
à sa recherche aux environs de Compiègne.
 Minuit.
Rentrée de ma visite au blessé. Je l'ai trouvé au château de
Francport Minuit.
Rentrée de ma visite au blessé. Je l'ai trouvé au château de
Francport .
Il était sous un hangar-garage, dans un lit. Je l'ai vite
reconnu dans la rangée, sa tête bandée, l'œil libre fermé.
Il dort. Je m'approche. Je le touche doucement. Il entrouvre sa
paupière, je vois un regard éteint, égaré qui me glace. Je
crois qu'il ne me voit pas et ne me reconnaît pas. Mais il
murmure : "Edouard"... et se met à sangloter pendant
que je l'embrasse : "me voilà avec rien qu'un" me
fait-il d'une voix étouffée par l'émotion qui l'étreint. .
Il était sous un hangar-garage, dans un lit. Je l'ai vite
reconnu dans la rangée, sa tête bandée, l'œil libre fermé.
Il dort. Je m'approche. Je le touche doucement. Il entrouvre sa
paupière, je vois un regard éteint, égaré qui me glace. Je
crois qu'il ne me voit pas et ne me reconnaît pas. Mais il
murmure : "Edouard"... et se met à sangloter pendant
que je l'embrasse : "me voilà avec rien qu'un" me
fait-il d'une voix étouffée par l'émotion qui l'étreint.
Je
l'apaise. Il fait un grand effort pour se surmonter. Une quinte
de toux le secoue. "On l'a opéré il y a deux heures"
me dit l'infirmier. Je comprends alors qu'on vient de lui ôter
un œil. Pauvre gros. Je le comble de caresses. Il se met à
sourire. Et je plaisante un peu sur sa belle infirmité et sa
chance. Il pouvait être tué, ou mutilé plus affreusement.
Cela ne l'empêchera ni de travailler ni de plaire, aimerais-tu
mieux que l'obus t'ait enlevé le nez comme à Gonin, lui
dis-je. Tu serais défiguré, les filles ne pourraient pas
t'aimer. Tandis qu'avec ton œil en verre et la médaille tu
seras un beau gars...
Puis
c'est le récit de mes anxiétés pendant ces cinq jours
d'attente et de furieuse canonnade.
"Tu
croyais me retrouver la tête dans ma musette" me dit-il en
plaisantant.
Puis
c'est le récit de son accident : le signal de l'attaque, la
sortie de la tranchée, les bonds en avant et à cinquante
mètres la secousse qui le renverse. Je n'ai pas bien su comment
ça venait. Je saignais au cou et à la tête. Cela me faisait
mal, je ne pouvais rester là, me faire hacher. J'ai voulu
quitter le plateau, regagner la tranchée, mais là c'était
encore plus intenable. Les obus y pleuvaient sur les morts. Je
me suis traîné aux grottes voisines. Par bonds. Arrivé là,
je ne me sentais pas grand mal. Je voyais encore clair, j'avais
envie de retourner vers mes hommes sans lieutenant. Puis je me
suis dit qu'il y en avait assez sans moi là-haut à se faire
tuer. Je suis resté en attendant la voiture d'ambulance.
Après
cette longue causerie, je suis allé trouver le major. J'ai
voulu être rassuré par lui sur la crainte d'une complication
affectant l'autre œil. Le major est très doux. Il s'excuse
d'avoir ôté l'œil, il a attendu autant qu'il a pu avant de
s'y résigner. Mais il fallait.
Il
vient avec moi voir le blessé.
Je
t'ai proposé pour la médaille militaire dit-il. Puis quelques
paroles de réconfort et la promesse de le faire transporter à
Compiègne. On se sent en famille avec ce M. Maubron.
Mais
le soleil baisse à l'horizon, j'ai encore quarante kilomètres
à faire ce soir et il ne faut pas fatiguer le malade. Je le
quitte en promettant une nouvelle prochaine visite.
La
route du retour est longue. Je passe par Trosly-Breuil où j'étais il y a quinze jours, où j'avais trouvé le beau
régiment presque heureux d'aller à la bataille tout impatient
d'en finir. Je n'y retrouve que les débris effarés de toutes
ces belles compagnies. On compte les survivants.
Quatre-vingt-sept sont redescendus sur deux cent cinquante qui
étaient montés sur le terrible plateau. Halte souper à
Pierrefonds et retour dans la nuit.
où j'étais il y a quinze jours, où j'avais trouvé le beau
régiment presque heureux d'aller à la bataille tout impatient
d'en finir. Je n'y retrouve que les débris effarés de toutes
ces belles compagnies. On compte les survivants.
Quatre-vingt-sept sont redescendus sur deux cent cinquante qui
étaient montés sur le terrible plateau. Halte souper à
Pierrefonds et retour dans la nuit.
 Le
24 juin - Cette fois je suis bien
rassuré, j'ai trouvé le blessé souriant, gai, tout gaillard
et sans souffrance qui faisait une sieste paresseuse sur un bon
lit dans la caserne de Royallieu transformée en hôpital. Le
24 juin - Cette fois je suis bien
rassuré, j'ai trouvé le blessé souriant, gai, tout gaillard
et sans souffrance qui faisait une sieste paresseuse sur un bon
lit dans la caserne de Royallieu transformée en hôpital.
C'est
extraordinaire comme il souffre peu. Plusieurs de ces camarades
sont là dans les salles voisines. Le fourrier, ce petit
parisien aux yeux ardents, encadré de son père et de sa mère,
deux braves vieux à l'air si honnête, se promène dans le
couloir, tout pâle, un œil enlevé lui aussi, un bras cassé,  et la capote pleine de sang brun. C'est le vieux marsouin,
l'adjudant Tisserand qui a reçu quatre ou cinq éclats d'obus
dans le ventre et qui raille la gueuse maladroite, puisqu'elle
n'a pas su "l'amocher davantage".
Et c'est le gros Dubois avec son sourire placide de bon
Franc-Comtois qui sourit en disant qu'il n'a pas assez de mal,
une simple blessure à la tête. Comme
de coutume, nous faisons notre petite correspondance aux parents
et aux intimes, puis je vais l'âme toute sereine reprendre
l'auto qui m'avait amené, sur la grande place de l'Hôtel de
Ville de Compiègne.
et la capote pleine de sang brun. C'est le vieux marsouin,
l'adjudant Tisserand qui a reçu quatre ou cinq éclats d'obus
dans le ventre et qui raille la gueuse maladroite, puisqu'elle
n'a pas su "l'amocher davantage".
Et c'est le gros Dubois avec son sourire placide de bon
Franc-Comtois qui sourit en disant qu'il n'a pas assez de mal,
une simple blessure à la tête. Comme
de coutume, nous faisons notre petite correspondance aux parents
et aux intimes, puis je vais l'âme toute sereine reprendre
l'auto qui m'avait amené, sur la grande place de l'Hôtel de
Ville de Compiègne.
Le
27 juin - Encore une dernière visite.
C'est bel et bien la dernière. Je ne le sens pas en arrivant à
l'hôpital où je trouve mon blessé à demi guéri. Nous
causons et écrivons longuement comme de coutume. Nous faisons
visite aux connaissances. Mais il faut que je m'en aille.
Demain, il partira pour l'intérieur de la France. Nous songeons
à l'avenir ; il sera quelques temps dans quelque coin paisible
; puis il va s'asseoir à la table, à Verne, et prendra place
dans le chantier."Tu iras semer du bon blé pour notre
retour à Louis et à moi". Tu as fait ta part ici, tu ne
seras pas inutile là-bas, à soulager ceux qui nous attendent,
car l'attente sera encore longue. Rentrerons-nous cette année ?
Je ne le prévois pas et je n'ose pas l'espérer. Non ce sera
pour l'an prochain. Que c'est long !
Et
voilà que je sens qu'il s'en va pour de bon, qu'il me quitte,
qu'il me laisse seul. Une angoisse de solitude m'étreint quand
je l'embrasse. Tache de revenir me dit-il.
J'assure
que je n'ai aucune crainte, aucun pressentiment de ne pas
rentrer.
-
Il ne faut qu'un coup, tu sais, et à la guerre on ne sait
jamais.
-
Embrasse les bien pour moi, porte leur mon espoir et mes baisers
lui dis-je en l'embrassant très vite et en partant pour ne pas
pleurer.
Il
me semble que tout est vide ici sur le front. Plus d'espoir
d'une heure de détente, plus de souci quotidien sur les
variations de la canonnade qui me semblera indifférente et
lointaine. Le pauvre Julien, il tenait tant de place sur ce
front de l'Aisne, pour moi. Nous nous connaissions si peu avant
la guerre. Jamais nous n'avions communié ensemble dans la joie
ou la tristesse ou l'inquiétude. Mais que d'heures ardentes
nous avons eues durant ces dix mois. Nous voilà scellés l'un
à l'autre. Il est simple et droit et peu bavard, mais il avait
une façon si tranquille d'accepter les fatigues de la guerre,
les dangers les horreurs de la situation souvent terrible. Un
patriotisme tout limpide l'animait contre les Boches qu'il
démolissait avec simplicité. Il tenait bon sans fanfaronnade
et sans panache, sans fièvre et sans inquiétude en paysan.
Quelle différence avec le frère d'Alsace qui se torture
d'impatience et de révoltes contre le sort et les injustices
ambiantes. Lui, il avait toujours le sourire serein. J'aurais
aimé être dans la tranchée avec lui.
Le 2
juillet 1915
J'ai
fait aujourd'hui une longue tournée au front : une halte à
Puisieux, où j'ai retrouvé le 2ème - reformé,
reposé. Que d'absents ! Que de nouvelles figures. J'ai vu
quelques braves garçons qui ont été heureux des nouvelles que
je leur apportais des blessés.
Vaine
recherche de l'obus.
Une
autre halte à Coeuvres  où j'ai déjeuner avec Sara et compagnie. Un peu l'air du pays,
l'air salubre de Montfaucon. Cela ne sent pas le Rübelein. J'ai
serré la main à Louis Girard, et en route j'espère aller à
Vic. A Ambleny
où j'ai déjeuner avec Sara et compagnie. Un peu l'air du pays,
l'air salubre de Montfaucon. Cela ne sent pas le Rübelein. J'ai
serré la main à Louis Girard, et en route j'espère aller à
Vic. A Ambleny ,
je m'informe de Maugras, il est en deuil, il est aux tranchées.
J'irai le voir. C'est l'escalade de la colline, les boyaux, les
abris. Nous le rencontrons sous bois qui se promène comme un
maître dans son domaine. Il m'en fait les honneurs. Cela dure
longtemps, je prends quelques vues photographiques. J'écoute le
récit de son deuil ; nous trouvons les collègues Lefranc et
Leine. Comme ils sont vieillis sous la longue barbe mal soignée
et la capote souillée. Cette vie de tranchées est trop longue
et trop rude pour ces braves vieux, qui ont peur de l'hiver
prochain et cependant peu à peu se préparent à leur insu
peut-être, à tenir jusque-là, jusqu'au-delà. ,
je m'informe de Maugras, il est en deuil, il est aux tranchées.
J'irai le voir. C'est l'escalade de la colline, les boyaux, les
abris. Nous le rencontrons sous bois qui se promène comme un
maître dans son domaine. Il m'en fait les honneurs. Cela dure
longtemps, je prends quelques vues photographiques. J'écoute le
récit de son deuil ; nous trouvons les collègues Lefranc et
Leine. Comme ils sont vieillis sous la longue barbe mal soignée
et la capote souillée. Cette vie de tranchées est trop longue
et trop rude pour ces braves vieux, qui ont peur de l'hiver
prochain et cependant peu à peu se préparent à leur insu
peut-être, à tenir jusque-là, jusqu'au-delà.
La
visite se prolonge. Je me suis attardé. Il est trop tard et
trop dangereux pour aller voir les tombes. Je prends le chemin
du retour. Je souperai à la Croix-Morel hospitalière.
Le
9 juillet - Les premiers
permissionnaires. Crépy-en-Valois . .
Dans
la cour de la gare, ils sont massés, les uns assis, les autres
appuyés aux grilles, d'autres accroupis, d'autres en groupes
animés. Tous, l'air heureux. Et la foule de la rue contemple
ces hommes aux uniformes râpés qui vont embrasser leurs êtres
chers puis retourner à la bataille, peut-être pour mourir.
C'est infiniment émouvant.
Ce
soir dans la rue nous croisons un capitaine qui fait sensation.
"C'en est un". Il est jeune encore avec un visage
bruni, l'air énergique et dégagé. Il descend la rue et croise
des sous-officiers de dragons et de simples automobilistes dont
les uniformes fringants insultent ce chef qui passe, qui revient
du front. C'est qu'il a une tunique ancienne toute passée, elle
n'est plus ni bleue, ni noire ; la pluie, la bise, la boue, le
soleil ont posé là leurs teintes. Un simple et un beau rouge
écarlate, la croix d'honneur se détache.
Calot
sur la tête, tout crie dans sa personne, je ne suis pas de
cette garnison d'embusqués. "J'en viens", oui de
là-bas, du front de bataille où l'on souffre, où l'on meurt.
Et
dans les mains qui se portent aux képis pour le saluer on sent
qu'elles élèvent une muette admiration, comme un drapeau
invisible, des banderoles de respect frémissent dans les cœurs
qui se pavoisent spontanément sur son passage.
Plus
loin, au détour d'une rue, j'aperçois un vieux territorial qui
a l'air d'être transporté par la joie. Il semble que ses pieds
ne posent pas sur le sol, qu'il flotte sur de la joie. Il tient
dans ses bras un tout petit bébé qu'il n'avait pas encore vu,
et à côté de lui, s'efforçant joyeusement d'accélérer
l'allure pour ne pas le perdre, la mère le suit, radieuse...
Plus
loin encore, c'est une toute petite vieille, au visage rose qui
accompagne un grand diable de zouave en kaki fané. Des images
de bonheur dans la grande horreur.
Le
12 juillet - Excursion à la
Ferté-Milon .
Visite à Bedu (Section d'hospitalisation) qui me fait visiter
en détail les curiosités de la vieille petite ville. Il a une
âme d'archéologue, un esprit cultivé, délicat, sensible aux
illusions de l'avenir comme aux vestiges du passé. .
Visite à Bedu (Section d'hospitalisation) qui me fait visiter
en détail les curiosités de la vieille petite ville. Il a une
âme d'archéologue, un esprit cultivé, délicat, sensible aux
illusions de l'avenir comme aux vestiges du passé.
Nous
allons tout droit comme il convient aux différentes statues de
Racine, la plus réputée est celle de David d'Angers, froide,
inexpressive, sans âge et sans relief. On croirait très
facilement que c'est un débris bien conservé de quelque temple
grec. Une autre, un simple buste érigé sur le Mail, montre un
Racine aux traits plébéiens, avec les cheveux coupés, on le
prendrait pour un conventionnel. Celle qui a le plus de charme
est une statue de Racine enfant : un petit écolier de
Port-Royal, rêveur un livre à la main.
Enfin,
la maison natale. Mais quelle est la maison natale de Racine ?
On ne sait pas. Et, ce qui révèle bien l'érudition timorée,
tatillonne de notre époque, on a apposé une plaque sur l'une,
sur celle des maisons qu'on juge le plus sûrement avoir vu
naître Racine, mais on se garde bien d'affirmer : il y a cette
inscription : "Cette maison appartenait en 1639 aux aïeuls
de Racine".
Ce
brave Bedu s'est mis en relation avec le curé du lieu qui est
un érudit archéologue, un esprit supérieur paraît-il.
Celui-ci a initié mon ami à toutes les curiosités historiques
de la ville. Et ainsi j'en ai profité au cours de la visite aux
deux églises, très vieilles et très originales avec des
vitraux rares... Puis
nous avons fait l'ascension des ruines du Château, le rival de
Pierrefonds, bâti sur les débris de l'ancienne ferté du IXème
des chevaliers Milon, par un d'Orléans frère de Charles VI,
vers 1392.  Les ruines sont encore imposantes, avec de bien curieuses
transitions de la forteresse au château renaissance ; les
mâchicoulis transformés en ornements, par exemple.
Les ruines sont encore imposantes, avec de bien curieuses
transitions de la forteresse au château renaissance ; les
mâchicoulis transformés en ornements, par exemple.
Après
nous avons dîné en causant naturellement de la lutte que Bedu
considère avec le robuste optimisme d'un Français qui a foi
dans la force de résistance de la "bonne terre de
France".
Le
14 juillet - Ravenet est venu
m'arracher à mon poste, m'emmenant dîner avec lui à
Nanteuil-le-Hardouin. L'après-midi, longue course à cheval ;
j'ai fait du galop forcené pour échapper à Ravenet qui aurait
voulu me faire manquer le train, me griser. Il m'a enfin avoué
que j'avais été proposé avec le n°2 pour le galon
d'officier.
Le
15 juillet - Rien de sensationnel.
Une simple et salubre émotion à la lecture du magnifique
discours de Poincaré aux Invalides .
Comme Paris devait être grave et beau hier pour sa fête
nationale. .
Comme Paris devait être grave et beau hier pour sa fête
nationale.
Ils
peuvent se dire avoir assisté à une des grandes émotions de
la France ceux qui ont écouté le Président dire les fortes
paroles de l'heure présente. C'est une belle page, à mettre de
côté avec celle du manifeste des intellectuels espagnols.
Voyage
à Mareuil-sur-Ourcq au C.B.
Rencontré
en route une vieille qui conduisait une voiturette d'enfant. La
plaine dorée ondulait sous le soleil, la moisson magnifique
s'étendait à perte de vue. Au ciel un biplan français passait
exactement au-dessus de nos têtes lorsque je la croisai. Elle
me montra du doigt le grand oiseau qui fait toujours frissonner
d'orgueil et d'espoir quand on reconnaît les cocardes
tricolores. Il n'y avait aucun doute possible, mais dans un
esprit hanté de pressentiments sinistres, de crainte obscure,
débordé dans l'incompréhension du malheur qui accable le
monde elle me dit ces paroles stupéfiantes. "Ils viennent
encore voler par ici pour brûler les blés !"... Je n'ai
pas compris et je filais trop vite pour m'arrêter et mesurer
son ignorante terreur.
Le
16 juillet - Le cri du cœur.
L'adjudant
Gruyelle, mon camarade de lit, de pension, un employé parisien
de la vraie France, intelligent, débrouillard, blagueur et
brave homme dans le fond, avec de rares qualités d'ordre,
d'économie, de sérieux, a reçu, selon les rites de la guerre,
en cachette et avidement, la visite de sa femme. Pendant
quelques jours, il a fait la navette entre le nid de passage
(Auger-St-Vincent) et Crépy plusieurs fois par jour. Les nuits
étaient... ce qu'elles doivent être entre gens qui sont
privés depuis de longs mois et qui ont la perspective d'être
séparés longtemps encore. Mais à ce régime le corps s'use,
s'épuise vite, et l'âme en ressent directement le contre-coup
sans doute, puisqu'au matin, vers 8 heures, rentrant dans notre
chambre après avoir reconduit sa femme dans le train, il me dit
en guise de bonjour : "Ah ! Enfin seul !". Mais un ah
! où il y avait une telle expression de soulagement candide que
c'en était comique, surtout avec l'expression transposée qui
suivait, et il ajouta en explication : "Je suis vanné ! Je
vais enfin pouvoir dormir tranquille".
Le
17 juillet - Crépy.
Bedu,
de la Ferté-Milon est venu me rendre visite. Tournée aux coins
historiques.
A
l'église, deux fillettes en sortant de l'école, avant de
rentrer à la maison viennent s'agenouiller et réciter un Ave
Maria. Bedu, instituteur laïque sent toute la beauté de cette
pratique simple, candide, et il la souligne de façon
remarquable, et il en reconnaît toute la valeur morale.
"Rien ne remplace l'éducation religieuse", me
dit-il...
Le
22 juillet - Voyages à
Villers-Cotterêts.
Livraison
du bétail existant en écurie au T.B. du 7ème
Corps.
Le
gestionnaire de ce dernier est un officier à trois galons.
Encore un qui justifie le mépris que l'on a, que je professe
pour les vieux galonnés. Leur tare la plus caractéristique et
la plus grave est leur pusillanimité, leur peur de
l'initiative.
Pas
une démarche, pas un geste, pas un mot, fût-il nécessaire au
salut de la Patrie, si un règlement bien explicite ne les
abrite. Pas d'histoires ! Tout, sauf cela. Et ils en ont une
crainte qui agit dans leur cerveau à la façon d'une pomme
gâtée dans un panier. Elle confine au gâtisme avec 4 galons,
à l'imbécillité avec 5. Ceux qui n'en ont encore que 3 ne
sont que froussards. Ah ! Malheureuse France gouvernée par des
bureaux où pullulent ces sortes de vieilles poires. Pas
étonnant que nous soyons vaincus, étranglés par
l'organisation vigoureuse et hardie de la jeune Allemagne. Des
hommes comme ce M. Chevassus nous en avons trop. Et ils sont
placés là où il faudrait un homme. Ils ont peur. Et ils n'ont
pas la foi. Que ferons-nous, me disait-il !... Pourquoi. A quoi
bon. On n'en sortira pas. Elle ne finira pas (la guerre). Ah !
Nous sommes engagés dans une belle aventure.
Et
lors de la retraite de la Marne, il remontait le moral de ses
hommes en se lamentant tout le jour : "Nous sommes foutus,
nous sommes foutus".
Le
23 juillet - Retour à Duvy.
Installation chez M. Legrand. Lehrer (instituteur).
Le
départ de Crépy, indifférent.
Gruyelle
était un bon camarade.
L'hôtesse,
Mme Brûlé, une brave femme. Le service, intéressant et
facile.
A
Duvy, c'est l'inconnu avec les possibilités de conflit entre
Töpfchen und ich.
Le
24 juillet - Journée riche en
impressions. Le matin, la remise de la médaille militaire à un
petit chasseur sur la place. Grand cérémonial de fête pour un
simple petit chasseur à pied blessé. Beau sujet de réflexion
philosophique avec épigraphe : "Ceux qui pieusement sont
blessés pour la Patrie ont droit..."
L'impressionnante
exécution du Chant du Départ. C'est un souffle qui emporte les
âmes.
Autre
chose, un peu plus tard, j'apprends avec preuves à l'appui que
j'ai failli être tué, il y a deux jours. La bombe d'un Taube
dont je riais, était bel et bien tombée à vingt mètres de
moi, dans la cour voisine.
L'après-midi,
c'est une longue excursion de service à Brasseuse. Je cause
avec une vieille femme qui lave devant sa porte. C'est une
bûcheronne de la forêt de Laigue réfugiée ici dans la
plaine. Deux de ses fils sont partis. L'un est blessé, l'autre
disparu ; sa belle-fille en pays envahi. Petit à petit on
glisse à la question à l'ordre du jour, à celle des
permissions : et à celle qui s'y rattache : les femmes
infidèles. Celles-ci sont légions. Ah ! elles s'en paient,
dans ces pays-ci où il y a de la troupe. Jamais on n'aurait cru
ça d'un tas de jeunes femmes. Les filles, ma foi, sont
excusables, de chercher à s'amuser, mais les femmes mariées !
C'est elles les plus enragées. Ce sera du beau quand les hommes
reviendront. Et comme la vieille a l'humeur joyeuse, elle ajoute
: "Il y aura de tout dans le pays : des petits dragons, des
petits arabes, des négrillons et des anglais ! Et c'est à
Saintines ici à côté qu'il est arrivé une drôle histoire à
une jeune femme. Elle était courtisée par un dragon pendant
que son mari est au front. Mais le dragon dut s'en aller appelé
ailleurs. Pourtant, l'amour continuait puisqu'un jour, elle
devait envoyer un billet de cinq francs à son cavalier, pendant
que d'autre part elle écrivait à son mari qu'elle ne pouvait
rien lui envoyer. Seulement la maladroite a simplement fait la
confusion des deux enveloppes. Elle a glissé dans l'enveloppe
du mari la lettre et le billet destinés au dragon... Celui-là
n'avait pas besoin de rentrer pour être fixé.
Si
cette histoire est un peu comique - à la Molière - en voici
une autre, à la Flaubert, plus profonde et plus triste. C'est
encore la vieille qui tout en bavardant me la raconte :
A
Verberie un brave artilleur père de famille obtient, parmi les
premiers une permission. Il y avait un an qu'il était parti,
laissant avec sa femme une fillette de deux ans. Maintenant elle
en a trois, et c'est un petit diable à la langue bien pendue.
Le père arrive un soir au crépuscule, le cœur gonflé de la
joie d'apporter une douce surprise. Il trouve la petite devant
la porte. Il l'embrasse. Elle ne le reconnaît pas. "Tu ne
connais pas ton papa-soldat" - C'est toi mon papa-soldat ?
-
Mais oui, mon petit.
-
C'est drôle, tu es habillé tout comme mon autre papa!
-
??? Ton autre papa ? Tu as un autre papa ?
-
Mais oui, celui qui vient tous les soirs.
-
Tu as un papa qui vient tous les soirs ? et qu'est ce qu'il
vient faire ?
-
Pardi, y vient se coucher un moment avec la maman, et pis il
s'en va.
Le
malheureux homme comprit. Un des artilleurs en cantonnement au
village l'avait remplacé.
Pâle
comme un mort, il prit la petite dans ses bras, la serra de
toutes ses forces, l'embrassa longuement, et lui dit: Adieu, ma
pauvre petite. Tu ne reverras jamais ton papa. Et sans rentrer
chez lui, sans un mot, sans une explication avec l'infidèle, il
tourna le dos à sa porte et d'enfonça dans la nuit, vers la
gare, vers le front.
Le
sergent Petit est rentré, lui, ce matin. Heureux d'avoir revu
les siens, dans sa maison à Besançon. Il y a les mêmes
scènes. Il m'a rapporté le récit d'un homme de Beure qui
ayant retrouvé sa place prise, a tué sa femme d'un coup de
hache...
Le
24 juillet - J'ai eu le plaisir dans ma tournée de
Brasseuse ,
de rencontrer un homme intelligent, le grand fermier Desvouges.
Il m'a raconté ses difficultés d'exploitation de la terre. ,
de rencontrer un homme intelligent, le grand fermier Desvouges.
Il m'a raconté ses difficultés d'exploitation de la terre.
Il
faut dire que dans cette belle plaine féconde, il met en valeur
600 hectares. Blé et betterave sont ses deux vaches laitières.
Il ne peut se sauver, s'en tirer que s'il fait le travail en
grand, la culture scientifique avec l'emploi des machines. De
plus il faut au fermier, pour n'être pas coulé et à la merci
des banques, un capital de mille francs par hectare ; avec cela
on peut supporter une mauvaise récolte, une récolte nulle, et
en préparer une autre et l'attendre sans sombrer, mais il faut
cela au moins. Mais ainsi armé et outillé et abrité on fait
de grandes affaires, de belles affaires si les saisons restent
clémentes. Il m'a montré la petite ferme où vivaient ses
ancêtres. C'est une ancienne bâtisse à demi féodale,
abandonnée et en partie en ruines.
Il
a aujourd'hui une ferme moderne immense, bien agencée avec une
distillerie et une villa d'habitation où rien ne manque.
J'ai
succédé à mon père, me dit-il, avec 200 hectares. J'en ai
aujourd'hui 600. Je fais vivre tout le pays. Sans moi ils
seraient incapables de faire rendre au sol de quoi les nourrir.
Notre
grosse difficulté est la main d'œuvre. Pour nos ouvriers
agricoles, le patron c'est l'ennemi. De là leur manque de
dévouement, leur paresse, leur jalousie, le peu de rendement
qu'ils fournissent. On a accusé les habitants du Soissonnais
d'être tous non pas des espions, mais des gens à vendre, et
fournissant le recrutement de pas mal de vendus. C'est un fait
exact, me dit-il, nous ouvriers n'ont point de patriotisme.
Le
patriotisme c'est la défense de la terre, à leurs yeux, la
Patrie c'est le sol, par conséquent la défense du patron.
Comme le patron c'est l'ennemi, le patriotisme est l'auxiliaire
de leurs patrons. Ils se gardent bien de se faire tuer eux, que
le patron soit Français ou Boche, cela leur importe peu, ils
seront toujours croient-ils, exploités. Ces sentiments-là sont
ceux des ouvriers français et plus encore ceux des émigrants
Flamands. Il faut se rappeler que les Belges forment des
colonies agricoles, tantôt sédentaires tantôt migratoires
dans toute cette région du Nord de l'Aisne, de l'Oise. Ces
sentiments hostiles tiennent à bien des causes. Les patrons ont
leur part de torts reconnaît mon interlocuteur, mais la
responsabilité en est surtout à la pratique éhontée de la
surenchère électorale, de l'absurde propagande socialiste dans
ces milieux prolétaires.
On
leur partagerait ma ferme je parie qu'ils font baisser le
rendement de cinquante pour cent et avant vingt ans, sur trente
co-partageants, il y en a vingt qui seraient redevenus
prolétaires tant il y a des éléments débauchés, paresseux,
imprévoyants et tant il y en a qui sont âpres au gain et au
développement. Nous avons l'activité, le goût de l'expansion
dans le sang, me dit-il avec une flamme dans les yeux. Et ce
petit homme grisonnant et sec qui vient de descendre de sa
moissonneuse est vraiment un type énergique. Je travaille deux
fois plus que si j'étais ouvrier, dix fois plus que si j'étais
mobilisé.
A
cela j'applaudis, et je lui affirme à sa stupéfaction : pas un
patron d'une exploitation agricole pareille à la vôtre, pas un
patron dont la présence est nécessaire pour assurer le
fonctionnement de la vie économique d'un village ne devrait
être mobilisé. Il rend, et vous rendez, j'en suis persuadé,
plus de services au pays, que s'il était un des premiers
soldats dans la tranchée. Plus de services indispensables
j'entends. La victoire sera au pays qui pourra subsister le plus
longtemps avec l'état de guerre. Or il faut faire vivre le pays
en même temps que le défendre. Les deux tâches sont aussi
importantes l'une que l'autre, c'est mon avis du moins.
Il
m'écoute jusqu'au bout, puis gouailleur, il objecte:
-
Et l'égalité qu'en faites-vous ?
-
Elle nous tue, elle nous tuera, vous dis-je.
La
discussion devenait politique, je la ramène au problème de la
terre. J'énumère les causes de la crise. La grande
propriété, la grande exploitation qui fait des paysans des
mercenaires.
Et
d'abord pourquoi la grande propriété ? La configuration du
sol, la richesse de cette terre, l'activité grassement
récompensée de ceux qui s'y appliquent. La grande exploitation
est une nécessité, un fait permanent dans la région.
Il
faut trouver des remèdes à la crise de la main d'œuvre.
Il
m'assure qu'il y a une réaction déjà commencée contre les
billevesées socialistes. Et il me lance cette proposition bien
inattendue de sa part :
C'est
par la coopération des patrons et des ouvriers que l'on se
sauvera. Il faut les intéresser au succès de l'entreprise,
leur donner leur part de bénéfices.
-
J'oriente mon jeune fils vers cela.
-
Vous n'avez qu'un fils ?
-
Oui, avec la grande propriété, si on veut qu'elle ne se
morcelle pas, c'est nécessaire, nous voulons toujours que le
fils continue le père.
J'objecte
que les Anglais ont un autre principe d'éducation. Le fils
recommence le père, l'aîné continue le père mais les autres
se débrouillent. Notre passion de l'égalitarisme nous oblige
à partager. Je n'ai jamais vu une famille nombreuse s'entendant
assez bien et assez longtemps pour faire prospérer une même
exploitation. Le remède c'est bien la coopération. Je crois
que j'y arriverai. Je leur proposerai une réduction de paiement
avec un tant pour cent sur les récoltes.
Et
notez que déjà ils sont plus heureux que les petits paysans de
chez vous, plus de gain, cinq francs par jour et logis, plus de
repos et moins de travail.
Le
25 juillet - L'inquiétude de
l'avenir nous oppresse. Les Russes sont battus, ils vont
abandonner Varsovie, évacuer toute la Pologne. La ruée
germanique aura conquis encore un gage de plus en vue de la paix
par épuisement qui viendra. Ensuite ce sera peut-être à notre
tour de la supporter. Y pourrons nous tenir tête. Je l'espère,
je n'en suis plus sûr depuis que nous nous sommes brisé les
dents sur Arras. Nous souffrons du manque de patriotisme et de
jeunesse de notre système gouvernemental et militaire
encrassé, usé. Nous n'avons que des vieux, des racornis, des
butés dans de vieilles formules creuses qu'ils ne peuvent
abandonner. Des jeunes, des jeunes, voilà la révolution qu'il
nous faudrait opérer pour utiliser l'arme ardente de la France
qui après s'être fait tuer, verse des flots d'or sur simple
appel du gouvernement. Je n'aurais pas soupçonné que le
patriotisme des Français pouvait aller jusqu'à les détacher
de leur or.
Le
26 juillet 1915 - Reprise des
tournées à travers la plaine pour les achats d'avoine. Ce
matin Roquemont Huleux Néry de retour par Glaignes.
 Le
Parc aux Dames Le
Parc aux Dames . .
Ruines
et emplacement d'une ancienne abbaye du 11ème
siècle - Bénédictins - rétablie en 1202 par Eléonore de
Valois (de Bouillancy), y installe des Cisterciennes - charte de
Philippe Auguste. St Louis visite le monastère en 1205 -
juillet, et y signe une charte en faveur de l'abbaye de
Morienval et donne aux religieuses le droit de prendre dans la
forêt de Retz (Villers-Cotterêts) chaque semaine 3 voitures de
bois, attelées de 3 chevaux.
Crise
vers 1245 - crise de discipline (excommunication des sœurs,
interdit de l'abbaye, déposition de l'abbesse). St Louis en
1244 accorde droit au passage dans la forêt.
XIVème
siècle. Abbaye dévastée, brûlée par les anglais - famine,
peste, destruction des titres, communauté ruinée se relève
car Henri III délivre lettre de confirmation des privilèges.
Vers
1650 - la 35ème abbesse est une sœur de Fouquet, le
surintendant: elle profite du crédit de son frère pour faire
embellir les lieux : reconstruction de l'église, vitraux,
cloître, nouvel autel (avec inscription du fondateur).
En
1652, lettres patentes l'érigent en châtellerie, avec droit de
haute justice à Auger St Vincent.
Vers
1720, l'abbesse est une sœur de Pelletier premier président au
Parlement de Paris (31 sœurs).
Dernière
abbesse : Suzanne de Saillant, fuit la révolution avec 19
religieuses.
Les
propriétés du Parc alors : moulin et étangs, fermes de
Bouville, Rouville, St Mard, Villeneuve, Magneval. Des terres
dans 6 villages voisins :
-Des
dîmes jusqu'à Verberie et Levignen.
-Des
revenus en natures jusqu'à Poudron, Thury.
-50
cordes de bois en la forêt de Retz.
-Des
rentes sur villes d'Amiens, Boulogne, Ferté-Millon, Crépy,
Retz, sur Hôtel de Paris, etc.
Total
des revenus évalués à 31000 livres.
Bâtiments
claustraux ont été presque entièrement démolis, il reste une
chapelle où était inhumée Eléonore de Valois.
Hélin
gouverneur du Valois, grand ravageur de domaines, met Philippe
Auguste en mouvement pour l'arrêter. Rencontre des deux armées
dans plaine de Trumilly, Baron. Conférence à la Grange St
Arnould près de Rully. Trêve. D'où possession du Valois fut
remise à Eléonore, 1184 - une maîtresse femme. Elle eut 2
maris, et pas d'enfants. Elle aimait les lettres, gouvernait
énergiquement - généreuse aux pauvres et aux églises -
rétablit l'abbaye du Parc aux Dames fonde celle de Longpré,
puis Haramont, dote hôpitaux et léproseries, meurt en 1214. Le
Valois alors réuni au domaine royal.
Le
27 juillet - Journée oisive,
journée morne. Ciel gris. Pas de nouvelles. L'horizon reste
chargé.
Du
Précis statistique du canton de Crépy en Valois . .
Chapitre
sur Bethisy St Pierre . .
 Les
châtelains de Bethisy avaient la haute justice, l'usage de bois
à brûler et à bâtir dans la forêt de Compiègne, le droit
de lever quatre deniers sur chaque femme publique qui passait ou
séjournait à Bethisy. On lit dans un aveu et dénombrement
servi en 1376 à Blanche de France, veuve de Philippe d'Orléans
que cette contribution qui rapportait anciennement dix sols
parises pendant la foire, n'en valait plus que cinq, le nombre
des contribuables ayant diminué. Le monde ne change pas. Les
châtelains de Bethisy avaient la haute justice, l'usage de bois
à brûler et à bâtir dans la forêt de Compiègne, le droit
de lever quatre deniers sur chaque femme publique qui passait ou
séjournait à Bethisy. On lit dans un aveu et dénombrement
servi en 1376 à Blanche de France, veuve de Philippe d'Orléans
que cette contribution qui rapportait anciennement dix sols
parises pendant la foire, n'en valait plus que cinq, le nombre
des contribuables ayant diminué. Le monde ne change pas.
Le
29 juillet - Transport d'avoine de
Glaignes à Crépy. De la ferme Thibault. Je déconcerte la
fermière en lui demandant et en lui donnant quelques
renseignements historiques.
Je
raconte à son fils l'histoire du lieu-dit le Champ au lièvre,
où en 1649 Jean de Hangest (?) de St Michel fut tué en
duel par le sieur de Javelle, blessé à mort pour un lièvre.
Visite
à la très vieille église : le porche remarquable est du XIIIème
siècle, des débuts de l'ogival, les piliers ont d'originales
décorations en feuilles de nénuphars et de vigne.
Restauré
à neuf en 1902 par le maître du château, M. de Chézilles,
qui vient d'être tué à la guerre.
Cueilli.
Dans l'histoire de B. Palissy par Jean Dupuy ces pensées :
ces pensées :
"Celui-là
monte le plus haut qui est parti le plus bas".
"J'aime
mieux dire la vérité en mon langage rustique que mensonges en
un langage rhétorique."
Le
30 juillet - J'ai mal dormi toute
la nuit ; la retraite des Russes, l'abandon de Varsovie me tourmentent ; la puissance de nos ennemis se développe de
jour en jour et s'affirme de plus en plus invincible.
J'entrevois la grande paix du néant, de l'épuisement ; la paix
boiteuse que refuse le Président. C'est beau de dire ce que
l'on ne veut pas subir. Encore faut-il prendre des mesures en
conséquence, et je ne sens pas que nous ayons agi en rapport
avec nos discours.
me tourmentent ; la puissance de nos ennemis se développe de
jour en jour et s'affirme de plus en plus invincible.
J'entrevois la grande paix du néant, de l'épuisement ; la paix
boiteuse que refuse le Président. C'est beau de dire ce que
l'on ne veut pas subir. Encore faut-il prendre des mesures en
conséquence, et je ne sens pas que nous ayons agi en rapport
avec nos discours.
On
ne sent pas la main ferme qui tienne le gouvernail avec la foi
sacrée, l'espérance indomptable, la volonté surhumaine qu'il
faudrait en présence de nos adversaires. Nous voguons au
courant du fleuve magnifique de l'enthousiasme du peuple, mais
sans pilote. Hélas où est le Gambetta qui nous électrise, où
est le Carnot qui martèle le bloc puissant des ressources
nationales et en forge une arme irrésistible.
Viviani ,
l'éteignoir, Messimy ,
l'éteignoir, Messimy et Millerand
et Millerand ,
Augagneur ,
Augagneur et Malvy
et Malvy ! Des baudruches ! Hélas, hélas.
! Des baudruches ! Hélas, hélas.
Ils
n'ont pas de foi, sinon de la mauvaise. Des arrivistes et non
des hommes. France, où sont donc les vrais enfants de la
Patrie, ceux qui ont l'amour sacré ? Où sont-ils ? Pourquoi ne
sont-ils pas au gouvernement ?
Le
30 juillet - Transport de paille de Trumilly-Baurain à
Crépy, de chez M. Ferry.
Le
propriétaire m'a fait les honneurs de son domaine et de sa
ferme. C'est un vrai roi mérovingien, du moins c'est
l'impression que je ressentais à voir ce beau vieillard actif
montrer en connaisseur toute la plaine avec les détails, toutes
les richesses de son installation. C'est une ferme magnifique.
600
hectares - 1/4 en blé, 1/4 en avoine, 1/3 en betteraves, le
reste en luzerne.
Il
a récolté jusqu'à 5000 quintaux de blé, 2000 x d'avoine. Il
élève 1200 moutons à la pulpe de betteraves et aux tourteaux.
Chacun
lui rapporte 50 à 60 (?) par an. Il a 80 bœufs
d'attelage, d'énormes charolais, 24 chevaux ; des étalons
boulonnais. Tout le pays est à lui, terres, bois, maisons,
ouvriers... un petit roi.
La
sucrerie est dans la plaine la succursale de la ferme-usine, où
l'électricité règne - pour l'éclairage, pour la batteuse,
pour la tonte des moutons, etc.
Ce
vieillard actif veille à tout. On sent l'œil du maître
partout, du maître passionné pour son œuvre... Il a un fils -
au front - l'héritier du domaine, le continuateur de
l'entreprise.
Dans
la maison, il m'a fait voir des tapisseries exécutées par sa
femme. Ce sont des chefs-d'œuvre, la tapisserie surtout. A
distance on jurerait voir des tableaux de peinture.
Le
31 juillet - "Nulle nature ne
produit son fruit sans extrême travail, voire et douleur".
B. Palissy.
C'est
samedi. Il y a un an j'arrivais le samedi soir à Verne quand la
cloche et le tambour annonçaient l'effroyable nouvelle : la
mobilisation... Je n'oublierai jamais les scènes d'atroce
effroi des femmes, la muette anxiété des hommes. Aujourd'hui,
c'est le vide morne ici, où les femmes travaillent habituées
à être seules.
Le 1er
août 1915
Dimanche.
Il y a un an j'étais à la messe à Verne pour la dernière
fois. J'évoque aujourd'hui, dans l'église de Duvy et les
scènes de l'an passé, et celles de cette année. J'attends des
lettres depuis plusieurs jours. Encore rien aujourd'hui. Mon cœur
se serre presque quand Moine me dit "Rien pour vous".
L'après-midi, je vais à Trumilly à la recherche d'un nid...
En même temps visite à l'église où il y a un bénitier qui
sert de fonds baptismaux magnifique. L'instituteur, une figure
énergique, belle tête plébéienne n'est pas un curieux.
Le
2 août - Réveil sensationnel. Je
suis simplement menacé de conseil de guerre pour
antipatriotisme ! Moi ! Antipatriote ! O ironie du sort.
Donc
hier après-midi, j'étais passé au cantonnement. J'aperçois
en train d'écrire, assis à une table, un soldat du 60ème.
Le numéro de ce régiment pique une curiosité. Je m'informe.
Et le jeune soldat m'expose qu'il a commis une
"couennerie". Qu'il a déserté ! Je me fais exposer
les détails. Il a quitté depuis trois jours Puisieux. Il
comptait aller chez sa mère dans la Loire, à pied. Une pauvre
tête fêlée, fouettée par le cafard. J'ai pitié de lui. Au
lieu de le faire arrêter et conduire à la gendarmerie je lui
conseille de regagner vivement son régiment. Aujourd'hui même,
ce n'est pas difficile. Je lui trace un itinéraire.
Mes
hommes l'ont réconforté, il montre tant de sincérité dans
son repentir, tant de véracité dans tous ses dires et
indications, que je n'ai plus nulle défiance à son égard.
D'ailleurs
je lui montre les avantages pour lui d'échapper à la
gendarmerie et par suite à toute la dureté du code ; la
perspective de se faire absoudre beaucoup plus facilement par
son capitaine et je lui recommande de ne rien dire sur moi qui
ne suis pas assez sévère envers lui, dans son intérêt, par
sympathie pour le 60ème par compassion envers un
malheureux égaré.
Paf
! Au moment où j'allais m'éloigner voici les officiers qui
entrent dans la cour. Leur signaler l'homme, c'est le livrer sur
l'heure aux gendarmes. Pour esquiver cette méchante action, je
m'éloigne sans rendre compte ; ils le découvriront et
l'interrogeront eux-mêmes s'ils le veulent. Je prétexte une
course et pars à Trumilly... sans plus songer à rien.
Le
soir, Petit me raconte qu'il a donné au déserteur avec de bons
conseils, une chemise propre et un paquet de tabac, et que le
garçon effrayé par la distance est allé à la gendarmerie...
Or, le soir ou le matin, des mouchards ont rapporté toute
l'histoire à l'officier qui n'avait rien flairé l'après-midi.
Il
a ruminé les conséquences ; s'est vu chargé de questions et
de responsabilités au cas d'une fuite du déserteur qu'il
supposait de mauvaise foi. Alors, il s'agissait pour lui de me
faire endosser toutes les responsabilités. Et comme les
circonstances et mon attitude se prêtaient bien à cela, il m'a
montré qu'on pouvait parfaitement me poursuivre en conseil de
guerre pour avoir favorisé l'évasion d'un déserteur, pour
manquement grave et conscient du devoir de tout gradé
d'arrêter un déserteur, et ceci ne pouvait être expliqué que
par l'antipatriotisme etc... etc. Qu'il se voyait obligé de
faire un rapport et qu'il n'apercevait pas le moyen de me
disculper, etc... Il fallait donc savoir si le déserteur
s'était rendu à son corps ou à la gendarmerie. J'ai couru à
Crépy - assez inquiet - mais où j'ai été pleinement rassuré
par le maréchal des logis de gendarmerie. Mon déserteur était
bel et bien de bonne foi.
(...
plusieurs lignes illisibles...)
Ah
! j'ai pu triompher, mais que la tentation a été forte.
Tout
conspirait à me pousser nach dem C. M .
J'avais un laisser-passer, j'ai un service commandé pour demain
matin là-bas dans le voisinage, le bruit de notre prochain
départ de la région, le vent favorable tout me disait,
va, c'est propice. Et une phrase de la lettre de Georges
semblait me dire si adroitement et si instamment : Venez, je
vous attends. .
J'avais un laisser-passer, j'ai un service commandé pour demain
matin là-bas dans le voisinage, le bruit de notre prochain
départ de la région, le vent favorable tout me disait,
va, c'est propice. Et une phrase de la lettre de Georges
semblait me dire si adroitement et si instamment : Venez, je
vous attends.
Mais
non ! Comment pourrais-je rentrer, un jour, et mentir. Ou bien
te dire qu'à l'heure où tu ne songeais qu'à moi, où tu te
préparais joyeusement à la fête intime et confiante, je t'ai
trahie, je t'ai oubliée. Et il m'a semblé t'entendre :
"Toi, tu n'es donc plus l'Edouard loyal que je
connaissais." Et comment s'approcher de celle-ci, confiante
aussi, ardente et jeune, qui ne demande qu'à m'aimer, à se
donner, où elle croit voir de la franchise. Et que pourrais-je
donner en échange de l'amour qui attire ? Non, je ne serais
plus moi.
Je
rougirais de profiter de sa candeur, d'avoir menti, d'avoir
obtenu un peu d'amour par subterfuge ou dissimulation.
Reste,
reste. Ne vas pas ! Et pour résister à la tentation bien
grande d'aller près de cette attirante enfant, je me suis
contraint à partir en vélo vers une direction opposée. Dieu
soit loué !
Et
je trouve en approbation ce passage :
 "Dans
le cours de vos joies, respectez toujours la dignité humaine ;
ne sacrifiez jamais à votre personnalité celle d'autrui, celle
de la femme surtout qui doit être protégée contre sa propre
faiblesse. Soyons sévères pour nous-même et n'oublions pas
que les seuls souvenirs qui ne laissent point au fond du cœur
quelque amertume ce ne sont pas ceux de nos jouissances ni de
nos ambitions trop souvent empoisonnées par le regret, mais les
souvenirs des services que nous avons pu rendre aux autres
hommes". "Dans
le cours de vos joies, respectez toujours la dignité humaine ;
ne sacrifiez jamais à votre personnalité celle d'autrui, celle
de la femme surtout qui doit être protégée contre sa propre
faiblesse. Soyons sévères pour nous-même et n'oublions pas
que les seuls souvenirs qui ne laissent point au fond du cœur
quelque amertume ce ne sont pas ceux de nos jouissances ni de
nos ambitions trop souvent empoisonnées par le regret, mais les
souvenirs des services que nous avons pu rendre aux autres
hommes".
Berthelot .
Discours à la jeunesse. Sorbonne 1897. .
Discours à la jeunesse. Sorbonne 1897.
Le
3 août - Voyage à Vauciennes pour
prendre du pain de guerre.
Il
y a là un ex-simple soldat à qui l'on a collé des galons
d'officier qui est gérant d'annexe. Un ingénieur, paraît-il.
Mais il n'a rien de puissant, le pauvre. Sur des épaules
voûtées une tête pâle affaissée s'incline. Des yeux ternes
à demi sortis de l'orbite sous des paupières trop grandes
élargies par force d'avoir été inclinées sur des livres. A
trop vouloir gonfler la poche on en a fait une loque. Ce savant
est une ruine d'homme. Aussi, quel piètre officier. Ni sang, ni
flamme. Pas un souffle viril d'espoir n'anime ce fatigué. Il
n'entrevoit que notre défaite, l'impossibilité de délivrer
notre sol. "Il y a longtemps que je n'espère plus qu'on
puisse les chasser" soupire t-il. Et dans ses yeux et dans
son geste et dans sa voix, il y a une résignation bêlante
d'impuissant.
Et
en fait de service, ces gens bombardés officiers par
protection, parce qu'ils ont ou des relations ou de
l'instruction et sans aucune considération de leur valeur en
tant que chefs, ces gens sont des nullités à peu près
complètes, ils sont d'une ignorance honteuse. Et j'enrage de
voir qu'on refuse obstinément de l'avancement à des adjudants
- voire même de l'active - et de la réserve, qui ont fait
déjà toute la campagne, qui sont au courant du service jusque
dans les détails pour avoir mis la main à la pâte dans toutes
les circonstances. Quelques-uns uns feraient des officiers
précieux, sérieux, trempés. Mais on les laisse végéter pour
galonner tous ces avortons de la bourgeoisie milleranesque ; on
donne les galons qui leur sont dus parce qu'ils les ont
mérités à des froussards du front ou des dépôts qui sauront
faire la noce élégamment avec des soldes gonflées dont on
dore leur oisiveté ou leur inutilité quand ce n'est pas leur
bêtise.
Si
nous sommes vainqueurs avec ce personnel là - et c'est ainsi du
haut en bas de l'échelle - ce ne sera pas notre faute.
Préparation
d'un nid. Que c'est doux.
Le
soir. Ordre de charger le convoi en vue d'un départ. Ce serait
pour Eméville... La nouvelle me rend tout pensif. Dois-je m'en
attrister, m'en réjouir ?
La
philosophie de la noblesse de la vie et celle de " Freut
euch des Lebens "
vont entrer en conflit. "
vont entrer en conflit.
Pauvre
Mille. Nos beaux projets tout prêts s'écroulent. Il faudra les
reconstruire et ce sera bien difficile. Il reste la
permission... Attendons.
Le
4 août - Départ pour Eméville, chez
Mme Pintat.
Le
12 août - Les jours passent vite à
cause de notre active occupation. Nous travaillons dur. Je ne
sais comment les hommes y peuvent tenir. Il faut ravitailler
chaque jour, recharger le convoi chaque jour et les
tâtonnements du début de nos deux apprentis font au moins
doubler le travail par leur maladresse.
Töpfchen
"schwimmt". Der blasse Helfer kennt nichts von der
Arbeit. Töpfchen ist ärgerlich und geärget. Er wagt den
Wagenmeister nach T. in Privatsachen zu schiken. Der arme Mönch
klugt sich sehr darüber. Die Wandergans hat nie sogar nicht
gedankt, sogar nicht ein Glas angeboten... Ja. Der Kerl
betrachtet die Mannschaft als seine diener Privatdiener. Hoch
und hohl. Kein Herz. Keine Ehrlichkeit.
Töpfchen
est perdu. L'auxiliaire qui n'y connaît rien ! Il est énervé,
et il énerve. Il ose envoyer le vaguemestre à T. pour des
raisons privées. Le pauvre Morel s'en plaint amèrement.
L'oiseau ne m'a même pas remercié, même pas offert un verre !
Ce type prend ses hommes pour ses propres larbins ! Gonflé mais
creux ! Sans cœur ! Malhonnête...!
J'ai
reçu aujourd'hui une lettre de M. R. quelle âme étonnante :
l'intelligence de Mme Bey avec un cœur digne de l'intelligence.
Une femme supérieure, sans envergure intellectuelle, faute de
culture, mais avec l'étoffe qui suffisait amplement. Et c'est
peut-être heureux. L'esprit aurait pu se développer aux
dépens du cœur, mais c'est celui-ci qui a reçu l'éducation
supérieure avec des dons rares, et cela fait d'elle une femme
exceptionnelle. Oh ! Heureux celui qui l'eut. Il paraît que
c'était un tendre, un doux, un peu faible. Ils ont vécu sans
autre passion qu'un amour réciproque, discret et ardent. Est-ce
le malheur qui l'a rendue si suave. Peut-être. Mais malgré ses
trente-cinq ans elle a l'âme plus vierge et plus riche que
beaucoup de jeunes filles à grande prétention. Quel est donc
cet archet qui m'émeut à chacune de ses pages ?...
 Le
13 août - On nous a communiqué il y
a trois jours un ordre du grand Q.G. qui interdit de fermer les
lettres, qui les soumet à la censure de l'un des officiers du
détachement! Ainsi les secrets les plus intimes vont être
jetés en pâture à un homme qui vous connaît, qui vous
commande, qui n'offre d'autre garantie morale que sa ficelle
dorée, et nous savons trop qu'elle est trop souvent cousue sur
la manche d'un goujat. Non, j'ai peine à croire à une
inquisition aussi effrontée. Si encore le salut de la Patrie
avait vraiment quelque chose à y gagner, nous nous inclinerions
en silence et nous ferions même ce sacrifice. Nous n'écririons
plus que des bulletins de santé, et nous refoulerions dans nos
cœurs les pensées chères. Jamais on n'avait poussé la
discipline aussi loin. Ce n'est plus de la discipline c'est la
plus odieuse compression qu'on puisse faire endurer à un
soldat. Et je crains fort qu'il n'y ait dans cette mesure tout
autre chose que le souci du secret de la position des troupes. Le
13 août - On nous a communiqué il y
a trois jours un ordre du grand Q.G. qui interdit de fermer les
lettres, qui les soumet à la censure de l'un des officiers du
détachement! Ainsi les secrets les plus intimes vont être
jetés en pâture à un homme qui vous connaît, qui vous
commande, qui n'offre d'autre garantie morale que sa ficelle
dorée, et nous savons trop qu'elle est trop souvent cousue sur
la manche d'un goujat. Non, j'ai peine à croire à une
inquisition aussi effrontée. Si encore le salut de la Patrie
avait vraiment quelque chose à y gagner, nous nous inclinerions
en silence et nous ferions même ce sacrifice. Nous n'écririons
plus que des bulletins de santé, et nous refoulerions dans nos
cœurs les pensées chères. Jamais on n'avait poussé la
discipline aussi loin. Ce n'est plus de la discipline c'est la
plus odieuse compression qu'on puisse faire endurer à un
soldat. Et je crains fort qu'il n'y ait dans cette mesure tout
autre chose que le souci du secret de la position des troupes.
Je
flaire que les vieux pontifes qui nous commandent, qui nous
morigènent depuis un an de leur suffisance creuse en nous
faisant répéter par des journalistes dociles : ça va bien, de
quoi vous tourmentez-vous, ça ira bien, quand l'heure sera
venue. Nous saurons choisir notre heure. Et la France ardente et
confiante a cru que c'étaient des conseils de patience ; elle a
attendu, elle attend. Et ces vieux fatigués n'ont au bout d'un
an rien à montrer de leur œuvre préparée dans le silence.
Quels succès ont-ils à offrir en réconfort au pays héroïque
: Rien, rien, rien. Et quel succès prochain peut-on entrevoir
après un an de préparation : aucun. On nous répète toujours
: le temps travaille pour nous. Attendez, ignorants, ne cherchez
pas à pénétrer les secrets des Dieux.
Nous
avons respectueusement été pleins de confiance. Mais comme à
la fin, vous répétez toujours la même antienne, nous
finissons par croire que vous nous "bourrez le crâne"
pour masquer votre impuissance. Et pour étouffer les reproches,
les critiques, les plaintes, les impatiences si justifiées par
votre stérilité, vous nous imposez une odieuse violation de la
liberté de penser à nous citoyens de la République en l'an
1915 ! Cela dépasse les bornes.
Tixier
le gouailleur m'a résumé cette indignation par cette phrase
vulgaire mais expressive : "Je crois qu'ils poussent"
nos chefs, hein ?
Oui
ils poussent la plaisanterie trop loin.
Le
père Joffre et ses acolytes après avoir inspiré une grande
confiance et de grands espoirs finissent par me faire songer à
une bande de vieux gagas suffisants et pusillanimes. Des chefs
jeunes, qui aient la foi et l'audace, de grâce.
Le
19 août - Billot quitte le convoi.
Il est affecté sur sa demande à une batterie d'artillerie
lourde. C'est un type original.
Il
y a exactement un an que je l'ai connu. C'était à mon second
ravitaillement, je crois. Je suivais à pied le convoi ; à
travers la plaine de Haute-Alsace, les voitures s'égrenaient au
long des champs d'avoine. J'étais monté sur une voiture au
hasard, et j'en avais choisi une à ressorts, une jolie
voiturette peinte en jaune. Et comme je suis curieux de
psychologie, j'avais fait connaissance avec ce brave conducteur
qui était tout simplement dans le civil juge d'instruction à
Annecy ! Juge d'instruction et ici un vulgaire tringlot. Rien
d'ailleurs dans son air, sa démarche, ses manières ne
trahissait le juge.
Une
allure dégingandée de garçon cagneux qui faisait craindre
pour son équilibre à chaque pas, un visage au premier abord
peu expressif, du laisser-aller dans la tenue, un air, seulement
un air nigaud et jemenfichiste, tout le déguisait. Donc il fut
conducteur. Puis plus tard, sa voiture étant légère, on avait
remarqué qu'elle serait bien commode pour les courses, les
emplettes, à droite et à gauche, et elle fut affectée au
service de la popote des officiers, le conducteur en même temps
; et c'est ainsi que Billot devint une sorte d'auxiliaire larbin
de ces messieurs les officiers. Il noyait son dégoût ou son
humiliation dans le vin, et prit souvent des cuites formidables
qu'il distinguait finement des cuites vulgaires ou cuites
crapuleuses en les nommant des cuites esthétiques !
Je
ne sais ce qui le fit abandonner ce poste plus tranquille que
digne, mais quelques mois après, mon Billot donnait gravement
des lavements aux chevaux malades. Affectation nouvelle,
l'infirmerie des chevaux ! C'est là qu'on vint le déranger
pour l'appeler à la défense d'une fournée d'accusés par le
conseil de guerre. Enfin il avait trouvé un emploi - accidentel
il est vrai - de ses capacités.
Ses
plaidoiries terminées, il s'en revint avec sa philosophie
habituelle étriller les chevaux fatigués.
J'arrivais
à causer avec lui. C'est un type bizarre. Il manque de cette
fierté ou de cette chaleur qui fait émerger et écarter hors
du vulgaire un homme doué comme lui. Mais soit gaucherie, soit
paresse, soit affaissement moral, il n'avait qu'un souci, se
tenir "peinard" pour éviter les "tuiles".
Il n'en est pas moins un esprit fin et cultivé. Il lisait
quelque peu - ne pensait plus guère dans cet avachissement
contagieux de la vie en campagne et en demi-caserne, pourtant il
avait des idées fort précises et fort justes sur les
problèmes diplomatiques. Il s'en va. C'est un vide, il
caractérisait un peu un aspect du CVAD 1/7.
Le
soir. Hier la fièvre s'est renouvelée. Oh ! Je n'ose examiner
la situation de ma conscience. Est-ce que nous ne nous
éloignerons pas d'ici. Ce serait mon salut.
Loin,
loin de grâce, pour rester fort.
 
|