|
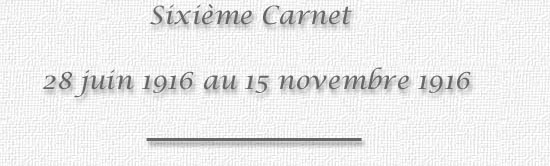
-Somme-
(Partie
2)
Le 1er
août 1916
Hier
les Boches nous ont envoyé quelques marmites. De grands trous
dans les champs de blés. Aujourd'hui répétitions. Ordre est
donné de creuser des tranchées-abris dans les abords de chaque
cantonnement.
De
Marthe S. "Vous vous souvenez encore des beaux soirs de la
Comté, où le ciel est si léger, où les collines qui se sont
éloignées, semblent bleues. Je voudrais pouvoir vous envoyer
un peu tout leur charme et toute leur douceur".
Le
camp de prisonniers. L'interprète - un frère mariste de
Fribourg (Suisse) - ex-professeur à St-Jean (Besançon), M.
Pasquier, me fait un excellent accueil. Il a un léger accent
alsacien, connaît plusieurs patois allemands.
Il
est préposé à l'interrogatoire des prisonniers. Dans son
bureau, des plans de défenses du front - défenses allemandes.
Les interrogés indiquent la tranchée, le boyau que tel ou tel
régiment occupe, les plus bavards, les occupants du secteur
voisin, etc… les secteurs divers occupés à diverses dates.
En
classant les renseignements, il a pu se constituer un dossier
très intéressant, lui donnant avec la rapidité d'un
dictionnaire la situation actuelle, et les mouvements passés de
chaque unité allemande.
Il
y là un beau travail, d'homme intelligent.
Il
m'a donné quelques brochures saisies sur les prisonniers.
Très
intéressantes pour la psychologie boche.
Le
2 août - Deuxième anniversaire de la
grande catastrophe.
Je
rencontre deux prisonniers, un Polonais, il est ravi d'être
pris. Beaucoup de Polonais se rendent. Un Rheinländer ; il est
las et ne songe plus à rien, rien qu'à l'avenir. Il n'admet
pas que l'Allemagne puisse être battue, mais être victorieuse.
"Das wird schwer sein" (Ça va être dur).
Visite
à l'ambulance. Rencontré Collot, Melcot. Pris connaissance
avec infirmiers Seger et Quinnez.
Le
premier, curé de Noidans-le-Ferroux, connaissance de Ravenet,
portant moustache et fumant la pipe, disant d'un jeune homme qui
se destine à la prêtrise :
"Encore
un qui va mal tourner". On le regarde pour savoir s'il
plaisante ou parle sérieusement.
Le
deuxième, vicaire à Besançon St-Jean, me donne des nouvelles
d'Auguste Grossard, me montre la photographie d'un groupe où se
trouve son frère de Baume-les-Dames. J'y reconnais Francis
Nottet.
Seger
est employé à la radioscopie. Il me laisse comprendre qu'il
assiste à des spectacles navrants que la faiblesse de
caractère des majors laisse insoupçonnés. Un bon nombre de
blessures à l'examen radioscopique présentent des grains noirs…,
de la poudre non brûlée… témoin irréfutable, irrécusable
et accablant d'une mutilation volontaire.
Blessures
aux mains faites par la grenade ou une fusée, enlevant
régulièrement les mêmes doigts…
Autre
misère encore plus grave : ce matin un capitaine, et deux
autres officiers se sont fait amener à l'ambulance avec
blessure fictive… Ce soir, il y a attaque…
Ah
! Le moral de nos poilus !…
Ces
faits sont gravement inquiétants, non parce qu'ils se
produisent, mais par l'indulgence tacite qu'on leur accorde.
Il
y a toujours eu des pleutres, mais j'aimerais qu'on leur fasse
payer leur lâcheté autrement que par des décorations, car je
vois d'ici le beau motif à citation d'un officier ayant un
bobo, une égratignure insignifiante qui réussit à se faire
évacuer par la complaisance lâche d'un major : "N'a
consenti à quitter son poste qu'après avoir donné tous les
ordres qu'exigeait une situation délicate"… citations
hypocrites et mensongères auxquelles les vrais poilus qui
gardent leur poste et qu'on menace du poteau ou du revolver ne
se laissent pas prendre.
Le
Commandement du 45ème Bataillon de chasseurs à
pieds serait l'objet d'une telle rumeur calomnieuse ou
médisante ?
Rien
d'étonnant à ce que les troupes de tels chefs lâchent pied.
Ce
soir je retourne au camp des P.G.. Je cause avec un interprète
qui descend des postes d'écoute. Il y a des appareils secrets
qui permettent de saisir ce qui se dit dans les postes de
commandement allemand.
Les
Boches fusillent nos interprètes saisis "auf die
Lauer" (en situation d'espionnage).
Pendant
que je parle avec lui arrivent, amenés au pas rapide des
chevaux arabes, deux prisonniers. Il sont hâves, poussiéreux,
blêmes, prêts à défaillir de fatigue tant les deux spahis,
sabre au clair les ont fait marcher vite.
Les
deux spahis font signer en grande hâte une décharge par l'aide
interprète. Ils n'entrent même pas dans le camp et détalent
au plus vite. Il y avait des raisons à cette hâte.
En
effet, à peine questionnés les deux pauvres diables se
plaignent que les spahis les ont battus et leur ont volé une
montre, "un souvenir de famille", ils disent qu'ils ne
sont pas responsables de la guerre, l'interprète leur fait dire
quel est le responsable : (le Kaiser).
Quant
à leur montre, on la ferait bien rendre par les spahis - deux blancs - mais ils sont partis et on ne les connaît pas.
Faire une enquête ? Bah !…
- deux blancs - mais ils sont partis et on ne les connaît pas.
Faire une enquête ? Bah !…
Quand
M. Pasquier arrive et qu'on lui rend compte de la plainte il dit
:
Ah
non pas ça. Il ne faut pas permettre ces indélicatesses, mais…
les spahis sont partis, … et puis de quoi se plaignent-ils,
ils sont là, hein ! Ça aurait pu leur coûter plus cher qu'une
montre. D'ailleurs ils en ont volé bien d'autres depuis deux
ans et en 1870.
(Un
piquant sujet de nouvelle, l'odyssée d'une montre, volée par
le père en 1870,et reprise au fils durant la seconde invasion.
Qu'on brode là-dessus le spahi, fils ou petit-fils du premier
propriétaire…)
Les
prisonniers se plaignent tous avec terreur de nos artilleurs. Le
supplice du bombardement est atroce. Que nos artilleurs ne se
fassent pas prendre, les Allemands leur en veulent tant qu'ils
leur crèveraient les yeux…
Le
3 août - Ravenet en rentrant hier
soir me signale "qu'il a fermé les yeux pour ne pas voir
une scène écœurante" :
Un
artilleur "à moitié mûr" s'est précipité sur deux
prisonniers (ceux que j'avais vus) une trique à la main et en
asséna deux coups sur le plus faible qui se mit à pleurer.
Les
spahis n'ont pas su l'empêcher, cette brute qui gueulait :
"il faut que j'en tue un", à quoi les assistants ont
répliqué en l'arrêtant : "va donc là-haut, tu en tueras
tant que tu voudras".
Les
spahis se sont éloignés, les camarades se sont agités, ont
désapprouvé, Ravenet a fermé les yeux pour ne pas voir… et
l'affaire passe au bleu.
En
France, il en est trop souvent ainsi, même presque toujours. Il
n'y a jamais personne pour sévir ; pas un caractère assez fort
pour appliquer les sanctions méritées ; on se contente de
désapprouver en silence. On "n'éduque" pas autrement
les enfants gâtés.
A
la suite des bombardements de plus en plus fréquents et
rapprochés, la Place ordonne de repérer les caves et de
creuser des tranchées-abris.
Nous
commençons au verger. La
propriétaire vient protester.
On
rebouche les tranchées à moitié faites. On creuse dans un
champ voisin. Ordre. Contre-ordre. Désordre.
La
Division est retirée des lignes. Les Postes ont reçu l'ordre
de se tenir prêtes à partir.
Une
heure après, contre-ordre. On ne part pas. Ordre. Contre-ordre.
Désordre.
Principe
: "Ne jamais exécuter un ordre sans avoir attendu et reçu
le contre-ordre."
Nouvelle
visite au camp de P.G.
Un
"socialdemocrat" fougueux. Des Saxons. Il déteste la
guerre.
Un
Rheinländer écoute les explications de l'interprète sur
l'origine du conflit. Ils sont moins convaincus de l'innocence
de l'Allemagne que les précédents prisonniers. Ils ne sont pas
sûrs de la victoire.
"Wir
waren nicht bereit, aber jetzt sind wir endlich bereit", (nous
n'étions pas prêts, mais maintenant nous le sommes enfin),
leur dit-on. Et ils sentent que c'est vrai.
Le
mécontentement et la Niederschätzung (mépris) envers
les officiers se répand.
-
Ils ne savent même pas lire une carte.
-
Ils n'ont aucune préparation militaire.
-
Ils ont eu leurs galons à cause de leur instruction et non pas
de leurs capacités.
-
Ils nous font tuer maladroitement.
-
Il y a beaucoup d'instituteurs qui ont les galons d'officier.
Le
4 août - Guillaucourt. Corvée de
lavage à la Luce. Pendant que nous étions dans le vallon, une
batterie allemande a envoyé sur Guillaucourt une cinquantaine
d'obus : la gare, l'hôpital, le centre de ravitaillement ont
été particulièrement visés, repérés, touchés. Miracle
qu'il n'y ait pas eu quelques victimes.
Pendant
le bombardement Bordenet ne vivait plus, paraît-il. Il s'est
tapi dans la tranchée ébauchée hier, muni de son casque et de
son masque. A chaque arrivée un bond en l'air, comme une
décharge électrique l'eût secoué. Une loque humaine qui ne
réagit même pas. Il se targue d'être un franc froussard.
A
midi, il n'a pas déjeuné. Il est parti tremblant, livide, dans
la vallée où les obus ne tombent pas ! Il est furieux contre
nos aviateurs de ce qu'ils ne démolissaient pas l'avion boche
régleur du tir.
Nous
reprenons du poil de la bête. Hier, à Verdun le village de
Fleury est redevenu nôtre, avec mille huit cents prisonniers.
Lu
dans le Frankischer Kurier, des articles dans le genre de ceux
du "Matin". Dénigrer l'adversaire russe, insister sur
ses pertes, nier ses propres pertes !… Bourrage de crâne.
Les
faibles sont menteurs.
Le
5 août - Proyart .
Hier au soir l'ordre est venu d'être prêt à partir au matin. .
Hier au soir l'ordre est venu d'être prêt à partir au matin.
Ravenet
a la visite de son cousin du 45ème chasseurs,
celui-ci sort de l'attaque où il a gagné la Croix de guerre.
Il nous en raconte qui donnent une idée juste - et singulière
- de la discipline réelle dans la tranchée ; non pas la
discipline des règlements, mais celle qui naît de la force des
choses et qui est peut-être l'opposé de celle qu'on se figure.
Il
résulte de leurs récits qu'il y a deux sortes de soldats, sans
distinction de grade ou de rang : les braves et les froussards.
La plupart des braves sont des casse-cous indomptables qui ont
en horreur l'obéissance passive pour les minuties des services
; ils ignorent généralement la politesse et n'ont aucune
notion du respect ; ils classent les hommes en deux catégories
: les peureux (des c…), les braves, leurs égaux qu'ils
tutoient.
La
plupart des bons soldats de la caserne, dociles, discrets,
timides sont timides au feu. Beaucoup de chefs feraient de bons
soldats. Beaucoup se terrent prudemment dans leur cagna ou poste
de commandement, dès que le danger se promène dans les
tranchées ; ils donnent leurs ordres, mais ne vont pas en
contrôler l'exécution. Aussi dès qu'ils peuvent reprendre en
main leurs hommes, ils n'y parviennent plus et essuient les
réponses injurieuses des casse-cous qui tenaient la place du
chef.
-
Vous ne faisiez pas tant le crâne, tel jour.
-
Quand les marmites tombaient vous ne veniez pas voir s'il
manquait des boutons aux capotes, etc… Je ferai ça si ce me
plait.
Départ
de Guillaucourt à 5 heures.
Arrivée
à Proyart à 8 heures.
Toute
la journée aménagement du cantonnement. Le soir visite du
Commandant de la Brigade (le colonel Beraud-Renaud (92ème
B) 152ème d'infanterie).
M.
Corbin s'est prudemment effacé pendant tous les préparatifs de
départ et travaux d'arrivée. Ses mains dans les poches, il
erre silencieux, impénétrable.
Jean
Roy est venu m'apporter quelques détails sur la mort de
l'adjudant Roy.
Le
6 août - Proyart. Revue du
cantonnement à 10 heures par le lieutenant. Messe des morts à
11 heures pour les officiers et soldats du 352ème
tombés à la dernière attaque.
Allocution
de l'aumônier divisionnaire :
"Pleurez,
mes frères dans le Christ, pleurez, parce que selon le mot de
l'Écriture que la lumière de votre œil s'est éteinte.
La
lumière de notre œil ce sont ces vaillants officiers,
sous-officiers et humbles soldats qui sont tombés l'autre jour
"au Chancelier ". ".
Pleurez,
mes frères dans le Christ, pleurons nos morts, mais ne pleurez
pas comme ceux qui sont sans espérance…
…Nous
chrétiens, nous pouvons regarder les tombes de nos morts. Elles
ne sont pas pleines de pourriture mais elles débordent de vie
éternelle.
Comparaison
simple et belle du grain jeté en semence dans la terre.
"Les splendeurs de notre cœur vont s'épanouir".
La
musique du régiment a joué la marche funèbre de Chopin.
Le
soir les pièces du train blindé tirent dans le voisinage et
font sursauter toutes les vitres et toutes les portes. A quoi
ripostent copieusement les Boches. On entend passer leurs obus
lourds comme un vol de tôles qui se heurtent. Bordenet, pâle,
cadavérique, ne peut souper.
Lettre
libératrice de Mme R.
Le
7 août - Proyart. Examen des C.O.A..
Mécontentement du lieutenant. Prescriptions et exigences telles
qu'un esprit de vieux sergent peut les formuler.
Motif
de punition dicté par lui :
Deux
jours de consigne au soldat Baston : "est arrivé en retard
au moment de l'appel".
L'après-midi,
bruits d'un nouveau départ.
Nous
partons demain à l'aube. Auparavant je suis allé faire un tour
dans la longue rue, vers le sud-est pour découvrir la plaine
où nos pauvres Comtois ont lutté en août 1916. Dans ces blés
le long de cette longue route qui se dissout à l'horizon, ils
ont sué sang et eau. Mes pauvres frères, mon Maurice, sa foi
ardente devait étinceler dans ces premiers chocs. Il me semble
que tu es triste à présent. Tant d'efforts sans résultat.
Que
dis-je ? J'ai tort. Il y a déjà un grand résultat, puisque
les terribles avaleurs de provinces seraient heureux de rentrer
chez eux. Ils n'exigent plus ni annexions ni indemnités…
Le
long d'une rue, devant une maison, il y a un, deux tertres,
presque ensevelis sous la poussière de la route.
Deux
croix, quelques fleurs souillées, des débris usés d'une
humble couronne en papier goudronné : deux tombes de soldats ;
je m'approche, sur l'une des croix pend la visière disparue,
une loque sans couleur précise et qui fut un képi rouge. Une
simple inscription sur la croix :
"Ici
reposent cinq soldats français".
Je
demande à une femme à quel régiment appartenaient les morts.
C'est du 45 et du 60, me dit-elle.
Je
me suis en allé bien vite pour cacher mon trouble.
C'est
du 60. Cher régiment bisontin ! Des enfants de la Comté qui
sont venus mourir là. On ne les reconnaîtra jamais, pas plus
que les neuf allemands de la tombe voisine, plus effacée que la
première. Elle est bientôt rentrée dans le grand oubli de la
terre.
22
heures. La canonnade éclate, furieuse. Il semble que les tôles
du ciel s'effondrent.
Le
8 août - Camp 59 (Morcourt). Départ
de Proyart à 6 heures, derrière le régiment. Marche paisible,
pas trop longue. Nous entrons dans la vallée de la Somme puis
remontons aussitôt après avoir aperçu de loin ses eaux
paresseusement étalées, vers le camp.
C'est
dans un boqueteau ravagé au couronnement d'une colline chauve
que campera le régiment. Les hommes et les chevaux y
grouillent. Nous ne sommes pas les premiers occupants car sur
les flancs de la colline et tout les abords le piétinement a
tué jusqu'au dernier brin d'herbe, et le sol fauve avec ses
tentes parsemées çà et là fait songer à un paysage arabe.
Dans
le bois, des baraques Adrian. On nous en affecte une,
insuffisante, Ravenet et moi dressons notre tente au pied d'un
chêne dont les chevaux ont rongé l'écorce mais dont l'ombre
est encore honorable.
Le
Colonel a promis une visite dans le camp. Grand remue-ménage.
Il faut installer le camp comme un cantonnement riche en
ressources. Grand remue-ménage. Cris, gronderies, etc.
A
4 heures le Colonel est venu ; il n'a pas regardé la baraque,
mais les hommes, et s'est comporté comme un vieil adjudant
rempilé, remarquant une cravate absente, des cheveux trop
longs.
Une
lettre de C.
A
300 mètres de nous, des batteries de pièces lourdes sur voie
ferrée envoient leur terribles décharges. On dirait des
collines d'acier projetées les unes contre les autres ; la
maison sursaute, la tente s'affaisse sous la déflagration.
Bordenet
ressent une commotion à chaque coup. Le premier est une
surprise pour tous, mais pour lui toutes les détonations lui
font également mal.
Il
ne mange pas, on l'appelle à table. Il répond : pas
maintenant, je les guette ! Il est grotesque et fait pitié.
Le
9 août - Camp. Le lieutenant,
talonné par le nouveau colon veut réagir contre les habitudes
de lambinerie que la Compagnie a prises de longue dates.
Il
est debout équipé dès l'aube.
Il
fait sentir des reproches sur les moindres détails du service.
Il
a une expression malheureuse qui nous fait sursauter, Ravenet et
moi.
"J'ai
senti hier une certaine résistance dans tout le
personnel".
-
Même nous ? fit Ravenet.
-
C'est notre grade... ? dis-je en même temps.
Le
pauvre est assis.
Louis
m'envoie lettre et journal de Salonique.
Pendant
le dessert, un nègre du voisinage est venu causer avec nous.
C'est
toute une révélation :
Musulman,
il refuse vin, rhum.
Fiancé,
il dit n'avoir jamais de rapports avec une femme, (sauf des
filles publiques). "Il ne faut pas se servir de ce qui
appartient aux autres".
Commerçant,
il nous établit bel et bien le décompte des pertes que lui
cause la guerre.
Visiteur,
il a des réparties fort spirituelles.
Tout en ses
propos révèle un homme beaucoup plus intelligent que la
plupart de nos simples soldats dont la moyenne intellectuelle
est si faible.
Mon
nègre d'ailleurs est instruit. Il parle français correctement,
connaît deux langues nègres (Youlof et mendengue) comprend
l'italien, l'anglais, un peu d'allemand, lit le Coran, parle
arabe. Il est interprète au 35ème Colonial.
Comme
je lui demandais s'il croyait à ses grigris, il me réplique :
"est-ce que les catholiques ne croient pas à leurs
médailles ?"
Le
10 août - Camp 59.
Pensée
: D'après le Code la femme suit le mari ; dans la vie l'homme
suit la femme.
Corvée
de lavage dans une des anciennes tourbières de la vallée de la
Somme à Morcourt. Pluie.
L'après-midi,
tir des C.O.A. Saillard fermant les yeux.
Depuis
vingt-quatre heures une canonnade infernale déferle du front
anglais, elle a parfois la précipitation d'un tir de
mitrailleuses.
Deux
victoires : Stanislau voit apparaître les Russes.
voit apparaître les Russes.
Les
Italiens ont emportés Gorizia .
Quelle ardente revanche, quel enthousiasme doit faire haleter
ces gens orgueilleux et passionnés qu'on menaçait il y a deux
mois d'une Strafexpédition (punitive), qu'on traitait de
mandolinistes… .
Quelle ardente revanche, quel enthousiasme doit faire haleter
ces gens orgueilleux et passionnés qu'on menaçait il y a deux
mois d'une Strafexpédition (punitive), qu'on traitait de
mandolinistes…
Italia
fara da se ! (L'Italie se fera par elle-même)…
La
courbe descendante de la guerre se dessine plus énergiquement.
Harden vient de sa rude voix rappeler l'Allemagne à la dure réalité
et lui hurler qu'il ne s'agit nullement de partager les
dépouilles des ennemis, mais de tenir ferme devant un très
grave danger.
vient de sa rude voix rappeler l'Allemagne à la dure réalité
et lui hurler qu'il ne s'agit nullement de partager les
dépouilles des ennemis, mais de tenir ferme devant un très
grave danger.
Le
11 août - Marche militaire avec
Ravenet par Morcourt-Cerisy.
La
vallée de la Somme noyée dans le brouillard.
Najowsky
piqué par les quolibets du Bataillon croisé en route pour le
Dépôt (des éclopés) me dit qu'il va demander à être versé
au 35ème.
"Au
moins c'est un régiment", celui-là.
Après-midi,
visite de Collot.
Le
12 août - Lettre de Marthe S. (sur
le féminisme et l'avenir des Françaises).
Le
lieutenant vient à l'exercice. Il est bavard, bavard,
intarissable aujourd'hui.
Sujet
de discussion : la conduite des femmes des guerriers.
"Je
serai impitoyable", nous assure-t-il. Et pourtant le bruit
court dans tout le régiment qu'il doit ses galons à sa femme…
Jean
Roy vient m'annoncer la mort de son Armance. Trois enfants
restent sans mère.
Le
13 août - Dimanche au camp 59. J'ai
fait une courte apparition à la messe en plein air sous les
grands chênes.
L'aumônier
disait :
"Faites
passer du divin dans votre vie. Priez comme vous respirez.
Priez, non pas le matin ou le dimanche, ni à genoux, mais priez
partout".
L'après-midi,
séance récréative après la grosse déception d'une simple
carte quand j'attendais depuis longtemps déjà une lettre de ma
pauvre Mille !
Une
scène provisoirement installée en plein air, l'ombre des
grands arbres, les avions dans le ciel, quelques bancs de
fortune, des planches, des drapeaux, de la verdure, des articles
d'occasion, un phonographe sorti de je ne sais où servant
d'orchestre, c'est un spectacle fort pittoresque.
Le
soir "bombe idiote". Brusque émulation à payer
chacun sa bouteille.
Le
14 août - Camp 59. Journée grise.
Malentendu
des hommes du 352ème et la corvée d'eau.
De
Dôle et la visite médicale.
Conférence
du général de Division aux officiers.
-
Service intérieur, discipline et tenue, "comme à la
caserne" !…
-
Le "devrait-être" du lieutenant.
Le
15 août - Camp 59. Quand l'aumônier
Dujardin m'a dit ce matin : "nous avons une messe à onze
heures" ; je l'ai regardé avec des yeux interrogateurs et
il fallait que je rassemble mes idées pour comprendre.
Ah
! En effet, c'est aujourd'hui le 15 août.
C'est
que ce matin il y avait de l'émotion à la Compagnie P.D.. La
visite médicale du médecin divisionnaire devait avoir lieu et
chacun sentait peser sur lui l'inquiétude du résultat. Plus
d'un doit remonter aux tranchées ; peu manifestent de
l'enthousiasme pour un départ.
Dôle
en tête nous fait des siennes.
Il
est sur la liste des soldats involontaires, liste que le
lieutenant a dressée avec le concours de deux adjudants. Et à
la suite de je ne sais quelle défiance étroite, il s'est
figuré que les adjudants étaient responsables de son
inscription sur la liste : je le croyais plus intelligent que
cela.
Donc
avec cette idée sotte dans la tête il a refusé hier soir un
cigare à Ravenet, il a interprété comme un coup droit une
plaisanterie bien innocente que j'avais faite sur les fourriers
! Ce matin, il ne salue personne.
A
midi, il s'est comporté grossièrement à table en se versant
à boire à lui seul. Faut-il le plaindre ou le blâmer. Il y a
comme cela des gens qui voient la persécution et l'hostilité
partout, même de la part de ceux qui leur sont acquis, comme
c'est le cas pour lui aujourd'hui.
Pauton,
essoufflé, pâle, vient me trouver pour que je fasse mettre une
rectification à sa fiche. Il me sort de son livret un papelard
avec des cachets pour me faire constater que c'est bien de
trachycardite qu'il est atteint.
Oui,
oui, lui dis-je, rassurez-vous.
Jarasson
est pâle comme un linge.
Comme
on les classe d'après leur habituelle résistance à la
fatigue, tous voudraient être parmi les plus fatigués.
Fossier,
écarté de ce groupe, murmure : "comme
"soignement" on nous donne de la prison et de la
gymnastique suédoise. Je veux écrire au ministre de la
Guerre".
Aillet,
examiné, reconnu bon, vient me trouver : "je demande à
parler au lieutenant, je suis proposé pour changement d'arme,
personne ne l'a signalé au major".
Toute
la première liste - établie par nous - comprenant les soldats
les plus faibles, les plus fatigués ne subit qu'un simulacre de
visite. Ils ne font que défiler devant le major qui leur pose
une vague question. Cela déconcerte et irrite les hommes à
juste titre, car en fait, les hommes que nous avions présentés
n'étant pas examinés, il en résulte que nous pouvons faire
escamoter la visite à qui bon nous semble, et par suite,
certains hommes peuvent être ainsi embusqués au P.D. sans plus
de façon ni d'effort.
Je
reconnais que la liste a été faite consciencieusement, sauf
pour quelques exceptions. Dôle en tête, bien guéri, bien
rétabli n'a même pas été appelé.
Bergay
a été omis.
Klöckner
au titre de cuisinier est venu en retard et n'a pas été
examiné.
 Picon
classé parmi les débiles parce qu'il est notre tampon. Ravenet
a glissé le mot efficace au moment psychologique. Picon
classé parmi les débiles parce qu'il est notre tampon. Ravenet
a glissé le mot efficace au moment psychologique.
Vanel
et Benoit parce qu'ils sont pères de quatre enfants.
A
11 heures, je suis allé à la messe. L'aumônier a fait un
sermon dont je n'ai pas entendu l'exorde mais j'ai été
intérieurement gêné par son argumentation si faible pour
démontrer que la Vierge protège tout spécialement la France.
Cela me faisait songer malgré moi au blasphématoire et
grotesque accaparement de la divinité que font les Boches avec
leur "Gott mit uns", et leur "unser alter
Gott". Cela m'a empêché de sentir passer le souffle
divin, même pendant le beau Magnificat chanté par cette foule
de soldats et pendant les émouvantes invocations aux diverses
Vierges de France.
N.D.
de Liesse donnez-leur la bonne humeur.
N.D.
de Bon Secours, venez-leur en aide.
N.D.
des Victoires, etc., etc., etc…
Ce
soir un nègre est venu causer avec nos hommes. Celui-ci est
plus fruste que mes interprètes de l'autre jour.
Il
expose avec logique sa théorie de couper cabèche aux Boches.
-
Ti battre avec moi, ti le plus fort, moi, couic, (et avec le
geste, une serpe en main, c'était très éloquent). Moi battre
avec ti, moi le plus fort, couic pour toi aussi.
Toi
Boche, couic aussi. Pas de pardon. Toi avec li Boche faire
prisonniers pour travailler sur la route, moa pas de
prisonniers. Cabèche, pas de pitié, macache bono, (et cela
avec un rire féroce à vous donner le frisson).
Il
a des grigris dans une corne de bélier.
-
Moi jamais mourir avec bons grigris. Si balle vient là, (il
montre sa cuisse) la balle tomber à terre.
Les
Français crient : Ah ! Mon dieu ! Nous avons des grigris
français. Bons pour le pinard, pas pour les balles.
Et
il sort son porte-monnaie en riant et montrant les grigris
français : des gros sous…
Ravenet
a eu la visite de son cousin. Il offre du vin blanc. Dôle
refuse. Pignouf, va.
Ravenet
et Bergay sont rentrés dans la nuit. Ils étaient allés
reconduire le cousin de Ravenet jusqu'à Bayonvillers. Ils sont
rentrés bruyamment, ivres, boueux, trempés de pluie. Cœurdevey,
je suis mûr, bégayait Ravenet en tombant sur moi ; Bergay lui,
s'est affalé sur ma tente, il ne pouvait qu'ânonner :
"mon adjudant, mon adjudant heu ! Mon adjudant".
Il
a fallu que je le pousse dehors pour qu'il se décide à
regagner en titubant sa tente située sous l'arbre voisin ; il
était temps car il y a rendu ses comptes malodorants.
Le
16 août - Le P.D. est dissous à la
date du 17. Dès ce matin, les hommes du 417ème
rejoignent leur Compagnie, les C.O.A. sont affectés à des
Compagnies du 3ème Bataillon.
Ils
sont rassemblés par groupes pour la soupe près de ma tente,
"pour la dernière fois". Ils sont exubérants, très
exubérants. Béquilleux avec son ton doux et malicieux qui lui
est habituel :
-
Si tu veux voir un brave, regarde-moi.
-
Je vais leur en faire de ces bonds en arrière !
-
S'ils comptent sur moi pour leur tuer des Boches, ils peuvent
courir.
-
Quand on me mettra dans un petit poste, je fais le poirier
fourchu pour qu'un Boche me touche une patte. "Ils" ne
diront pas que je me suis mutilé.
-
S'il y a une attaque, moi je bondis mais dans le premier trou
d'obus et je n'en bougerai plus.
Un
vrai Français, ce Béquilleux ; il blague, il ricane, et je
sais que dans un combat ce sera un héros. Il dit être prêt à
déserter, et on peut pourtant compter sur lui.
Aillet
a été oublié hier sur la liste des hommes proposés pour
changement d'arme. C'est la faute de M. Lebureau - en la
circonstance de M. Bordenet. Aillet vient réclamer ce matin
seulement et présente un billet d'hôpital concluant à son
changement d'arme. Il s'étonne d'avoir été oublié. Il est
bien reçu :
-
Vous croyez qu'on qu'à songer à vous ? Vous vous imaginez
qu'on peut avoir toujours à l'esprit que l'un a mal aux dents,
l'autre à la jambe ! Il fallait vous annoncer au moment de la
visite.
M.
Corbin m'envoie soumettre le cas au major (Dr Rouzeau).
L'erreur
de Lebureau retombe sur le pauvre diable :
Comment,
c'est quand tes camarades se font casser la figure que tu veux
t'en aller ! Tu souffres de la marche ! Bon, mais à la
tranchée on ne fait pas de marches. Tant que la guerre de
tranchées durera tu peux faire ton service. Allons, essaie
encore une fois de reprendre ton poste à la Compagnie et de
faire ton devoir.
-
Je l'ai déjà fait mon devoir, M. le Major, puisque j'ai été
blessé, réplique le soldat.
-
Il y en a qui l'ont encore plus fait que toi ; il y en a qui
sont restés là-haut, il n'y a que ceux-là qui sont à
plaindre.
-
Allons, va ; on te déchargera du sac. Et Aillet, un bon gros
gars, paysan, ira un peu mécontent, mais sans réplique se
faire tuer obscurément.
Les
protégés, les moindres spécialistes trouvent (ou font emploi)
des "filons" qu'on leur accorde en souriant
indulgemment. Les majors manquent de caractère.
Je
suis affecté à la 8ème Compagnie du 417ème.
Ravenet à la 12ème. Il se trouve que ces Compagnies
sont Compagnies de renfort et ne montent pas immédiatement aux
tranchées. Ravenet dit que nous sommes "vernis".
J'ai
fait connaissance ce soir avec mon nouveau Commandant de
Compagnie, le sous-lieutenant Cassaing.
Vingt
et quelques années, l'air emprunté, des cheveux bruns mal
soignés et trop longs sur la nuque, un uniforme de simple
soldat ajusté par un tailleur d'occasion, vareuse et pantalon
passablement fripés, képi à la soutache passée, l'homme n'a
rien qui en impose ni qui révèle un chef.
Un
simple soldat pas très dégourdi qu'on aurait bombardé
officier. Il paraît qu'il était sergent à la mobilisation. La
langue est du Midi, organe en bon état et bon fonctionnement,
mais le regard terne et mal assuré ne promet guère qu'un
moulin à paroles.
Corbin
avec son bégaiement, son air gauche et bouché dépasse
celui-ci de plusieurs coudées.
De
quoi faisons-nous des officiers, grand Dieu ! Si encore on
prenait parmi les sous-officiers les plus intelligents, il y en
a encore. Mais on semble avoir choisi les plus cruches - c'est
en effet les plus dociles, les plus plats, les plus chanceux.
Je
me l'explique quand j'entends et vois les distinctions qui se
produisent encore - en fait - entre active et réserve.
Un
sous-officier, un officier est-il de la réserve, aussitôt les
juges suprêmes, c'est-à-dire les officiers supérieurs, tous
de l'active, se mettent en défiance. Est-il de l'active,
d'avance, de prime abord, (et l'on pose rarement l'élémentaire
réserve de l'expérience) il est les tables de loi, il a toutes
les qualités militaires et toute la science - même si pâle et
si anémique - science militaire.
De
sorte qu'en principe et par principe l'avancement a été donné
aux gradés de l'active. Or on sait de quels déchets, fruits
secs, fainéants ou cancres, se composait le corps de nos
sous-officiers rengagés du temps de paix, et qu'un certain
nombre, passablement fort de nos officiers d'active du temps de
paix n'étaient guère plus brillants moralement,
intellectuellement.
Aujourd'hui
c'est toute cette queue d'humanité qui possède les galons, les
officiers d'élite de l'armée active ont été tués ; on les a
remplacés par leurs parents pauvres dans les postes de
confiance - je veux dire qu'officiers d'approvisionnement,
officiers de détails, officiers d'habillement ont pris le
commandement de Compagnies et sont devenus avec la sélection
aveugle du canon, commandants de Bataillon, tout au moins
capitaines.
Les
sous-officiers rempilés qui ont survécu aux batailles sont
sous-lieutenants, lieutenants voire même capitaines.
Le
17 août - Camp 59-56. Le matin,
préparatifs de départ pour le Camp 56.
Camp
56. Il est introuvable ! Ravenet est envoyé à la recherche.
Inconnu dans la région, on s'amuse de regarder l'ordre, de le
lire intelligemment : camp 56 au nord de Proyart, c'est pourtant
clair ; pourquoi s'obstiner à chercher ce camp aux environs de
Morcourt ?
Départ
fixé à 13 heures.
A
11 heures, déjeuner avec les nouveaux camarades. Le régiment
aura une Compagnie de dépôt par Bataillon MC.
Chaque
Compagnie a comme cadre un officier, un chef de section, deux
comptables. Ceux-ci sauf les trois officiers sont à notre
popote, dont Dôle et Bordenet s'écartent impoliment.
Départ
dans la "pagaye" habituelle.
En
route averse orageuse.
Arrivée
à 16 heures au camp 56 dans le voisinage de Proyart. Les
"Marabouts" insuffisants. On dresse la tente dans un
champ de gerbes, malgré moi, malgré mon avis. En effet, une
heure après, ordre vient de dissimuler ces tentes sous les
arbres.
Principe
militaire : ne jamais exécuter un ordre avant d'avoir reçu le
contre-ordre. Le caporal Morel "râle". Je le rabroue
affectueusement :
Qu'il
devrait être habitué aux fausses manœuvres.
Qu'il
devrait s'estimer heureux de n'avoir fait que huit kilomètres,
alors que l'étape aurait dû être de dix-huit avec les mêmes
"à-coups".
Que
c'est un passe-temps - le dressement de la tente - plus
agréable que la marche sous la pluie.
Que
cette fausse manœuvre enfin est une excellent leçon, car vous
vous étiez trouvés embarrassés en montant la tente. Ceci sera
une profitable répétition.
Et
Morel sourit, apaisé.
20
heures.
J'ai
des crampes d'estomac, au lieu de souper avec les camarades je
vais en promenade vers le cimetière, vers la colline voisine.
Entrée
attirante et peu banale ; une allée d'acacias en boule,
protégée par de gros arbres : marronniers, charmilles,
tilleuls, avec un taillis d'arbustes entre les fûts. L'allée
monte droit la colline, au centre un grand crucifix, des bancs
dans le petit rond-point, enfin le cimetière avec une abondance
de sépultures riches. Le Santerre n'est pas une province
miséreuse.
Tout
au fond, plus loin que les tombes des pauvres, s'alignent les
tombes des militaires. Il y en a de toutes les dates : de fin
août 1914 à août 1916… de toutes nations, français,
africains, anglais, allemands. Un scandale m'émeut en passant :
les tombes des Anglais sont entièrement délaissées. Non,
l'Entente n'est pas encore cordiale, elle en est encore à la
phase intéressée, et nous avons, nous Français, le sentiment
d'avoir fait la première mise de fonds, de sang, de sacrifices.
 Tant que l'Angleterre ne se sera pas sacrifiée au profit de la
France - et ce n'est pas près d'arriver - nous n'oublierons ni
Fachoda
Tant que l'Angleterre ne se sera pas sacrifiée au profit de la
France - et ce n'est pas près d'arriver - nous n'oublierons ni
Fachoda ni l'histoire plus lointaine. J'ai entendu souvent les hommes
discuter là-dessus, tous, sauf les gens très éclairés, sont
unanimes : ils n'aiment pas les Anglais, ils n'ont pas confiance
encore.
ni l'histoire plus lointaine. J'ai entendu souvent les hommes
discuter là-dessus, tous, sauf les gens très éclairés, sont
unanimes : ils n'aiment pas les Anglais, ils n'ont pas confiance
encore.
Passons…
Les tombes en longues rangées s'épanouissent au soleil
couchant, comme des fleurs sanglantes au pied de la haie du
cimetière. Je jette un coup d'œil au-delà. Horreur et
tristesse, le champs de Morts a débordé. Au-delà de la
clôture trois funèbres rangées de croix neuves, avec des
couronnes que le soleil n'a pas défraîchies. Je vais à pas
lents, les obus, à cadence lente, ponctuent d'un hoquet la
marche de l'heure dans le soir qui tombe.
Voitures,
autos, cavaliers et piétons passent indifférents sur la route
voisine. Voici un groupe de soldats. L'un deux chante d'une voix
avinée : Hop héha di ohé ! Hop héha di ohé ! Hop héha di
ohé ! Ils longent la haie, je ne les vois pas. Bientôt ils
dépassent le cimetière où j'erre parmi les sentiers
attristés. Ils arrivent à hauteur des tombes récentes, en
plein champ. Alors, l'un deux dit au braillard : "Ferme ta
gueule, on passe près des morts".
Le
18 août - Camp 56. Proyart. La nuit
a été mouvementée. Les hommes connaissant la dislocation du
P.D. et leur séparation prochaine échappent à la discipline.
Les adieux s'arrosent. Beaucoup d'hommes sont ivres. Le caporal
Vallet dit à Gorce : tu tires la patte quand tu veux.
Pipereau
pleure d'émotion. Fossier chante, chante à tue-tête, même
après l'appel, après l'extinction des feux. Je vais à sa
tente voisine de la mienne :
-
Allons, il faudrait te taire bientôt. Il continue à chanter,
feignant de ne pas entendre.
-
Silence Fossier, dis-je dans l'obscurité.
Il
demande, feignant de ne pas me connaître :
-
Qui es-tu, toi ? Qu'est-ce que tu veux ?
-
C'est l'adjudant Cœurdevey.
-
L'adjudant ? L'adjudant ? Qu'est-ce que ça peut me faire ? On
sait ce que c'est qu'un adjudant. On se taira si on veut. On
s'en fout. On remonte demain aux tranchées.
Dès
que je fus rentré sous ma tente qu'il savait mitoyenne il
reprit, s'adressant à ses camarades - et à moi à travers la
toile !
-
Ce C… là ! Il me fait ch… Qu'est-ce qu'il veut cet enc…
là ! Je ne veux pas partir sans lui casser la figure.
"Ils" nous font tous ch… !
Si
tous les soldats étaient comme moi, la guerre finirait vite.
J'en ai marre ! Depuis le temps qu'ils nous bourrent le crâne,
c'est tous des assassins.
Et
les réflexions continuaient sur ce thème et sous cette
forme...
Moi,
je faisais le sourd pour éviter une sale histoire à ce voyou
pour lequel je suis intervenu à plusieurs reprises quand Bergay
ou Léger ou Morel voulaient lui infliger une punition avec
motif salé déclenchant le conseil de guerre.
Il
reprit : je n'ai pas sommeil. Je vais me promener. Si je le
rencontre, je lui casse la figure à ce con-là. Qu'il ne se
trouve pas sur mon chemin, sans ça, il n'y coupe pas. Ah ! Non.
Je ne veux pas partir sans le payer, je te le jure…
-
Tais-toi, disaient vainement ses camarades.
Il
se leva, sortit, fit un tour, puis vint à ma tente :
Il
se baissa : Hé ! Là-dedans, tu dors ? C'est toi ! Pipereau ?
Un
silence.
-
Ah ! Non, je me trompe, c'est pas Pipereau. Qui est-ce qui est
là ? Veux-tu répondre, nom de Dieu de con…Tu ne veux pas
répondre. Attend, je vais démolir la tente si tu ne réponds
pas.
Ravenet
survint derrière lui à l'improviste.
-
Qu'est-ce que vous faites-là ? fit-il.
-
Je ne fais rien.
-
Ah…
Je
me levai et je dis : - Voilà une heure qu'il met ma patience à
bout. Appelle la garde.
-
La garde ? Pourquoi ?
-
Appelle la garde. Ou je serai obligé de lui brûler la cervelle
; il vient pour me casser la figure, dit-il.
Comme
Ravenet ne comprenait pas, je sortis et appelai la sentinelle
qui prévint le chef de poste et quatre hommes vinrent chercher
mon loustic qui faisait un tapage tel que les officiers couchés
dans la tente voisine se levèrent. Le capitaine Fontanel vint
et menaça le récalcitrant qui fut enfin emmené.
La
paix revint à demi car à une autre tente un ivrogne empêchait
ses camarades de dormir parce qu'il avait perdu son briquet dans
la paille.
Enfin
le silence et le sommeil arrivent. Pas pour longtemps. Dès deux
heures du matin les marmites tombent dans le voisinage avec une
belle régularité. On entend à loisir le sifflement de l'obus,
le petit silence puis l'explosion violente. Pour les obus
rapprochés, on jouit encore du bruit d'abeille des éclats.
Au
réveil, j'ai rendu compte de l'incident Fossier à M. Corbin.
Il l'a fait appeler :
Ce
n'est pas moi qui parlait, c'est la boisson, a-t-il donné en
excuse.
Si
on l'avait déjà porté quitte trop de fois, je n'aurais rien
dit, ou j'aurais plaidé l'indulgence. Or M. Corbin déjà
fâché pour un autre incident a renvoyé Fossier au poste en
disant : "c'est bien, on verra", et à moi :
"vous établirez un compte-rendu".
Je
voudrais bien que le misérable aille se faire pendre ailleurs.
M.
Corbin était hors des gonds, car Bordenet sachant la
dislocation et la transformation du P.D., a refusé tout service
dès l'heure précise où le P.D. cessait d'exister
administrativement.
Il
a refusé carrément de faire un état.
Pourquoi
cette grossière mauvaise volonté ? C'est dans son caractère.
Mais cette mauvaise volonté d'aujourd'hui va avoir une
importance décisive me semble-t-il sur son avenir, et par choc
en retour sur le mien.
En
effet, le Dépôt divisionnaire succède au P.D. ; il est en
voie de formation de d'organisation. Un commandant est arrivé,
avec ordre de procéder à cette nouvelle création. C'est le
Commandant Goys de Meyzerac. Il s'est mis en relation avec M.
Corbin. Il lui demande un secrétaire. M. Corbin songe
naturellement à Bordenet, mais Bordenet est absent, est
introuvable ; faute de Bordenet M. Corbin m'envoie,
provisoirement.
Je
me présente. Quelques questions sur ma situation militaire, mon
savoir-faire. Il conclut : c'est bien, vous pourrez me rendre
les services dont j'ai besoin. Nous allons donc travailler ;
asseyez-vous. Avez-vous de quoi écrire ?
Il
me donne quelques renseignements sur la constitution du D.D. et
m'envoie chercher les officiers des divers groupes.
La
journée s'est passée en marches et démarches, à droite et à
gauche cependant que les éléments du D.D., cadres et troupe et
renforts arrivaient, s'installaient avec peine dans un camp trop
exigu.
Le
Commandant est un noble. Il est bien élevé. Grand, sec, froid
; il paraît énergique et intelligent. Il porte les écussons
du 160ème.
Dîner
et déjeuner de fortune. Bordenet par vengeance en partant a
emporté les ustensiles indispensables sous prétexte de
partage. Il a emporté en outre sa caisse de comptabilité.
Dôle
proposé pour être secrétaire du Commandant deviendrait mon
"sous-verge". L'explication loyale et la
réconciliation entre nous deux. Ce que c'est qu'une parole
insignifiante mal interprétée. Toute la journée les Boches
bombardent les abords du village. Ils finissent par mettre le
feu à la gare.
Le
19 août - Journée écrasée sous la
paperasse.
Pas
une minute de paix avant 18 heures. Comptes-rendus, états,
ordres, etc, rédigés, expédiés avec le Commandant sous la
tente à moi réservée au camp 56.
Départ
du renfort du 417ème. C'est de la classe 16. Le cœur
se serre à voir partir ces pauvres enfants vers la fournaise.
Pauvre France saignée. Que de belle jeunesse moissonnée !
Hélas ! On n'ose songer à tous nos morts. Ils sont des
légions innombrables. Je les vois passer dans le soir qui
tombe. Des bataillons sans fin de spectres en pleurs, pleurant
la vie. Les femmes en deuil, les enfants orphelins, suivant. Des
cris, des sanglots. Du sang, des canons, des mitrailleuses
horribles. Oh ! Mon Dieu. Que reste-t-il de ces régiments
innombrables qui faisaient haleter les wagons bondés du mois
d'août 1914 ? Les bandits, ils nous ont tué nos frères, nos
enfants avec leurs mitrailleuses et leurs mortiers. Oh ! De la
boue sanglante. Des champs de chair. Des morceaux d'homme
partout… Pitié.
Et
ce soir, la canonnade continue furieuse. Et voici que reviennent
près du camp les frelons d'acier.
Le
20 août - Camp 56. La nuit a été
agitée : arrivée des fusiliers mitrailleurs, cherchant dans
l'obscurité le cantonnement des unités.
Ceux
du 417ème, 1er Bataillon - racontent la
pluie des 210. Premières rafales de marmites.
A
minuit et demie, des ordres : on vient chercher le cycliste ou
moi. J'envoie le cycliste à une heure. Pluie proche de
marmites.
Le
cycliste revient à deux heures, pâle.
"J'ai
failli être zigouillé. Une marmite est tombée à cent mètres
de moi". Elle est tombée sur le poste de police. Il y a
sept tués, beaucoup de blessés.
3
heures du matin. Les marmites ont recommencé à tomber.
Au
réveil, je vais voir l'effet du bombardement. Un 150 est tombé
en plein sur le poste de police. Ce sont de malheureux
permissionnaires et hommes du poste qui sont tués.
Fossier,
la fripouille a été renvoyé du poste où il devait coucher,
pour faire place à ces malheureux ! Vraiment, la mort choisit.
Bordenet
se trouvait être chef de poste, mais il avait abandonné son
poste dès la première marmite. Sa frousse lui a sauvé la
peau.
Je
le rencontre, hâve, désossé.
Il
me fait des excuses sur son humeur impolie des derniers jours.
"Je ne suis pas maître de moi", dit-il. Le résultat,
c'est que je me trouve en "carafe", le seul de
l'ancien P.D. qui ne soit pas casé.
Je
ne me suis pas aperçu que c'était dimanche tant le surmenage a
été violent par suite de l'arrivée des renforts à caser,
d'une situation infernale à établir en tâtonnant.
A
deux heures au courrier, retour de nos demandes.
Un
affront.
Le
Commandant me dit : vous avez fait une demande de
réintégration dans l'active ?
-
Oui, mon Commandant.
- Tenez,
lisez, fit-il en me tendant la page griffonnée et il détourne
la tête, je lus en pâlissant :
Avis
du Colonel Brécard Commandant (?) la 121ème
DI.
Le
renvoi (2) de la circulaire n°14462 du 21 mai 1916 du Général
Commandant en chef s'applique évidemment à l'adjudant Cœurdevey,
mais la demande de ce militaire adressée surtout aujourd'hui
indique un état d'esprit fâcheux qu'il est pénible d'avoir à
constater chez un adjudant.
N°
3187 a/6 Q.G. 22 juin 1916, signé Bricard.
Demande
conservée au Q.G. 35ème.
16
août 1916. Les demandes des adjudants Cœurdevey et Ravenet ont
été ajournées jusqu'après la période des attaques.
N°1933/1
Puis
une série indéchiffrable de cachets du Q.G. 35 à 2ème
CA, puis à X armée, puis retour par même voie sans solution
avec la seule signature du Général Brécard.
Encaisse,
Cœurdevey. Il est permis à un bourgeois de se défiler,
d'aller à un vague emploi, mais à un adjudant plébéien,
allons donc.
Si
mon patriotisme était de même qualité que le vôtre et de
tous ceux que vous avez vu se défiler, mon Général, sinon
aidé, j'aurais une révolte, mais ce n'est pas pour vous ni par
souci de votre estime que je resterai à mon poste.
Le
Commandant m'a dit :
Je
ne veux préjuger de rien, mais il est toujours regrettable de
se trouver dans cette situation. Je vous ai pris pour
secrétaire, mais il faut que je sache quel est votre état
d'esprit actuel.
J'étais
totalement en désarroi. J'ai donné quelques explications
confuses et j'ai demandé quelques heures de réflexion.
Je
répondrai que je reste où je suis.
J'ai
lambiné avec le rapport contre Fossier. Le résultat est
obtenu. M. Corbin d'impatience a dit : c'est bien, on a trop de
travail pour une plainte en conseil de guerre. Je vais lui
infliger huit jours de prison et ça va bien.
Ravenet
à qui j'ai communiqué les demandes a répondu et conclu :
Nous
avons réclamé pour le prinipe après on nous remballe. Eh
bien, je m'en fous. Laissons souffler le vent.
Nous
ne pouvons pas faire une demande l'un sans l'autre. Tu restes,
je reste.
Le
21 août - La paperasse prend de
l'ampleur. La marée des états s'annonce par un premier flot.
Tenons-nous bon.
Dôle
m'est adjoint. Je ne sais pas être rosse. Je suis secrétaire
en pied du Commandant ; je suis remonté dans son estime depuis
que je lui ai dit :
"En
ce qui concerne la demande qui m'est revenue hier, j'ai décidé
de n'y plus penser".
C'est
bien, votre réponse me satisfait. Je ne veux m'engager en rien
pour l'avenir, mais je vous garde avec moi. Votre réponse m'est
un signe de votre état d'esprit. Je vois que vous n'êtes pas
à l'abri du soupçon que faisait peser sur vous un jugement de
chefs qui vous connaissent mal.
Me
voilà donc adjudant chef de bureau, adjudant secrétaire du
Commandant du D.D.. Délicates fonctions pour lesquelles je n'ai
peut-être pas toutes les qualités et toute l'expérience
bureaucratique désirables. Je ferai de mon mieux, et dame, si
j'ai du papier par-dessus les épaules, j'irai où l'on reçoit
de l'acier.
Le
22 août - Le Commandant est
énergique, froid et méticuleux semble-t-il, à l'examen qu'il
fait de la situation préparée par Dôle et moi.
Renforts
vont et viennent.
Au
renfort du 417ème, un adjudant-chef de détachement
se présente (figure souriante et bonasse), il a perdu en route
un sergent et un homme.
Le
sergent est rentré à la nuit ; il est venu sous ma tente, se
présenter, il avait les larmes aux yeux.
-
Qu'est-ce qu'il est arrivé ? lui dis-je.
-
Un malheur, fit-il.
-
Un malheur ?
-
Oui, tout s'en est mêlé, et il me raconte toute la série de
circonstances malencontreuses qui l'ont fait mettre en retard :
correspondances de métro ratées, courant du train coupé,
départ en avance du train. Ils louent un auto-taxi, panne et 45
francs de frais, dix minutes trop tard.
A
Montdidier, on les fait descendre par erreur. Tant pis, les
malheureux ont fait quarante kilomètres à pied pour arriver.
Je le console de mon mieux, ce brave garçon qui a payé si cher
le plaisir d'embrasser les siens en fraude, au Bourget.
Ah
! Cette gare du Bourget. Que de drames elle a vus ou causés.
Le
23 août - (…lignes sous collage…)
…ne
puis ni penser, ni lire, ni écrire, ni même un peu réfléchir
ou rêver.
Reçu
une lettre de Cam.
Le
24 août - Vie absorbante du Bureau.
Suite. J'ai le souci et la responsabilité de vingt questions à
la fois. Le Commandant est méticuleux, il sait contrôler un
travail.
Rien
de gai dans cette paperasse. A peine un sourire germe-t-il au
passage d'une bourde, comme celle-ci :
État
de la décomposition du renfort du n°x au D.D.
Reçu
une lettre de B. avec une branchette de bruyère en fleurs !
O
mes bruyères de la lande sans fin… dans la rêveuse
Lünebourgerheide ! Bruyères du Taunus, bruyères de Durrestein
sur les bords heureux du Danube. Bruyères ! Fleurs préférées
de mon cher Maurice ; je revois encore celles, rapportées
d'Allemagne, et qui fleurissaient la chambre joyeuse de
l'étudiant dans la sombre École Normale. Bruyères du Ballon
d'Alsace et Bruyères des Vannotes ! Grosses gerbes mauves
répandant un parfum de jeunesse et d'amour.
Bruyères
de la Forêt familière, vous que j'ai découvertes un matin au
tournant du sentier qui mène à la Croix Morel, vous m'avez
fait pleurer en parant ce sentier où l'ami mort était passé
pour tomber bientôt. Et voici que cette année, l'une d'entre
vient me sourire avec douceur et mélancolie.
Que
de choses profondément vraies et bien souvent déplorables dans
cette constatation si juste d'Herriot :
"Chez
l'ennemi, des valeurs moyennes s'additionnent, chez nous, des
valeurs supérieures s'ignorent ou se neutralisent".
Le
25 août - Paperasserie.
Le
26 août - Départ du camp 59
(Proyart) pour le camp 52 (Bayonvillers).
Les
ordres mal donnés. Confusion. Départ en trois fractions.
En
route, Rocourt se trompe de direction. Il entend des murmures.
Cela le met en humeur chatouilleuse.
Installation
dans les baraques Adrian.
Le
27 août - Dimanche surmené. La
Division demande un état des renforts disponibles avec les onze
unités du D.D., on n'en finit pas. Je me couche à une heure du
matin.
Le
28 août - Réveil très matinal.
Cinq heures.
Les
messages succèdent aux messages. Arrivée de renforts. Pas une
minute de paix ni de repos.
Entre-temps,
dans cette trépidation survient la nouvelle prodigieuse,
inattendue, enivrante d'espoir et de confiance sur le cours de
l'histoire, sur la Revanche attendue, espérée.
"La
Roumanie a déclaré la guerre à l'Autriche". C'est
l'épée du Brenn dans la balance perplexe ! Vae victis !
Malheur aux Bulgares, les plus traîtres. Malheur aux Boches,
les plus redoutés.
Coup
sur coup, deux autres nouvelles aussi surprenantes et riches
d'avenir fécond : l'Italie a déclaré la guerre à l'Allemagne
: le ciel est pur - la Grèce a remplacé les chefs d'E.M.
hostiles à l'Entente et remplacés par deux amis. Constantin
jette du lest. Il y aura de grandes choses dans quelques mois.
La
joie, l'allégresse me font oublier ma fatigue. J'ai des ailes,
mais je ne puis dans mon surmenage, m'abandonner à ma joie. A
peine, puis-je m'esquiver cinq minutes, jeter un coup d'œil à
un soleil en fête qui fait flamboyer l'horizon avant de
disparaître en promettant pour demain l'aube salvatrice.
Je
jette deux mots à C. et à mon Louis, il me revient à l'esprit
la réflexion attristée de ce pauvre cher Bedu en juin 1915 :
-
C'est ça la Revanche ?
C'était
triste et piteux, en effet, mais la France a serré les
mâchoires, elle est devenue tenace et volontaire.
Aujourd'hui,
voici la récompense. La Revanche semble sonner.
Il
me vient encore en la mémoire les articles pessimistes de
Clemenceau en décembre, janvier, lorsqu'on redoutait
l'anéantissement de l'armée d'Orient, lorsque Clemenceau
prévoyait le dur coup de Verdun. Je partageais ses craintes, je
ne comprenais pas Briand. Personne ou presque. Lui a été assez
clairvoyant pour rester ferme en son dessein, il a lutté contre
les vues d'hommes éminents, contre tous les diplomates et
militaires de l'Entente. Il a su leur imposer une vue
générale. Voici sa récompense et la nôtre.
La
France sera sauvée, et lui est consacré grandhomme d'État. Je
m'étais plaint que pas un de nos gouvernants ne semblait digne
de la France, pas un qui ait le cœur et l'intelligence digne de
la forte et grande race. Je m'étais trompé ; j'avais été
injuste. Briand s'est dévêtu de la robe écarlate du grand
cardinal. Il monte d'un coup de reins, avec le coup d'épaule de
Bratiano de plusieurs degrés au-dessus de tous les diplomates
européens.
Le
29 août - Ansauvillers. Toute la
nuit il a fallu courir, télégrammes sur télégrammes,
renforts demandés, rectification, etc - ordre de départ.
Départ
de Bayonvillers, camp 52, en camion automobile. Direction
inconnue, ou plutôt soupçonnée. Direction du sud. Nous
passons à Guillaucourt. Salut de la main à mes anciens hôtes.
Caix, entrevu. La route redevient sèche et poussiéreuse. Je
dîne de poussière et de vapeurs d'essence. Les cahots ne sont
pas trop déprimants. Je me souviens de l'émotion qui me
serrait quand je recherchais Julien emporté par ces monstres
bruyants. Aujourd'hui c'est mon tour d'être emmené. Mais nulle
angoisse n'est de mise. J'ai idée qu'on groupe les D.D. dans
une zone moins mouvementée.
Traversée
de Montdidier ; les pentes raides de la vallée de l'Avre sont
descendues et remontées, interrompant l'immense moisson de la
plaine opulente du Santerre.
Les
autos d'arrêtent à l'entrée du village d'Ansauvillers - Oise. C'est là que nous nous installerons. Les deux autres
D.D. du C.A. viennent partager avec nous le cantonnement.
- Oise. C'est là que nous nous installerons. Les deux autres
D.D. du C.A. viennent partager avec nous le cantonnement.
 Village
propret, opulent, presque. Une pâtisserie avec une jeune
pâtissière de blanc vêtue, c'est une nouveauté
sensationnelle. Des femmes avec des blouses claires, des hommes
avec des melons : c'est donc un pays civilisé. Village
propret, opulent, presque. Une pâtisserie avec une jeune
pâtissière de blanc vêtue, c'est une nouveauté
sensationnelle. Des femmes avec des blouses claires, des hommes
avec des melons : c'est donc un pays civilisé.
Le
Commandant loge chez la vieille belle-mère d'un instituteur
parisien, celui-ci paraît avoir devant elle la saine et sainte
frayeur de Moïse devant le buisson ardent. Il m'accueillerait
cordialement, s'il ne craignait pas de contrarier sa belle-mère
!
Le
Commandant m'avait envoyé reconnaître sa chambre :
"j'estime qu'il n'est pas de ma dignité de faire de telles
démarches". Culture aristocratique.
Le
30 août - Installation. La pluie.
Nos cantines ont été chargées sur des voitures qui ont suivi
la voie de terre et ne sont arrivées que ce soir. Je vais à
St-Just avec le Commandant. L'instituteur est un demi-vieux,
obséquieux, plat et sot. Il embrasse sa "maman" avant
d'aller au lit, au réveil. Il nous vient conter les petits
trucs pour plaire à cette vieille, nous confie ses petites
misères de gendre. Pitié.
Le
31 août - Situation, rapport de
dizaine, dévorent notre journée. Je n'ai pas le temps, encore
d'écrire…
Le 1er
septembre 1916
La
nuit dernière a été lourde. Un cauchemar. J'ai rêvé que mon
Louis, blessé en Salonique appelait au secours, que sa marraine
Maria avait reçu un télégramme d'appel. Que signifie cette
image horrible d'un frère appelant : Maria, maman ?
Le
Commandant qui épluchait mon travail, situation d'effectif, le
signe aujourd'hui en pleine confiance !
Il
est dur cassant, autoritaire, et pourtant il n'augmente pas une
punition.
Le
2 septembre - Visite du Général.
Le
Commandant à cette occasion entr'ouvre un coin de son
tempérament.
Il
y a les ordres habituels préparant à toute visite,
étiquettes, feuillées, etc.
Le
Commandant en les dictant, de mauvaise grâce, dit : "c'est
comme toujours, on ne verra que les étiquettes et les
feuillées, l'instruction, on peut la faire passer par-dessus la
tête, ça n'a pas d'importance".
Autre
chose. Demain, repos. Il donne liberté de s'évader à tous les
villages voisins, "pour changer d'air", dit-il.
Or
il y a un ordre de la Place, fixant à deux cent mètres des
limites du cantonnement.
C'est
bien, rapportez ce que je viens de dire. C'est un ordre. Il n'y
a qu'à s'y conformer.
Une
gentille lettre parfumée de bruyère bretonne et de senteurs
marines et d'amitié envoyée par Marthe S…
Le
3 septembre - Dimanche. Le travail
semble vouloir nous accorder enfin une trêve de quelques
heures.
Messe
le matin. Chants et violons.
Es
erweckt in mir ein Hochamt in Krems...(Cela me rappelle une
messe solennelle à Krems…)
L'après-midi,
une courte station devant la scène improvisée sous les
tilleuls en jeu de Paume.
De
véritables acteurs. Des artistes parisiens même, sous
l'uniforme.
Roberty
déclame le Bon gîte avec une mimique extraordinaire.
Un
autre chante le Rêve passe, avec couplet supplémentaire.
Un
troisième a du succès avec une apostrophe à un embusqué.
Le
4 septembre - Le Commandant est
d'une nervosité qui ne s'était pas encore révélée aussi
forte. Il me soutient avoir…
M.
Pennelier est venu payer le prêt au détachement du 48ème.
Je l'ai trouvé au moment où il sortait de l'auto. Il a paru
visiblement chiffonné de me voir ici.
Vous
êtes toujours à ce dépôt, me fit-il. Vous n'allez pas y
rester éternellement.
Et
l'après-midi, passant devant l'entreporte de mon bureau, il
dit, moitié figue, moitié raisin : "je vous cause plus à
vous deux (Dôle et moi) vous n'êtes que d'infects embusqués
!"
Heureusement
que vous l'êtes aussi, répliquai-je, cavalièrement, sans cela
le reproche pourrait nous piquer.
Le
5 septembre - Le service
s'adoucit. Se régularise.
Le
6 septembre - Ansauvillers.
Journée de tranquillité. J'ai lu pour mon plaisir, le livre de
Bainville sur les rapports franco-allemands.
Le
soir, la cloche appelle à la prière quand je sors de la
popote. Je suis libre. Je vais prier un instant.
Je
ne parviens pas à tracer les lignes de mon avenir si la guerre
m'épargne. Mais je suis las d'une situation fausse, de ce
malentendu que j'ai laissé grandir dans l'esprit de cette idée
que caresse Mme R. de m'attacher à elle. Je ne tarderai pas à
le lui dire carrément.
En
sortant de l'Église, je vais faire une courte promenade dans la
plaine dorée par la moisson et le crépuscule. Une bonne odeur
de blés mûrs me rappelle…
(…insert
collé, lettre ci-après…)
Le 4/10/16.
Je
t'aime, ma Camille. Sens-tu bien tout ce qu'il y a d'aspirations
inassouvies dans ces mots : je t'aime. Un camarade m'a raconté
tout à l'heure comment en campagne il avait trouvé un
véritable ami. Ce récit me donne soif. Tous mes amis sont
tués. Ma Camille, tu me restes, mais tu es si loin ! Je tends
les bras autour de moi. Personne, là, tout près, où
m'appuyer. Il est midi, je viens de déjeuner assis sur un
tonneau vide. Autrefois c'était la demi-heure douce, où nous
quittions la table, et le Lion d'Or ou l'autre bout du quai.
Nous nous en allions tous deux, pas à pas, l'un près de
l'autre, si près, si sûrs, si heureux de bonheur simple, nous
allions au hasard des itinéraires selon l'heure et la saison
pour aboutir à Rivotte. Ma Mille aimée, est-ce que tu ne sens
pas s'agiter en toi le fourmillement immense des souvenirs et
des tendresses ? Je sais toutes nos promenades, par Micaud, par
Chamars, par la rue des Granges, par le square et la rue de
Lorraine, ou même la rue Barsot, ou par le canal Millettes,
pourquoi était-ce si beau, et pourquoi es-tu si lointaine. De
toi, il me vient seulement de temps en temps, un mot tendre,
mais ce n'est pas le beau temps lointain, le temps passé où tu
étais toute proche. Dis-moi, aurons-nous encore quelques jours
ce bonheur apaisant ? Quand ? Quand ? Peu à peu s'infiltre
l'habitude de vivre l'un sans l'autre. Les lettres deviennent
plus rares, plus vagues. La force des choses, quoi, contre
laquelle on s'insurge douloureusement aux heures les plus
ranimées ; on s'habitue par contre à ceux que la guerre nous
"inflige". Trois années. C'est terrible. Ma Camille,
il me tarde de te revoir.
Je
t'embrasse si longtemps. Edouard
…les
champs natals avec une telle intensité que je me sens ému au
point de sentir les larmes perler au bout des cils. Hier la
canonnade était violente, on sentait l'horreur de la terrible
lutte qui arrache nos pauvres villages à ces monstres.
Ce
soir, un grand silence heureux.
Le
7 septembre - Ce matin, achevé la
lecture du livre de Jacques Bainville : "Histoire de deux
peuples".
L'écrivain
sait quelque peu d'histoire, il a une idée directrice juste,
mais il "cherre" un peu par endroits, avec la
clairvoyance des Bourbons, "parce que Bourbons", et
l'aveuglement des démocraties. Il néglige de parti pris
certaines forces historiques, il dissimule, mal, si tant est
qu'il les dissimule, ses sentiments et convictions de Camelot du
Roy. Cependant, somme toute, ouvrage qui n'est pas inutile, et
que beaucoup de primaires qui ne sont jamais sortis de l'horizon
historique de leurs manuels d'après Quinet et Michelet ou
Martin, liraient avec fruit.
Le
8 septembre - Ansauvillers. Visite
du Général Buat. Il est nerveux de ne trouver personne au
cantonnement. Tous les chefs sont sur le terrain d'exercice. Je
l'y conduis. En route, rencontre du lieutenant Corbin ; je lui
jette cette proie à triturer pour en faire sortir de vagues
renseignements que je ne saurais fournir et que le lieutenant
Corbin n'est guère plus à même que moi de donner.
Le
Commandant est à cheval, je ne sais où.
Le
Général tombe sur le lieutenant Elissèche qui instruit les
fusiliers-mitrailleurs.
Il
n'a pas l'air d'être enchanté de la marche de l'instruction
ici. Il semble avoir des idées fort nettes. Je m'écarte sous
le prétexte d'une course.
Pour
vivre heureux, vivons cachés.
Le
9 septembre - Paperasserie.
Les
Russes reprennent la marche en avant. L'offensive roumaine n'a
pas encore accroché les forces autrichiennes - ni Bulgares. On
pose la question de l'offensive dans les Balkans et le but :
Sofia ou Constantinople ?
Le
10 septembre - Ansauvillers. Il
ne m'a pas été accordé une minute de répit. Jusqu'à 9
heures du soir incessantes notes, contre-notes.
Le
11 septembre - Ansauvillers. Je
suis encore tout frémissant de l'affront que vient de me faire
Rocourt, lieutenant au 48ème.
Le
Commandant venait de me dicter une note fixant l'heure du
rassemblement à treize heures quinze. Un quart d'heure après,
lorsque les plantons étaient partis, Rocourt m'envoie une autre
note fixant le rassemblement de son équipe à treize heures,
nécessitant ainsi une deuxième tournée de plantons.
J'ai
supposé qu'il n'avait pas encore connaissance du rapport du
Commandant ; je lui fais parvenir un billet pour le mettre au
courant et lui demander si je devais envoyer à nouveau les
plantons en tournée dans les onze bureaux.
Le
primaire infatué qu'il est me fit dédaigneusement savoir par
le porteur du billet "qu'il n'avait rien à me
répondre".
"Fouette-cul
galonné ! ", dirait Ravenet.
Et
Cam. qui m'écrit sa joie de me savoir tombé dans cette
servitude ! Ah ! Non, mais j'étais moins bouleversé de la
chute immédiate d'une marmite que de ces coups de pied de
l'âne en pleine joue.
Et
si j'encaisse en silence, c'est par discipline. L'armature d'une
armée ne se soutient que par le respect apparent des
subordonnés envers leurs chefs, même si ceux-ci sont des
mufles ou des cancres.
Je
vais relire pour m'apaiser le chapitre 46 du livre III de
l'Imitation.
Le
12 septembre - "Parce qu'on
est sorti dans la joie on revient dans la tristesse, et la
veille joyeuse du soir attriste le matin". I, I, 20.
Le
13 septembre - 10 heures du soir.
J'ai attendu que tout dorme pour me recueillir un peu et songer
à l'ami que je pleure pour le deuxième anniversaire !
Je
viens de relire son "Carnet d'impressions"… J'ai
voulu lire jusqu'au bout. C'est déchirant et doux.
J'ai
écrit à ceux et celles qui pleurent en même temps que moi.
Que c'est loin et près tout à la fois ce temps d'horreur.
Le
14 septembre - Ansauvillers.
Préparation de la conférence du Commandant aux officiers.
Les
tableaux noirs, croquis, etc.
Surmenage
effréné. Pas une minute jusqu'à huit heures du soir.
Pour
me délasser je compare ces trois motifs de punition. Ils sont
révélateurs.
x…
quatre jours de consigne, % du lieutenant C…
"Est
arrivé en retard à l'heure de l'appel".
Larché,
caporal - classe 1900 - Quatre jours de salle de police % du
sous-lieutenant D, Commandant la Compagnie.
"Étant
malade depuis plusieurs jours pour coliques a été trouvé en
train de manger des pommes ramassées sous un arbre".
x…
quinze jours de prison. % du Colonel :
"A
été trouvé assis étant de garde devant les locaux
disciplinaires".
Le
15 septembre - "Seigneur,
délivrez-moi de mes nécessités".
Le
16 septembre - Les permissions
sont rétablies. J'ai encore rêvé que Louis était mourant.
Le
17 septembre - Dimanche à
Ansauvillers.
Le
théâtre improvisé. Dans une cour de bistro, une planche sur
deux tonneaux devant une voiture, voilà la scène.
L'espace
libre de la cour rempli de tables où l'on consomme du pinard à
1.50 lorsqu'il est baptisé, 4.25 quand il est recouvert d'un
bouchon.
Les
acteurs volontaires.
Le
Colonel a déchiré les permissions des pauvres diables
demandant à aller voir leurs frères (Rothen).
Le
18 septembre - La journée
creuse.
Le
19 septembre - Course à St-Just
chez le Colonel Commandant les groupe des D.D.
Un
beau sous-lieutenant d'E.M., monocle à l'œil ne peut me donner
que de vagues renseignements. Le capitaine, guère plus.
Vient
enfin le Colonel, un grand vieillard racorni sentant le gaga :
Rien… Rien de nouveau, fait-il bégayant de faiblesse.
-
Mon déjeuner est-il prêt ?
-
Je n'ai pas pu trouver de lait, mon Colonel, fait l'ordonnance.
-
C'est un peu fort que dans St-Just il n'y ait pas même du lait
pour moi !
Quand
il y aura un départ de renfort, vous me préviendrez, je veux
aller voir comment cela se passe, que les hommes soient
corrects, tenue, etc…
Voilà
ses soucis ; de tous ces vieux blanchis sous le képi ; ils
n'ont plus que la manie de l'étiquette. Et ils imposent aux
innombrables civils mobilisés les mesquines servitudes qui
étaient à peine admissibles pour des bleus. Autre plaie, ces
gens veulent tout voir, tout savoir. Il sont le rude et hargneux
échelon dans cette redoutable voie hiérarchique. Dans notre
organisation on pourrait les appeler, tous ces vieux casés à
ces postes intermédiaires : "les entraves".
Le
20 septembre - Ansauvillers. Les
journaux apportent un compte-rendu de la Chambre sur un sujet
brûlant.
Roux-Contadour
crie que la guerre pèse atrocement, qu'il faut prendre garde à
l'affaiblissement de la France ; il a le courage de souligner
que ce sont nos paysans qui ont fait les plus lourds sacrifices.
Et
Briand de sa place réplique :
-
"Il n'y a plus de paysans, plus d'ouvriers, plus de
bourgeois, tout le monde combat dans le même élan pour
l'idéal commun".
-
Oui, fait remarquer un poilu, mais les bourgeois combattent à
l'arrière.
Par
contre je goûte mieux l'apostrophe de Briand à Brizon :
"Vous
ne connaissez pas l'Allemagne ! "
"Regardez
votre pays"…
J'ai
entendu commenter ces discours par les simples. Cela se résume
en deux objections :
1-
On voit bien qu'il n'y a jamais goûté (aux tranchées) pour
parler ainsi.
2-
Qu'il demande donc l'avis aux poilus et il saura si la France
veut aller jusqu'au bout.
Le
21 septembre - Un pauvre diable
demande une permission à titre exceptionnel à l'occasion de la
naissance de son fils. Il appuie sa demande d'une lettre
pitoyable que lui a écrite sa femme.
Elle
se plaint des insultes de la belle-mère qui a dit : "tiens
elle est accouchée cette vâche là mais c'est joliment une
vilaine pour dire sa, mais elle donne bien son nom à les
âutres car faut joliment qu'elle soit vache elle-même pour le
dire après les autres mais je t'assure que j'ai eut le gros cœur
quand j'ai appris des affaires pareil surtout que j'&avais déjà
gros cœur quand j'ai recu ta carte que tu parter pour le front
je n'ai pas peut m'empêcher que de pleurer en lisant ta carte.
Cher
mari si tu veux te débrouiller pour avoir une permission tu
peux en avoir une car tout soldat sur le front à droit à une
permission tu n'auras qua parler à ton colonnel et lui dire que
tu as un garçon et il est obliger de te donner une permission
il est venut le 4 et toit tu es partit le 5 pour le front mais
j'espère bien que tu auras reçu mes lettres qui t'auras
annoncer la naissance du petit guerrier maintenant on va
attendre pour le batiser quand tu reviendras si tu as une
permission enfin tu me donneras des réponses tout suite".
Et
pour terminer ! "ta femme chérie qui t'embrasse fort sur
ta bouche, ta femme chérie pour la vie (au revoir)(Milles
baisers)"…
A
quoi le "colonnel" a répondu : "la naissance de
l'enfant a eu lieu le 4 septembre et c'est le 21 septembre que
la permission est demandée. Il y a abus : c'est la dernière
fois que j'accorde dans ces conditions".
Dix
minutes d'entretien avec le député Debierre, il tombe des nues
de ce que les soldats n'ont pas d'isolateurs ! "Pourtant,
il y des crédits de votés…"
Le
22 septembre - Le vieil
alcoolique bisontin Diez, a été reconnu apte ; hier une
demande de renfort arrive : "tous les hommes
disponibles" dit l'ordre. Diez doit donc partir. Je le
rencontre ce matin.
"Ils"
veulent que je remonte aux tranchées, me dit-il, eh ! bien ça
ne veut pas traîner, je vais me faire bousiller à la première
occasion. Le capitaine Laffargue écrivait dans sa brochure
"Conseils aux fantassins" : se faire tuer ou blesser
dans la tranchée par imprudence ou négligence est absolument
stupide, parce qu'on n'a servi à rien.
Que
penserait-il de ceux qui se font blesser exprès !
Les
journaux boches écrivent, paraît-il, que notre infanterie
actuelle n'est plus que l'ombre de celle qui les attaquait il y
a deux ans. Ils exagèrent un peu, mais que de cruelle vérité
dans cette remarque. Les "Diez" ne sont pas rares.
Beaucoup qui se sont battus avec courage et bonne volonté se
classent maintenant dans la "canaille", c'est à dire
selon Laffargue, "les soldats qui se défilent", ceux
"qui ont l'idée bien arrêtée de ne pas accomplir leur
devoir". La guerre est trop dure pour durer si longtemps.
Les sacrifices qu'on demande sont de ceux qu'on peut consentir
dans une ruée courte et décisive quand l'enthousiasme ou les
illusions soutiennent les combattants. Pas après une lutte
aussi froide, lente, tenace, incertaine.
L'enthousiasme,
disent encore les Boches est un plat qui ne se mange pas froid.
J'imagine que leurs fantassins aussi ne sont plus ceux qui
voyaient surgir dans leurs rêves Paris, et que chez eux les
lâches se multiplient singulièrement.
Il
faut reconnaître qu'on ne sait guère réconforter les pauvres
poilus. Je viens d'entendre une vieille brute de colonel au
sujet d'une permission qu'il refuse à un pauvre petit soldat
ayant perdu son frère. Il disait au Commandant : …"il a
un frère tué… Ben on le sait bien et après, il est mort
quoi (sic). Un frère tué ! Il a du chagrin, une vive douleur,
je sais, mais quoi, il y a un mois qu'il a été tué. Qu'est-ce
que ça avancera qu'il aille dans sa famille ?"
-
Que voulez-vous, quand il y en a un de mort, la famille est un
peu consolée de voir celui qui reste, objecta M. de Goÿs…
Et
le vieux de dire : "Oh ! Je ne sais pas, ça ravive leur
douleur. Et puis si on les écoutait, ils s'en iraient tous…
Il y en a des tas qui ont ainsi des prétextes…
-
Je vous dirai, mon colonel que sur ce chapitre, dans des cas
là, je suis très coulant, insistait le Commandant de Goÿs.
Mais l'autre n'a pas compris. Quand la férocité est si
inconsciente, elle ne peut plus comprendre…
Et
dire qu'on ruine et démoralise la France à maintenir à leur
poste ces vieux gagas, pour leur ménager un ruban, un galon.
On
a fendu l'oreille aux fameux "Commissaires" de gare
parce qu'ils embêtaient par trop le public, les civils. Mais
ceux qui brisaient les pauvres soldats, on les laisse exercer
indéfiniment leur malfaisante imbécillité.
Dans
l'Oeuvre. Explication d'un discours.
Roux-Contadour
rétablit son texte profondément juste et triste. "Tandis
que cette guerre exécrable a épargné pour une raison ou pour
une autre une certaine quantité d'ouvriers et de bourgeois,
eux, les paysans, elle les a fauchés largement et terriblement.
Ceux-là, on ne les réforme guère, on ne les embusque pas. Ils
sont la classe sociale qui n'a ni chance, ni faveur, et qui
remplit les tranchées. Ils constituent l'élément le plus
robuste, le plus sain, au moral comme au physique, de toute la
nation."
Le
23 septembre - Ansauvillers. Ce
froussard de Bordenet, à force de se décaver et d'aller à
visite sur visite pleurer dans le gilet du major, a fini par se
faire proposer pour passer devant une commission de réforme. Il
serait versé dans le service auxiliaire… O rêve, sa peau
serait sauvée, sa peau précieuse pour le salut de laquelle il
commettrait l'infamie qu'on voudrait. Le voilà donc rassuré,
le souci de partir au front ne le tenaille plus, et comme la
séance du conseil de réforme est encore à date indéterminée
Bordenet a peur de reprendre bonne mine. Aussi, il s'applique à
ne plus manger afin de continuer à maigrir…
Canaille
! On en a fusillé, des pauvres diables qui avaient eu
d'accidentelles défaillances. Lui, de sa lâche et cauteleuse
manœuvre est mille fois plus coupable.
"La
guerre m'a rendu égoïste", dit-il.
Le
24 septembre - J'espérais un peu
de paix. C'est le surmenage le plus dur.
Bonne
nouvelle pourtant, les "vieilles entraves" seraient
remerciées… Dissolution des groupements de D.D.. Nous
reprenons notre autonomie.
Longue
lettre de Louis. Description de la Macédoine.
Le
25 septembre - Ordres de départ
pour demain. Va-et-vient de circonstance.
Lettre
de Marthe : "Et plus l'épreuve se prolonge, mieux le
partage s'accuse de ceux qui montent toujours plus haut, sans
éclat et sans fanfaronnades, et de ceux qui s'amoindrissent de
plus en plus".
Nous
partons demain en auto pour Hangard. Nous allons nous retrouver
dans cette délicieuse vallée de la Luce.
 Berteaucourt
revient en souvenir. J'ai appris seulement aujourd'hui une chose
écœurante qui s'est passé là-bas, durant mon premier
séjour. Berteaucourt
revient en souvenir. J'ai appris seulement aujourd'hui une chose
écœurante qui s'est passé là-bas, durant mon premier
séjour.
Le
cuisinier Klöckner a eu les faveurs de la jeune femme blonde
où était installée la cuisine.
Veuve
depuis quelques mois d'un mari tuberculeux ; elle même sans
doute atteinte, et soignant désespérément une fillette qui
est morte pendant notre séjour là-bas.
Or
Dôle et Pichon m'ont affirmé aujourd'hui, que cette femme
avait reçu dans son lit le jeune Klöckner la nuit où la
fillette était au cercueil !
Le
26 septembre - Ansauvillers.
Lever tôt. Départ prévu pour 8 heures. Le Commandant est là
de bonne heure. Il m'emmène au point d'embarquement à la
sortie du village où les autos doivent venir nous prendre.
Voici
sur la route le Commandant Crambelli qui s'avance, muni de trois
hommes chargés comme des bourriques.
-
Qui sont ces hommes, demande M. de Goÿs.
-
Ce sont les cuisiniers de M. Ciambelli.
Et
le Commandant de Goÿs étouffe un sourire.
Départ
en auto à 11 heures. La poussière et la fumée d'essence font
de l'autobus un séjour atroce. J'arrive à midi aux abords
d'Hangard avec un sentiment de délivrance.
Dans
ces convois d'autobus on est entassé et abruti comme des veaux
dans la voiture d'un boucher.
La
poussière odieuse, le vacarme, la chaleur, les cahots, les
toiles par côtes, la file de camions en avant, en arrière,
tout se ligue pour rendre matériellement impossible le moindre
intérêt au paysage parcouru.
Nous
filons d'abord à travers le Santerre, toujours plein de gerbes,
nous gagnons la vallée de l'Avre à Montdidier : je ferme
constamment les yeux pour ne pas penser, pour ne pas sentir.
A
Pierrepont la route est barrée par une colonne d'infanterie qui
défile musique en tête.
Des
soldats s'arrachent les journaux, je happe le Journal. Rancourt
puis Combles encerclés. Quatre mille prisonniers, ça craque
là-haut.
Un
peu plus loin, une vision digne des paysages de fer entrevus
autrefois avec envie dans les environs de Hannover, quand
j'allais à Hambourg.
Ici
un immense champ où se croisent en réseau des voies ferrées
derrière l'écran d'une raide colline. Entre les voies, des
piles de matériel, de longs alignements de roues, d'affûts des
forêts de canons géants, et là comme des bataillons couchés
prêts au bond menaçant, des lignes et des lignes de tubes de
rechange.
Çà
et là des grues ambulantes promènent les pièces lourdes entre
deux voies.
Et
parmi les centaines d'artilleurs affairés, des prisonniers
boches portent la brouette ou manipulent du matériel.
Enfin,
nous sommes outillés. Il a fallu deux longues années et les
appels angoissés de Charles Humbert pour secouer notre routine.
Hangard.
Le
Commandant m'attend au presbytère. Il me sonne de ces ordres
brefs, nets, impérieux. Voici le bureau. Vous coucherez là
avec le fourrier. Ma chambre sera là-haut avec celle du
Commandant Ciambelli et capitaine Girard.
La
popote des officiers de chasseurs dans la salle à manger.
Voilà la cuisine, j'entends qu'il n'y ait aucun mélange ou
va-et-vient entre le service et les cuisines. Vous passerez par
cette porte, et cette entrée sera exclusivement réservée au
service. Le perron sera pour la sortie privée. Vous me
comprenez, n'est-ce pas ? Et il nous plante son regard noir
jusqu'au fond de l'orbite.
Le
27 septembre - Hangard. J'ai
dormi avec pas mal de puces. Dès le réveil, du travail. Vers
le soir, cela déborde, puis à 7 heures, quand j'ai tous mis en
ordre pour une installation confortable, crac, ordre de départ
pour demain matin. Rassemblement des fourriers, va, vient,
ordres de détails, emballage des paperasses, coups de
téléphone, fièvre jusqu'à minuit, et j'ai moins sommeil
qu'à 6 heures du soir, tant l'organisme en branle a de peine à
se mettre au calme.
Le
28 septembre - Départ de
Hangard-sur-Luce. Réveil furibond du Commandant qui s'est
oublié, que les cuisiniers et l'ordonnance ont également
oublié. Il descend à l'heure du rassemblement et n'a pas même
un café. Les cuisiniers ont tout balancé pour partir.
Il
fait beau. Je reste jusqu'à 9 heures pour derniers détails.
Le
28 septembre - Arrivée aux camps 57-58.
Nous
rentrons dans le bruit infernal. Il faut avoir été englouti
dans le flot de véhicules sur la grande route d'Amiens à une
bifurcation pour sentir ce que c'est que l'arrière d'une armée
moderne.
J'ai
revu en passant le camp 59, et ses canons géants. Nous sommes
dans le ravin, plus pittoresque, mais où le travail ne me
laisse pas le loisir de voir le paysage.
Ravenet
est sur les dents, hargneux, insolent. Le Commandant décide
pour les permissions. Travail jusqu'à 20 heures. Je n'ai pas eu
le temps de voir un journal ni de prier une minute - encore
moins d'écrire. Nous verrons demain. Bonsoir à tous ceux que
j'aime.
Le
29 septembre - Amiens. Dans la
cathédrale. L'ange claironnant la résurrection m'accompagne.
La visite à la Stefanskirche.
Une
maman et son fils.
Mon
fils ! Oh mon Dieu ! Mein Sohn ! Toi que j'aurais tant aimé.
Mon
Dieu ! Sauvez la France. Délivrez-nous. Donnez-moi la
bénédiction de l'avenir.
Je
n'ai pas de chance au cours de mes visites à Amiens. Deux fois
temps brumeux, pleureur qui donne au paysage et à la ville un
air maussade.
Pour
la cathédrale, cela n'a pas d'importance.
Entré
dans un magasin. Un jeune employé, pâle et rouquin, me dit
d'un air profond :
-
"Voilà encore la pluie. Mauvais temps. Cela va gêner les
opérations".
-
Les opérations, fis-je, oui, en effet, mais plus encore les
opérateurs.
Cela
l'a "assis".
Retour
en auto. Toujours le même fleuve de voitures, de camions de
caissons sur cette route. C'est effarant, ces roues dévorent la
route. Des équipes travaillent sans relâche à la nourrir de
pierres. J'ai compté dix-huit cylindres à vapeur. Dix-huit
barrages pour les autos. Dix-huit poses. Les gendarmes
tout-puissants. L'auto de Joffre doit faire halte comme un
vulgaire camion.
J'ai
vu moins d'Anglais qu'en juin.
Le
30 septembre - Camp 57.
Proposition
des candidats au grade de chef de section. Présentation. Je
suis interloqué de voir quelles ressources en intelligence, il
y a encore dans l'armée combattante. Il y a bon nombre
d'embusqués ; des légions ; mais il reste encore d'autres
légions de jeunes gens de valeur restés pour le sacrifice.
Receveurs
d'enregistrement, notaire, séminariste,
ingénieur-électricien, comptable, étudiant, économiste,
élève de l'École des Hautes Études, de l'École Coloniale,
employés de banque, instituteurs… tous ces candidats à la
gloire et au sacrifice défilent en quelques instants sous l'œil
perçant du Commandant.
L'un
deux m'a ému profondément.
Quel
motif vous incite à suivre le cours, fit le Commandant.
Mon
Commandant, je suis des régions envahies, j'ai perdu ma femme
les premiers jours de la guerre, je suis seul à présent ;
j'aurais ainsi un but dans la vie, et je serais plus utile…
Tout
un drame, toute une vie brisée.
Le 1er
octobre 1916
Camp
57. J'ai revu les camarades du convoi. Durand a été heureux,
très heureux de me retrouver, ce brave Durand. Ça fait une
émotion. Quelle étoffe d'homme auprès de Rübelein…
Le
2 octobre - Les Roumains seraient
frottés, en retraite, sous la poussée de Mackenser et
Falkenhayn. Ce sont des gens prodigieux ces Boches. Ils font
jaillir des légions et de l'outillage à coup d'énergie…
Ah
! Si la France avait un gouvernement de cette valeur…
Le
2 octobre - J'ai veillé hier jusqu'à minuit pour des
rapports à établir. Pluie. Froidure.
Le
3 octobre - Les déjeuners sur un
coin de banc au pied levé. Ce matin, c'est typique. Dôle
savoure longuement en petit fromage "Bondon" arrosé
de vin blanc à 1,50 le litre… et qu'on a eu avec les
protections et le dévouement d'un cycliste qui a fait trente
kilomètres pour en trouver.
Dôle
est installé. Dôle est tranquille. Dôle déguste pendant que
j'achève ma toilette. Je viens en hâte invité à partager
avec lui. A peine suis-je assis que, de la baraque voisine part
l'appel énergique et volontaire du Commandant :
-
Cœurdevey !
-
Mon Commandant ! Et un ressort me jette sur la porte au
"garde à vous".
-
Apportez-moi tel dossier…
J'apporte
la pièce demandée. Je me rassieds, coupe une tranche de pain,
racle un peu du "Boudon". Déjà je sens la salive du
bon appétit courir sur ma langue !
-
Cœurdevey !
-
Mon Commandant.
Nouveau
bond, nouveau "garde-à-vous".
-
Appelez-moi M. David…
-
Oui mon Commandant.
Je
cours à la baraque de M. David. Je le confie au Commandant, et
je reviens à mon fromage. J'en étale une tranche sur ma
tartine ; je déguste la première bouchée pendant que Dôle me
verse du vin blanc dans mon quart en disant : il vaut ses trente
sous, celui-ci. Et j'admire la chaude couleur dorée qui sort du
bidon.
-
Cœurdevey !
-
Mon Commandant.
Un
bond. Sur la porte. Garde-à-vous.
Dites
à la voiture du 55ème d'atteler pour aller à
Chuignolles et préparez le bon pour les éléments Brun.
-
Oui, mon Commandant.
Course
dans le talus au 55ème. Griffonnage d'un bon.
Je
reviens à Dôle, gouailleur :
-
Allons, goûtez donc à ce fameux pinard. Il est "urf"
! Qu'est-ce que vous courez au lieu de déjeuner. Voyez, puisque
vous n'en voulez pas, j'ai mangé le fromage que vous avez
raclé.
-
Canaille ! lui dis-je. Vous avez du culot. A-t-on jamais vu un
sous-verge aussi effronté !
-
Ah ! fit-il, moi je ne suis pas "des huiles", je ne
suis pas "juteux de bataillon", je déjeune. A votre
service.
-
Qu'est-ce que vous trottez tout le temps. Goûtez donc ce vin
blanc. C'est bien la peine que je vous trouve du pinard blanc et
du fromage pour que vous n'en profitiez pas.
-
Misérable, je veux vous faire balancer si vous continuez à ne
rien faire, et à m'acheter pendant que je trime ?
-
Ça m'est égal. Quand vous voudrez, mais goûtez-moi un peu
ça.
Et
prêchant d'exemple, il fait couler lentement et voluptueusement
sur sa langue une lampée du pinard blond et rare…
Je
bois à mon tour, je m'engage dans la suavité du quart plein,
puis je fais le savoureux mélange de la croûte blonde avec le
fromage blanc. Quand on a bon appétit, c'est un régal de roi.
-
Cœurdevey !
-
Mon Commandant…
Et
je m'arrache d'une brusque secousse de mon déjeûner pour
porter quelque dossier ou appeler un sergent-major.
Le
4 octobre - Rien que l'abrutissant
travail de paperasses. Nostalgie.
Le
soir, trois adjudants du régiment sont appelés. L'un deux fait
du chahut, il râle parce qu'il est désigné. Il lui semble,
non sans raison (il a vingt mois de tranchées, trois enfants)
que c'est plutôt à Ravenet et à moi à monter. C'est
irréfutable, et pourtant.
Le
5 octobre - L'armée d'Orient a des
succès, mais il ne me vient aucune lettre de Louis.
Travail
acharné, de paperasse vaine. Sur le soir, le ciel se
rassérène. Je regarde dehors avec envie et par-dessus les
épaules de cette prison.
Je
crois que je ne pourrai pas m'y asservir 'longtemps".
Le
6 octobre - L'adjudant Robert du 48ème
donna l'ordre à ce sergent d'emmener le soldat Becker au poste
de police. Il refusa à nouveau et d'une façon très
catégorique menaça ensuite l'adjudant de voies de fait en lui
disant : veux-tu que je t'égorge à plusieurs reprises"
(sic).
Ory,
quatre jours de salle de police % de l'adjudant Narcel de la 8ème
Compagnie : "A uriné dans le cantonnement".
C'est
le jour des punitions cocasses !…
Le
7 octobre - Camp 57.
Il
m'arrive une drôle de lettre de Mme R.. Elle fait allusion à
une autre lettre qu'elle regrette d'avoir écrite, à une autre
lettre qui est partie malgré elle, et qu'elle voudrait que je
ne lise pas. Je ne l'ai pas reçue cette lettre qui pique si
fort ma curiosité.
Dans
celle d'aujourd'hui, il y a une explication embrouillée, une
soldat qui l'a interpellée sur sa porte, une réponse qui l'a
bouleversée, un cri de folie vers moi s'en serait suivi…
Et
moi j'ai l'involontaire soupçon qu'un acte de folie s'en serait
suivi, là-bas dans la griserie troublante du soir et le flot de
désirs trop longtemps contenu et soudain débridé…
J'ai
idée qu'elle renouvelle la manœuvre de Marguerite.
Les
théologiens du Moyen-Age se demandaient si la Femme avait bien
une âme raisonnable. Je les admire. Ce n'étaient pas des
novices. Et ils avaient bien remarqué ces heures d'aberration
qui arrivent en rafale sur ces pauvres créatures de chair…
Le
8 octobre - Dimanche. Visite à
Petit - Pouteau - Pointaire… L'évocation des mois passés. A
Pouteau j'ai allongé sur la face que mon départ du convoi
avait été une délivrance.
Le
9 octobre - Journées mornes. Le ciel
est bas, gris, le sol boueux, l'âme visqueuse. Rien ne saille,
rien qui fasse espérer. Le duel est dans sa phase morne.
L'offensive franco-anglaise reprend haleine. Les Russes ne
communiquent plus rien, les Italiens sont rivés dans Gorizia,
les Roumains refluent vers leurs frontières, la lutte apparaît
égale, sans conclusion, sans fin. Ce sentiment de l'inutile
effort paralyse, accable. Nos rangs s'éclaircissent. La France
n'a plus de réserves. Tous les dépôts sont vides, les
régiments au front sont peuplés d'hommes fatigués ou
blessés, tous âgés ! Plus de jeunesse, plus d'espoir.
Attaquer encore c'est faucher les derniers blés avant qu'un
seul soit mûr. Avec quoi ferons-nous des attaques ? Chaque
division à déjà été décimée plusieurs fois…
Pourrons-nous seulement rester l'arme au pied, ceux qui restent,
pendant qu'Anglais, Italiens, donneraient à l'Allemagne les
assauts suprêmes en 1917 ?…
Chaque
jour, un deuil de plus. Cardinaux est tué.
Mon frère
Louis a écrit le 16. Bonne lettre de Mme Letombe.
Le
10 octobre - Cette nuit les avions
allemands nous ont rendu visite. Ils ont prodigué les bombes.
Elles tombaient comme les grains d'un chapelet entre des doigts
fébriles. Deux projectiles sont tombés tout près de ma
baraque sans exploser.
Il
faisait un clair de lune magnifique au point que j'ai pu
distinguer l'avion ennemi dans le ciel.
Une
lettre démoralisée de mon frère Louis. "Il en a
marre". C'est à faire pitié.
Le
11 octobre - Camp 57. La nuit
dernière les avions sont encore venus à deux reprises rendre
visite aux camps de la région. Ils ont agrémenté leurs
crottes explosives d'un copieux arrosage à la mitrailleuse.
Ils
volaient si bas que dans la nuit claire on les distinguait
facilement, ils passaient comme des ombres sinistres.
Le
Commandant s'inquiète avec une insistance mal rassurée des
points de chute.
Bordenet,
paraît-il a erré toute la nuit.
Je
suis resté couché pour la deuxième visite de ces Messieurs.
Le
soir, ordres de départ.
Préparatifs.
Nervosité du Commandant. Il s'irrite facilement, s'acharne sur
une futilité. Deux caisses de grenades lui causent un souci
disproportionné. A cause de ces deux caisses, il persécute le
casernier. Pour un peu il le ferait relever.
De
même pour le vaguemestre.
Maurice
Bernard s'est tué en aéroplane. O vanité des vanités…
Le
12 octobre - Je me suis levé très
tôt pour embarquer les mitrailleuses.
Nous
monterons en auto à midi. De 8 heures à 11 heures, je vais
être libre.
J'ai
trouvé le dernier roman de Bourget. Assis sur un banc derrière
la baraque j'en goûte les premières pages avec toute la
sérénité des anciens beaux jours, quand je pouvais butiner
dans les livres tout en buvant l'air calme et frais des champs.
Le camp est silencieux. Je suis sur la terrasse ; dans le vallon
pas de bruit, il monte entre les arbres épargnés du bosquet
une délicieuse fumée bleue, ce sont les débris du balayage
qui fument tranquillement, sous un ciel gris d'automne, sans
brise. La canonnade si furieuse hier et cette nuit s'est
apaisée. On dirait que dans la nature, quelqu'un est à
l'agonie et que les choses se taisent pieusement.
Matin
d'octobre.
Se
sentir un chiffre vivant dans une addition vivante.
La
division doit attaquer demain. Le 352ème aurait
repoussé neuf contre-attaques. Pauvres vieux Comtois, assaillis
par des jeunes Berlinois, dit-on.
"L'armée
du Salut", l'appelait-on par dérision. Et le régiment
tient comme la Garde.
De
Pascal, une pensée dont il y aura lieu de se souvenir…
"La
charité envers les morts consiste à faire les choses qu'ils
nous ordonneraient, s'ils étaient vivants ". ".
Nous
sommes allés au point fixé pour l'embarquement, nous avons
attendu trois heures. Personne n'est venu. Information par
téléphone. Erreur de date. Le 13, non pas le 12. Retour au
camp. Repos.
Le
13 octobre - Embarquement certain
cette fois. Un contre-ordre n'avait pas été transmis. Le mal
n'est pas grave, mais…
Une
lettre de Marthe S. et de Fernande.
Nous
irons cantonner à Sourdon.
La
poussière est atroce. Itinéraire bien connu.
A
Moreuil nous inclinons vers le plateau, repassons en haut de
Mailly-Raineval, à peine entrevu.
Le
14 octobre - Sourdon . .
Hier
au soir, ce fut le travail encombré de toute installation
nouvelle. Nouveaux ordres, nouveaux renseignements, nouvelles
dispositions, à-coups dans tous les services. Installation du
bureau à la Mairie. Le Commandant me présente à l'instituteur
comme un "collègue". C'est un vieillard à peau
ratatinée, mal rasée on dirait mal lavée, l'air timide,
battu, souffreteux.
Le
soir, un peu las, je suis allé à la recherche de la popote,
installée dans une cuisine pleine d'enfants.
Le
vaguemestre me remet une poignée de lettres. C'est ma fête. Il
n'y a que Bertha qui y songe, et je trouve très doux ce soir ce
souhait plaintif et lointain de la forêt.
C.
m'a écrit aussi, mais rien. Elle m'apprend une nouvelle qui me
donne le cafard.
Feuvrier
est tué. Enseveli par un 305. Avant-hier Malblanc me demandait
de ses nouvelles ! Hélas.
Il
n'en restera donc point, de jeunes gens.
Le soir, à 20
heures, Ravenet à moitié mûr fait une scène idiote et
méchante. Nous avons failli en venir aux mains.
Le
15 octobre - Sourdon.
Dimanche.
Je n'ai pas encore vu le village, mais je m'évade un peu à
midi, pour respirer un peu. Je découvre dans un repli de
terrain qui me rappelle la Combe Bouzot, une délicieuse petite
chapelle dédiée à St-Aubin, élevée en 1673. Des graffiti
sans nombre, de soldats se recommandant à la Vierge.
Il
pleure en moi le souvenir de la chapelle de Krems.
Les
16, 17, 18, 19 octobre - Toujours
la même paperasserie bouleversée avec ce terrible Commandant
qui ne vous laisse rien achever dans son impatience. Dans le
temps qu'il passe d'une idée à une autre il faut avoir
exécuté la première et que la seconde soit en voie
d'exécution.
Aujourd'hui
visite du Général Buat, accompagné du Général Bricart.
Buat
semble un homme froid, posé, mais j'ai l'impression en le
voyant qu'un Général de Division dans le formidable appareil
de guerre est un rouage secondaire. Que peut-il ? Si peu…
Les
permissions remettent la troupe en émoi. Pourcentage énorme,
quarante pour cent. Tous vont partir, même ceux qui en
reviennent presque. Enfin, après deux ans, on arrive à une
solution un peu généreuse et logique envers ceux qui seuls
presque méritent des permissions : les fantassins qui
descendent des tranchées. Mon tour pourtant, viendrait en
queue. C'est plus que je n'en espérais.
Le
20 octobre - Sourdon.
Visite
des anciens convives appelés aux Compagnies actives pour
l'attaque. Ils ont subi le bombardement sans trop de danger,
reviennent indemnes, soulagés d'un cauchemar, et un peu
vieillis - Quillet notamment.
A
table, récits de guerre, récits de bataille, récits
d'attaque. L'assaut de l'infanterie se fit dans le désert…
Un
tableau croqué dans un récit, le sujet d'une nouvelle à la
lieutenant ER., ou à la Maupassant.
C'est
à l'aube, le capitaine fait une tournée dans la tranchée
silencieuse. La sentinelle assoupie appuyée à son fusil et à
la paroi. Le Capitaine bourru et bon cœur lui envoie une
taloche : Eh bien ! On ne dort pas quand on est de fonction.
Silence
et immobilité du dormeur. Deuxième taloche. Pas de réponse.
Le
Capitaine se baisse et regarde : c'était un mort, la sentinelle
avait une balle dans la tête.
Le
21 octobre - Sourdon.
Spectacle
pénible : une machine à battre. Des vieilles femmes, des
jeunes filles bottèlent la paille, haussent les gerbes, remuent
les sacs de blé. Autour d'elles, les mains dans les poches, des
soldats oisifs les regardent.
Un
paysan ce matin est venu demander des hommes de corvée pour
travaux agricoles au Commandant. Refus catégorique :
"Impossible de distraire un homme de l'instruction".
Le cultivateur objecte les circulaires ministérielles.
Le
Commandant répond qu'entre lui et le Ministre il y a toute une
échelle de supérieurs dont les ordres le touchent beaucoup
plus directement que ceux du Ministre.
Le
paysan insiste. Le Commandant s'impatiente : "Monsieur, je
ne veux pas vous écouter".
Monsieur,
je réclamerai à qui est plus haut que vous.
Et
voilà l'idiotie des situations et de la bureaucratie et des
règlements.
Voici
le 20 octobre, le blé n'est pas battu, à plus forte raison la
semence n'est pas confiée à la terre, faute de bras. Ici il y
a des centaines d'hommes qui sauraient hâter ces semailles
indispensables.
Faute
d'ordre direct, un esclave du règlement préfère abrutir ses
hommes à faire de l'à droite par quatre dans les champs. Avec
la même conscience, s'il en avait l'ordre, il mettrait mille
deux cents hommes à ensemencer la terre au lieu de la fouler
stupidement.
Dôle
a des accès de mauvaise humeur comme une femme. Peut-on être
aussi maniaque quand on est homme. Enfin, patience.
Le
22 octobre - Ce matin le Commandant
nous a dit : il vous faut profiter du dimanche pour un peu vous
changer d'air et vous détendre. Il suffit qu'un de vous reste
au bureau. Entendez-vous.
-
Si vous n'y voyez pas d'inconvénient mon Commandant, j'irai
voir cet après-midi à Hargicourt un de mes amis que je n'ai
pas vu depuis trois ans.
-
Accordé, m'a t-il dit.
Et
je suis parti voir Malblanc. Le pauvre grand idéaliste a encore
accusé sa physionomie d'ascète. Je l'ai embrassé comme un
frère. Je n'ai pu être avec lui qu'une demi-heure. Juste le
temps de lui faire part de la mort de Victor Feuvrier.
"Encore
un ! Hélas !", et d'entendre une demi-confidence sur la
trahison de sa fiancée.
Encore
une fois le bonheur se dérobe sous la main avide de cet affamé
d'amour.
Le
23 octobre - Annonce de départ.
J'ai
achevé la lecture du "Démon de midi" de Bourget. La
conclusion de cette mesquine histoire trop fréquente s'applique
si bien à notre génération :
"Quod
non rapui tunc, exolvebam…"
"Ce
que j'ai volé alors, je l'ai payé…"
"J'ai
payé la dette qui n'était pas la mienne".
C'est
le cri douloureux qui s'échappe de cette pauvre lettre de mon
frère Louis relatant ces malheureux blessés français
abandonnés dans les ravins de la Macédoine.
Le
24 octobre - Matin gris. Il bruine.
Dans la salle de mairie un air douillet nous enveloppe. C'est
une joie d'écouter les premiers ronflements d'un poêle et de
sentir aux premiers froids, la chaude caresse du chez-soi, la
confidence d'un bon feu. O douceur vaine des illusions ! Nous
devons partir demain vers un nouveau gîte ; nouvelle épreuve
d'un transport en auto, d'un déménagement et d'une
installation à recommencer.
Un
quart d'heure de paix. Je tends la main vers un exemplaire des
Châtiments - de la bibliothèque municipale. Je retrouve comme
un vieil ami très cher longtemps délaissé, ce passage qui fut
le conseiller de ma jeunesse !
"Ceux
qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux
dont un dessein ferme emplit l'âme et le front.
Ceux
qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime.
Ceux
qui marchent pensifs épris d'un but sublime.
Ayant
devant les yeux, sans cesse, nuit et jour
Ou
quelque saint labeur, ou quelque grand amour.
Ces
vers me réveillent. Je crois sortir d'un sommeil prolongé -
pendant lequel mon idéal, ma vie morale ont été suspendus.
Ces
principes de vie haute, je ne les avais plus à l'esprit
"sans cesse" comme autrefois entre vingt et trente
ans.
On
espère s'améliorer en avançant dans la vie, et l'on s'enlise
peu à peu sans s'en rendre bien compte, comme un voyageur qui
perd sa route dans une campagne ensevelie sous la neige.
21
heures. Quelle journée mouvementée. Le Commandant m'a infligé
une cinglante rebuffade dont je me souviendrai. Je serai moins
soucieux de lui épargner les gaffes.
Dôle
de son côté m'a fait attraper par excès de zèle.
Ravenet
est venu me donner sur les nerfs.
L'appareil
téléphonique n'a pas voulu marcher malgré les innombrables
tours de la magnéto.
Constanza
est pris par les Bulgares… Mais tout cela ce soir est emporté
comme un mauvais brouillard. Mon cœur bouillonne, ô ma France
quel sursaut réconfortant ! Le fil rétif vient de se décider
pour une bonne nouvelle à nous faire bondir de joie.
-
Allô ! Me dit-on à l'appareil.
-
Allô ! Voici Sourdon le D.D. Qui est là ?
-
C'est Moreuil Central !
-
Allô ! Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a ?
-
Rien, mais une bonne nouvelle. Nous avons repris Douaumont et
fait trois mille cinq cent prisonniers.
-
Douaumont ! Bravo ! Pas possible !
Et
je sens des bouillonnements insoupçonnés en moi.
Douaumont
! La pierre angulaire, le pilier principal de la principale
place forte de France. Douaumont, qui était le 27 février
comme la porte ouverte du Paradis pour les Boches ! Douaumont,
la grande entrée vers Verdun qui rayonnait dans le soir
sanglant ! Douaumont ! Quand on sait tout ce que ce nom a
caressé d'orgueil germanique, quelle âpre et fière résonance
il a dans nos cœurs outragés qui se reprennent ! Allons, mon
âme tu étais lasse ce soir et te voici jeune à nouveau.
Debout ! Douaumont est repris.
Le
25 octobre - Gournay.
Arrivée
à Gournay-sur-Aronde. Le ciel coloré du matin au départ nous
a valu une copieuse ondée à l'arrivée.
Voyage
en camions-autos, par Montdidier. Paysage ordinaire avec ses
mouvements de terrain qui s'étirent paresseusement avec parfois
de brusques inflexions pour nous montrer au flanc des talus la
craie blanche sous son manteau de limon.
Montdidier.
Il a grand air vu de loin, avec sa coiffure de maisons, de
clochetons. Il rappelle les quartiers hauts du vieux Besançon.
C'est
à la limite du département que cesse la Picardie crayeuse,
vers Rollot les haies vives encadrant les vergers reparaissent.
On retrouve enfin des prés verts, des bois, des bouleaux.
Voici
notre village à cheval sur un dos de terrain. Une très vieille
église se blottit près de la rivière où j'ai entrevu de
belles cressonnières. Mais ce qui est irritant, c'est la
mauvaise volonté de la population à nous loger.
Je
frappe à plus de vingt portes avant de pouvoir trouver un
bureau.
Il
sont las, les habitants. Et nous ! Alors ?
Enfin
une bonne vieille maniaque souffre que nous nous installions à
sa buanderie.
Je
n'ai pas eu le temps de lire un journal. Pourtant, ils devraient
être intéressants aujourd'hui.
Le
26 octobre - Gournay-sur-Aronde . .
Journée
d'installation. J'ai pu enfin me procurer un journal d'hier : le
succès à Verdun dépasse toute espérance. Nous avons repris
en sept heures ce que les Boches nous avaient arraché en sept
mois !
France
étonnante ! J'ai honte un peu d'être resté si longtemps
embusqué à demi - et j'ai le vague et secret espoir d'être un
temps parmi ceux qui vivent dangereusement et de façon assez
haute pour apprendre à mourir.
Une
carte de mon frère Louis, presque malade.
Le
27 octobre - Gournay.
Nouvelle
lettre de mon frère Louis du 12 octobre. Il va mieux. Il me
fait la remarque fort juste que mes actes ne sont pas en rapport
avec mes idées. Il a raison. Mais que faire ? Demander à
partir aux Compagnies actives ? Conquérir avec le danger des
palmes et des galons ? Non. Je n'ai fait aucune demande pour
être à l'abri, je n'en ferai aucune pour être en danger.
C'est écrit. Je suivrai mon sort tel qu'il se présentera.
Dôle
vient de m'arracher à ma lecture de Polyphème pour aller
sabler le champagne au bureau de tabac. Il suffit d'un peu de
vin mousseux pour affronter la Vie et la Mort d'un regard égal.
Le
28 octobre - Gournay-sur-Aronde.
 Le
vaguemestre a distribué des cartes postales en franchise
illustrées du dessin d'Abel Faivre : le petit bleu et criant
"on les aura". Le
vaguemestre a distribué des cartes postales en franchise
illustrées du dessin d'Abel Faivre : le petit bleu et criant
"on les aura".
Ces
paroles magiques à certaine heure n'ont plus qu'un effet
décourageant. Depuis si longtemps que les "gens payés
pour ça" nous racontent la même décevante promesse, que
la foi s'en va comme une étoffe brûlée par le soleil. Ça ne
prend plus. Les prôneurs d'optimisme ont trop raconté que
chaque heure qui s'écoulait affaiblissait l'Allemagne et voyait
s'accroître les forces des Alliés. Si on voulait tenir compte
du rapport des forces mises en jeu, c'est peut-être le
contraire qui a eu lieu. Il saute aux yeux du plus borné
qu'après vingt-huit mois de guerre, l'Allemagne affronte
hardiment le choc de toute l'Europe, elle met en outre dans les
transes la Roumanie téméraire. On ne voit pas d'issue à cette
lutte forcenée. Pourtant si la coalition des Alliés avait pris
les mesures exaspérées qu'il fallait pour terrasser un tel
adversaire que le germanisme, il est très probable que le sort
se serait décidé à délivrer la Victoire et que les tueries
et les souffrances seraient finies. Le patriotisme s'en va, il
est parti. C'est vraiment trop demander à des hommes que deux
et trois années d'une telle guerre. Chacun de ceux qui luttent
effectivement se dit que ceux qui avaient assumé la charge de
diriger le duel auraient dû faire mieux et plus vite. Rien
n'apparaît à l'horizon et alors le doute se répand, le
découragement fait tache d'huile. Messieurs les bourgeois,
gouvernants paisibles, prenez garde. A faire une belle guerre
bien bourgeoise sans violence à vos habitudes, à vos amitiés,
à vos influences de camaraderie ou de cloche ; prenez garde que
la France lasse ne se laisse choir dans l'abîme. Et ce
jour-là, elle vous entraînerait aussi… elle refusera
peut-être les fonds indispensables à la continuation de la
lutte. Et dans ce cas, c'est le désastre. Vous accusez des
rumeurs infâmes, des bruits perfides répandus par de
mystérieux agents, disant :
"Souscrire
à l'emprunt c'est faire durer la guerre".
"Ne
pas souscrire, c'est la faire cesser".
Eh
! Oui, ces bruits courent ; et je les entends partout, j'en suis
enveloppé mais n'accusez pas l'ennemi, n'accusez que votre
coupable indolence. Ils émanent tout spontanément du fait
qu'il y a deux ans que l'étranger foule notre sol et nous vole
et nous saigne, et que vous n'avez rien pu dresser pour le
chasser, ni même qui menace avec un peu d'apparence de le
chasser. C'est toujours la même chose, la même situation. On
sait seulement de façon sûre que les uns se font casser la
figure, et qu'un bon nombre d'autres édifient des fortunes avec
les larmes, les ruines et le sang des autres.
Tout
cela fait un mélange dangereux et malsain. Ne vous étonnez pas
que de la réaction il s'en dégage des miasmes empoisonnés et
délétères.
Les
rumeurs coupables, mais elles sortent de tout cet or et de tout
ce sang, comme les miasmes putrides d'un marécage.
J'ai
montré les cartes au Commandant qui m'a fait la singulière
réflexion : "tout ça, c'est bizarre. Cette guerre est un
singulier mélange de bluff et de force, de confiance et de
duperie. Il serait bientôt temps qu'on sache où est le droit.
Pendant qu'il y en a qui se font casser la figure il y en a
d'autres qui s'enrichissent…"
Le
29 octobre - Gournay. C'est le
dernier jour de l'emprunt. J'hésite à y prendre part. Julien
m'a écrit avoir souscrit pour moi un titre de cinq cents francs
et autant pour son compte. C'est respectable. Pourtant j'ai cent
cinquante francs sur moi. C'est beaucoup et j'ai des scrupules
de ne pas pouvoir dire plus tard à mes fils que j'ai fait tout
ce que j'ai pu.
J'ai
peur en gardant cet argent de céder involontairement à l'idiot
calcul : "souscrire à l'emprunt, c'est faire durer la
guerre", car je ne sais quelle mauvaise paresse me cloue,
me fait tarder, puis esquiver la porte de la poste.
Je
suis allé hier jusque devant la poste, puis encore aujourd'hui
avec le projet vague de verser cent francs. Deux fois j'ai
continué mon chemin. Il y a là une étrange suggestion. Enfin
cet après-midi je me suis ressaisi et j'ai frappé au guichet.
C'est fait ; je n'ai pas réservé mes cent francs pour le
gaspillage, malgré la tentation.
Ces
cent francs-là je puis dire que c'est par patriotisme que je
les ai versés. Je sentais que j'aurais eu honte de les avoir
gardés. Tant de soldats autour de moi ont ricané contre cet
emprunt ; c'est bien le moins que ceux qui comme moi prévoient
les dangers d'une paix précaire souscrivent courageusement.
La
receveuse des postes m'affirme que cet emprunt va beaucoup mieux
que le premier. Dans la sphère étroite de ce bureau, en tout
cas, il a rendu trois fois plus que le premier. Elle m'explique
le calcul intéressé des capitalistes qui se réservaient, lors
du premier emprunt et qui même se sont réservés encore cette
fois, mais dans une moindre mesure.
Je
bavarde longuement avec cette receveuse, qui n'est pas sotte du
tout.
Les
30, 31 octobre - Jours mornes,
pas de lettres, pas de soleil. Du vague à l'âme et de la
bruine.
Ravenet
a saoulé Baltzinger. Tous deux sont heureux.
Cela
bat toujours froid entre Ravenet et moi.
Je
ne puis refermer la plaie au cœur qu'il m'a faite à Sourdon.
Il m'a fait depuis plusieurs avances, mais pas une excuse, il
n'a pas eu un geste qui efface, et à toutes ses avances j'ai
opposé un refus poli mais énergique : invitation à prendre le
café, à déjeuner, à partager sa popote. Non - cela m'a fait
trop mal, cette attitude haineuse et malhonnête qu'il a eue se
soir-là.
Parce
que je m'étais couché sans prendre toutes les précautions
nécessaires pour le renseigner à son retour tardif et parce
que Dôle n'a pas su me suppléer et qu'il en est résulté pour
son travail un retard d'une heure, il a profité de l'occasion
pour essayer de me faire "chanter", me menaçant d'une
réclamation au Commandant et disant n'en rester là que pour
éviter une "tuile" à un fourrier quelconque, et cela
avec ses injures habituelles : "tu n'es qu'un c…".
Le
lendemain et le jour suivant, il n'a pas mis les pieds au
bureau, il m'a fait inviter à prendre le café par un de ses
larbins, toutes choses qui ont retourné le fer dans la plaie,
qui depuis reste ouverte…
Le
31 octobre - Les journaux annoncent la mort du capitaine
Bölke, le redoutable aviateur allemand. Ils citent ses quarante
exploits victorieux. Mince, fait un poilu, "il en avait du
crime dans le ventre celui-là".
Marthe
m'a envoyé le "Sens de la Vie" et c'est demain la
fête des Morts…
Étrange
lettre de mon frère Louis. Étrange et douloureuse. Là-bas,
des conflits que ma présence seule adoucirait. J'ai trop
affiné son âme…
Le 1er
novembre 1916
Toussaint
!
Premiers
mouvements d'un déménagement possible, probable, puis retardé
ou supprimé.
Mais
va-et-vient au bureau. A 10 heures, le calme se rétablit.
-
"Est-ce que je puis m'absenter pour aller à la messe, mon
Commandant ?
-
Mais oui, mon ami (sic), je n'y vois pas d'inconvénient ! Au
contraire…"
Ce
brutal a des mansuétudes infinies…
Je
suis allé à la messe. Sermon froid, sans fil qui le rattache
à l'atroce actualité. Un discours théologique. Quelle
tristesse morne, alors qu'on pourrait le faire vibrant, ce
sermon.
Qu'importe,
j'ai puisé dans mon "Imitation" les paroles qui
fortifient, qui émeuvent, qui protègent et relèvent.
Peut-être pourrai-je atténuer et écarter les tentations.
"En quoi la maladresse des serviteurs, diminue-t-elle la
gloire du Maître".
Cet
après-midi, j'ai été chef du convoi chargé de toucher les
couchettes à Marquéglise. J'ai rencontré le C.V.A.D. et bu un
bon verre avec Robert. Durand m'a accompagné avec sa chaude
amitié.
Ce
soir, dans la rue, des voix avinées chantent un refrain idiot
de quelque café-concert. Je distingue parmi les voix d'hommes
quelques voix de femmes… Et c'est le soir de la fête des
Morts ! Où sont les cloches qui pleurent dans mon pays natal ;
où, les femmes en deuil, les veuves et les mères qui
sanglotaient ?…
Le
3 novembre - Lettre douloureuse de
Mme R.. Réponse délicate, difficile.
J'ai
achevé la lecture du "Sens de la Vie". Le dernier
chapitre a des suavités qui rappellent l"Imitation".
Tout le drame religieux de nos âmes de dilettantes est là :
ses sécheresses, ses soifs, ses efforts, ses déceptions, ses
triomphes trop rares. Jamais la pauvreté morale de nos esprits
critiques ne m'était apparue avec autant de tristesse, jamais
la Vérité, cette bulle vaporeuse que nos maîtres
intellectuels nous proposaient d'atteindre et de saisir et
d'étreindre ne m'avait semblée si chimérique et si creuse.
Oui la nostalgie de la Foi pleure en nous, pleure en moi.
Et
je suis allé à l'Église ce soir rechercher les Ave Maria
fervents de ma jeunesse ; je ne les ai pas retrouvés peut-être
tels quels, mais je suis revenu avec la vision nette des dangers
que je remarque rôder autour de moi depuis que nous sommes dans
ce pays de Gournay.
Les
tentations sortent du sol à chaque pas comme les bulles d'air
d'un terrain marécageux que l'on foulerait. Garde-toi de
t'enliser ; le danger menace. Veille. Il faut me remettre à
l'étude pour tuer les occasions.
Parfois
aux meilleures heures, je sens que j'ai besoin d'aller à la
tranchée, que l'épreuve me serait sanctifiante. Qu'il plaise
donc à Dieu de m'y conduire si c'est à ce prix que je garderai
mon âme ou retrouverai la ferveur d'autrefois.
Le
4 novembre - Gournay.
Visite
d'un capitaine d'artillerie de l'E.M. de l'Armée. Des allures
de commis-voyageur débraillé, bonhomme et bavard. Mais quelle
compétence. Voilà au moins pour une fois "the right man
in the right place".
Prière
du soir dans la vieille église… Les choristes répétant pour
demain un beau cantique : "Vous qui passez, allez à Lui
qui demeure".
Dans
la rue des vauriens ouvrent les portes des magasins et
s'enfuient dans l'obscurité. Je tire les oreilles à l'un
d'eux.
La
plupart des gamins de ce pays ont l'air de petits vieux usés.
Ils fument la pipe et boivent l'alcool au bistro…
Ah
! bon gouvernement, interdis les processions, ferme les
couvents, et sois tranquille : les filles peupleront les
trottoirs et les bistros s'ouvriront démocratiquement…
Le
5 novembre - Dimanche. Journée
bousculée. Va-et-vient. Pas de paix. Le fort de Vaux est
repris.
Le
6 novembre - Les lettres de C. et de
M. S.. Le soir, Faby offre les huîtres. Le Commandant à la
joie enfantine de son appareil photographique. Il s'apprivoise.
Le
7 novembre - Visite du Général
Gérard, Commandant la 1ère Armée. Il a l'air d'un
vieux bonapartiste. On le dit "très dur". Le
Commandant me dit qu'il paraît être comme on le dépeint :
très dur. Il est trop loin pour qu'on sente son âpreté.
Dôle
renâcle devant le travail. Les hommes montrent leur caractère
quand on trouble leurs habitudes.
Arrivée
aujourd'hui d'un renfort de la classe 17 ! Hier c'étaient des
jeunes gens de la classe 16 qui venaient au 417ème -
pour la première fois au front. D'où vient cette hâte à
amener des très jeunes ou ce retard de ménagement de la classe
16 ?
Ces
bleuets de dix-neuf ans sont arrivés par une pluie battante,
mais des rires plein les rangs et des fleurs au bout des fusils.
On n'est pas habitué à cette gaîté, à cette confiance. Les
guerriers actuels sont graves et soucieux.
Les
8, 9, 10 novembre - L'été
de la St-Martin revient avec une splendeur inaccoutumée. L'air
est suave, la nature a des grâces d'amoureuse. J'ai une
fringale intense de détente. Et l'horizon de la guerre reste
terne, chacun laisse ses griffes cramponnées au sol, plus rien
ne bouge ; là-bas en Allemagne on fait la levée en masse des
usines pour parer à la ruée des adversaires au printemps et
faire en sorte que se soit encore un coup nul : ce serait la
paix par lassitude générale, la seule porte de salut de la
Pangermanie, notre perte à nous ; en Amérique, même lutte
sans résultat sur le terrain politique, Hughes, Wilson se
serrent à quelques voix !…
Le
11 novembre - Samedi. La St-Martin
! Toute la journée j'ai été sur les dents. Demain sera une
journée analogue.
Où
sont les veilles de St-Martin, le récurage de la ferme, les
brioches dorées de maman, le poulet que mes sœurs pleuraient,
l'étalage rutilant de la pacotille à deux sous, la fièvre
berceuse des prochaines danses sur le bal du père Jacques… O
joies enfantines de mon adolescence.
Ce
soir j'erre comme une âme en peine. Des jeunes filles
effrontées me disent : "bonsoir, petit", et j'ai
envie de pleurer de tant d'ironique gaîté.
Les
12, 13 novembre - Journées
brumeuses sans lettres - et beaucoup de travail. Autrefois
c'étaient deux jours de fête… Pauvre fête de Verne, joie
des enfants, détente des vieux, réconciliation des voisins…
Maintenant, c'est les deuils.
Le
14 novembre -
Nouvelles
de Louis à l'hôpital de Salonique.
"…
Ce dont le pays a besoin, ce n'est pas d'une sentinelle de
l'ordre moral, c'est d'un chef, et ce chef, elle ne l'a
pas".
Discours
de A. Tardieu à la séance d'hier, où Briand a couvert toutes
les fautes ou les incompétences de son copain, le bourreur de
crânes Marcel Sembat…
Pauvre
Chambre, piteuse Chambre, et pauvre France qui en vingt-huit
mois n'a pas su trouver l'Homme qu'il fallait pour te dresser et
te guider, t'entraîner. Résultat, la guerre continue, et
devrait être finie.
Le
15 novembre - Traits de caractère
du Grand Chef.
La
châtelaine est venue demander un fumiste pour son calorifère.
Je rends compte :
Bah
! Ce sont des gens riches, il n'ont qu'à s'adresser à un
fumiste civil. Et je ne veux pas intervenir pour ces gens qui ne
sont pas du tout intéressants.
Pour
toute punition qui sent la petitesse d'esprit de la part de
celui qui l'inflige, régulièrement le Commandant se contente
de mettre : "Vu".
Il
a des impolitesses d'ancien régime. Sur une feuille de papier
chiffonné il écrit : "Prière au
"Sous-intendant" (sic) de me faire connaître le tarif
des rémunérations des militaires employés aux travaux
agricoles".
Une
autre fois, il s'agit de rendre libre pour des conférences la
salle de mairie occupée par le Bureau du Commandant du P.A. ;
il écrit à 9 heures du matin et fait communiquer :
"L'Artillerie évacuera pour midi la salle de la Mairie qui
doit servir à l'école des Commandants de Compagnie".
Il
passe pour un sauvage.
Par
ailleurs, il a certaines délicatesses supérieures. Il
s'informe de la toux de Dôle, il envoie Dôle à la visite, il
s'inquiète le lendemain de l'évolution du rhume.
Mais
dès qu'il revient à une question de service, il retrouve une
fougueuse énergie. Il ne se permet ni ne tolère chez autrui
aucun accommodement avec les exigences du devoir. Un ordre cela
s'accomplit jusqu'au bout. Il fait songer par son austérité à
Piéfort. Ils étaient beaucoup plus nombreux qu'on ne le
savait, ni même qu'on ne le soupçonnait dans l'ancienne armée
d'active, ces officiers d'un caractère antique. Ce sont eux qui
ont mené si noblement et si imprudemment à la mort glorieuse
et inutile les légions françaises sous les lames d'acier des
mitrailleuses allemandes.
Le
16 novembre - Les Anglais ont
essayé et réussi pour la première fois à mener une affaire
à grandes guides : cinq mille cinq cents prisonniers en deux
jours. Allons, c'est un beau coup de filet, à la française.
Ils finiront par savoir "y faire" comme nous.
Le
18 novembre - Pour obtenir une
permission à titre exceptionnel il faut fournir une pièce ;
les uns ont une dépêche laconique et discrète, mais beaucoup
n'ont qu'une lettre qu'ils joignent à leur demande. Les unes
sont simples, péniblement intimes. Cela me fait mal de voir
étaler ces pensées d'inconnues à un mari, à un frère, à un
fils. En voici une admirable que je n'ai pu lire sans émotion.
Tout le drame des âmes françaises durant les guerres est dans
la lettre de cette mère, une noble femme, sûrement.
Mon
bien Cher Pierrot,
Comme
ma lettre d'hier t'aura fait du chagrin, mon Pierrot, et
pourtant je ne pouvais te cacher plus longtemps l'atroce
réalité. Comment continuer à t'écrire sans te dire ma peine
? Je sais combien vous vous aimiez tant et je sens comme tu dois
souffrir, pauvre enfant. Ici nous sommes tous anéantis, nous
étions bien loin de penser à un tel malheur : jamais ton
frère ne nous parlait des dangers qu'il courait. Il nous
rassurait toujours sur son sort, tandis qu'au contraire il nous
disait de reporter toute notre sollicitude sur toi, beaucoup
plus exposé. Pauvre, pauvre Grand, dire que jamais plus jamais
nous ne le reverrons.
C'est
vendredi soir qu'une première lettre de son camarade nous
apprenait le malheur, mais comme il nous disait que si sa
blessure était grave, son état n'était pas désespéré, nous
voulions garder un peu d'espoir. Cependant moi je sentais déjà
dans mon cœur que tout était fini, mais pour ne pas
désespérer Jeanne je feignais de croire qu'il n'était que
blessé. Hélas, lundi matin, Jeanne recevait une autre lettre
l'informant de la mort notre pauvre Henri. Il a été tué sur
le coup, le lundi 6 à trois heures du soir, et le lendemain ses
camarades l'enterraient. En même temps que sa lettre, l'ami de
ton frère envoyait un paquet contenant le portefeuille de ton
malheureux frère, son porte-monnaie, son alliance, ses
médailles d'identité, beaucoup d'argent aussi, car le pauvre
enfant gardait précieusement toutes les coupures qu'il recevait
de Jeanne, ne dépensant rien, se privant de tout bien-être
pour en faire un jour sans doute la surprise à sa chère petite
femme. Quelle perte nous faisons tous, mon petit Pierre. Que
maudite soit la guerre qui apporte avec elle tant de souffrance.
Mais lui, c'était un idéaliste, il combattait pour le bien,
pour le mieux, et il est mort en gardant sa foi dans une
humanité meilleure. Il gardait aussi l'espoir d'une victoire
complète. En souvenir de lui, mon petit Pierre, garde tout ton
courage. Dis-toi que c'est assez d'épreuve pour nous, que tu
nous seras conservé, que toi aussi tu aimeras et tu veilleras
sur son cher petit Lulu qu'il aurait tant aimé. Jeanne a
beaucoup de chagrin, et hélas personne ne peut la consoler. Ton
père est anéanti, Marcelle, tous. On nous dit que tu pourrais
obtenir une permission de quarante-huit heures pour venir nous
apporter un peu de consolation. Cela nous sera bon de
t'embrasser, mon cher petit, et aussi de pleurer avec toi.
Je
n'ai pas encore osé écrire à Lucien et cependant il paraît
bien qu'il sache. Robert à du recevoir le coup hier au soir.
Quelle peine cela me fait en plus encore de la mienne, que
d'être la messagère d'un pareil malheur.
Je
te quitte mon cher Pierre, ton père se joint à moi pour
t'embrasser fort.
Ta maman bien
affligée.
Le
25 novembre - Toute la semaine
s'écoule dans la grisaille humide de novembre. Rien ne saille.
L'ennui suinte, le découragement se mêle à la boue visqueuse.
Pas d'horizon. Nous avons pris Monastir, mais les Roumains
reculent, reculent, voilà les Boches au cœur de la Valachie.
Et pour la ruée du printemps, ils mobilisent les civils. Ils
vont faire un effort inouï qui doit les sauver si nous
continuons à patauger sans gouvernement.
A
la Chambre, on crie "A bas la guerre". Les ministres
n'inspirent pas confiance, ni dans leur patriotisme, ni dans
leur savoir-faire. Nos épreuves s'entassent sans résultat.
Nous n'avons pas de gouvernement à poigne. M. Jardel me disait
qu'il n'était pas encore Camelot du Roy, mais… La situation
de la guerre de sept ans se renouvelle. Dieu que j'en redoute
les mêmes résultats.
C'est
honteux de laisser écraser ces pauvres Roumains, de leur
laisser infliger le sort de la Belgique, de la Serbie. Que les
Grecs prudents ont eu raison de rester à l'écart ! L'immense
Russie est un monstre, un corps énorme sans direction. Sinon,
à elle seule, elle devrait écraser l'Allemagne…
Il
n'y a encore que la France au monde qui soit de taille. Les
Boches savent bien que nous sommes l'Erbfeind.(L'ennemi
juré)
Kerlen,
die Fransozen…(Quels types ces français…)

 

(…insert
joint…)
(Feuillets
isolés à réinsérer dans le texte suivant chronologie ou à
transférer dans l'annexe).
Mr Pierre Paris
le 9 novembre 1915
N° 12533D
En
application de ma circulaire du 4 novembre 1915 n°11674D,
j'avais prescrit par mes instructions complémentaire des 5 et
12 novembre, n° 11674D et 11815D que toute demande de militaire
appelant sur sa situation personnelle l'attention de ses chefs
devait en tous cas être transmise par la voie hiérarchique.
Consulté
sur la procédure qu'il y avait lieu de suivre pour que des
militaires à quelque degré de la hiérarchie qu'ils
appartiennent fussent assurés que la demande parviendra bien à
l'autorité compétente pour statuer, j'ai décidé qu'au cas
où il ne pourrait être fait droit à la requête formulée,
cette demande serait retournée au militaire dans un délai qui
ne dépassera pas un mois avec la mention : "Cette demande
a été examinée, mais elle n'est pas susceptible d'être
accueillie" avec notification succincte du motif du rejet
de la demande.
Je
prescris, en outre qu'au cas où la réponse de l'autorité
militaire qui aura statué prêterait à une réclamation
autorisée par les règlements, le militaire intéressé pourra
demander que sa requête soit transmise à l'autorité
supérieure conformément à mes instructions du 5 novembre
dernier.
Ouvrages à
consulter pour études diverses.
| A.
Sarraut |
L'instruction
publique et la guerre. Voir dernière partie. Leçons de
la guerre et réformes à opérer, chez Didier Henri
édition. (Recueil d'actes et discours). |
| A.
Cochin |
V.
Correspondant : n° du 25/3 et 10/4 1909 sur Taine et
Aulard. (inexactitudes de A. dans son histoire de la
révolution). |
| V.
Cambon |
Ouvrages
d'économie politique sur l'Allemagne. |
| Engerand,
député du Calvados |
Article
sur l'exterritorialité de la Lorraine. Échos de Paris.
25/7/1916. |
| De
Bülow |
Deutsche
Politik. |
| G.
Faniez |
Le
père Joseph. |
| E.
Bourgeois |
Manuel
de politique étrangère. |
| Engerand |
Voir
les études du député du Calvados dans le
Correspondant de ces mois-ci, juin, octobre, sur la
question sidérurgique. |
| Ed.
Rod |
Le
sens de la vie. (Perrin édition). |
 
 
  
|